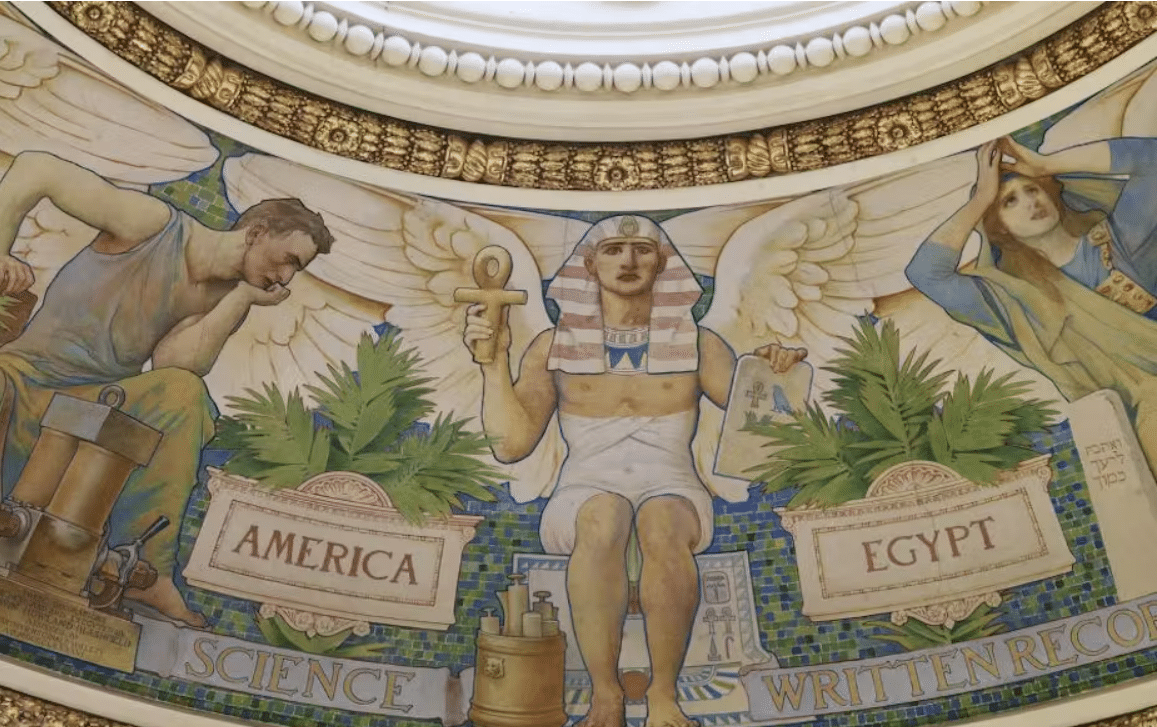De retour de restauration, La Vierge du Chancelier Rolin fait l’objet d’une exposition du Louvre du 20 mars au 17 juin – l’occasion pour le grand public de redécouvrir ce classique du Louvre mis pour l’occasion en perspective avec ses contemporains flamands.
Depuis son acquisition en 1800 par le musée du Louvre, l’œuvre du maître flamand n’avait jamais été encore restaurée. Profitant de l’engouement pour Van Eyck, dont l’actualité avait été marquée par la restauration de l’Agneau mystique de Gand entre 2012 et 2019, le musée parisien s’est attelé à nous faire redécouvrir ce chef-d’œuvre de la Renaissance flamande.
Exposition Van Eyck au Louvre.
Un chef-d’œuvre d’art flamand
Peinte en 1435 pour le très riche chancelier du duc de Bourgogne Philippe le Bon, Nicolas Rolin, la toile représente une conversation sacrée entre le commanditaire et une Vierge à l’Enfant. Pensée comme un ex-voto, elle se structure en deux groupes distincts : à gauche du tableau, Nicolas Rolin, en tunique de brocart d’or et de fourrure brune et, à droite, une Vierge assise de trois quarts avec l’Enfant reposant sur ses genoux, tout cela surmonté d’un Ange couronnant le groupe.
Séparés par un carrelage à damier, symbolisant la distance qu’il y a entre l’homme et le divin, les groupes laissent place à une véritable perspective sur une ville non identifiée et un horizon montagneux. Paysage idéalisé et idéalisant, il fait converger vers lui les lignes de fuite, unifiant la compréhension du spectateur et participant à donner un souffle de vie à cette scène divine.
À la fois impressionnante par le nombre d’allusions symboliques à la Bible ou à la vie de l’époque, ainsi que par le niveau des détails parcourant la toile, La Vierge du Chancelier Rolin constitue l’un des chefs-d’œuvre de Jan Van Eyck.
Illustre représentant de la peinture renaissante flamande, il représente le moment où l’art des Flandres sort des manuscrits enluminés pour s’accomplir sur des toiles. En effet, la peinture dans le nord-ouest de l’Europe, contenue dans ces cathédrales gothiques dont les parois étaient envahies de verrières, ne s’est pas développée comme en Italie sur d’immenses fresques. C’est par le manuscrit qu’elle commence à se formaliser, à trouver sa profondeur, ses couleurs envoûtantes et vives. C’est l’époque de Paul de Limbourg et de son célèbre Livre d’Heures commandé par le riche duc de Berry.
Jan Van Eyck, avec son frère Hubert, participe donc à cette libération de la création picturale qui représente ce mouvement d’individualisation propre à la Renaissance. Contrairement à l’Italie, qui avait choisi le chemin de l’érudition mathématique et de la science des formes, Van Eyck choisit le chemin de l’imitation la plus parfaite possible, fondée sur la stricte observation. C’est ce qui fait d’ailleurs des Flamands les premiers à respecter l’aspect total de l’homme, sans rien y ajouter que leur force à pénétrer la ressemblance. Ressemblance qui est poursuivie avec une ténacité menant à la représentation parfaite du plus petit des détails de la composition. C’est cette ressemblance matérielle qui, à force d’exactitude, entraîne à la ressemblance morale avec l’individu dont les fonctions et caractères ont peu à peu modelé le visage.
Un parcours simple et efficace
Mis à part cela, comme on pouvait s’y attendre de la part du Louvre, l’exposition est très bien réalisée, composant à merveille avec les contraintes d’une seule salle d’exposition, la salle de l’Horloge. La scénographie est épurée, permettant une circulation simple malgré le nombre de visiteurs.
Elle se décompose en plusieurs parties, permettant de mettre l’œuvre en contexte avec les autres réalisations de Van Eyck, ou bien avec ce qu’il se faisait en son temps par d’autres peintres, qui parfois reprirent l’œuvre. On s’aperçoit alors que les éléments vestimentaires du chancelier Rolin sont très proches d’une autre de ses peintures, celle du Portrait de Baudoin de Lannoy. Ou bien, on apprend à apprécier la star de l’exposition en comprenant que Van Eyck n’avait jamais déployé un tel paysage, si magnifique et richement agrémenté de détails, notamment en allant regarder dans la quatrième section son Saint-François recevant les stigmates.
Enfin, la mise en perspective de l’œuvre avec celles de Robert Campin, Rogier Van der Weyden et Bosch permet de vraiment saisir les tensions qui traversent l’art flamand du début du XVe siècle, sortant progressivement de la tradition gothique, sous certaines influences italiennes, pour s’inscrire dans la singularité d’un art qui, en retour, ira abreuver l’Italie.
En définitive, l’exposition est à voir. Le drame n’étant pas tant l’afflux de monde que la mode naissante du colle-vitre ; cette détestable pratique qui tend à se pérenniser et qui se traduit par une pratique de collage de tête-sur-œuvre, comme si le fait de plaquer sa tête, empêchant aux autres visiteurs d’en profiter, aller mener à une révélation métaphysique de l’œuvre. D’autant plus lorsque la pratique s’accompagne d’un shooting photo où le visiteur colle, une fois de plus, son téléphone à 2 cm du tableau pour prendre chaque détail en photo.
À ceux-là, nous conseillons deux choses : premièrement d’aller chercher de meilleures photos sur Internet – oui, elles existent – et secondement de passer plus de temps à confronter les autres œuvres de l’exposition (c’est d’ailleurs le but d’une exposition), ils en apprendront plus et pourront profiter de la présence unique d’œuvres venant des quatre coins du monde (on notera que c’est la première fois que La Vierge du Lucques est prêtée par le Städel Museum de Francfort), au lieu de rester bêtement devant quelque chose qu’ils ne comprennent pas, qu’ils ne ressentent pas.
-

Jan van Eyck, La Vierge Rolin APRES RESTAURATION © RMN-Grand Palais (musee du Louvre), Michel Urtado
-

Jan van Eyck, Portrait de Baudoin de Lannoy © Staatliche Museen zu Berlin, Gemaldegalerie, Christoph Schmidt
-

Jan van Eyck et atelier, Saint Francois recevant les stigmates© The John G. Johnson Collection, Philadelphia Museum of Art, Cat. 314
-

Breviaire de Marie de Savoie © Collection Bibliotheques municipales de Chambery Camberi@, MSS. C4
A lire aussi:
« L’exception culturelle française ». L’État dirige l’art en ignorant les lois