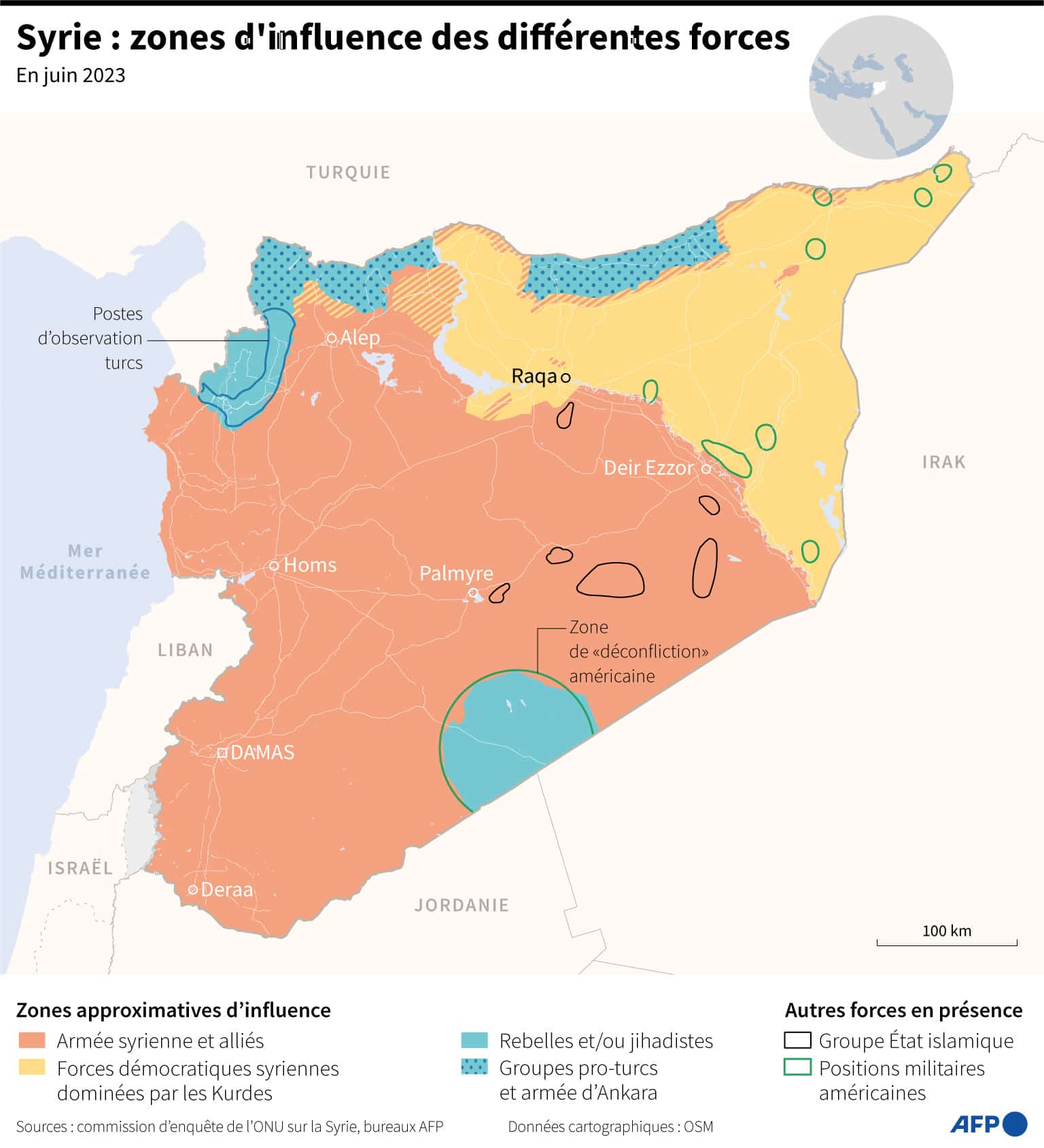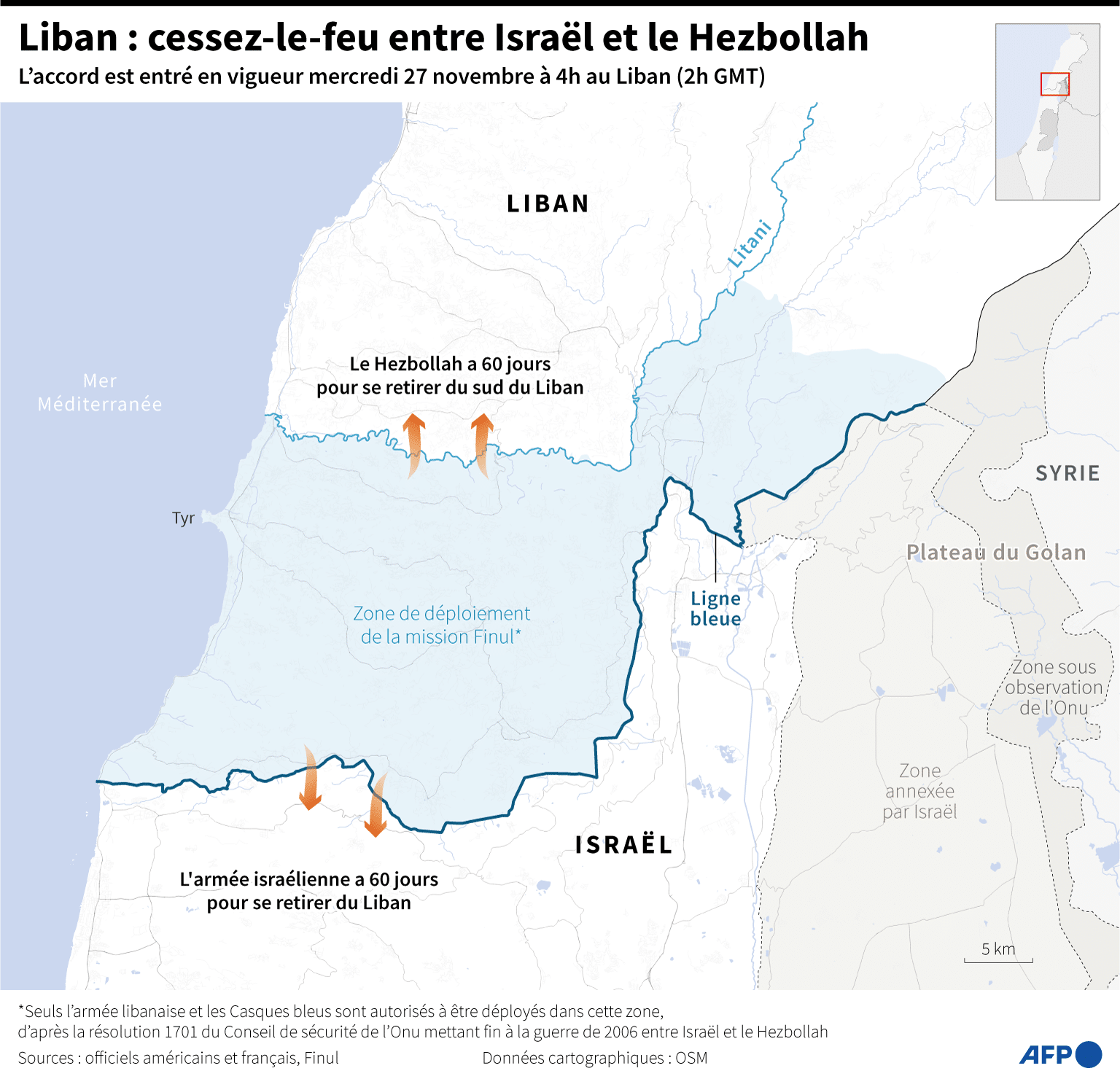L’échec du putsch du 15 juillet 2016 a métamorphosé les forces armées turques. Désormais, militaires et islamo-conservateurs avancent sur les mêmes brisées.
Ankara, 30 août 2021, Fête de la Victoire, (Zafer Bayramı), Recep Tayyip Erdoğan passe en revue les rangées impeccables. En ce jour anniversaire de la victoire sur les Grecs, les casques d’acier luisent, des torses bombés jaillissent le même cri : Her sey vatan için ! (Tout pour la patrie !) Derrières ces verres fumés, à quoi peut bien penser le reis ? Longtemps, l’armée et le président turc se sont voués une franche animosité. En effet, la République s’est construite au corps défendant d’une société attachée à l’islam. L’establishment militaro-laïc a toujours craint qu’une dérive trop forte d’un État otage des désirs de la société bouscule son projet d’ingénierie sociale. À chaque intervention armée (1960, 1971, 1980, 1997), mission revient au glaive d’extirper la subversion, qu’elle soit gauchiste ou réactionnaire. Désormais, tout cela appartient au passé. Stratège consommé, Erdoğan a tout de suite compris le parti qu’il pouvait tirer du processus d’adhésion à l’Union européenne. Passée au crible des critères démocratiques, la magistrature militaire s’est désagrégée. Dans un deuxième temps, le reis a profité de la déconfiture factieuse de l’été 2016 pour reforger l’outil régalien. Son mot d’ordre est simple : confessionnaliser, civiliser, personnaliser.
À lire également
Nouveau hors-série : Armée de terre, le saut vers la haute intensité
De l’armée de la République…
Lorsque Mustapha Kemal proclame la République (1923), les hommes forts du nouvel État sont tous issus des tranchées. En un peu plus d’une décennie, ils ont connu, une révolution (Jeune Turque, 1908), deux guerres balkaniques (1911-1913), une guerre mondiale et la guerre d’indépendance contre la Grèce (1919-1922). Plus profondément, de l’Empire à la République, l’armée se veut la gardienne de l’âme turque. Sous l’Empire ottoman, construction théocratique et cosmopolite, elle est l’institution nationale et musulmane par excellence. L’armée est aussi le corps de l’État par lequel dès le xviiie siècle transitent les innovations techniques et les idées nouvelles en provenance d’Occident.
Lorsque l’Empire s’effondre au lendemain du premier conflit mondial, ce sont les militaires qui pallient à la faillite générale. En substance, c’est l’armée qui crée la République et la République qui crée la nation. Dès lors, le soldat fait figure d’accomplissement naturel du caractère national. La Turquie est une nation armée. Un dicton populaire clame : « Chaque turc naît soldat. » Ancien directeur de Haute Institution de la langue, de l’histoire et de la culture d’Atatürk (Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kurucu-AKDTYK), le général Suat Ilhan (1925-2020) résume ce lien intrinsèque : « La culture militaire est une des sources de la culture turque, elle l’insuffle… Que cela soit dans nos savoir-faire, nos schémas mentaux, nos attitudes, nos compétences, il y a une contribution militaire[1]. »
Les combats fondateurs, la République, la sacralisation de la nation et de ses morts contribuent à enraciner la guerre comme une expérience totale génératrice d’un homme nouveau : l’homo kemalus. Durant quasiment un siècle, le modèle du Turc nouveau se confond avec celui du soldat-citoyen. À travers le service militaire, il s’agit de réaliser la nationalisation des masses, point d’aboutissement d’une régénérescence morale. Religion civique, la laïcité garantit un lien national au-dessus de l’islam. Surtout, la laïcité annonce une ère nouvelle. Elle est la porte ouverte à la raison et donc à la science et au progrès. Traumatisés par les défaites impériales, les kémalistes estiment que seule l’occidentalisation, gage de modernisation, leur donnera les moyens techniques de résister aux périls extérieurs et de garantir l’indépendance nationale. Adopter un mode de vie sécularisé pour le soldat turc, ce n’est pas devenir occidental, c’est ne plus vouloir subir l’Occident. En vertu de cette mission, l’armée s’ingère dans les affaires civiles à chaque fois qu’elle juge le triptyque État laïc, État-nation, État unitaire menacée. Ainsi, le Conseil de sécurité national (Milli Güvenlik Kurumu-MGK) instauré en 1961 coiffe le gouvernement élu. C’est le chef d’état-major des armées qui a le dernier mot. Ses recommandations jusqu’au début des années 2000 sont obligatoirement suivies d’effets. En outre, les articles 35 et 85 du règlement interne (abrogés en 2013) stipulent que le devoir des forces armées est de protéger la patrie, la République et la Constitution : « Si besoin par les armes contre les menaces extérieures et intérieures. » Une lecture large de ces articles autorise l’armée à agir, y compris par la force, afin de restaurer l’harmonie perdue.
À lire également
À l’armée de la nation…
Si l’armée se veut la gardienne de l’héritage d’Atatürk et de sa religion laïque, elle n’en jette pas moins des ponts en direction des masses conservatrices qui fournissent les gros bataillons des appelés. L’islam est la religion des pères et donc naturellement la religion nationale. Aussi, l’armée turque est appelée le « Cœur du Prophète » (Peygamber Ocağı). Chaque soldat est un Mehmetçik, petit Mahomet. À eux d’imprimer leur pas dans celui du Prophète, de sa foi, de ses combats. Cela y compris jusqu’à l’immolation suprême. La croyance en une autre vie n’étant que la juste contrepartie du don ultime de soi. Les soldats tombés au champ d’honneur deviennent des martyrs (şehit). Arrosée du sang de ses martyrs, l’Anatolie sanctifie sa turcité grâce au sacrifice de ses fils. Quant au nom de guerre de Mustapha Kemal, il renvoie lui-même à la guerre sainte (djihad). Le Ghazi, dans la tradition turco-ottomane, désigne le chef de guerre en lutte contre les Byzantins. Six siècles après la chute de Constantinople (1453), Kemal reprend le titre à l’occasion de la guerre d’indépendance (İstiklal Harbi), l’ennemi demeure toujours le même : grec.
Depuis le coup de force manqué de 2016, la visibilité de l’islam s’accroît.
Dans l’esprit du reis, la nation surplombe les institutions. La nation (millet), c’est la confession maîtresse de l’Empire ottoman : l’islam sunnite hanafite. Pour Erdoğan, une République impie aux mains d’une élite aussi étrangères que hors sols l’aurait étouffé. Par conséquent, renforcer le lien armée-nation revient à consacrer la croyance majoritaire. Ainsi, pour la première fois de l’histoire de la République, un chef d’état-major s’est incliné devant la Kaaba lors d’un pèlerinage à La Mecque accompagné d’Erdoğan[2]. De même, les normes vestimentaires sont revues. Désormais, les femmes soldats peuvent revêtir le voile. La réappropriation d’une culture vraiment nationale implique l’élimination de tout ce qui rappelle l’Occident. À ce titre, la marche funèbre de Chopin, qui rythmait depuis les années 1930 les funérailles militaires, a laissé place à la prière du Tekbir (Dieu est le plus grand).
Erdoğan, chef de guerre
Sommet du pouvoir et siège unique de la « volonté nationale » (Milli Irade), tous les leviers aboutissent au reis :
– Le président turc désigne le chef d’état-major des armées. Il donne directement des ordres aux commandants de chaque arme.
– Le Conseil de sécurité national a perdu son rôle de pouvoir militaire parallèle. Les orientations prises sont celles du président.
– Le Conseil militaire suprême, (YAS-Yüksek Askeri Şura), qu’Erdoğan préside, a barre sur la carrière des officiers supérieurs. Subordonnés aux civils, les militaires ne peuvent plus se coopter entre eux.
– Le sous-secrétariat de l’industrie à la défense (SSM-Savunma Sanayii Müsteşarlığı) passe sous la coupe de la présidence de la République. Erdoğan décide en matière d’équipement et donc de modernisation des armées.
En vérité, les réformes entreprises depuis 2016 n’ont qu’un seul objectif : casser l’esprit de corps qui faisait des forces armées une institution à part. Accusées de favoriser l’entre-soi et de perpétuer l’idéal « d’un État pour le peuple, maismalgré celui-ci », les académies militaires qui formaient les cadets sont closes. En lieu et place a été créée une Université de la défense nationale (MSÜ-Milli Savunma Üniversitesi). Les élèves officiers recrutés à la sortie du supérieur y reçoivent une formation générale avant d’entrer en écoles d’applications. Un tel système permet aux islamo-conservateurs un meilleur brassage des futurs cadres. Surtout, il ouvre grand la porte aux diplômés des lycées Imam-Hatip jusqu’alors discriminés. Ces écoles, pépinières de « vrais croyants », destinées au départ à former les desservants du culte se sont peu à peu érigés en un système éducatif parallèle. Un objectif transperce : irriguer le corps national de jeunes dévoués corps et âmes au projet de « Turquie nouvelle » (Yeni Türkiye).
Passant outre les institutions, le reis a personnalisé son rapport aux armées[3]. Le poste de ministre de la Défense échoit à l’ancien chef d’état-major Hulusi Akar. Cette nomination ne doit rien au hasard. Entre Akar et Erdoğan, existe une connivence ancienne. Proche de la mouvance islamo-conservatrice, il joue un rôle décisif lors de la tentative de putsch le 15 juillet 2016. Agissant de manière ambiguë, Akar aurait accouché du coup d’État. Une fois dévoilée au grand jour, la conjuration aurait été plus facilement écrasée. À la tête de l’EMA, le président turc appelle le général Yaşar Güler. Carriériste indifférent aux idéologies, il est l’exécutant dévoué de l’axe Erdoğan – Akar.
La tâche du nouvel état-major est énorme. À tous les étages, les purges ont creusé des vides béants. Depuis 2016, sur 348 généraux et amiraux 151 (42 %) ont été démis. À la place, toute une génération d’officiers a été promue en catastrophe. Parmi eux, beaucoup ont bénéficié de la débâcle de la confrérie de Fethullah Gülen. Cet imam réfugié aux États-Unis dirige un vaste réseau médiatique, éducatif et financier. Longtemps Erdoğan et Gülen ont marché ensemble. En quelques années, les gülenistes infiltrent la police, la justice, l’éducation et décapitent l’establisment militaro-laïc. Des centaines d’officiers sont jetés au fer. À l’inverse, les militaires gülenistes connaissent une ascension fulgurante. L’aviation, une fraction de la marine, le service de santé, la justice militaire deviennent des places fortes Fethullahçi. Mais une fois l’ennemi commun à terre, l’alliance Gülen-Erdoğan explose. Aucun des deux hommes ne souhaite partager le pouvoir. Incapable de lutter sur deux fronts, Erdoğan conclut une trêve avec les radicaux-kémalistes qui sont amnistiés (2014). Considérés comme l’élément moteur du putsch raté de 2016, les gülenistes encaissent de plein fouet la répression. Dans les rangs, les gülenistes atlantistes disparaissent au profit des néonationalistes eurasistes.
Eurasistes et atlantistes
En apparence monolithique, l’armée turque masque une institution fractionnée en de multiples courants antagonistes :
– Proches de la gauche souverainiste, les Ulusalcılar revendiquent un retour au kémalisme originel : nationaliste, étatiste, anti-impérialiste. S’ils partagent avec les islamo-conservateurs la croyance en une voie propre à la Turquie, ils regrettent la disparition de l’esprit de corps et l’influence croissante de l’islam.
– Les conservateurs (Muhafazakarlar), longtemps brimés, tiennent leur revanche avec Erdoğan. Nostalgiques de l’époque impériale, ils peuvent dorénavant mettre en avant leur pratique religieuse (jeûne, prière du vendredi).
– Les atlantistes (Atlantikçiler) voient dans l’Alliance la quintessence du professionnalisme. Cette école rassemble aussi bien des laïcs que des conservateurs. Toutefois, elle était hégémonique chez les gülenistes. On retrouve d’ailleurs parmi les factieux beaucoup de militaires ayant occupé des postes OTAN.
– Les eurasistes (Avrasyacılar), très proches des Ulusalcılar, regardent vers Moscou et Pékin. Ils prônent une Turquie non alignée donc hors OTAN[4].
Si Ulusalcılar et islamo-conservateurs se sont réconciliés contre Gülen, l’armistice reste fragile. Deux réseaux entrent en concurrence. Avides de se partager les dépouilles gülenistes, d’autres confréries (Kurdoğlu, Menzil, Süleymancı)s’engouffrent[5]. Plus traditionalistes, plus rudimentaires, elles tissent une nouvelle hiérarchie occulte. Aussi structurés, les Ulusalcılar agissent via le Vatan Parti (Parti de la Patrie) de Dogru Perinçek. Le parti réunirait plusieurs centaines de sympathisants parmi des officiers de tous grades. Erdoğan les ménage jusqu’à un certain point. Ils sont d’utiles passeurs vers la Chine et la Russie. Dans le tumulte de l’après 2016, le reis a forgé une épée sur mesure. Toutes les puissances en devenir aspirent à une armée forte, elle est l’instrument de la renaissance nationale.
À lire également
Ukraine – Turquie : un partenariat à multiples facettes
[1] Suat Ilhan, Türk Askerî Kültürünün Tarihî Gelişmesi « Kutsal Ocak », (Développement historique de la culture militaire turque, « Le Foyer Sacré », Ötüken, Istanbul, 1999, p. 30.
[2] Hürriyet, 16 février 2017, « Erdoğan ve Akar Mescid-i Nebevi’de namaz kıldı », (Erdoğan et Akar ont prié à la mosquée du Prophète).
[3] Aurélien Denizeau, « L’armée turque et le parti AKP : entre tensions persistantes et convergence stratégique », in Le général et le politique, Le rôle des armées en Turquie et en Égypte, Clément Steuer et Stéphane Valter, L’Harmattan, 2021, p. 50.
[4] Metin Gurcan, Opening the black box, The Turkish military before and after July 2016, Helion Company, Warwick, 2018, p. 266.
[5] KRT, 10 août 2019, « TSK’da FETÖ’den sonra hangi tarikat ve cemaatlar yapılanıyor? », (Dans le TSK après le FETÖ, quels sont les ordres et les confréries qui se structurent ?).