Il y a un siècle, le 10 août 1920, le dernier des « traités de paix » qui semblaient achever la Première Guerre mondiale était signé à Sèvres. Dans l’esprit des vainqueurs, essentiellement la France, le Royaume-Uni et les États-Unis, ce traité était considéré comme secondaire et fut donc conclu le dernier. Après les traités de Versailles pour l’Allemagne (juin 1919), de Saint-Germain-en-Laye pour l’Autriche (septembre 1919) de Neuilly pour la Bulgarie (novembre 1919) et de Trianon pour la Hongrie (juin 1920), le traité de Sèvres entendait régler le sort d’un Empire ottoman déchu.
De ces traités émergeait une Europe entièrement nouvelle avec la disparition d’empires séculaires, comme l’Autriche-Hongrie ou l’Empire ottoman et avec l’éclosion de nouveaux États par exemple la Tchécoslovaquie, la Pologne ou la Yougoslavie. De la même façon, certains États en furent profondément affectés, soit à cause des traités eux-mêmes – ce fut le cas de la Hongrie sévèrement amputée par le traité de Trianon – ou à cause de processus internes comme la révolution russe.
À lire aussi : Turquie: le pays à cheval
Plus à l’Est, le traité de Sèvres était censé régler le sort de l’Empire ottoman vaincu. Le récit dominant stipule qu’entre autres dispositions, ce traité établissait un nouvel État arménien, à l’est de la Turquie, qu’il délimitait la frontière entre la Turquie et ce nouvel État comme il le faisait par exemple entre la Turquie et la Syrie ou entre la Turquie et la Grèce. Le récit dominant considère aussi que ce traité n’a jamais été ratifié et qu’en conséquence ces dispositions au sujet de l’Arménie devinrent nulles et non avenues et qu’elles furent en l’espèce remplacées par le traité de Lausanne signé en 1923.
Controverses juridiques
En vérité, les choses sont loin d’être aussi simples et de nombreux juristes et experts en droit international soulignent que ces récits sont fallacieux. D’abord en raison même des principes du droit international qui considèrent avec constance que les actes de ratification (ou de non-ratification) par les Assemblées parlementaires sont secondaires. Au contraire, la participation d’une délégation plénipotentiaire au processus de signature et son acceptation préalable de la future mise en œuvre des clauses des traités sont considérées comme les facteurs clés de validité par le droit international. À cet égard, la validité légale du Traité de Sèvres est supérieure à celle du traité de Lausanne parce que le premier a recueilli l’accord signé d’un bien plus grand nombre d’États que le second. Le fait que l’Empire ottoman ait été plus tard remplacé par la République de Turquie ne modifie rien à ce point de doctrine dans la mesure où les États successeurs – et en l’espèce l’État continuateur même selon certains experts – est engagé par les droits et obligations découlant des traités signés par son prédécesseur.
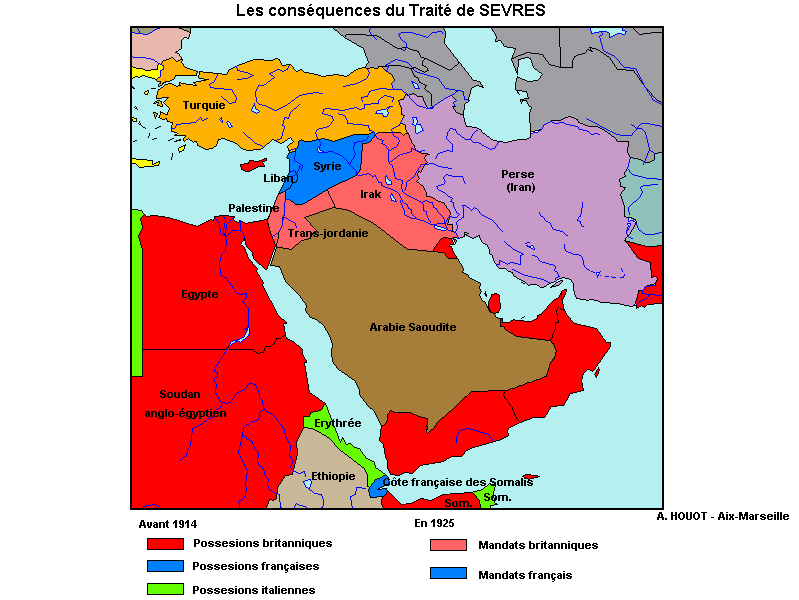
Cartes à retrouver sur le site d’Alain Houot
La seconde raison pour laquelle ce discours est incorrect réside dans le contenu même du traité de Sèvres entre les Puissances alliées et la Turquie. Un examen approfondi montre qu’il délimite effectivement de nouvelles frontières pour la Turquie, mais que le traitement de la frontière arménienne y est traité de manière substantiellement différente des autres. En fait, l’important article 27 du traité donne des indications quant aux frontières de la Turquie en Europe (§27.I) et en Asie (§27.II). Pour les secondes, cet article fournit directement des instructions détaillées à propos des frontières avec la Syrie et avec la Mésopotamie– en se référant à une carte précisée par l’article 28 – tandis que quatrième paragraphe de l’article sur les frontières « à l’Est et Nord-Est » est rédigé de la manière suivante :
« Du point ci-dessus défini et jusqu’à la mer Noire, la frontière actuelle entre la Turquie et la Perse et les anciennes frontières entre la Turquie et la Russie, sous réserve des dispositions de l’article 89 »
L’article 89 auquel il est fait référence dans la section VI déportée et dévolue à l’Arménie commence par l’article 88 qui affirme que « La Turquie déclare reconnaître, comme l’ont déjà fait les Puissances alliées, l’Arménie comme un État libre et indépendant ».
À lire aussi : Arménie, la nation singulière du Caucase
L’article 89 stipule quant à lui que « la Turquie et l’Arménie ainsi que les autres Hautes Parties contractantes conviennent de soumettre à l’arbitrage du Président des États-Unis d’Amérique, la détermination de la frontière entre la Turquie et l’Arménie dans les vilayets d’Erzeroum, Trébizonde, Van et Bitlis et d’accepter sa décision ainsi que toutes dispositions qu’il pourra prescrire relativement à l’accès de l’Arménie à la mer et relativement à la démilitarisation de tout territoire ottoman adjacent à ladite frontière ».
Ce traitement déporté extrait en vérité la question de la frontière arméno-turque du cadre juridique du traité de Sèvres pour le replacer dans un autre cadre juridique, celui de la procédure d’Arbitrage. Les règles d’arbitrage international avaient été définies assez clairement par la première Convention de La Haye en 1899 et renforcées par la seconde Convention de La Haye en 1907. L’Empire ottoman avait signé et ratifié ces conventions et était donc lié par ses dispositions, y compris celles sur « le règlement pacifique des différends internationaux » par la voie de l’Arbitrage.
La question arménienne
C’est un fait historique que l’Arbitrage du Président Wilson est resté lettre morte : quand il fut prononcé le 22 novembre 1920, l’Arménie qui était indépendante depuis le 28 août 1918 était sur le point de disparaître à nouveau. Le Sénat des États-Unis venait juste de refuser l’établissement d’un mandat américain sur l’Arménie le premier juin et la défaite des maigres troupes arméniennes face aux nationalistes turcs contraignit le gouvernement arménien à signer les nouveaux traités d’Alexandropol et de Kars avec ces forces kémalistes. Face à la perspective d’un anéantissement définitif par les Turcs, l’Arménie fut incapable de résister à l’Armée rouge et fut finalement soviétisée le 29 novembre 1920 avec l’idée qu’il valait finalement « mieux être rouge que mort ».
Cependant, plusieurs points d’importance juridique méritent d’être relevés. Le traité subséquent d’Alexandropol fut signé le 3 décembre 1920 entre le ministre des Affaires étrangères d’une République d’Arménie déjà disparue et un représentant des forces kémalistes qui ne jouissait alors d’aucune espèce de reconnaissance internationale. En termes de droit international, ce traité est donc dépourvu de toute validité de même que le traité suivant de Kars, signé le 13 octobre 1921 entre le régime de Kémal toujours illégal et les Républiques soviétiques alors non reconnues de Russie, d’Arménie, d’Azerbaïdjan et de Géorgie. On peut dire la même chose du traité intermédiaire de Moscou (16 mars 1921). De surcroît, on peut arguer que lorsque fut signé le traité de Kars, l’Arménie soviétique pas plus que l’Azerbaïdjan ou la Géorgie soviétiques ne constituaient des États indépendants, un point qui achève d’ôter toute validité à ce traité (ce serait la même chose si, par exemple, l’Alabama ou la Bretagne signaient un traité international).
À lire aussi : Les ambitions impériales de la Turquie
L’idée courante que le traité de Lausanne (24 juillet 1923) ait pu « remplacer » le traité de Sèvres constitue également un raccourci trompeur. D’abord parce qu’il n’a évidemment pas été signé par aucune des Républiques arméniennes – soviétique ou pas – et pas même par l’Union soviétique qui n’était alors reconnue ni par la France, ni par le Royaume-Uni, ni par les États-Unis. Ensuite parce que ce traité de Lausanne ne traite absolument pas de la frontière orientale de la Turquie.
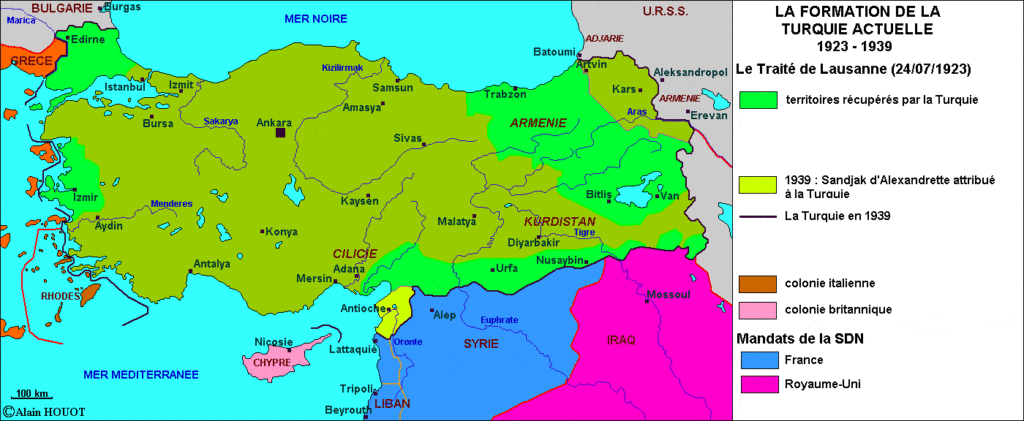
Cartes à retrouver sur le site d’Alain Houot
Évidemment, ces quelques rappels juridiques ne sont certainement pas suffisants par eux-mêmes pour modifier la frontière actuelle entre les deux pays. C’est probablement le destin général du droit international de n’être qu’une sorte d’expédient pour justifier de bien plus prosaïques rapports de force. De nos jours, l’Arbitrage de Wilson n’a pas été mis en œuvre parce que personne ne veut ou ne peut le faire, mais cette situation de blocage politique n’altère pas sa validité juridique. C’est la raison profonde pour laquelle la Turquie presse tant l’Arménie – même aujourd’hui – pour lui arracher un document qui légaliserait la frontière de facto entre les deux pays (sans parler des menaces et intimidations régulières, y compris les très inquiétants rappels et glorifications du génocide des Arméniens).
Jusqu’à présent, la République d’Arménie a résisté à ces manœuvres. D’une part, elle a affirmé à plusieurs reprises n’avoir aucune revendication territoriale sur le territoire de facto turc. Cette situation est donc également une conséquence du génocide des Arméniens qui empêche l’Arménie actuelle – avec seulement trois millions d’habitants – de peupler ces territoires étendus (quoique ce n’est pas réellement un argument ; il y a de nombreux pays avec de grands territoires et de faibles populations comme, par exemple, l’Australie ou le Canada). Mais d’autre part, l’Arménie s’est contentée d’affirmer qu’elle veut des relations diplomatiques intégrales avec la Turquie « sans préconditions », ce qui signifie que l’Arménie évite avec pragmatisme d’ouvrir un contentieux devant la Cour Internationale de Justice ou d’exprimer des revendications territoriales tant que ne sera pas réglée d’une manière mutuellement acceptable cette question des relations diplomatiques aujourd’hui inexistantes avec la Turquie.
Un discours contre la Grande Arménie
Cela dit, ces rappels nous permettent de mieux comprendre l’usage politique fait par la Turquie d’un discours autour du prétendu « syndrome de Sèvres » afin de discréditer le mythe d’une Grande Arménie. La situation réelle est exactement inverse : l’incapacité de la communauté internationale à imposer sa propre légalité en Asie Mineure a ouvert la voie à une Grande Turquie qui – sous le vocable captieux de « l’Anatolie orientale » empiète aujourd’hui très largement sur le territoire légal de l’Arménie.













