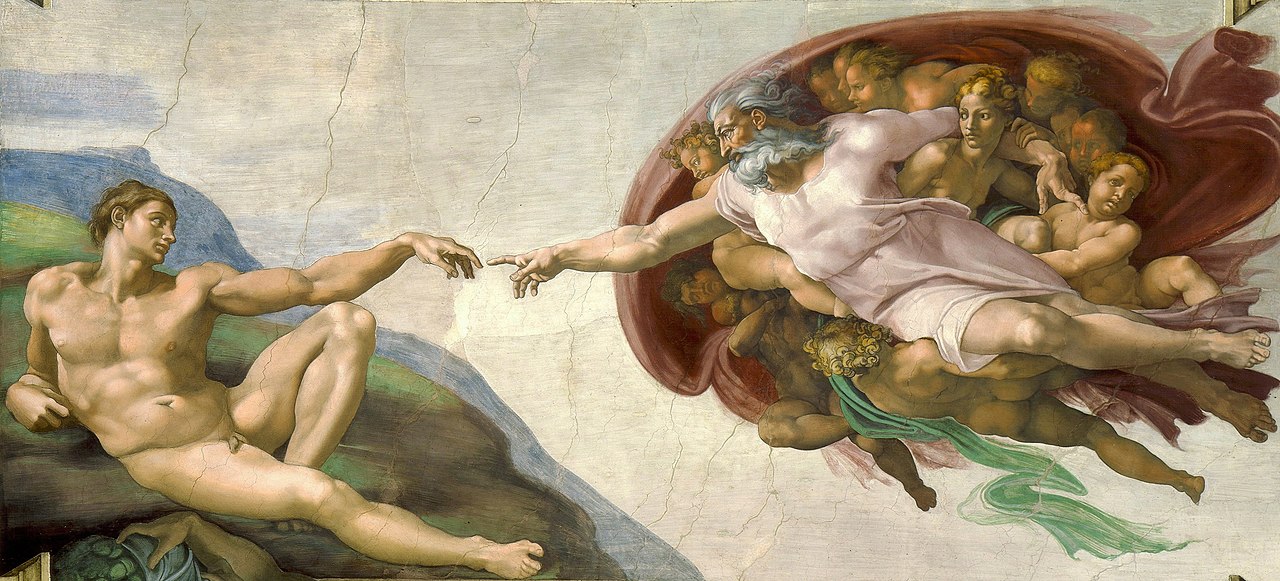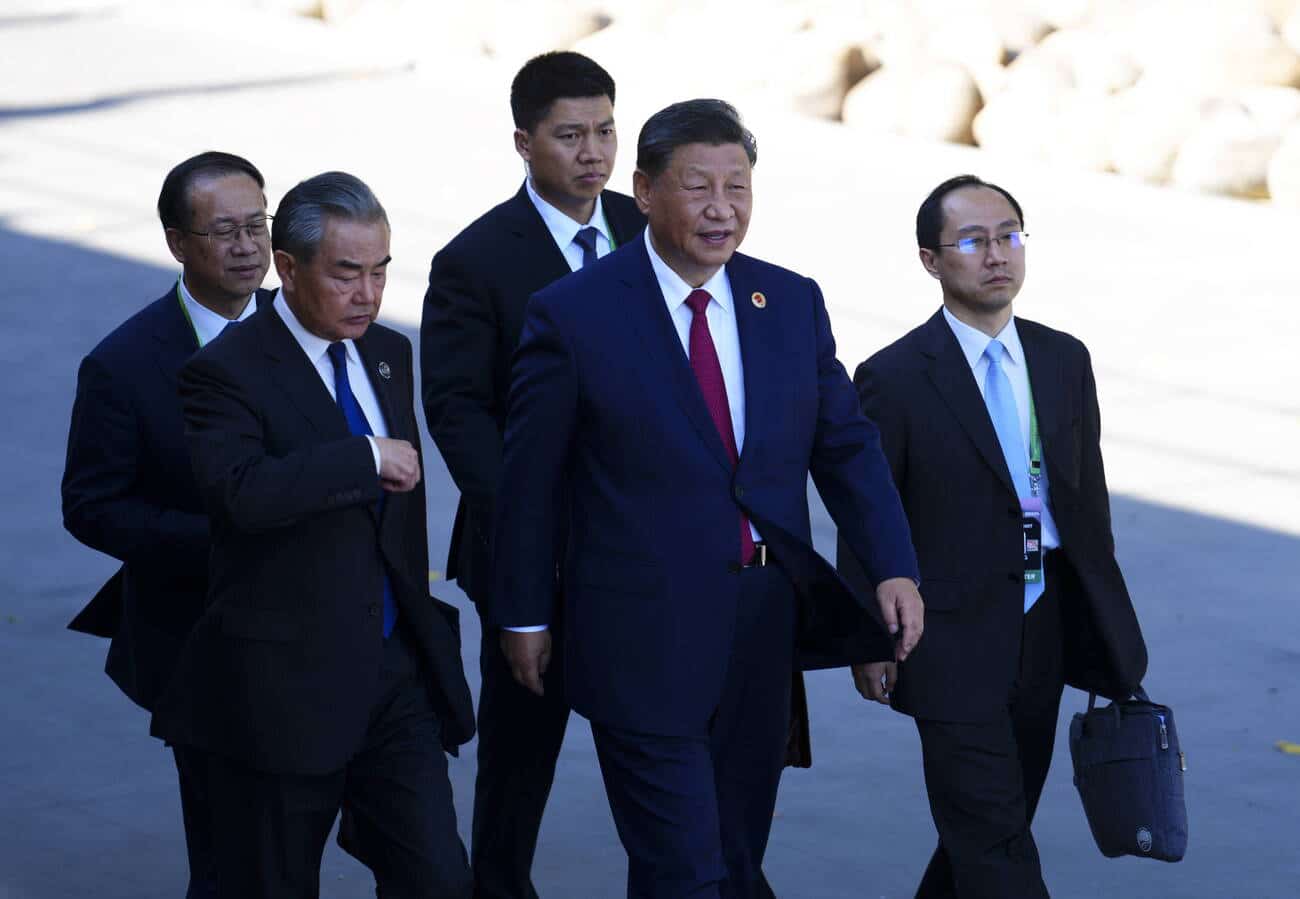L’industrie de la défense doit sans cesse s’adapter aux besoins des armées et faire évoluer ses outils de production. Dans cet entretien, Christophe Salomon, Directeur Général adjoint en charge des systèmes terrestres et aériens du groupe Thales, présente la façon dont son groupe fait face à ces nécessités.
Propos recueillis par le CC Quentin Savary et Jean-Christophe Robert*
Courte biographie de M. Christophe Salomon
Christophe Salomon est ingénieur de l’armement, diplômé de l’École Polytechnique en 1994 et de Sup’Aéro en 1999. Il débute sa carrière au ministère des Armées où il occupe divers postes de la Direction Générale de l’Armement (DGA). En 2012, il rejoint le cabinet de Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, en qualité de conseiller technique, puis de conseiller pour les affaires industrielles, rôle qu’il tiendra pendant toute la mandature, jusqu’en 2017. En 2017, il rejoint le groupe EDF (Électricité de France) en qualité de directeur des systèmes d’information, en charge également de la transformation numérique du groupe et de sa cybersécurité, animant ainsi une filière de près de 6 000 collaborateurs. Depuis 2020, il est membre du comité exécutif du groupe Thales, leader mondial des hautes technologies, en qualité de directeur général adjoint pour l’activité systèmes terrestres et aériens. Avec plus de 12 000 talents, présents dans 24 pays, cette activité recouvre le domaine des radars de surface, de la défense aérienne, de l’optronique, des systèmes terrestres, et de la gestion du trafic aérien. En 2023, Christophe Salomon est nommé vice-président du Conseil Général de l’Armement par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu.
Quentin Savary : L’économie de guerre est définie dans la LPM comme la capacité à « produire plus, plus vite et à coûts maîtrisés ». Que pensez-vous de cette définition et pensez-vous que ce modèle soit applicable dans la durée, pour l’entreprise que vous représentez ?
Christophe Salomon : Je rejoins cette définition qui me semble très adaptée à une logique de conflictualité accrue, au titre de laquelle les armées doivent accéder au plus vite à des volumes plus importants de matériels, et forcément à des coûts maîtrisés. Il faut toutefois noter un point : dans les programmes d’armement, nous évoquons souvent le « triptyque coût-délai-performance ». Le principe « plus, plus vite à coûts maitrisés » ne traite que deux des trois piliers, car il ne traite pas celui de la performance. C’est d’ailleurs normal : il est difficilement imaginable de faire plus vite, plus performant et moins cher, en tous cas à court terme. Lorsque l’on place la priorité sur les coûts et délais, cela peut vouloir indiquer qu’on le fait potentiellement au détriment de la performance. C’est un parti pris que personnellement je peux rejoindre à partir du moment où l’on ne tombe pas dans un piège inverse qui est celui de sacrifier ce qui jusque-là faisait notre force, c’est-à-dire l’excellence technologique de nos produits.
Il y a d’ailleurs peut-être une voie pour résoudre cette quadrature du cercle : nous n’évoluons en fait pas seulement à l’intérieur des trois piliers du triptyque coût/délai/performance. Il en existe au moins un quatrième, qu’on pourrait qualifier « d’environnement d’exécution ». On y retrouve là les exigences réglementaires, les modalités de contractualisation, de qualification, de documentation, etc. Alléger, simplifier ce quatrième pilier, c’est peut-être permettre à l’industrie de progresser sur les trois autres simultanément. C’est, je crois, un des axes du projet « impulsion DGA ».
Jean-Christophe Robert : Donc éviter le mouton à cinq pattes français…
CS : Je ne ferai pas de généralités, d’autant que l’on retrouve cela partout dans le monde. Mais ce que je constate sur le territoire européen, c’est que les exigences vont toujours en se durcissant et qu’elles évoluent à un rythme plus rapide que nos temps de développement.
Prenons l’exemple des exigences de certification. Quand telle substance aujourd’hui autorisée se retrouve soudainement frappée d’interdiction, cela nous force à repartir dans un nouveau cycle d’identification d’alternatives, d’intégration, de qualification puis de certification, etc. Et qui plus est cela nous empêche de faire des anticipations pour ne pas nous trouver dans une situation où un stock de produit se retrouve inemployable. L’autre point sur lequel on peut probablement progresser, c’est que le corpus de spécifications ne soit pas pensé qu’à l’aune d’un besoin exprimé qu’il soit fonctionnel ou technique, mais également à celui d’une « politique produit ». Ainsi se poser la question : « l’industriel qui répondra à ce cahier des charges a-t-il une chance de placer le produit qui en sera issu sur le marché mondial, de sorte de pouvoir bénéficier d’un effet d’échelle ? ». Cela n’a pas forcément de sens sur certains systèmes (quand on fait un sous-marin nucléaire, on n’est pas dans une logique de produit exporté dans le monde entier) mais quand on parle d’une jumelle, d’un obus ou d’une radio j’imagine que l’on peut chercher aussi à introduire dans la dimension « spécification du besoin », le fait de coller à une politique produit mondiale.
QS : Cela passe donc par des produits peut-être un peu moins technologiques et qui pourraient se produire plus vite et à moindre coût ?
CS : Oui et non. À nouveau, il n’y a pas que la question technologique. Mais c’est la technologie qui apportera le différenciant opérationnel sur le marché export. Ce qui est sûr, c’est qu’il faut faire tomber une exigence pour le « plus, plus vite, moins cher ». L’exigence peut être une exigence de sécurité de type « mon équipement doit se connecter à la fois sur un réseau secret et sur internet » et cela n’est pas forcément une exigence technique, c’est une exigence de besoin, car celui qui écrit le besoin se dit qu’idéalement il voudrait brancher son produit dans un certain contexte d’utilisation puis l’utiliser dans d’autres contextes. Mais cela peut amener à de telles complexités qu’il faut s’interroger s’il ne vaut mieux pas en avoir deux…
À lire également
État de l’industrie française de l’armement
Ensuite cela peut être une exigence de performance : est-ce que mon équipement doit fonctionner de -40°C à +80°C. Peut-être que s’il fonctionne de -10°C +50°C cela suffirait. Ces exigences peuvent aussi concerner le poids, la consommation électrique, etc. Et si j’ajoute à tout cela le fait que l’on va imposer que notre équipement soit fait dans un matériau recyclé, qu’il ne va pas contenir de peinture de tel type, ce que d’autres pays ne n’imposent pas, nous nous retrouvons avec une ligne de produits que j’aurai du mal à placer sur le marché export. À nouveau, cela peut ne pas être grave, mais il sera plus difficile à l’industriel de faire des stocks « au cas où » il serait nécessaire de produire plus vite.
JCR : Cela passe-t-il aussi par des architectures spécifiques où l’on va créer une base qui a un niveau de performance X et par système incrémental on va rajouter ou étendre des capacités pour ensuite adresser des besoins plus spécifiques. Cela veut dire qu’au niveau de l’architecture de base il faut que ce soit ouvert tout en ayant la capacité d’intégrer les évolutions ultérieures (ce qui complexifie aussi l’architecture de base) Est-ce un axe envisagé ?
CS : Dans l’absolu oui, c’est l’idéal : faire un produit à géométrie variable du point de vue des performances, avec des versions rustiques et d’autres, plus sophistiquées, le tout sur la même base. Cela fonctionne sur des systèmes à logiciels prépondérants. D’ailleurs nous observons ce cas dans le monde de l’ATM (Air Traffic Management) où nous sommes les leaders mondiaux. Jusqu’à récemment, on a beaucoup procédé à base de systèmes « sur-mesure ». Chaque grand pays, ou association de grands pays, souhaitait s’équiper de systèmes très spécifiques. Mais tous se disent que cela coute cher à l’acquisition, cela coute cher en soutien (il faut vraiment introduire la dimension soutien dans l’équation), cela coute cher en réactivité (lorsqu’un de nos 10 grands clients nous demande une évolution, il est compliqué de définir une forme de priorisation entre eux), chacun ne bénéficie pas des évolutions qui sont faites pour l’autre, etc.
JCR : Il n’y avait pas une logique de politique produit.
CS : Effectivement. Quand on détecte une faille de cyber sécurité sur l’un, elle ne s’applique pas forcément à l’autre etc. Dès lors, nous travaillons avec tous dans une logique d’abaisser le niveau de spécificité : Thales a cette chance qui est de pouvoir accéder à des dizaines de pays qui se réunissent et qui se demandent comment ajuster leur besoin de sorte de permettre ensuite à l’industriel de déployer une politique produit et même à la limite d’aller jusqu’à l’ « ATM as a service ». Rappelons qu’au-delà des enjeux de sécurité, l’ATM représente un élément clé pour la réduction des émissions de CO2 du secteur aérien. Un ATM relié à des cockpits connectés permet de réduire rapidement de 10% les émissions du secteur aérien. Et j’y crois, car on va avoir une vraie politique produit, une seule souche, comme par exemple pour une suite bureautique comme Office 365 : il n’y a pas l’Office 365 français et l’Office 365 hongrois alors que dans le monde de l’ATM ce n’est pas le cas, même si c’est le même avion qui décolle de Paris et qui atterrit à Budapest !
Donc ce sont des logiques auxquelles nous croyons et effectivement nous allons même offrir des modes moins sophistiqués pour des clients qui n’auraient pas les besoins les plus élevés (donc gérer moins d’avions simultanément, sur des zones plus simples, etc.). Et si c’est bien fait, bien conteneurisé, bien modularisé, alors on peut imaginer des versions à moindre coût, tout en respectant les plus hauts standards de sécurité.
En revanche, j’y crois moins quand il s’agit d’obus de mortier, de missiles, de lanceurs, de jumelles même : je vais avoir du mal à dire « si j’enlève une lentille, j’ai une jumelle moins chère », cela ne fonctionne pas comme ça.
En résumé, la logique d’économie de guerre dans le principe de produire plus et plus vite, je la rejoins complètement et cela nous aidera même à être plus performant sur les marchés export. Pour autant mon alerte serait de se garder de vouloir sacrifier la performance. Comme souvent il faut faire un compromis et ce qui a fait l’excellence de nos produits et a contribué à l’excellence de nos armées et quelque part installé nos industriels comme étant les plus performants au monde c’est aussi l’excellence technologique qui est sous-jacente, c’est la formation de nos ingénieurs. Si on commence à dire que l’on va faire uniquement du lowcost (je caricature à dessein, car ce n’est pas le discours), je ne suis pas certain que ce soit au bénéfice de notre écosystème en général. Donc c’est plutôt une logique de compromis et d’abaisser un peu certaines de nos exigences pour mieux se positionner sur un marché qui me permet de bénéficier d’un effet volume. Parfois ce n’est pas grand-chose, c’est 2mm sur un calibre par exemple…
QS : Une question sur la gestion des stocks. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, regrettait une absence de prise de risque et d’anticipation des industriels, notamment pour saisir les opportunités à l’export pour développer de nouveaux produits, au détriment des stocks français. Qu’en est-il chez Thales ?
CS : Je peux au moins répondre aux bornes de mon périmètre, et vous dire que :
1/ Si vous prenez un radar de surface, 80% sont produits dans la chaine de sous-traitance. Ces questions d’anticipation et d’accélération ne portent donc pas uniquement sur les grands maitres d’œuvre, elles pèsent aussi sur toute une supply chain, qui sont parfois des grandes entreprises et parfois aussi des PME ou des entreprises étrangères.
2/ Nous sommes conscients que nous avons une responsabilité particulière, nous maitres d’œuvre vis-à-vis de cette supply chain et singulièrement quand elle est petite. Pour cela, nous avons lancé par anticipation beaucoup de commandes. Nous avons investi sur beaucoup de moyens industriels pour répondre à l’exigence du ministre et à l’économie de guerre. Si nous poursuivons avec l’exemple des radars, nous allons doubler la capacité de production avant la fin de l’année. Ce n’est pas uniquement lié au contexte en Europe de l’Est, c’est aussi simplement parce que nos produits sont très demandés dans le monde entier et dans le contexte d’aujourd’hui, avec la priorité qui est mise sur la défense aérienne, nous avons une énorme demande sur nos produits. Nous avons donc pris la décision de doubler notre capacité de production, ce qui ne veut pas dire uniquement recruter plus de personnes à Limours ou installer plus de moyens.
C’est aussi se tourner vers notre supply chain et faire en sorte qu’elle-même soit capable de délivrer deux fois plus vite, et les aider pour cela, en leur donnant d’ailleurs une visibilité que nous n’avons pas nous-mêmes… C’est le premier point.
Le deuxième c’est que nous disposons aujourd’hui de plusieurs radars qui sont en production sans avoir reçu de commande clients. On parle de stock, on parle de réduction de leadtime mais nous avons aujourd’hui des radars en cours de production qui ne sont pas affectés, donc oui, nous prenons nos responsabilités. Le jour où l’on nous passera une commande pour un de ces radars, nous aurons la capacité de le livrer par qu’il sera en stock et s’il ne l’est pas encore, sa durée de mise sur le marché sera bien plus rapide que si nous devions le démarrer aujourd’hui.
Le troisième point c’est qu’il se trouve que la France a acheté et achète les mêmes radars que nous commercialisons dans le monde entier donc il n’y a pas réellement de spécificité française. On revient à la question antérieure. Je peux faire des stocks avec dans l’idée que cela serve la France ou l’export à partir du moment où la « France = export » d’un point de vue produit. S’il y a des produits spécifiques français, je peux faire tous les stocks que je veux je ne pourrais pas bénéficier du marché export pour amortir d’éventuelles inflexions de besoin.
Il y a enfin une autre voie pour les systèmes complexes. Plutôt que de faire des stocks de radars ou de pods aéroportés, nous pouvons anticiper en décidant de stocker le sous-ensemble qui ralentit le délai (le long lead item). S’il me faut deux ans pour faire un produit, mais qu’en fait plus d’un an est pris par un produit qui porte à peine 10 % de la valeur, alors peut-être que celui-là j’ai intérêt à le mettre en stock. Parfois, ce produit vient de ma chaîne de sous-traitance c’est donc le sous-traitant en question qui est sur le chemin critique. Je vais donc demander à ce sous-traitant d’accélérer et je prends mes responsabilités, car je n’ai aucune garantie que le produit sera utilisé ou non.
QS : Mais avec le risque que 3 ou 4 ans après cela s’arrête et l’entreprise supporte le coût de ce stock.
CS : Oui et c’est à nous de faire en sorte que l’on ait une compréhension fine du marché pour faire ce type de pari. Toutefois nous avons une autre difficulté, c’est que dans le monde de l’industrie de défense, nous ne pouvons être certains que nous serons toujours autorisés à exporter tel ou tel produit. C’est un frein aux paris que j’évoquais plus tôt. Attention, je ne dis pas que c’est le cas de la France, car la France est toujours très « juste » dans ses décisions relatives à l’exportation de matériels de guerre. Mais parfois j’ai des produits qui reposent sur des composants qui viennent d’autres pays qui n’ont pas les mêmes logiques. Ou alors un retournement géopolitique peut entrainer la fermeture d’un marché. C’est très difficile à gérer vis-à-vis d’une supply chain.
`À lire également
L’industrie militaire et la guerre. Entretien avec Pierre Conesa.
Le deuxième point est la nécessité d’avoir une visibilité sur le long terme. Il est difficile pour moi de lancer de grands plans de recrutement, d’investir sur des moyens, de mobiliser toute une supply chain, si dans le même temps je suis à la merci d’une rupture de commandes pendant 5 ans parce que les priorités ont changé. Ce n’est bien sûr pas la garantie de saturer mon outil de production sur les 10 prochaines années, c’est plutôt une visibilité et une sécurisation sur un minimum de commandes qui me permettent d’absorber les à-coups des commandes exports.
JCR : Parce qu’aujourd’hui on est dans des mécanismes contractuels qui prévoient des tranches optionnelles dans les marchés, voire des marchés-cadres sans garantie de commande.
CS : Un marché-cadre, ou des tranches conditionnelles dans un marché, c’est déjà une énorme valeur ajoutée, car cela réduit le temps de contractualisation à presque rien. Toutefois cela n’offre pas la garantie d’une commande ferme. D’un point de vue de la responsabilité d’entreprise, c’est difficile d’acheter un équipement à 50 millions d’euros dans l’éventualité que quelqu’un commandera des objets un jour. Il y a quand même une logique de business model derrière.
QS : Mais est-ce qu’a contrario, si le ministère des armées vous garantit une visibilité, vous vous engageriez à prioriser les besoins français sur, par exemple, une grosse commande à l’export qui pourrait arriver deux ou trois ans après et qui pourrait retarder le programme français ?
CS : Prenons un produit au hasard, disons que nous sommes capables d’en produire 50 000 par an. Et on nous dit que les besoins français pourraient dépasser ce chiffre. Donc on nous demande de porter notre capacité de 50 000 à 100 000 par an. Je peux assumer cet investissement-là (je vais devoir l’assumer avec toute la supply chain) c’est-à-dire que je vais racheter des bâtiments et des moyens, je vais recruter du personnel, je vais augmenter mes effectifs, je vais lancer des commandes pour donner de la visibilité aux sous-traitants, etc. Ce que je pourrais demander, ce n’est pas de me garantir 100 000 par an, mais de m’en garantir par exemple 30 000, durablement (à nouveau ce sont des chiffres pris au hasard, ils sont évidemment à adapter au business plan de l’investissement). De sorte que, si un marché export arrive, je lui offrirai la capacité qui sépare les 30 000 du 100 000. Et il n’y aura pas d’effet d’éviction sur la France. Et bien sûr, on peut imaginer que si l’export sature la capacité de production dans un moment où la France a moins besoin de ces produits, alors un mécanisme contractuel nous permet de libérer cette capacité.
En résumé, nous prenons déjà nos responsabilités, nous comptons faire bénéficier la France des volumes que l’export peut générer, nous anticipons, nous réduisons nos délais. Pour sécuriser notre approche, deux critères sont importants :
la limitation des exigences spécifiques sinon il n’est pas possible de bénéficier de cet effet de mutualisation avec l’export ;
un minimum de visibilité et d’engagement sur la durée.
Et je dois reconnaître que c’est déjà le cas dans plusieurs domaines, par exemple les munitions de mortier pour ce qui concerne l’activité dont je m’occupe.
QS : Il y a néanmoins des choses qui ne sont pas du ressort de l’État, je pense notamment à certaines pénuries de denrées rares ou composants qui peuvent venir perturber votre chaine d’approvisionnement. Comment faites-vous pour gérer cela chez Thales ? Ainsi que la compétition entre industriels pour ces denrées rares ?
CS : Cela peut se faire de plusieurs façons :
- On massifie et on cherche à bénéficier de l’effet de masse que peut créer un groupe comme Thales.
- Toutefois, même en groupant nos achats, on se rend compte que l’on restera petit par rapport à de très gros fournisseurs de composants électroniques ou de matières. Cette fois, ce que l’on va chercher à faire c’est se regrouper avec d’autres pour essayer d’aborder ensemble ces marchés.
- Le multi sourçage : il ne faut pas que l’on soit dépendant d’un seul fournisseur. Cela permet d’avoir de la flexibilité quand l’un d’entre eux commence à être défaillant.
- Parfois on ré-internalise une partie des développements ou l’on conçoit de nouveau certains de nos produits ou composants de sorte qu’ils permettent d’accéder à un marché moins spécifique.
Il faut noter que chez Thales, nous avons bénéficié de l’expertise de notre entité « Digital Identity and Security », qui résulte de l’acquisition il y a quelques années de Gemalto. Cette entité est par nature très exposée aux composants électroniques (elle fabrique par exemple les cartes bancaires, les passeports, les cartes SIM, …). Elle avait vu arriver ce sujet bien avant nos activités traditionnelles et a mis en œuvre très vite les quelques mesures citées ci-dessus. Elle avait saisi le problème avec beaucoup d’énergie et finalement a réussi à s’en immuniser largement, et nous avons bénéficié de cette expérience et de leur approche « temps court ».
Dernière mesure dans le cas particulier de la Défense : utiliser des dispositifs étatiques pour demander une forme de priorité dans la délivrance de composants. Les Américains ont par exemple mis en place le dispositif DPAS (Defense Priority and Allocations System Program) qui répond à cette finalité, en fléchant vers les industries de défense des composants nécessaires à la poursuite de leurs activités.
Nous avons exploré tout cela. Pour autant, nous ne sommes pas sortis de l’ornière et un risque demeure. En effet, nous ne savons pas projeter complètement l’évolution du marché des composants ou des matières premières mais le fait est que, par rapport au risque que l’on avait évalué au début de cette évolution de contexte, nous avons réussi à en maitriser une large partie.
QS : Justement vous parliez des Américains. Pensez-vous que l’économie de guerre ne peut être que nationale ou pourrait passer par une BITD européenne ? Pensez-vous que cela peut fonctionner ou que les logiques industrielles derrière n’y sont pas adaptées ?
CS : Oui je suis convaincu que, en règle générale, et quand on met de côté les questions de souveraineté nationale, une BITD européenne sera plus forte sur le marché mondial intégré que fragmentée. Car nos grands compétiteurs extraeuropéens eux, le sont. Cela dit le chemin est encore très long. De nombreux vents contraires soufflent encore. Je prendrai par exemple « l’anti-trust » qui empêchera la concentration des entreprises. Je prendrai le non-alignement des politiques export qui fait que même si j’ai un composant étranger ne représentant que quelques pour cent d’un système que je cherche à exporter, alors je serai à la merci du bon vouloir du pays concerné. Enfin je citerai la taxonomie et la perception des activités Défense par les investisseurs européens. Alors entendons-nous bien : chacune de ces règles porte du sens prise isolément, et est relativement incontestable. Pour autant le cumul de l’ensemble ajouté à l’évolution très rapide du corpus réglementaire (je vous engage à regarder ce qui se prépare autour des PFAS, les substances polyfluoroalkylées par exemple), n’aide pas à l’ambition de constituer une BITDE très intégrée. Enfin, gardons en mémoire que ces règles ont un impact encore plus fort sur les petites entreprises et sur leur accès aux financements. Ces entreprises sont pourtant des maillons essentiels de la BITD et de la souveraineté industrielle de notre pays.
QS : une dernière question peut être plus orientée RH. Comment faites-vous pour attirer et conserver les talents dans un marché qui devient de plus en plus compétitif à la fois entre industriels et avec la Défense également ?
CS : Bonne question. Vous avez vu notre objectif de 12 000 personnes cette année. Nous avons un marché qui est tendu en termes d’emploi. Ce que l’on constate c’est que l’écosystème de formation en France ne permet pas de produire suffisamment d’ingénieurs et de techniciens par rapport à la demande du marché. Donc se creuse un écart chaque année entre un système qui produit X milliers de personnes et un besoin qui est de Y milliers, Y étant égal à peu près au double de X. Le besoin est deux fois supérieur à ce qui est produit. Du coup, le marché est très compétitif. Aux bornes d’une entreprise, on ne va pas chercher à régler le problème de manière systémique : on ne va pas chercher à doubler le nombre d’ingénieurs formés, même si on fera tout pour aider, mais on va essayer d’en capter le plus possible. Et comment fait-on ? Plein de mesures :
1/ Très en amont, notre responsabilité en tant que grand industriel de défense consiste à ré-attirer les jeunes vers les métiers de l’ingénierie quels qu’ils soient, de l’électronique, de la pyrotechnie, de l’informatique, de la cybersécurité etc. donc notre boulot c’est de travailler en amont : on intervient dans les écoles d’ingénieurs, on parraine des promotions, on fait venir des jeunes, on accueille des apprentis, des stagiaires, etc. pour renouer le lien entre des jeunes qui ont peut-être perdu l’intérêt pour ces matières.
2/ Diversifier nos voies de recrutement. Il n’y a pas que les écoles d’ingénieurs et les classes préparatoires, il y a les facultés, les formations parallèles, etc.
3/ Mettre en place des outils de formation interne dans les métiers qui sont le plus en tension pour permettre de donner des compétences à des personnes avant d’occuper certains postes.
4/ Chez Thales, nous mettons en avant l’immense variété des métiers que nous offrons. D’ailleurs les jeunes le savent et Thales apparait toujours dans le top 3 des entreprises préférées par les étudiants. Chez Thales vous pouvez travailler du fin fond des océans jusqu’aux confins de l’espace et quand vous entrez chez Thales, vous pouvez faire 40 ans de carrière et occuper 20 postes différents tout en ayant l’impression d’avoir 40 vies différentes et ça je le vois à la tête de mon activité. Quand je passe d’un site à l’autre, je vois des mondes totalement différents et des gens passionnés par ce qu’ils font. Et je constate que les salariés chez Thales évoluent beaucoup. Ceux qui sont autour de moi sont passés par plusieurs entités de Thales, donc ils ont bénéficié d’une grande variété d’expériences, avec toujours l’ADN technologique au cœur de nos activités. On donc sait pourquoi on choisit Thales. Il est possible de travailler pour la défense et immédiatement après d’aller faire de l’observation spatiale pour la météorologie, de l’IFE (In Flight Entertainment) dans les avions, de la cybersécurité à très haut niveau ou même de l’optique pour le cinéma… c’est assez extraordinaire et c’est un atout que nous mettons en avant et qui rend l’entreprise attractive.
Dernier point, nous menons une réflexion constante sur ce que l’on peut externaliser. En effet, à ressources constantes et contraintes, je vais chercher à orienter la capacité productive de l’entreprise (workforce) vers ce que je considère comme étant la plus forte valeur ajoutée pour l’éco système et admettre de sous-traiter certaines parties à d’autres, comme certains développements logiciels. Nous n’avons pas la vocation à tout faire en interne à Thales, rappelez-vous qu’un Radar est produit à 20 pour cent chez nous. Nous travaillons donc sur la logique de faire versus faire faire afin de trouver à l’extérieur des relais qui permettent de soutenir notre croissance. Car non seulement le marché du travail est très compétitif, mais pendant ce temps nous continuons à croître à un rythme assez élevé et il faut qu’on arrive à trouver une organisation et une efficience de l’organisation qui nous permette de soutenir cette croissance. C’est souvent en maitrisant la plus haute valeur ajoutée et en externalisant quand il y en a besoin à d’autres compagnies françaises (en général on cherche quand même dans le premier cercle), ou en Europe ou dans le monde, dès lors que les règles Défense l’autorisent.
Après arrive la question de la rétention donc de la qualité des conditions de travail, car il faut que nos salariés se sentent bien dans leur entreprise. Nous avons un faible taux d’attrition (quelques pour cent) par rapport à d’autres marchés. Cela s’explique par un cadre de travail qui est satisfaisant, du travail flexible etc. Nous travaillons à tous ces aspects, y compris la formation interne (les salariés y sont très attachés) et le loan boarding. Nous travaillons à l’accueil des nouveaux entrants de sorte qu’ils se sentent dès le premier jour bien accueillis dans l’entreprise. Bref, un nombre de chantiers colossal, c’est une problématique que nous saisissons à bras le corps.
JCR : comment Thales cultive et inculque l’esprit de défense à ses jeunes ingénieurs qui connaissent peu ce monde-là ?
CS : À nouveau, on peut entrer chez Thales par plein de portes et se retrouver à un moment ou un autre dans la défense. Ce que je vois c’est qu’il n’y a pas besoin d’inculquer l’esprit de défense, car la finalité prime. Je le vois chez les jeunes, ou par exemple quand le ministre ukrainien est venu sur le site de Limours : nos salariés sont fiers de ce à quoi ils contribuent, car ils perçoivent l’impact qu’ils ont sur les forces armées, pour lesquelles ils ont un profond respect. La responsabilité que nous avons d’équiper nos forces armées avec des équipements qui potentiellement peuvent leur sauver la vie ou y contribuer, ou les aider à remplir leur mission, c’est une mission très noble et nous n’avons pas besoin de l’inculquer, car les employés en ont parfaitement conscience. D’ailleurs nos salariés sont nombreux à être impliqués dans la réserve, que nous encourageons au sein de Thales.
Par ailleurs, il y a une forte proximité entre les forces armées, la DGA et nos équipes. À tous les niveaux. Ils se connaissent et ils travaillent ensemble. Plus ils travaillent en transparence et meilleurs sont les résultats et je le dis aussi parce que j’ai connu les deux mondes (j’ai passé 18 au ministères des armées). Les armées et la DGA prennent nos équipes et les emmènent sur les bases, les bateaux, dans les régiments, ou sur les sites DGA et généralement ils en reviennent transformés, avec une compréhension bien meilleure du besoin militaire. Réciproquement, les armées et la DGA viennent chez nous et comprennent pourquoi telle exigence nous a menés, ou pourrait nous mener dans le mur. Nous devons entretenir cette transparence pour ne surtout pas s’installer dans une logique de « je suis le client, je vous ai envoyé un cahier des charges et vous le respectez ». On arrive à trouver des compromis en cours d’exécution, car en 3 ou 4 ans de développement, beaucoup de choses évoluent. C’est aussi ça l’esprit de défense pour moi, c’est que le triptyque armée-DGA-industrie se réunisse et se parle. La « feuille de route munitions de mortiers » que nous avons mise en place par la DGA et l’EMAT procède de ce principe : les trois parties se mettent autour de la table et se disent, dans l’intérêt commun, qu’elles vont construire une feuille de route dans laquelle on offre de la visibilité à l’industriel, l’industriel investit, et le client adapte un peu son besoin pour bénéficier d’un effet de masse. C’est aussi ça « l’esprit de Défense ».
* Stagiaires de la promotion P30 de l’École de Guerre
À lire également