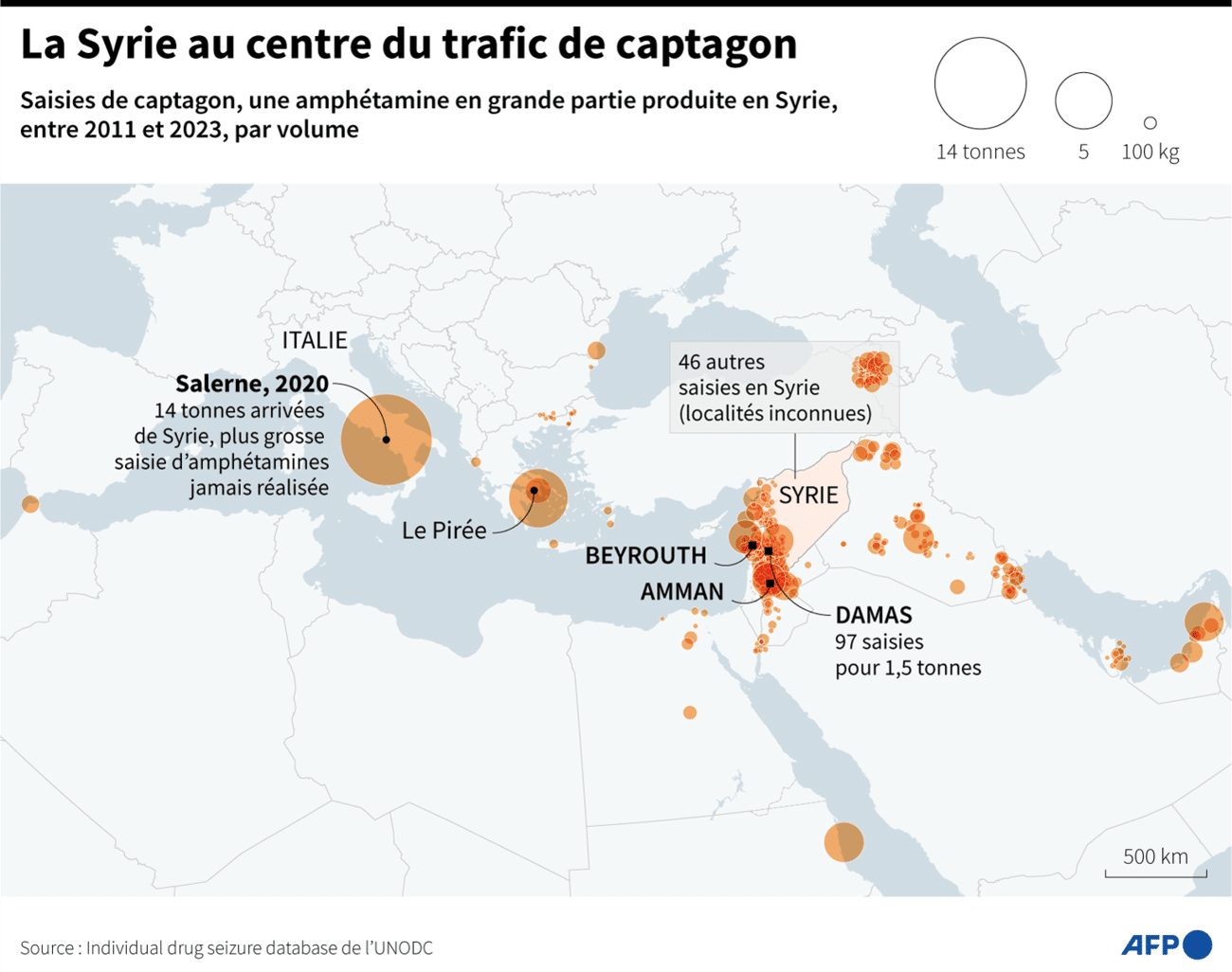Paru quelques semaines après le début de l’opération militaire spéciale déclenchée par la Fédération de Russie contre l’État ukrainien, cet ouvrage composé par un ensemble d’articles de spécialistes du sujet apporte un éclairage particulier sur les ressorts de la politique étrangère de ces deux États.
Isabelle Facon – Russie – Turquie, un défi à l’Occident. Éditions Passés composés. Avril 2022. 219 pages, 18 €.
Héritiers des deux empires hostiles, qui se sont affrontés à de nombreuses reprises, ces deux états, et leurs actuels dirigeants, Vladimir Poutine et Reycip Erdogan, exercent le pouvoir depuis plus de 20 ans. Ils n’ont eu de cesse, par un référendum pour Erdogan, et par des votes à la Douma pour Poutine, de renforcer leur pouvoir.
La guerre en Ukraine qui se déroule entre autres sur les rives de la mer Noire implique nécessairement la Turquie, toujours gardienne des détroits, aux termes de cette convention de Montreux qui s’applique encore. Membre de l’OTAN depuis 1952, la Turquie a dénoncé l’invasion russe, mais n’a pas pris de sanctions contre Moscou, et paradoxalement livre de l’armement à l’Ukraine.
Dans ces relations russo-turques, il faut évidemment faire appel à l’histoire pour en comprendre les ressorts, et notamment le retour à l’affirmation impériale des deux protagonistes. Mais il convient également d’en cerner les éléments contradictoires qui conduisent ces deux pays à collaborer en Syrie et à s’affronter en Libye par exemple.
Les deux premiers chapitres de l’ouvrage, rédigés par Claire Mouradian, qui fait évidemment référence à la guerre du Haut-Karabakh de l’automne 2020, rappellent que depuis le XVIe siècle les deux empires se sont affrontés 13 fois. Cela représente 70 années d’engagements militaires. Les affrontements ont lieu dans le Caucase, mais également sur les rives de la mer Noire avec cette obsession russe, d’Ivan le Terrible à Pierre le Grand pour la forteresse d’Azov. La question de la mer Noire et de ses détroits est évidemment centrale et la guerre de Crimée conclue à l’avantage de la sublime Porte grâce au soutien franco-britannique n’empêche pas la Russie de peser, après la paix de San Stefano, en 1878, sur le destin de l’espace balkanique.
Les deux empires exercent sur leur frontière une forme de diplomatie en miroir assurant la gestion de populations frontalières plus ou moins turbulentes, les cosaques comme les Tatars entre autres, qu’il convient de soumettre. Les déplacements de population, c’est-à-dire les exils forcés, sont largement pratiqués de part et d’autre, tout comme les prétentions russes à vouloir « assurer la protection » des sujets chrétiens des empires voisins.
Il convient évidemment d’aborder les violences de masse de l’Empire ottoman, entre 1895 et 1915, à l’encontre de ces populations arméniennes. L’armée russe n’intervient pas en 1915 pour empêcher ou stopper le génocide, et peu de temps après l’effondrement de l’Empire ottoman et l’installation au pouvoir des bolcheviques, un traité « d’amitié et de fraternité » montre que les Soviétiques comme les kémalistes sont en mesure de faire preuve de pragmatisme pour mettre un terme, effectivement provisoire, à des conflits passés.
Le troisième chapitre rédigé par Dorothée Schmid montre comment fonctionne ce subtil jeu de bascule entre les deux pays qui se font face de porter d’autres de la mer Noire. Hostiles pendant des siècles, les deux empires qui se sont effondrés pendant la Première Guerre mondiale ont pu trouver une sorte de modus vivendi jusqu’au début de la guerre froide. La Turquie apparaît comme un bouclier face à l’expansionnisme soviétique, et comme un frein à l’ambition russe d’accès aux mers chaudes.
La chute du mur de Berlin a évidemment changé la donne même si très rapidement la Russie entend maintenir son influence sur son étranger proche. La Turquie joue aujourd’hui un subtil jeu d’équilibre, surtout depuis 2016. Malgré un incident particulièrement violent, le 24 novembre 2015, lorsqu’un avion russe est abattu par la Turquie, la tentative de coup d’État de juillet 2016 contre Erdogan, favorise le rétablissement de bonnes relations entre les deux puissances. Cela se traduit par l’acquisition par Ankara de batteries de défense antiaérienne russe de type S400. Les deux pays se retrouvent également dans une forme d’équilibrage à propos de la Syrie, même si des tensions persistent, y compris en mars 2020 à Idlib.
Les Occidentaux sont évidemment très attentifs aux possibilités de voir un antagonisme russo-turc se réveiller, ce qui explique d’ailleurs, de façon indirecte, l’intérêt que l’on porte, au-delà des approvisionnements gaziers, à l’Azerbaïdjan, soutenu par Ankara dans les conflits qui l’opposent à l’Arménie.
Pour Igor Delanoë, dans le quatrième chapitre de l’ouvrage, la crise syrienne a pu réveiller des oppositions entre la Russie et la Turquie. La brouille consécutive à la destruction du Sukoi 24 russes par la chasse turque le 24 novembre 2015 a pu générer des tensions qui se sont assez vite terminées. Les deux politiques de puissance se répondent quand l’objectif est très clairement, pour les deux protagonistes, de prendre leurs distances à l’égard du monde occidental. Le soutien que la Turquie apporte aux Frères musulmans s’inscrit dans une démarche de soft power qui n’exclut pas non plus, et c’est le cas en Libye, comme en Syrie, l’utilisation de la puissance militaire. Il est possible de considérer que l’Eurasisme, comme ressort de la politique étrangère russe, peut séduire du côté d’Ankara avec un partenariat stratégique, qui se retrouve d’ailleurs dans l’actuel conflit ukrainien, avec la Russie, l’Iran et la Chine. Il suffit de regarder comment se répartissent les livraisons d’armes qui permettent à la Russie de maintenir sa présence sur le territoire ukrainien.
Pour ce qui concerne la Syrie, il est possible d’aborder les relations entre la Russie et la Turquie sous l’angle de la coopération compétitive, la Turquie essayant actuellement d’imposer son espace de sécurité dans les zones kurdes. Le dernier attentat à Istanbul, attribué au parti des travailleurs du Kurdistan, permet aujourd’hui de justifier la volonté d’Ankara d’imposer sur le territoire syrien une zone tampon. Ce 20 novembre 2022, l’aviation turque a bombardé la zone de Kobané dans les zones que les forces kurdes avaient libérées de l’État islamique.
Un ancien protocole qui avait été négocié en 1998 entre la Turquie et la Syrie permettait aux forces turques de poursuivre les combattants du parti des travailleurs du Kurdistan en territoire syrien jusqu’à 5 km de profondeur. Un accord de ce type permettrait de normaliser les relations, sous l’égide de la Russie, entre le régime de Bachar al-Assad et la Turquie. Le mode de gestion de crise se négocie en permanence entre les deux chefs d’État, ce qui a pu conduire à des accords de sécurité entre les deux pays. En principe, les deux états qui disposent l’un envers l’autre d’une certaine capacité de nuisance ont tout intérêt à ce que cette relation bilatérale basée sur des avantages mutuels persiste.
Actuellement oublié sur le terrain médiatique, le conflit en Libye met en présence la Turquie et la Russie avec des objectifs divergents.
A lire également :
Turquie : vers l’armée nouvelle ? L’après 15 juillet 2016
Galip Dalay est chercheur associé à l’institut français des relations internationales. Il revient sur le contexte général de la situation en Libye, en prenant le soin de revenir sur le printemps arabe qui date déjà de 2011. À la suite des risques majeurs d’écrasement du soulèvement par les forces de Kadhafi, le conseil de sécurité des Nations unies a voté le 17 mars 2011 la résolution 1973, permettant une intervention de l’OTAN. La Russie s’est abstenue, ce qui a permis à cette intervention de disposer de la légitimité des Nations unies. La Turquie a dans un premier temps condamné cette intervention, avant de la soutenir. Membre de l’OTAN le pays pouvait trouver une solution avantageuse en termes d’influence, une fois terminée l’intervention occidentale. Une fois le régime de Kadhafi mis à bas, les occidentaux se sont assez peu préoccupés de maintien de la paix, ce qui a laissé la place au cas où entretenu par les milices locales. Le pays c’est assez rapidement divisé en deux, avec le gouvernement d’entente nationale reconnu par les Nations unies et l’armée nationale libyenne du maréchal Hafthar. Le gouvernement d’entente nationale, situé à Tripoli, reçoit le soutien de la Turquie qui décide d’une intervention militaire. L’armée nationale libyenne est soutenue par l’Égypte, les Émirats arabes unis et la Russie.
Les motivations du gouvernement d’Ankara sont, dans un premier temps, économiques, en raison des liens anciens avec le précédent régime, sans parler de l’intérêt pour les entreprises turques pour les chantiers de reconstruction du pays à venir. Mais au-delà de ses intérêts immédiats, l’enjeu géopolitique, avec la volonté, dans le cadre de la doctrine de la patrie bleue, d’exercer une influence sur la Méditerranée orientale dont les avantages en matière énergétique sont connus.
Pour la Russie qui exerce depuis son intervention en Syrie une influence évidente dans la même zone, à partir du port de Tartous les motivations sont de même nature, sans compter l’influence à venir sur la reconstruction du pays et sur son potentiel énergétique. À partir de 2019 le Turquie s’est fortement engagée dans le soutien au gouvernement d’entente nationale, par des livraisons d’armes et l’envoi de mercenaires. Les pays occidentaux ont laissé l’initiative aux émirats, à l’Égypte, à la Russie et la Turquie, tandis que Français et Italiens s’opposaient également à propos de l’avenir du pays.
La Russie comme la Turquie ont consolidé les positions militaires de leurs alliés respectifs, tout en essayant de trouver un accord, comme le 8 janvier 2020, lorsque les deux présidents, Erdogan et Poutine ont appelé un cessez-le-feu. En l’état actuel, le soutien militaire de la Turquie au gouvernement d’entente nationale semble porter ses fruits, tandis que la Russie a dû limiter ses ambitions, en raison de son engagement en Ukraine.
Jean-François Pérouse présente dans le sixième chapitre le repositionnement de la Turquie en mer Noire face à la Russie. Maître de conférences à l’université de Toulouse Jean Jaurès, Jean-François Pérouse revient sur l’intérêt énergétique que les autorités d’Ankara trouvent, depuis août 2020, aux gisements de gaz exploitables sur le plateau continental de la mer Noire. Cet espace longtemps disputé entre les deux empires riverains occupe désormais une place particulière, un enjeu, une ressource multiforme, et un espace stratégique à investir, pour la Turquie. La rive nord de la Turquie a été largement dévitalisée par le départ des Arméniens et des Grecs après 1915 et par les migrations vers les grandes agglomérations. Depuis une quinzaine d’années, cet espace connaît un aménagement important, avec la route littorale de la mer Noire achevée en 2007, de nouvelles liaisons ferroviaires ou des tunnels routiers. Il est considéré comme un pont stratégique entre des ensembles entre Balkans, Caucase, et Moyen-Orient.
Ce changement de perception est évidemment lié à la disparition de l’URSS et à la volonté turque de s’inscrire dans la continuité de l’Empire ottoman. L’ambition s’exprime à différents niveaux, y compris avec le développement d’un complexe militaro-industriel national, associé à une diversification de ses fournisseurs d’armement. La Turquie est le pays riverain qui possède le plus long linéaire côtier avec plus de 1700 km de littoral sur la mer Noire, et bien évidemment une légitimité historique, ethnique, et religieuse, y compris dans les pays du Caucase. Cela se traduit par le développement de nouvelles installations militaires sur le territoire, de même que par une démarche plus autonome en direction des autres pays riverains. En même temps, et sous réserve d’évolution que la guerre en Ukraine peut générer, l’initiative turque dénommée « harmonie en mer Noire » institutionnalise la coopération navale avec le voisin du Nord. Cela explique sans doute la place particulière que la Turquie a pu occuper dans les accords de sortie des céréales ukrainiennes à partir de la mer Noire.
Gaïdz Minassian que les lecteurs du monde connaissent comme journaliste travaille sur la résolution des conflits dans l’espace postsoviétique. Il présente dans le septième chapitre de cet ouvrage les relations entre la Turquie et la Russie dans le Caucase du Sud. Cette région se trouve à l’intersection de la Russie, de la Turquie et de l’Iran. On notera que ces trois anciens empires se retrouvent réunis dans le processus d’Astana pour la paix en Syrie.
À partir de 2008, date de l’intervention russe contre la Géorgie à l’appel de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie, un rapprochement stratégique entre Moscou et Ankara a pu être observé. Toutefois l’auteur de l’article nous invite à la prudence, car les deux états eurasiatiques sont à la fois rivaux et partenaires dans cet espace qui a occupé dans l’histoire des deux pays une place particulière. Pour la Turquie cet espace caucasien a pu être contrôlé par la sublime Porte pendant la période ottomane. Dans le même temps, les pays qui composent cet espace trans caucasien, pour reprendre l’appellation russe, ont des intérêts divergents. La Russie exerce une forme de tutelle sur l’Arménie, tandis que les liens entre la Turquie et l’Azerbaïdjan sont devenus de plus en plus étroits, depuis la guerre à propos du Nagorny Karabakh. Pour la Russie la domination du Caucase a pu constituer un marqueur historique majeur qui a supposé de la part de l’empire des tsars trois siècles d’intervention. Dans le même temps, pour les Turcs, le Caucase peut représenter un socle historique puisque c’est à partir de ce territoire qu’a été réalisée la conquête de l’Asie Mineure. Comme pour les groupes djihadistes en Syrie, l’attitude de la Turquie se révèle très ambivalente. Pendant le conflit en Tchétchénie, la Turquie sert de base de repli aux rebelles nationalistes sans pour autant dénoncer les crimes commis par la Russie. On retrouve la même posture dans le conflit ukrainien évidemment. L’enjeu reste le contrôle des voies de communication dans la région tandis que la Turquie réalise son opération d’influence en direction de l’Azerbaïdjan. De la même façon, l’attitude de Moscou à l’égard de son allié arménien est également très ambiguë, avec un soutien affiché à l’Arménie accompagné par des fournitures d’armes à l’Azerbaïdjan. Jusque l’automne 2020, la question du Nagorny Karabakh a pu faire partie de cette série de conflits gelés largement oubliés par la communauté internationale jusqu’au moment de la crise sanitaire qui a contribué à faire baisser les revenus de l’Azerbaïdjan. Pour détourner la colère de la population azérie contre la corruption, le régime en place a repris à son compte une rhétorique guerrière antiarménienne qui s’est concrétisée par une offensive fortement soutenue militairement par la Turquie.
Dans cette situation, l’Azerbaïdjan se retrouve fortement avantagé, puisqu’ il a pu bénéficier du soutien d’Ankara, de la complaisance de Moscou, et qu’ils se retrouvent, depuis la crise énergétique consécutive à la guerre en Ukraine courtisée par l’Union européenne.
Bayram Balci : influences croisées de la Turquie et de la Russie en Asie centrale
Comme ses autres co-auteurs, le directeur de l’institut français d’études anatoliennes revient sur la perception négative que le monde occidental entretient à l’égard de la Russie et de la Turquie.
Au Moyen-Orient comme en Libye, les deux états sont rivaux parfois, mais coopèrent souvent. En mer Noire on retrouve la même logique nourrie par une histoire largement conflictuelle. Par contre pour l’Asie centrale post soviétique, la situation est sensiblement différente, marquée par un héritage conflictuel majeur même si, d’après cet auteur, les antagonismes ne sont irréconciliables qu’en apparence.
À l’exception du Tadjikistan, les populations du Kazakhstan, du Kirghizistan, de l’Ouzbékistan et du Turkménistan pratiquent majoritairement une langue turcique proche du turc anatolien. L’islam sunnite est aussi un facteur d’unité de même que l’importance des confréries. Toutefois les états indépendants issus de l’implosion de l’URSS ne sont pas enthousiastes à l’idée de se fondre dans un ensemble plus vaste et le pan-turquisme reste à un statut de courant idéologique, que l’on appelle également le pan-touranisme.
La Russie a colonisé ces territoires à partir du XVIIIe siècle, et elle a largement contribué à forger leur identité nationale. Ces jeunes états sont loin encore d’une émancipation totale à l’égard de Moscou même si, dernièrement, la réunion des états membres de la CEI a montré une nette prise de distance à l’égard de Poutine sur fond de guerre en Ukraine. Considérés comme des « boulets » dans la décennie 1990, ces territoires sont redevenus l’objet des attentions russes avec la doctrine Kozyrev de « l’étranger proche ».
A lire également :
La Russie, l’épouvantail de l’Europe occidentale
Les effets de la doctrine situent ci-dessus se vérifient surtout à partir des années 2000, au moment de l’arrivée de Vladimir Poutine aux affaires. C’est dans ce cadre que les initiatives pour conserver les républiques d’Asie centrale dans le giron de la Russie se multiplient. L’initiative la plus aboutie reste l’union eurasiatique qui semble battre de l’aile aujourd’hui, du fait de la guerre en Ukraine. Pour autant, dans la sphère politique de ces états, Moscou conserve de multiples relais. Si la Russie détient encore le leadership en Asie centrale pour ce qui concerne le domaine clé des énergies fossiles, elle subit la pénétration chinoise dans la région. Une forme de dépendance associe également les populations des républiques d’Asie centrale avec la Russie, par le biais de travailleurs qui transfèrent dans leur pays d’origine une partie de leurs revenus gagnés en Russie.
Moscou continue d’entretenir des bases militaires en Asie centrale, au Tadjikistan et au Kirghizistan et entretient ses liens par le biais de l’organisation du traité de sécurité collective fondée en 2002. Depuis 2021 avec le retour des talibans en Afghanistan, les pays d’Asie centrale semblent pouvoir entamer un rapprochement avec l’organisation dont la vocation affichée et la lutte contre le terrorisme islamiste.
Dans la pratique, avec les attributs du soft power, la Russie conserve une capacité d’influence en Asie centrale, même si la plupart des pays de la région n’apportent pas de soutien effectif à Moscou pour son opération militaire spéciale en Ukraine.
Malgré de nombreuses tentatives, la Turquie a essayé de développer une politique d’influence en Asie centrale, mais très rapidement le projet ambitieux d’un « monde turc allant de l’Adriatique à la muraille de Chine » s’est heurté à la volonté farouche des jeunes états de sauvegarder leur identité nationale. Priorité a donc été donnée à des projets bilatéraux. C’est dans le domaine militaire que la coopération aurait pu entretenir de gros espoirs, mais seul l’Azerbaïdjan a pu en bénéficier. Et il ne s’agit pas à strictement parler d’un pays d’Asie centrale.
La Turquie conduit une vigoureuse action dans le domaine économique par le biais de ses entreprises de travaux publics même si c’est dans le secteur de la culture que les projets sont les plus aboutis.
Dans la pratique, même si on aurait pu imaginer le retour de la rivalité séculaire entre les deux empires, les deux états sont davantage enclins à une coopération basée sur des actions différentes et des objectifs spécifiques.
Nicolas Mazzucchi est chargé de recherche à la fondation pour la recherche stratégique. Il revient ici sur « la coopération énergétique russo-turque, relation désirée, relation subie ».
La croissance économique de la Turquie, la réorientation énergétique des pays des Balkans du charbon vers le gaz naturel et la volonté russe de l’affranchir du corridor énergétique ukrainien ont placé Ankara au centre du jeu. La découverte de gisements gaziers en mer noire méridionale et en méditerranée orientale suscite également l’intérêt. La dépendance de la Turquie à l’égard de la Russie en matière énergétique est aussi ancienne que l’exploitation des champs pétrolifères de la Caspienne. La Turquie largement ouverte aux hydrocarbures russes cherche toutefois à s’affranchir d’une trop forte dépendance en diversifiant ses fournisseurs, notamment l’Azerbaïdjan soutenu par Ankara dans sa guerre contre l’Arménie. La Russie dispose de capacités importantes de raffinage pour plus du double de sa consommation intérieure tandis que la Turquie est en sous-capacité chronique bien que des accords avec l’Azerbaïdjan aient permis de passer le cap des 800 000 barils par jour. Mais dans la pratique la Russie fournit à la Turquie 35 % de sa consommation de produits raffinés. Elle fournit également le tiers de la consommation turque de gaz naturel. SI les États-Unis et le Qatar proposent du gaz naturel liquéfié à Ankara, le différentiel de prix joue en faveur de Moscou d’autant que les infrastructures de type gazoduc sont déjà installées.
Une coopération active dans le domaine nucléaire
Dans ce domaine le savoir-faire russe a pu s’imposer avec la centrale d’Akkuyu qui devrait diverger en 2023 et produire effectivement en 2026. Elle pourrait fournir 16 % des besoins turcs en matière d’électricité et ce contrat assorti de fourniture de combustible et de formation d’ingénieurs permettrait à la Russie de s’imposer sur ce marché et d’y développer ses propres normes.
La coopération se révèle structurante et, malgré la guerre en Ukraine, le gazoduc Turkstream ouvert en 2020 alimente le sud de l’Europe tandis que d’autres dispositifs directement à partir de l’Azerbaïdjan mettent la Turquie en position de carrefour énergétique. Le Kanal Istambul qui doublerait le Bosphore et s’il était mis en œuvre effectivement en 2023, renforcerait cette position en sécurisant le transit pétrolier.
Le S 400 et après ?
Isabelle Facon, la directrice de publication de l’ouvrage revient sur cet achat de matériel d’interdiction aérienne russe qui a évidemment défrayé la chronique, puisque pour la première fois un pays membre de l’OTAN faisait l’acquisition de matériel de ce que l’on pourrait qualifier de camp adverse.
Ce dispositif a été livré depuis le mois de juillet 2019, avec un schéma de financement particulièrement attrayant, en roubles, couvrant 55 % du contrat. Montant global est estimé à 2 000 000 000 ½ de dollars. L’achat semble davantage politique que dicté par de simples considérations militaires, même si le gouvernement d’Ankara reproche aux Occidentaux leur absence de soutien lors de la tentative avortée de coup d’État de juillet 2016. C’est à partir de cette date, et malgré les tensions entre la Russie et la Turquie à propos de l’avion de chasse russe abattu en 2015 par la force aérienne turque que les négociations ont été ouvertes. Vladimir Poutine a été le premier chef d’État à soutenir Erdogan après la tentative de coup d’État.
Les réactions au sein de l’OTAN ont été particulièrement vives, même si l’argument qui a été donné par la Turquie était de bien différencier les usages de ces différents matériels, réservés à des missions spécifiques, sans interfaces avec l’OTAN. Le contrat à propos de ce dispositif antiaérien pourrait ouvrir la voie à une coopération plus importante, avec des transferts de technologie. D’après l’auteur l’enthousiasme à propos de cette coopération russo-turque est assez vite retombé, d’autant qu’Ankara a rapidement passé des accords de coopération avec l’Ukraine, notamment pour la production de drones et d’unités navales. La Turquie trouve également un certain intérêt dans le transfert de technologies de moteurs ukrainiens, une ancienne spécialité qui date de la période soviétique et que le gouvernement de Kiev a été en mesure de poursuivre. En réalité l’ouverture de la Turquie à des accords de coopération militaire en direction de la Russie semble obéir à une volonté d’exercer une pression directe sur les États-Unis, ce qui peut conduire la nouvelle administration à remettre en cause l’interdiction prononcée par l’administration de Donald Trump faite à la Turquie de participer au programme de l’avion F 35.
Pour reprendre la conclusion générale rédigée par la directrice de la publication, le terme d’aléatoire ou de volatile semble caractériser cette relation entre la Turquie et la Russie. De façon peut-être plus brutale, cette citation, « les états n’ont pas d’amis, ils n’ont que des intérêts », s’applique parfaitement dans ce cas d’espèce. La Turquie utilise tous les atouts qui sont les siens pour s’imposer comme puissances régionales incontournables, en associant son influence religieuse et la référence à l’Empire ottoman. La Russie s’inscrit dans une démarche équivalente en utilisant les populations russes présentes dans l’étranger proche et bien entendu sa puissance militaire. Pour autant la Russie observe avec méfiance la relation que la Turquie développe avec la Géorgie et l’Azerbaïdjan, sans parler du maintien de ce pays au sein de l’OTAN. Mais en même temps le gouvernement turc n’a pas cherché à inscrire directement sa réponse diplomatique à propos du conflit ukrainien dans celle de la communauté euro – atlantique.
L’ensemble des contributions dans cet ouvrage montre à l’évidence cette ambivalence des relations entre les deux politiques que je qualifierais d’impériales. Toute la question qui mérite d’être posée se situe dans les perspectives de l’élection présidentielle qui devrait avoir lieu en Turquie cette année 2023 et dans l’évolution politique intérieure de la Russie. À cet égard, pour les deux pays, cette année 2023 est lourde d’incertitude. Et c’est évidemment le cas de l’observateur attentif à l’évolution de cette région du monde qui se situe au cœur de ce que l’on appelait il y a plus de 20 ans, « l’arc de crise ».
A écouter également :