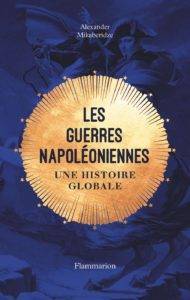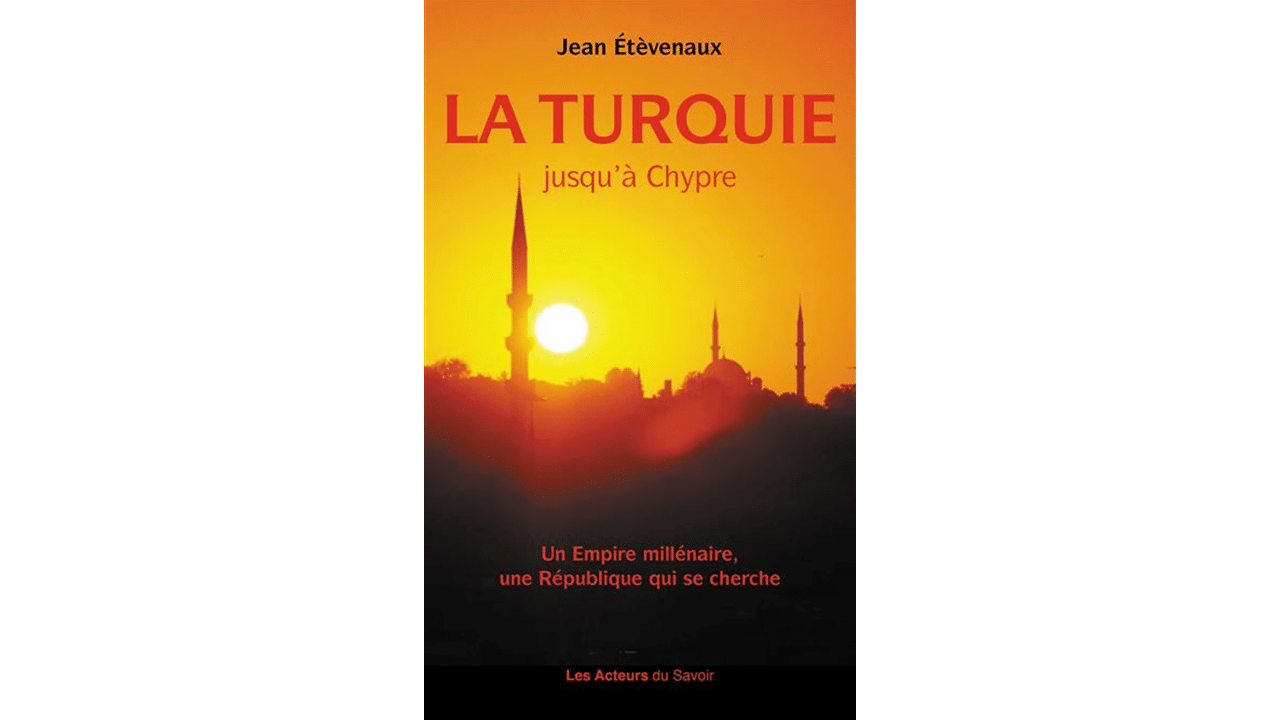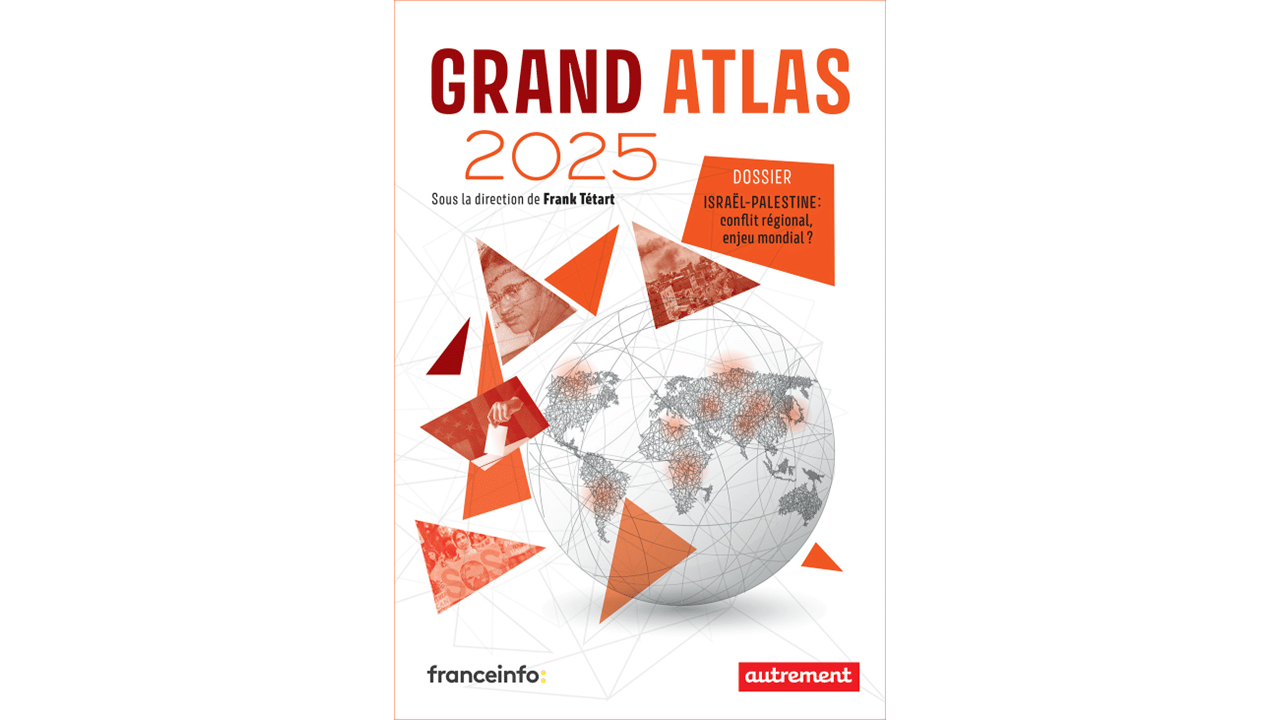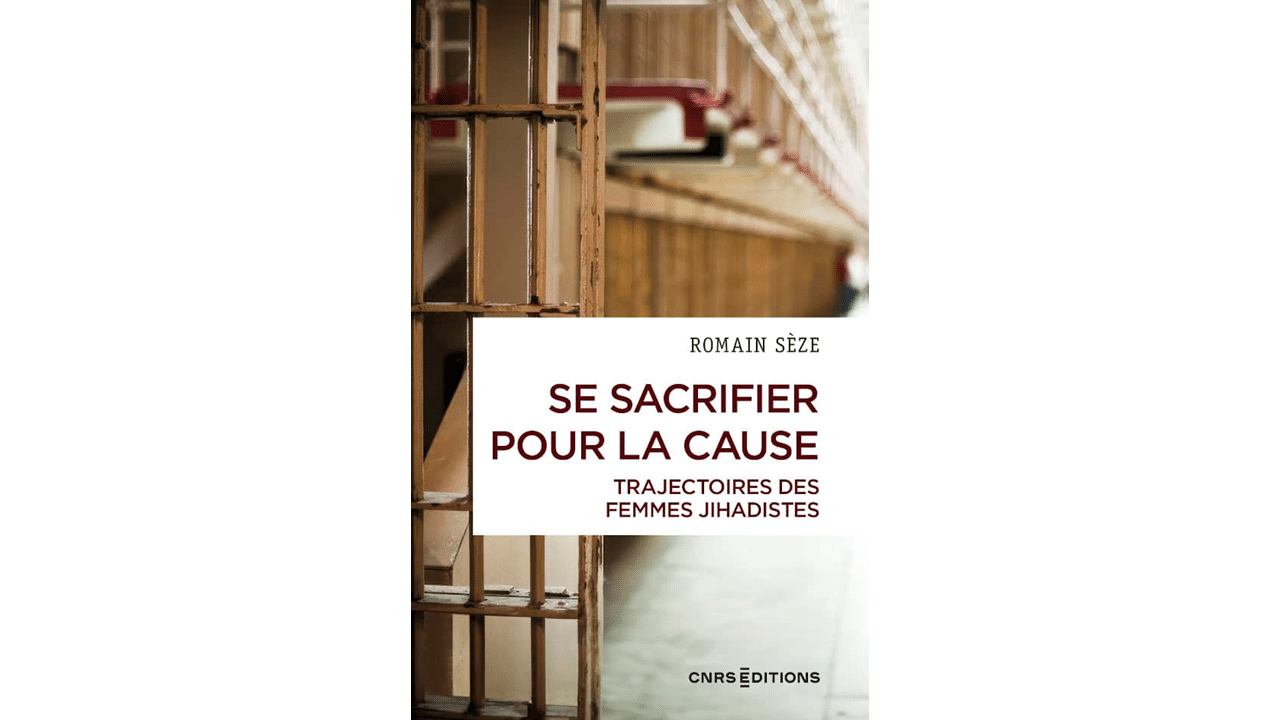Une année de commémoration prend fin, laissant une impression mitigée. Quand les célébrations officielles sont apparues embarrassées, l’accueil fait aux ouvrages et aux revues qui en ont traité sans timidité a été favorable et les publications de qualité n’ont pas manqué.
Alexander Mikaberidze, Les guerres napoléoniennes. Une histoire globale, Paris, Flammarion, 2020, 1180 p.
Parmi celles-ci, une synthèse ambitieuse, les Guerres napoléoniennes, une histoire globale, est consacrée à l’impact mondial des campagnes menées par la France dès la Révolution. Sa traduction en français a suivi de quelques mois sa publication aux presses de l’université d’Oxford. Son auteur, Alexander Mikaberidze, professeur à l’université de Louisiane, est parvenu à retracer en quelque mille deux cents pages un parcours exhaustif des conséquences, jusqu’aux plus lointaines, du cycle de guerres commencé en 1792, durant la révolution, et poursuivi jusqu’à la défaite de Waterloo. À différents moments et sous des formes diverses, les quatre parties du monde (selon la division classique) s’y sont trouvées mêlées.
Au premier plan, quelques acteurs — la France, bien sûr, et son implacable adversaire, la Grande-Bretagne, mais aussi l’Autriche, la Prusse et la Russie. Au second plan, des États européens tels que la Scandinavie ou la péninsule ibérique que la résistance espagnole — la guerrilla — va porter au premier plan.
À lire également
Nouveau hors-série : Armée de terre, le saut vers la haute intensité
La marche des empires
Le point de vue adopté pour décrypter ce foisonnement est celui de la marche des empires. À l’ascension de l’empire français en Europe, aussi fulgurante que son effondrement accompagné de la perte des territoires qui constituaient son empire outre-mer — les Antilles, les possessions américaines, les îles de l’océan Indien, les enclaves asiatiques —, répond l’essor durablement prospère de l’Empire britannique en Asie, l’Inde pour joyau, où le jeu mené par la compagnie des Indes entre la couronne britannique et les principautés locales est finement décrit. Le déclin inéluctable des empires autrichien et ottoman qui s’achèvera un siècle plus tard par leur désintégration est contemporain de la montée de la Prusse (bien qu’on ne puisse parler d’empire à propos d’un État de 150 000 km2 et de quelques millions d’habitants). Dans cet ensemble dynamique, la position de l’empire occidental russe apparaît compliquée et fragile.
L’accent est mis sur les déterminismes économiques, les ambitions des États, les jeux complexes de la diplomatie et des opérations militaires. Les aspects politiques, culturels et les changements sociaux, sans être absents de cette fresque, n’interviennent qu’en second lieu.
Le lecteur non spécialiste en apprendra beaucoup sur des zones que l’historiographie française tend à négliger — l’Empire ottoman (pourtant allié traditionnel de la France), l’Amérique du Nord aux prémices de son expansion[1], les Amériques espagnole et portugaise qui entament des processus d’indépendance qui ne sont pas toujours guerriers.
La question de l’Amérique latine
Une synthèse aussi vaste ne peut se fonder que sur des sources primaires et l’auteur a donc puisé à de bons ouvrages la plus grande partie de sa matière. On comprendra qu’il a donné la préférence à des auteurs anglo-saxons. C’est parfois dommage, car des courants historiographiques ont été écartés qui ne s’expriment pas en anglais et qui, surtout, ne s’inscrivent pas dans des modèles convenus. Ainsi semble ignoré l’effort conceptuel réalisé à partir des années 1980 par des historiens européens et latino-américains qui proposaient, à côté des modèles français et nord-américain, un modèle révolutionnaire hispanique qui, lui, ne faisait pas du passé table rase[2]. Cette négligence conduit à présenter le processus complexe qui, de la résistance espagnole contre l’armée napoléonienne, mène à plus de vingt années de guerres outre-mer, comme on le fait depuis deux siècles : ç’aurait été une pagaille noire et une déplorable anarchie. Assommé par l’énumération de soulèvements, de retournements d’alliances et de projets politiques antagonistes qui ravagent l’Amérique espagnole, le lecteur aura du mal à identifier les forces qui ont mobilisé ces sociétés si durablement.
On pourra supposer que des critiques comparables pourraient être formulées par les spécialistes d’autres espaces touchés par le contre-coup des guerres de la Révolution et de l’Empire. Cela n’empêchera pas de recommander vivement cet ouvrage comme une référence indispensable pour toute étude de la période.
Quid de l’histoire bataille ?
Enfin, la commémoration laborieuse du bicentenaire de la mort de l’empereur incite à revenir sur une question qui a partagé les historiens français depuis un siècle, celle de l’histoire-bataille. À la condamnation fulminée par le groupe des Annales, reprise par le gros des troupes de l’université française pendant des décennies, a succédé une ouverture tentée à partir d’une « nouvelle histoire-bataille », celle proposée par John Keegan voici quelque quarante ans, dont le succès fit des émules. La bataille méritait à nouveau d’être étudiée, non pour ses objectifs et ses enjeux, mais pour l’expérience vécue par ses acteurs. Elle devenait le concentré d’une vie sociale, d’une manière de sentir, de vivre et de mourir. Le glissement vers une victimisation du combattant n’a pas tardé.
À l’exception des spécialistes des études napoléoniennes, dont la constance et les travaux méritent d’être salués, on notera que ce sont des romanciers qui ont continué de s’intéresser à la bataille pour ce qu’elle est : un duel dont l’un sortira vainqueur et l’autre défait. De ces auteurs, il en est plusieurs d’excellents, je n’en citerai que trois, Robert Margerit et son Waterloo, Yves Amiot et La Bataille, Patrick Rambaud pour Il neigeait[3].
À lire également
Napoléon homme d’État – Entretien avec Éric Anceau
[1] En dépit de quelques ouvrages pionniers tels que Le ferment nationaliste : aux origines de la politique extérieure des États-Unis (1789-1812) que Marie-Jeanne Rossignol avait publié en 1994 chez Belin.
[2] L’ouvrage coordonné par Antonio Annino von Dusek et François-Xavier Guerra (Inventando la nación. Iberoamérica siglo XIX, Madrid, Fondo de cultura económica, 2003) fournit une bonne synthèse de ces recherches.
[3] Robert Margerit, Waterloo, Gallimard, Trente journées qui ont fait la France, 1964, 640 p. Yves Amiot, La Bataille : juin 1807, Paris, Librairie José Corti, 1980, 152 p. Patrick Rambaud, Il neigeait, Paris, Grasset, 2002, 333 p. (Ces trois ouvrages ont aussi été édités sous forme électronique.)