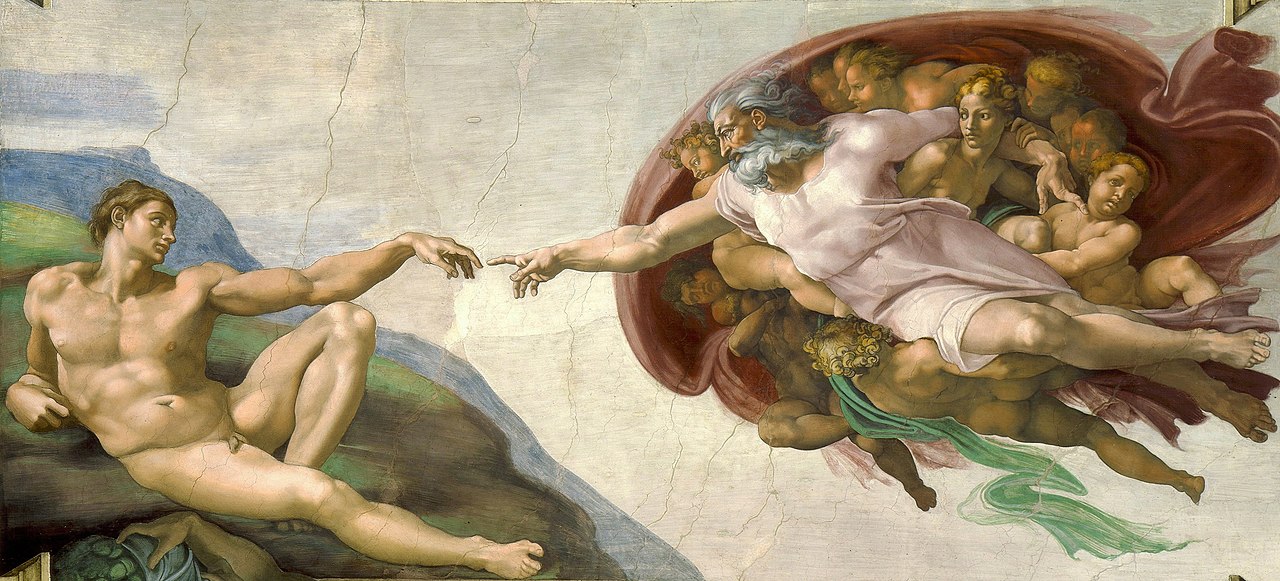Si l’on admet que les idées mènent le monde, alors il est plus que jamais nécessaire de comprendre celles qui nous dirigent aujourd’hui. Entre la pensée classique et la pensée relativiste, ce sont deux conceptions de l’homme et du monde qui ne perçoivent pas les événements de la même façon. Comment alors rebâtir une société commune et favoriser la fraternité et le bien commun dans un corps social qui se délite ?
Entretien avec Pierre de Lauzun auteur de Pour un grand retournement politique. Face aux impasses du paradigme actuel, Le Bien commun, 2019. Propos recueillis par Conflits.
Vous présentez deux paradigmes intellectuels qui s’opposent, et qui ont des conséquences politiques et sociales fortes : le paradigme classique et le paradigme relativiste. En quoi les deux s’opposent-ils et pourquoi le paradigme relativiste est-il dominant aujourd’hui ?
Le paradigme relativiste domine notre culture commune depuis trois siècles, mais n’a fait sentir que progressivement ses effets. C’est l’idée qu’il n’y a pas de vérité objective en matière morale, politique et sociale, et que chacun se détermine donc comme il l’entend. Dès lors la seule notion du bien que doit reconnaître la société est le droit de chacun à définir comme il l’entend ses valeurs et références sous réserve du droit équivalent du voisin – ce qu’on trouve pour la première fois clairement exprimée dans la Déclaration des Droits de l’homme de 1789. Il en résulte une lente dérive, qui ronge ces biens communs essentiels qu’à des degrés divers l’humanité avait repérés ou construits au cours de son histoire. Au stade actuel, cela se traduit par une radicalité et une emprise considérables, dont témoigne ce qu’on appelle le politiquement correct, une police de la pensée qui eût été impensable sous cette forme il y a cinquante ans. Mais échapper à l’emprise d’un paradigme dominant n’est pas simple. Un paradigme est un cadre qui structure et oriente toute la pensée collective d’une époque. Comme l’a montré Kuhn en matière scientifique, un paradigme n’est dépassé que lorsqu’un autre émerge du fait que le premier rencontre des difficultés insurmontables. Tant qu’on n’en est pas là, la pensée reste conditionnée par le paradigme précédent.
La pensée classique présente un cadre de pensée tout à fait différent et donc véritablement alternatif. Elle se fonde sur l’expérience des siècles, qui permet de dégager par la réflexion et l’usage une référence sûre pour la vie et l’action communes. Elle a été formalisée en politique notamment par Aristote, Cicéron puis Thomas d’Aquin et est toujours vivante depuis, inspirant à des degrés divers des penseurs comme Burke, MacIntyre ou Scruton, voire Tocqueville. Dans cette conception on trouve d’abord le sens de l’objectivité du bien et du vrai ; l’importance centrale de la personne, qui ne peut exister et se développer qu’au sein de communautés solidaires, grâce à une éducation humaniste, tournée vers le vrai et le bien. Un autre aspect important est la conscience que les sociétés sont des édifices complexes, construits au cours du temps et non à partir de théories édifiées a priori, impliquant l’interaction de très nombreuses personnes et qui se régit par des règles de vie dégagées au cours du temps et intériorisées. L’une des forces de la pensée classique, même dans un contexte hostile comme le nôtre, c’est qu’elle donne du recul. Ce qui aide à ne pas se perdre dans les méandres du débat politique au jour le jour, sans pour autant cesser d’espérer et d’agir.
La pensée politique est parfois confuse, car les concepts employés sont polysémiques ou mal définis. Il en est ainsi des concepts de libéral et de conservateur. Comment ces deux concepts peuvent-ils se définir et quels sont leurs points communs et leurs points de divergence avec la pensée classique ?
Oui les concepts politiques sont fréquemment ambigus et mal définis. Cela ne résulte pas seulement de la complexité du sujet, ou de limites intellectuelles. C’est aussi du fait de leur rôle comme bannières dans le combat politique, soit pour rassembler, soit pour stigmatiser.
Le mot libéral est un des plus ambigus qui soient. Si on discerne bien un libéralisme philosophique qui s’inscrit clairement dans le cadre de notre paradigme, on trouve aussi un libéralisme politique ou un libéralisme économique dont le sens peut varier selon les personnes ou les contextes : le premier entre la mise en œuvre politique de notre paradigme, et le souci légitime de l’état de droit ou de l’autonomie des personnes face à l’État ; le second entre le laissez-faire intégral ou le culte irrationnel du marché absolutisé, et la promotion d’une économie de libre initiative et d’entreprise, où le marché trouve sa place. En faisant un bloc du libéralisme, on risque de sacrifier au passage des dimensions essentielles.
La notion de conservatisme n’est guère plus claire. Cela peut viser tout partisan de la situation politique qui domine un pays à un moment donné : en ce sens Brejnev était conservateur. Mais, de façon plus fréquente, on désigne par là un courant de pensée politique, bien représenté dans le monde anglo-saxon, mais pas seulement, que j’analyse comme une forme dérivée de la pensée classique, hybridée sous l’emprise du paradigme actuellement dominant. D’où un certain flou. Ainsi aux États-Unis on a fini par appeler conservateur quelqu’un qui en économie est ultra-libéral ; même si tout récemment on sent une nette évolution pour retrouver une conception plus conforme à la tradition conservatrice. Le conservateur se veut pragmatique, mais tend à privilégier la préservation d’une situation existante. C’est souvent justifié. Mais cela reste conditionné par cette situation. Et au fur et à mesure qu’elle évolue, le conservatisme glisse avec, et risque de confondre le provisoire avec l’essentiel, ou ses intérêts avec le bien commun.
Lire aussi : Méfiez-vous des rêves. Éditorial du hors-série n°7
Vous écrivez : « Un débat qui ne pose pas la vérité, y compris la vérité morale, comme objectif commun n’est plus un débat, car il n’y a plus de critère commun ; c’est au mieux une négociation. […] Et si tout est négocié, alors les rapports de forces les plus brutaux finiront pas l’emporter, et finalement l’état de nature au sens violent de Hobbes. Au minimum une délinquance latente. »
En effet, sur bien des points, il semble que la notion de vérité a disparu et que l’usage de la raison s’efface. Comment rebâtir alors un paradigme classique dans ces conditions ?
La base de notre paradigme relativiste est bien ce refus de reconnaître que l’on ne peut débattre sérieusement sur le vrai ou le bien que si les participants admettent au départ une idée régulatrice, qui est que l’objet de tout débat est la recherche du vrai en soi ou du bien en soi ; c’est ce qui inspirait Socrate dans ses discussions serrées, notamment avec les sophistes, ancêtres de nos relativistes actuels. Même si la recherche de cette vérité et de ce bien est un effort constant, jamais terminé. MacIntyre a très bien analysé cette question. Sinon il ne reste plus que le rapport de force, physique, juridique, économique, dialectique ou autre ; et notamment le règne de l’argent, qui est matériellement neutre : on peut toujours mettre un prix sur quelque chose même si on n’est d’accord sur rien d’autre. C’est ce que nous constatons de plus en plus.
Rebâtir un paradigme classique suppose certes l’exercice du débat socratique, mais en gardant en tête la puissance actuelle de l’emprise du paradigme, qui structure la pensée collective et plus encore le débat. Certes au fond d’eux-mêmes les personnes savent que la vérité ou le bien n’ont de sens qu’objectif, mais dans la majeure partie des cas le cadre de pensée régnant ne leur permet pas de le reconnaître ou de l’intégrer. Il faut pour cela que l’expérience personnelle ou collective leur ait mis sous les yeux les limites de ce paradigme, ses échecs. Au stade actuel cela reste trop partiel.
Vous démontrez également que le relativisme aboutit à une culture de mort, qui se manifeste notamment dans les conflits : bombardements de villes, massacres de civils, etc. Le relativisme n’est-il pas alors un facteur aggravant des guerres ?
La terrible dégradation de la façon de mener la guerre depuis un peu plus de deux siècles a plusieurs causes, y compris la technologie ou la passion démocratique, mais le relativisme y a une part appréciable : l’Europe ancienne reconnaissait en effet être une communauté, fondée sur des valeurs communes, fêlées il est vrai à la Réforme. Mais à partir du moment où vous considérez qu’il n’y a plus rien de commun entre vous et l’ennemi, potentiellement tout est permis. Ce qui est compatible avec des prétentions moralisantes, mais selon les critères nouveaux : je défends la liberté, donc je peux raser Dresde ou Nagasaki. Et je peux aussi mener une guerre totalement dissymétrique sans état d’âme.
Autre sujet géopolitique, l’idéalisme, qui cherche à imposer la démocratie par la guerre et qui nie les spécificités des peuples et des cultures. Dans les relations internationales, relativisme et réalisme ne s’opposent-ils pas aussi autour du refus ou de l’acceptation du paradigme classique ?
L’idéalisme démocratique est en effet un phénomène assez curieux : je prétends me battre pour la liberté des gens et leur droit à se déterminer comme ils le veulent ; mais au nom de cette abstraction et pour faire passer mon idée, je n’hésite pas à employer la violence la plus débridée. L’approche classique, bien plus ferme sur les principes, et notamment sur l’existence d’un bien objectif, sait en même temps que la vie commune des hommes est un fait complexe, et que l’imposition d’un programme unilatéral, surtout par la violence, a toutes chances de produire des effets pires que le mal.
Dans chaque situation, elle recommande la recherche du bien, et elle est autrement plus ferme sur l’idée d’un bien objectif et de principes moraux qu’une approche inspirée par le paradigme relativiste ; mais elle sait aussi que ce bien se discerne à la lumière d’une analyse spécifique, d’un jugement propre à la situation considérée qui peut être complexe et où les conséquences d’une action peuvent être inattendues.
Ce qui est déjà vrai au niveau personnel l’est a fortiori au niveau collectif et plus encore international, où il n’y a plus d’arbitre et où la violence n’est pas aisément régulée. Concrètement la question n’était pas de savoir si M. Kadhafi était satisfaisant d’un point de vue idéal ; mais de savoir ce qu’il fallait faire avec la Libye de l’époque pour obtenir le meilleur ou le moins mauvais effet possible. Et donc certainement pas de l’attaquer comme on l’a fait dans ce qui se révèle avec le recul avoir été un véritable délire.
Vous analysez la question de l’autorité et de la sécurité, écrivant que « L’État moderne est absolu par nature, du fait de son monopole de la force, de la loi, de la conscription, de l’impôt, et de l’organisation commune – d’où son contrôle de la famille, de l’éducation, des mœurs, etc. Il n’y a aucune limite théorique à son pouvoir, qui s’exerce directement sur les individus. Un tel accroissement du pouvoir de l’État n’a été possible qu’avec la fiction qu’il était le fait des citoyens eux-mêmes (ce qu’on appelle démocratie). On a alors moins cherché la sécurité à l’égard du pouvoir, mais plus la participation au pouvoir. »
L’État essaye aujourd’hui d’assurer un contrôle social des personnes : contrôle de la pensée, des naissances, de la mort, des modes de déplacement également. Existe-t-il encore des espaces de liberté dans cette vision politique ?
Nous voyons bien que le degré de contrôle sur les citoyens dont dispose l’État moderne aurait été jugé effroyable par les générations précédentes et les époques anciennes. Un totalitarisme fondé sur ces outils serait terrifiant. Ce qui le freine de façon appréciable est d’une part le fait, cher à la pensée classique, de l’état des rapports humains dans la société, qui reste encore modéré par l’usage et n’a pas fait l’objet de transgression irréversible : sous cet angle, il est clair que toute remise en question majeure et violente des rapports sociaux et politiques offrirait à un tel totalitarisme une opportunité considérable. Et d’autre part l’existence dans le système juridique de crans d’arrêt, ce qu’on appelle l’état de droit ou libertés fondamentales, hérités de la période libérale ; à ceci près que le relativisme fait que leur contenu est passablement imprécis et pourra être apprécié tout autrement si les dominantes de la société y conduisent. La montée de l’intolérance du politiquement correct en témoigne ; ou l’exemple des deux guerres mondiales.
Une autre idée que vous analysez est celle de la nation, qui est confrontée à plusieurs enjeux : mouvements migratoires, finances mondialisées, guerre du droit, etc. La nation a-t-elle encore une place dans ce nouveau monde ou bien est-elle une antiquité qui doit s’effacer ?
La nation reste la seule communauté politique vivante de nos jours, malgré ces menaces bien réelles. Vivante dans l’esprit des gens, et opérationnelle par son organisation concrète, c’est la seule base de solidarité active et concrète. L’alternative n’est pas une utopie mondialisante, qui est sans fondement dans la réalité ; ni un ensemble de réseaux économiques s’appuyant sur une soft law incapable d’ordonner la vie commune des personnes et dépourvue de pouvoir coercitif légitime. La seule alternative possible est en fait de type impérial : un pouvoir rustique, mais qui n’exige pas pour fonctionner d’être fondé sur une communauté : de ce point de vue, la poursuite de l’éclatement de nos communautés, nationales, en une mosaïque hétérogène peut rendre un jour les solutions impériales les seules praticables. Fort heureusement nous n’en sommes pas encore là, même si la direction est claire.
L’analyse objective et réaliste du monde actuel peut devenir déprimante pour les jeunes générations, notamment ceux qui sont étudiants et qui peuvent avoir l’impression que l’avenir ne va leur réserver que des catastrophes (crise financière, enjeu migratoire, atonie de l’Europe, etc.). Quels motifs d’espérance peut-on leur donner ?
Outre qu’à bien des époques les perspectives disponibles pouvaient conduire à douter de l’avenir de façon analogue, et que se sentir déprimé est le plus sûr moyen pour que les faits le justifient, l’important est à nouveau la recherche de ce qu’on a à faire là où on est, à la base : de ce qu’il est bien de faire et qu’on peut faire. Cela n’empêche pas de se préoccuper ou d’agir face aux catastrophes possibles. Mais il n’est pas raisonnable de fonder son équilibre de vie sur ce sur quoi on n’a qu’un pouvoir d’action limité. Ce qui peut donner un sens à notre vie est par nature ce qui est à notre portée, sous notre main. Et cela d’autant plus que, collectivement, le dépassement de cette dépression collective qu’induit notre paradigme relativiste étant la seule voie collectivement sûre, c’est par la multiplication de conversions individuelles qu’elle se fera, c’est-à-dire du changement de la vision de chacun, opérant à son niveau dans sa famille, sa profession, ses engagements associatifs, l’école de ses enfants, etc. Si chacun attend les autres, rien ne se fera ; dès qu’on s’engage, on a trouvé la première réponse à ses interrogations.
Lire aussi : L’Europe et la romanité. Entretien avec Rémi Brague