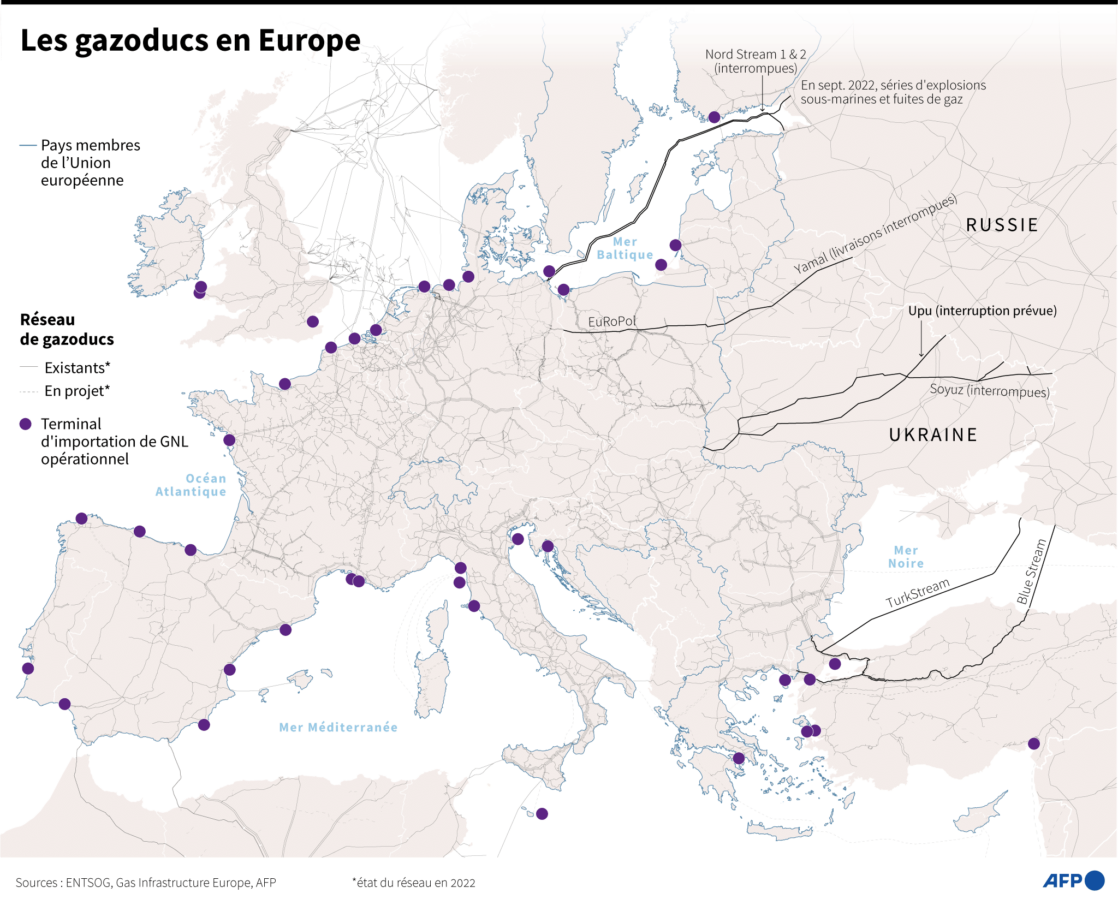La stratégie hydropolitique menée par Ankara depuis une trentaine d’années oscille entre projets de coopération, inaboutis pour l’essentiel, et tension avec ses voisins d’aval, à l’instar de la politique étrangère turque, et plus singulièrement celle de l’AKP, caractérisée par une alternance de périodes d’apaisements et de confrontations.
Les projets inaboutis de coopération hydraulique
L’un des premiers, côté turc, à avoir réfléchi à l’eau comme outil de rapprochement au Proche et au Moyen-Orient est l’ancien président Suleyman Demirel, qui exerça la profession d’ingénieur hydrologue avant d’intégrer la vie politique. En effet, la Turquie, dans le cadre du processus de recomposition de la carte géopolitique moyen-orientale qui s’est accéléré à la suite de la guerre du Golfe en 1991[1] espère alors pouvoir se servir de sa richesse hydraulique, celle des chaînes très arrosées du Taurus pour intervenir directement dans les affaires du monde arabe et pour s’imposer comme une force incontournable. Elle propose ainsi de faire de « l’or bleu » une arme de coopération privilégiée avec « les pipelines de la paix » lancés en 1992, qui ambitionnent de vendre de l’eau à différents États en situation de stress ou de pénurie hydriques, alors qu’elle est jusque là peu impliquée dans son voisinage arabo-oriental à cause d’un passé historique vécu comme traumatisant et d’un tropisme pro-occidental alors assez prégnant.
Le premier écho favorable vient d’Israël, où Shimon Pérès, spécialiste de la coopération régionale, à l’époque ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Rabin, affirme à des journalistes turcs qu’Israël ayant déjà importé du gaz, il lui serait possible d’importer aussi de l’eau[2]. Un rapport gouvernemental israélien de 1996 propose qu’Israël, l’Égypte, la Jordanie et les Palestiniens coopèrent sur des projets d’importation d’eau turque afin de surmonter la pénurie.
A lire aussi : Le traité de Sèvres : de la Turquie à l’Arménie
Cependant, cette idée est lancée en février 1996, peu avant l’accession de Benjamin Netanyahou à la tête du gouvernement. Son premier mandat, achevé en 1999, gèlera quasiment tout projet associant Israéliens, Arabes et Turcs. Même avec ces derniers, le rythme sera ralenti, car il faut tenir compte de l’arrivée au pouvoir à Ankara et pour la première fois d’un chef de gouvernement islamiste en 1996, Necmettin Erbakan, et aussi du fait que la Turquie préfère dans la mesure du possible inscrire ses projets dans le cadre le plus large possible afin d’apparaître dans la région comme un État qui n’est pas exclusivement associé à Israël, mais qui serait ce fameux « pont » entre Orient et Occident. Ainsi, c’est lors du retour en force des travaillistes à la Knesset avec Ehud Barak que le Président Demirel, lors d’une visite officielle en juillet 1999, lance l’idée qu’Israël pourrait bénéficier des « eaux du Manavgat »[3] afin de pallier ses problèmes chroniques de pénurie. Près d’un an plus tard, le conseiller sur les questions hydrauliques de Barak, Noah Kinarti, proposa au gouvernement un plan d’importation d’eau de Turquie, à hauteur de 50 millions de mètres cubes annuels.
Cette eau aurait été transportée dans deux bateaux géants et entreposée dans un terminal spécial de la ville côtière d’Ashkelon et, de là, acheminée vers le désert du Néguev[4]. Il estime alors que le prix de l’importation serait équivalent à celui de la production d’eau issue du dessalement. Ce sont ces deux hypothèses qui sont privilégiées, car elles comportent à la fois des avantages et des inconvénients. Le choix qui se pose à l’époque conditionne alors l’avenir des relations économico-hydrauliques entre Turcs et Israéliens : une coopération plus forte si c’est l’importation d’eau qui a la préférence de Tel-Aviv, mais avec un coût probablement plus élevé. D’où des hésitations et une attitude partiellement dilatoire de l’État hébreu, qui espérait que les progrès des techniques relatifs au dessalement[5] amèneraient leurs partenaires à faire un effort sur les tarifs, d’autant qu’Israël est alors en position de force, les Turcs n’ayant guère réussi à exporter leur eau, à la notable exception de la partie nord de l’île de Chypre, mais celle-ci leur étant totalement inféodée, il s’agissait plus d’un prolongement logique et naturel que d’un succès véritable. Dans le même temps, importer de l’eau rend tout aussi dépendant du fournisseur, aussi bien intentionné soit-il au départ, qui peut modifier ses alliances stratégiques dans le temps et ainsi accroitre la vulnérabilité de l’État qui privilégie cette stratégie d’apport extérieur pour parvenir à assurer l’intégralité de ses besoins hydrauliques.
A lire aussi : Pour quelles raisons la Turquie s’implante-t-elle en Afrique ?
Quant aux projets envisagés avec les pays arabes, ils se soldent également par des échecs, brisant ainsi les ambitions hydrauliques turques et ceci pour plusieurs raisons. Outre le risque de dépendance déjà évoqué, cela tient également aux relations souvent conflictuelles avec la Syrie ou l’Irak, voies de passage obligées vers la péninsule arabique[6], sans négliger la dimension financière qui rend ces projets de transferts d’eau, outre leur impact négatif sur l’environnement, onéreux, et finalement assez rares[7]. Le dessalement semble être la solution qui rencontre à ce jour le plus de succès pour les États en stress hydrique étant donné le coût de plus en plus bas des différentes technologies utilisées, mais la vulnérabilité stratégique reste élevée, puisque quelques missiles peuvent suffirent à rendre assoiffées des populations urbaines en forte croissance, comme dans les pétromonarchies du Golfe.
Une puissance hydro-hégémonique en retenue
Il est incontestable que l’eau est un élément de puissance, parmi d’autres, pour la Turquie, qui si elle possède peu de ressources naturelles majeures (pétrole, gaz, charbon) dispose en revanche et en abondance de celle que l’on considère comme la plus indispensable à la vie humaine. On parle même de puissance hydro-hégémonique car c’est un pays qui peut en influencer d’autres sur le plan hydrique et politique en utilisant soit l’arme de l’eau, soit plus classiquement par la pression militaire, pour obtenir ou conserver une situation avantageuse dans le domaine hydrique.
Certes, Ankara n’est pas à l’abri de certaines vulnérabilités (sécheresse ou sa situation de pays d’aval de l’Oronte), mais le fait d’abriter les sources des deux grands fleuves historiques du Proche et du Moyen-Orient, le Tigre et l’Euphrate, qui ont façonné plusieurs des premières et grandes civilisations de l’humanité constitue un atout précieux pour la Turquie. Mais pour être une puissance hydro-hégémonique il ne suffit pas d’être un pays d’amont, mais encore faut-il disposer d’une capacité à influencer les autres États du bassin partagé (situés en aval) par d’autres moyens que la seule menace de « fermeture » du robinet, mais par une combinaison de pressions politiques, économiques et militaires comme précisé précédemment. Ainsi, toujours au Proche-Orient, le Liban abrite une des principales ressources du Jourdain, le Hasbani, mais il peut difficilement menacer de tarir cette source au risque de subir les représailles israéliennes.
A lire aussi : Charalambos Petinos : Où va la Turquie ?
Il en est autrement pour la Turquie, mais dans une certaine mesure seulement. En effet, il est vrai que la stratégie de pression maximale a fonctionné il y a plus de 20 ans, lorsqu’en 1998, la Turquie, excédée par le soutien de la Syrie aux Kurdes du PKK exigea l’arrêt de cette aide et l’expulsion de leur chef charismatique, Abdullah Ocalan, ce que consentit finalement le vieillissant président Hafez el Assad, père de l’actuel chef de l’État syrien. Cependant, c’est bien une association d’une double menace, hydraulique d’une part et militaire d’autre part, avec des centaines de chars massés à la frontière dans un contexte d’affaiblissement physique du Président syrien qui fonctionna.
Cependant, l’utilisation de l’arme hydraulique s’est finalement révélée d’un usage délicat pour la Turquie ces dernières années alors qu’elle aurait probablement souhaité pouvoir s’en servir contre ses ennemis. Ainsi, avec la Syrie, encore une fois, elle n’a pas réitéré la même stratégie qu’en 1998, alors qu’elle a été en pointe pour faire chuter le régime baasiste lors du mouvement des « printemps arabes » de 2011, qu’elle souhaite remplacer par un gouvernement dominé par ses alliés du mouvement des Frères musulmans, tout en souhaitant affaiblir les zones kurdes dominées par les YPG, branche syrienne du PKK. En effet, si la Turquie avait diminué le débit d’eau cela aurait impacté les vastes plaines agricoles où habite alors une grande partie de l’opposition qui aurait été plus pénalisée que les espaces alaouites côtiers moins arides. L’arme de l’eau est ainsi parfois comparée à l’arme atomique et son utilisation est tellement dévastatrice, y compris vis-à-vis de ses alliés[8], qu’elle reste virtuelle, mais comme elle ne peut être totalement écartée, elle incite ceux qui sont à sa merci à la prudence voire la coopération[9].
Il en est de même pour l’Irak où les relations sont notoirement compliquées avec le pouvoir central dominé par les chiites, soutien de la Syrie. Mais en baissant le débit, les sunnites auraient été affaiblis, alors que la Turquie a l’ambition d’en être le chef de file. Cependant, et au-delà du moindre approvisionnent, réel, puisque la Turquie a fortement augmenté sa capacité hydraulique dans le cadre du gigantesque GAP (Projet d’Anatolie du Sud-Est)[10] la crise hydraulique qui sévit dans l’ancienne Mésopotamie s’explique en grande partie par des raisons exogènes (changement climatique) et aussi endogènes (la mauvaise gestion et le mauvais entretien du réseau, la surconsommation et la gabegie).
Notes
[1] Yves LACOSTE, L’eau dans le monde (les batailles pour la vie), Paris, Larousse, 2003, p. 92.
[2] Konuralp PAMUKCU, “ Water Trade Between Israel and Turkey: A Start in the Middle East? ”, Middle East Policy, Winter 2003, p. 94.
[3] Les « eaux du Manavgat » font référence à l’eau retraitée, issue d’une usine construite sur la rivière du même nom, située à quatre-vingts kilomètres en amont de la ville balnéaire d’Antalya, au sud de la Turquie. De là, elle a vocation à être exportée afin de rentabiliser le coût de l’investissement, assuré essentiellement par Ankara pour le moment.
[4] Konuralp PAMUKCU, “ Water Trade Between Israel and Turkey ”, op.cit., p. 94.
[5] La Turquie espère aussi qu’elle pourra mener des travaux de recherche ou de financement en commun avec Israël, pays à la pointe de la technologie, notamment dans le domaine hydraulique.
[6] L’Irak ne semble pas être en mesure d’être une voie de passage dans les années à venir étant donné la déstabilisation profonde du pays suite à l’intervention américaine de 2003.
[7] Voir le cas notable de la Libye, avec la grande rivière artificielle, projet pharaonique au prix exorbitant, construit sous Kadhafi, qui amène de l’eau souterraine (malheureusement souvent non renouvelable) du Sud pays vers le littoral où réside l’essentiel de la population
[8] Certains soulignent que l’usage de l’arme atomique contre Israël de la part de l’Iran, à supposer qu’elle puisse en disposer un jour et qu’elle ait la volonté de le faire, pénaliserait fortement les populations associées aux Hezbollah libanais ou au Djihad islamique palestinien avec lesquels Téhéran a noué des liens étroits.
[9] Barah Mikaïl, « La Turquie, la Syrie et le potentiel hydraulique : de l’abstention comme arme de dissuasion massive », Orients Stratégiques, n°8, 2018.
[10] Le projet d’Anatolie du Sud-Est (en turc, Güneydoğu Anadolu Projesi ou GAP) est un projet d’aménagement du Sud-est anatolien lancé par gouvernement turc dans les années 1980 pour un coût de 32 milliards de $. Il consiste essentiellement à irriguer 1,7 million d’hectares de terres arides à partir de 22 barrages principaux construits sur les bassins versants du Tigre et de l’Euphrate. En parallèle, 19 usines hydroélectriques permettront de fournir 7476 MW. Ce projet devrait réduire de 22 km3 par an le débit des fleuves Tigre et Euphrate et vise à mettre en valeur les zones kurdes afin de diminuer leurs revendications autonomistes.