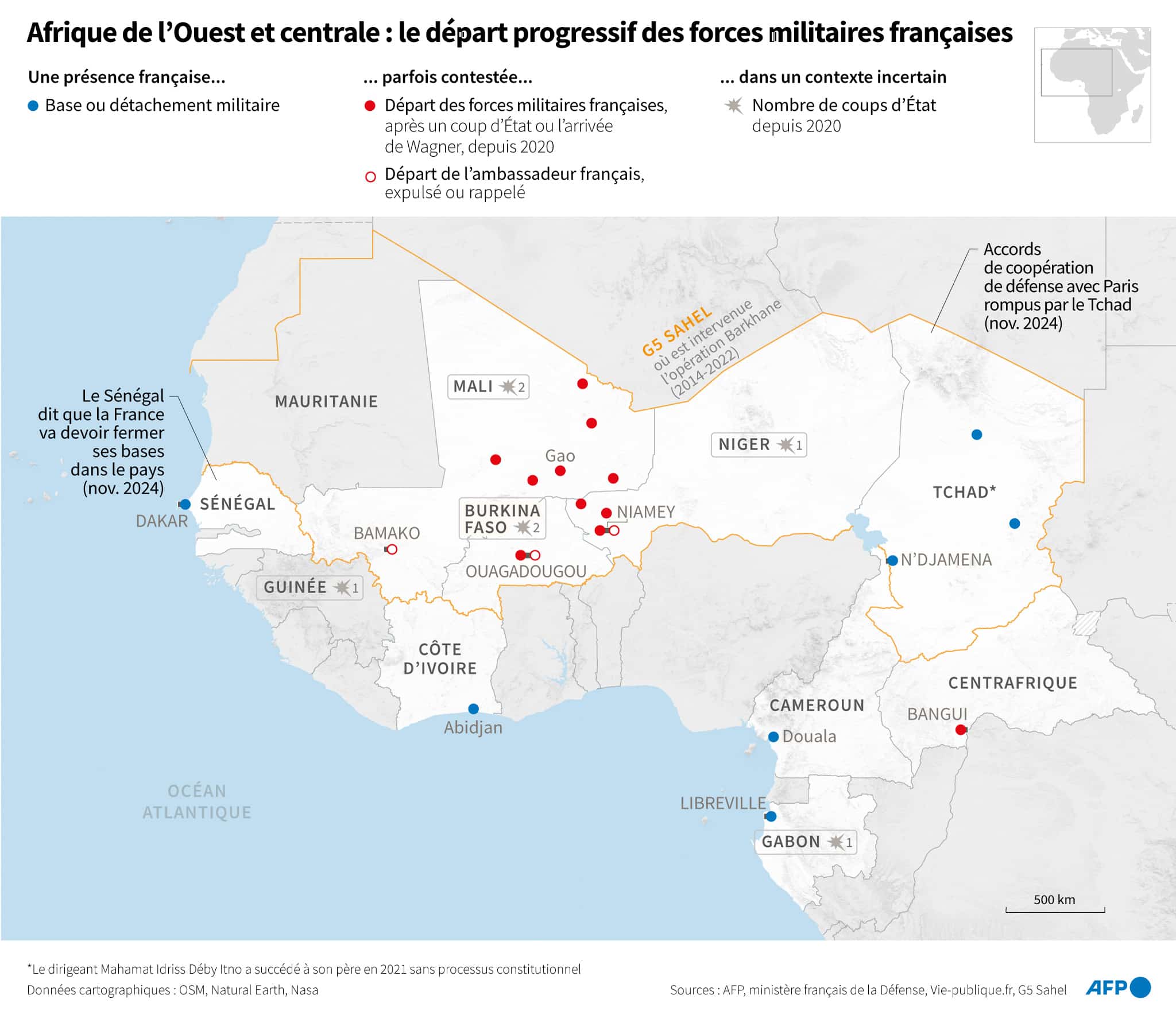Même si le nom de Pie XII reste associé à la Seconde Guerre mondiale et à la fameuse problématique du silence, on ne saurait faire l’impasse sur le fait que son pontificat a duré jusqu’en 1958, englobant ainsi les périodes cruciales de la guerre froide et de la décolonisation.
Frédéric Le Moal, docteur en histoire, auteur de Pie XII. Le pape face au Mal, Perrin, 2024.
Étudier la diplomatie du pape Pacelli dans le conflit Est-Ouest revient en fait à contester un certain nombre de lieux communs. En premier lieu, celui qui fait du Vatican une simple caution morale du camp occidental, alignée sur la politique de Washington. Certes, Pie XII a noué, lors des terribles années de la guerre contre l’Axe, un lien particulier avec les États-Unis qu’avait matérialisé la présence à Rome d’un représentant spécial de Roosevelt, Myron Taylor. Et il n’eut de cesse de convaincre le président américain du danger que représentait l’avancée soviétique sur une Europe orientale en ruine. Ce fut donc avec un soulagement non feint que le souverain pontife accueillit la prise de conscience des responsables américains en 1946, le retournement de 1947 matérialisé par la doctrine Truman en faveur de la politique du containment ainsi que le plan Marshall de sauvetage des économies européennes, et enfin la création de l’alliance militaire de l’OTAN en 1949. La même année, le Saint-Office émit un décret de clarification d’une grande dureté interdisant, sous peine d’excommunication, la moindre collaboration entre les catholiques et les communistes. L’année précédente, les élections législatives en Italie avaient donné lieu à une collaboration indéniable, mais officieuse, entre l’Église italienne, le Saint-Siège et la CIA pour empêcher le PCI de rafler la mise. Bref, Rome et Washington marchaient de concert.
L’aumônier des États-Unis, vraiment ?
Cette stratégie offensive ne doit pas, en vérité, masquer une réalité beaucoup plus complexe. Précisons bien que la pression des événements s’avéra déterminante dans le positionnement de Pie XII en faveur d’une super-puissance qui, seule, possédait les moyens de bloquer la poussée communiste, interne et externe. Les terribles persécutions dont fut victime l’Église dans les pays tombés dans l’escarcelle de Moscou ne laissaient aucun doute sur la violence du système marxiste, lequel n’hésitait pas à s’attaquer à des évêques jetés en prison. Avec des pays européens anéantis, il n’y avait pas d’autres choix que de s’en remettre au gouvernement des États-Unis. La vision apocalyptique du communisme, qui imprégnait l’esprit des dirigeants du Saint-Siège, faisait le reste. Pourtant, à y regarder de plus près, on s’aperçoit que Pie XII n’écartait aucune option et restait le diplomate réaliste qu’il ne cessa jamais d’être.
Ainsi se montra-t-il disposé entre 1945 et 1946 à des ouvertures diplomatiques en direction de Moscou, par l’intermédiaire d’un jésuite hongrois, le P. Sándor Nagy. Pour résumer, le Vatican accepterait de discuter, comme il l’avait fait avec tous les régimes totalitaires, à condition que le Kremlin fît de son côté des pas positifs. Peine perdue. Il ne reçut comme réponse que les persécutions et les accusations de Radio-Moscou de collusion avec le fascisme. Autre point important à retenir, les divisions au sein de la Curie sur la meilleure ligne politique à suivre. Trois groupes évoluaient autour du pape : les plus intransigeants anticommunistes, menés par Mgr Alfredo Ottaviani, prêts à mener la bataille ; les réalistes regroupés autour de Mgr Domenico Tardini ouverts au dialogue y compris avec le diable moscovite ; et enfin, les neutralistes menés par Mgr Giovanni Battista Montini, futur Paul VI, alors très proche du saint-père, partisans d’une attitude équidistante entre l’URSS et les États-Unis. En fin de compte, Pie XII, poussé par les violences soviétiques davantage que par son anticommunisme, se rallia au premier camp. Mais cela revenait-il à faire de lui le nouvel Urbain II de la croisade anticommuniste ?
Certainement pas ! Non seulement le pape condamna tout recours aux armes, mais, comme il l’affirma dans son message de Noël 1947, la guerre des blocs n’était pas la sienne : « Notre position entre les deux camps opposés est exempte de toute idée préconçue, de toute préférence envers l’un ou l’autre peuple, envers l’un ou l’autre bloc de nations, comme elle est étrangère à toute considération d’ordre temporel. Être avec le Christ ou contre le Christ : c’est toute la question. » Il n’y avait donc pas alignement, mais convergence entre la Curie et la Maison-Blanche dans le combat contre le communisme, dans lequel la papauté s’était jetée depuis les années 1930. Or, très vite, une prise de distance avec Washington se fit sentir, mettant en lumière les spécificités de la diplomatie vaticane que l’on ne saurait confondre avec les intérêts américains. Outre le fait que Pie XII refusa avec force de participer au projet de Harry S. Truman d’une vaste coalition œcuménique des religions chrétiennes, il ne cacha pas sa profonde déception devant l’impossibilité du président à imposer au Congrès et à l’opinion publique récalcitrants la création d’une ambassade auprès du Saint-Siège en bonne et due forme[1].
Dès la fin de 1951, un début de rééquilibrage s’opéra, donnant à Mgr Montini un surcroît d’influence dans sa promotion d’un Saint-Siège, médiateur et pacificateur. Dans son message nataliste de 1951, Pie XII insista sur la neutralité de l’Église : ni l’un ni l’autre bloc ne pouvaient « faire de l’Épouse du Christ leur alliée ou l’instrument de leurs combinaisons politiques nationales et internationales ». Puis, en juillet 1952, il adressa aux peuples de Russie une lettre apostolique, Ad universos Russiae populos, pour rappeler qu’il combattait le communisme, et seulement cette idéologie, en insistant sur la distinction nécessaire entre les dirigeants et la population. On sentait bien un détachement par rapport au camp atlantiste, au moment où sa cohésion idéologique se renforçait. Il est vrai que l’agressivité de la nouvelle administration Eisenhower, élue en 1952 sur une ligne très dure, suscitait des inquiétudes au sujet du maintien de la paix. Le paradoxe résidait dans le fait que ce fut ce même gouvernement qui abandonna à leur triste sort les Français à Diên Biên Phu, scellant ainsi leur défaite et ouvrant la voie à la communisation du Vietnam avec son lot de persécutions. Les responsables de la Curie ne ménagèrent pas leurs critiques à l’encontre d’une telle attitude.
La question principale concernait la coexistence pacifique que Nikita Khrouchtchev, une fois aux commandes de l’URSS en 1955, installait dans les rapports internationaux : fallait-il croire à la sincérité du nouveau maître du Kremlin ? Disons-le : Pie XII resta de glace devant cette offensive de charme. Non seulement il ne croyait pas à la volonté de paix des Soviétiques, mais il jugeait même dangereuse leur changement d’attitude et de langage : pas de meilleurs moyens que ce genre de mystification pour tromper les pacifistes de tous poils et naïfs progressistes, prêts à se jeter dans les bras de l’ours moscovite. La preuve de cette duperie ? Le renforcement des persécutions antireligieuses dans l’URSS khrouchtchévienne, en somme logique dans cette atmosphère de retour aux sources léninistes du système soviétique. Si Pie XII se montrait, sur le principe, disposé à des discussions diplomatiques, il exigeait au préalable l’arrêt des tourments infligés in odium fidei. Il se voulut alors très clair : « Dans de telles conditions, indiqua-t-il dans un message envoyé aux catholiques allemands en septembre 1956, les initiatives diplomatiques ou paradiplomatiques, les efforts de propagande auxquels elles servent de prétexte ne sont qu’autant d’essais pour amener la masse catholique, sinon l’Église, à accepter un fait accompli et brutalement accompli. » Les terribles événements de Hongrie, où l’insurrection populaire et nationale d’octobre 1956 fut écrasée avec férocité, apportèrent une douloureuse confirmation de cette analyse. Le pape les suivit de très près, publiant trois encycliques lors de la Toussaint 1956, pour apporter son soutien aux insurgés et condamner leur sanglante répression.
À lire également
Le Vatican et le refus des blocs
Le père d’une Europe catholique
L’autre grande affaire de la seconde partie du pontificat, en lien d’ailleurs avec la guerre froide, concernait l’unité de l’Europe. Dans les années de l’immédiat après-guerre, Pie XII exhortait les Européens à la réconciliation, à la sollicitude à l’égard des vaincus et au souvenir de leurs racines chrétiennes. Avec la brutale dégradation de la situation politique sur le Vieux Continent, il monta dans le train du processus unitaire, comme le montra la présence du nonce, Mgr Giobbe, au congrès fondateur de La Haye de 1948. Mais il s’agissait à cette date davantage d’un soutien à un renforcement de la cohésion des pays de l’Ouest, afin de consolider leur système de défense face à une menaçante Armée rouge installée de l’autre côté du rideau de fer.
Une étape fut franchie avec les projets de la CECA et surtout de la CED qui favorisèrent l’orientation de Pie XII vers des thèses plus fédéralistes. Portées par les gouvernements dirigés par les démocrates-chrétiens De Gasperi, Pinay, Schuman, Spaak et Adenauer, ces initiatives avaient entre autres avantages, pour le Vatican, d’intégrer la RFA dans le bloc ouest-européen, ce que n’avait pas su ou voulu faire les intransigeants vainqueurs de 1919, surtout français, avec la République de Weimar. Les Allemands, délivrés de leurs vieux démons, organisés autour du noyau catholique des régions rhénanes que Pacelli aimait tant, retrouvaient ainsi toute leur place dans une Europe susceptible de prendre elle aussi ses distances avec Washington, voire de revêtir un rôle de modérateur entre les deux blocs. Bref, cette Europe des six, carolingienne en quelque sorte, faisait écho au regroupement des nations latino-catholiques que l’ancien secrétaire d’État de Pie XI avait rêvé de bâtir contre le national-socialisme.
Or, on le sait, la CED se heurta aux résistances conjuguées des communistes, mais aussi des gaullistes, ce qui ne contribua pas à l’amélioration des relations entre le général de Gaulle et le souverain pontife, toujours méfiants à l’encontre de l’intransigeance nationaliste de l’homme du 18 juin. Pie XII, déçu par cet échec, condamna de nouveau cette résurgence des nationalismes en Europe, approuva l’entrée de la RFA dans l’OTAN, palliatif à l’échec de la CED, et se félicita de la signature du traité de Rome, le 25 mars 1957, acte de naissance de la CEE et étape cruciale de l’unification du continent[2].
À lire également
Les prudences sur la décolonisation
Ce prisme de la guerre froide imprégnait aussi son analyse de la décolonisation. Le pape ne s’opposait pas au vaste mouvement d’émancipation des peuples extra-européens. Mais il lui apporta un soutien aussi prudent que tardif, soucieux de ne pas le voir dégénérer en nationalisme violent, attentif au maintien des liens unissant l’Afrique à l’Europe et à la préservation de l’Église dans les pays musulmans. Dans leur lutte contre les colonisateurs, mais aussi contre Israël, les mouvements indépendantistes arabes cherchèrent très vite le soutien du Saint-Siège qui, de son côté, se maintint sur une ligne équilibrée. D’un côté, il lui fallait éviter de lier le sort de l’Église à celui du colonialisme européen en reflux, mais aussi assurer la protection des minorités chrétiennes et favoriser une résolution du conflit israélo-arabe en conformité avec les intérêts chrétiens, notamment autour de l’épineux statut de Jérusalem. De l’autre, Pie XII, diplomate expérimenté, analysait sans difficulté aucune l’instrumentalisation par Moscou dont faisaient l’objet des luttes arabes. Comme l’historiographie l’a d’ailleurs prouvé depuis lors, la diplomatie soviétique exploitait avec maestria le nationalisme arabe, africain et asiatique pour damer le pion aux Occidentaux. Les documents tirés des archives vaticanes désormais accessibles mettent en lumière les craintes de plusieurs prélats au sujet de l’islam politique, lequel, associé aux mouvements révolutionnaires, constituait un grave danger. Cette union du croissant et de l’étoile, très présente dans le dossier algérien, explique le souhait pontifical d’une victoire de la France dans sa guerre contre le FLN. Pas question de se retrouver avec une Algérie indépendante, révolutionnaire et musulmane aux portes de l’Europe et de l’Afrique noire[3].
[1] Frédéric Le Moal, Pie XII. Le pape face au Mal, Perrin, 2024. Ce n’est qu’en 1984 que les États-Unis et le Saint-Siège ont établi des relations diplomatiques officielles.
[2] Philippe Chenaux, Un’Europa vaticana ? Dal Piano Marshall ai trattati di Roma, Roma, Studium edizioni, 2017.
[3] Marialuisa Lucia Sergio, Pio XII e l’indipendenza algerina. La Chiesa cattolica nella decolonizzazione dell’Africa francese, Roma, Edizioni Studium, 2022.