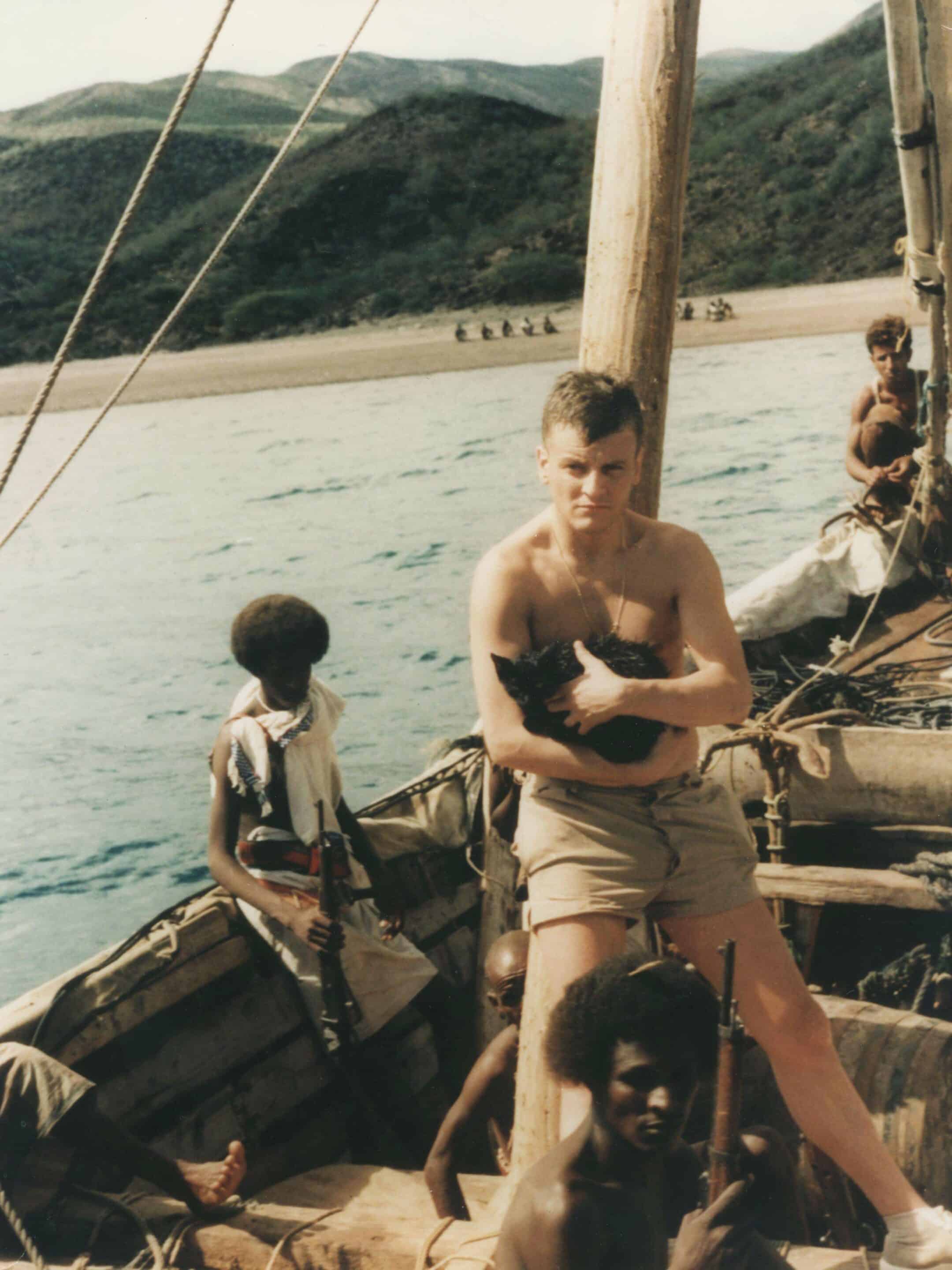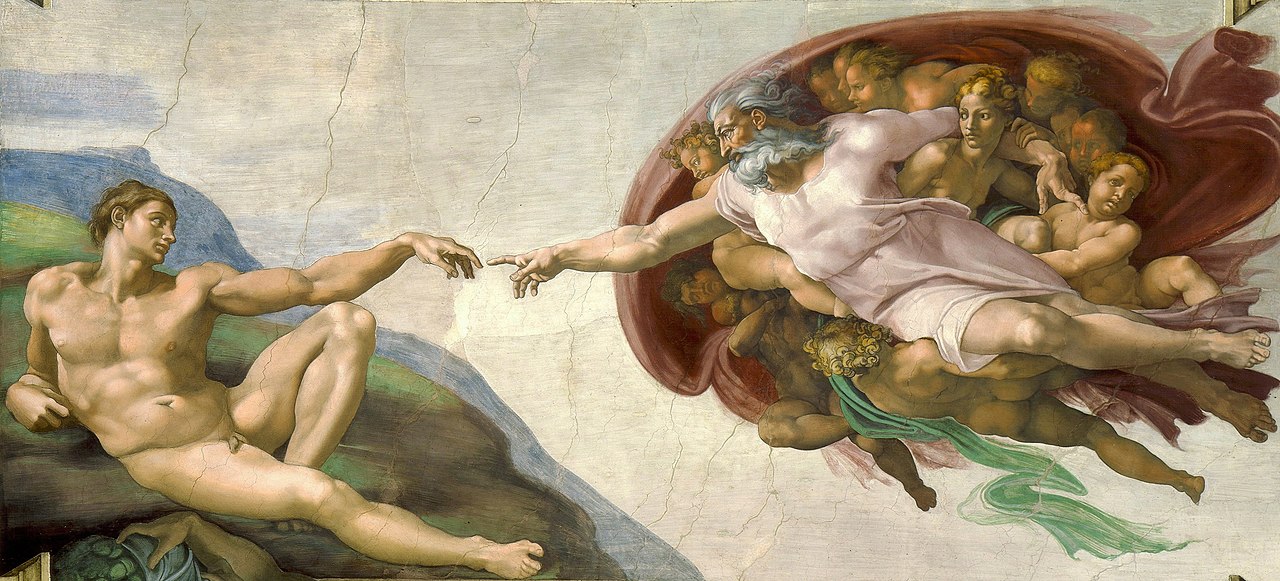Le XXe siècle a vu la guerre prendre une dimension nouvelle, la rendant presque hors de portée pour les arts traditionnels et les confrontant de fait à une incapacité de la raconter dans son entièreté. L’émergence du cinéma, rapidement considéré comme un art à part entière, a permis, par la puissance de son approche, de disposer d’un outil artistique total permettant d’appréhender la nouvelle dimension de la guerre.
Par Jonathan Plasmans, officier de marine. Ce texte est issu de son mémoire de l’École de guerre qui a été primé du prix Conflits 2022.
Servie par les progrès de la science et de la technologie, la guerre prend un essor croissant au xxe siècle pour atteindre une dimension mondiale et absolue. Cet essor vient interroger la capacité de l’artiste à témoigner de cette guerre dont la dimension le dépasse. L’émergence du cinéma, sa reconnaissance comme art et la rupture qu’il apporte, notamment par la combinaison de la lumière, du son et du mouvement, vient apporter une réponse crédible pour raconter et comprendre la guerre qui associe elle aussi ces éléments.
A lire également :
Akira Kurosawa : le soleil rouge du cinéma
Des artistes au plus près du conflit, mais limités face à son ampleur
Avant que n’apparaisse la conscription en 1914, les artistes contemporains des guerres qu’ils représentaient n’y participaient que rarement. La Première Guerre mondiale marque en cela une rupture, car les artistes y sont massivement mobilisés. Ainsi peuvent-ils retranscrire ce qu’ils vivent sous la forme de témoignages plus authentiques qu’auparavant. Néanmoins, cette proximité de la guerre, gage de réalisme, porte en germe l’incapacité pour l’artiste à saisir de manière exhaustive l’essence d’un conflit d’ampleur majeure voire à déformer sa vision pour percevoir ce qui est réellement à l’œuvre. Placé au cœur de la guerre, l’artiste se retrouve face à lui-même, mais aussi face à ses propres contradictions pouvant ainsi brouiller le témoignage qu’il cherche à apporter. L’historienne Annette Becker témoigne par exemple des contradictions révélatrices d’Apollinaire, fasciné par la guerre, mais la dénonçant, patriote aimant la verve antimilitariste[1]. Ajoutée à sa propre complexité humaine, celle de la guerre en elle-même, rend plus difficile la lecture de l’œuvre produite pour l’artiste qui la découvre et la vit. Le trauma des artistes pris dans les tourments du conflit fait ainsi écho à celui des sociétés en guerre.
La capacité pour l’artiste de raconter et de comprendre la guerre trouve aussi sa limite lorsque celle-ci dépasse l’entendement ; la production artistique se retrouve ainsi brisée et la représentation de la guerre devient, dès lors, impossible. À ce titre, l’ultime œuvre de Felix Nussbaum, le Triomphe de la Mort[2], peinte deux mois avant sa déportation vers Auschwitz, illustre parfaitement cette limite potentielle de l’artiste. Rappelant une danse macabre médiévale, le peintre, se sachant condamné, y exprime son attente d’une mort inévitable en peignant une scène apocalyptique de fin des temps, symbole de son renoncement artistique ; le peintre ne peut plus peindre, la guerre l’a vaincu.
A lire également :
Exposition Jean Gabin : la redécouverte d’une icône du cinéma français
La reconnaissance progressive du cinéma comme art « total »
Si la naissance du cinéma a lieu en 1896, sa définition comme art à part entière doit attendre les années 1910[3] et l’abandon du statut de divertissement populaire. Le critique italien Canudo emploie le surnom de 7e art en 1919 et le développe dans Le Manifeste des sept arts[4] en 1923. Il montre non seulement la singularité du cinéma devenu un art après avoir été une industrie et un commerce – au contraire des autres formes d’art d’essence fondamentalement esthétique – mais dépassant cette opposition en témoignant de sa puissance en tant qu’art « total ». Au-delà de ses qualités esthétiques, cette puissance réside selon lui en ce qu’il synthétise tous les autres arts en les fusionnant dans le cinématographe, cette fusion combinant les effets artistiques issus de la « pulsion plastique » – qui veut arrêter les formes (peinture, architecture, sculpture) – et de la « pulsion rythmique » qui se développe dans le temps (musique, danse, poésie). Au travers de l’image dont l’ambition n’est autre que de présenter une vision transfigurée du monde, le cinéma permet dès lors d’accéder à une nouvelle forme d’expression faisant appel à la complexité des arts dont il ambitionne de faire la synthèse. Il trouve ainsi dans la guerre une dramaturgie à sa mesure. Par ailleurs, si au premier abord le cinéma ne fait qu’imiter la réalité, il s’avère en fait bien plus complexe. En choisissant de présenter un récit en jouant sur la combinaison d’effets visuels (cadrage, lumière, gros plans, plans séquence) et sensitifs (sons, musique), il sollicite en effet notre intellect et notre imaginaire. Par la combinaison de ces effets, le réalisateur peut transfigurer la réalité pour mieux la théâtraliser. Dès lors, il fait directement écho à la guerre qui d’une part se présente aussi comme la combinaison des effets son/lumière/mouvement et d’autre part comporte une théâtralité intrinsèque, car en son sein se jouent les drames humains. Ce rapprochement, au-delà de la coïncidence calendaire de développement, montre la pertinence de l’outil filmique pour tenter de raconter et de comprendre la guerre.
Puissance de l’approche filmique
Le cinéma, par le mouvement qui permet la juxtaposition de tableaux, propose une expérience transcendant l’expérience artistique existant jusqu’alors. Utilisant l’ensemble des champs de conscience, l’œuvre filmique l’emporte sur l’œuvre classique car limitée par sa nature intrinsèque d’œuvre immobile et limitée à la seule expérience visuelle. La supériorité de l’œuvre filmique se fonde alors non seulement sur le triptyque lumière/son/mouvement, mais aussi par sa capacité à permettre la nuance via la métaphore et le symbolique, à créer de véritables tableaux vivants et à toucher le plus grand nombre.
A écouter également :
Podcast – Actrices, cinéma et vie culturelle. Philippe d’Hugues
La nuance de la métaphore et du symbolique
Dans le film Voyage au bout de l’enfer de Cimino, la guerre est présentée comme l’antichambre de l’enfer. Le glissement vers la folie destructrice de Christopher Walken le conduit dans un tripot « au bout de l’enfer » ; son ami, incarné par Robert De Niro, doit alors emprunter une embarcation nocturne pour le retrouver, métaphore du Styx annonciatrice de l’impossibilité de retour. Cette scène constitue le paroxysme dramatique du film. Par opposition, la nature est présentée comme un éden originel et spirituel où les hommes se retrouvent et communient. Dans cet éden apparaît une autre métaphore, celle de la chasse, activité de prédation dont la guerre constitue l’expression ultime. En ayant fait l’expérience de cette guerre, De Niro ne peut plus tuer. Ainsi se retrouve détruit le mythe de l’homme prédateur blanc américain, the deer hunter, titre original du film. Dans Le Tombeau des lucioles de Takahata, la métaphore passe par cet insecte qui, dans la croyance shinto japonaise, contiendrait l’âme des soldats morts sur le champ de bataille[5]. Le mot japonais hotaruutilisé n’est d’ailleurs pas le plus usuel ; le choix a été fait par Takahata d’employer la somme des mots feu et chute. Ce choix renvoie aux bombardements de Kobe. Dans Au revoir là-haut de Dupontel, la métaphore la plus puissante est celle liée au masque et au déguisement. Il travestit la laideur de la « gueule cassée » en beauté par le biais de masques sophistiqués faisant écho en cela non seulement à Jean Genet pour qui « il n’est pas à la beauté d’autre source que la blessure », mais aussi à la guerre qui contraint l’homme à endosser un masque qui n’est pas le sien, celui du soldat. Par ce recours, le film dépasse la dimension militaire et donne de la profondeur au sujet de la guerre en permettant d’approcher sa complexité pour aborder sa dimension sociale, culturelle, esthétique, philosophique ou éthique.
La création de tableaux vivants
La puissance de l’œuvre filmique réside en ce qu’elle est capable de donner vie, par l’image, à de véritables tableaux vivants dont l’esthétique est magnifiée par le jeu des acteurs. Dans Voyage au bout de l’enfer, les deux scènes controversées de la roulette russe plongent le spectateur au cœur du drame, la première suscitant même une fascination perverse où la mort des geôliers est attendue avec impatience. Dans Le Tombeau des lucioles, c’est la scène de la mort de Seita en présence de son fantôme qui constitue l’un des tableaux les plus saisissants, car à la fois révoltant, mais aussi poétique et onirique. Il lâche la boîte à bonbons dont s’échappe l’âme de sa sœur en même temps que des lucioles, symbole d’impermanence. La création de ces tableaux vivants, à la force évocatrice indéniable, mais complexe, constitue l’une des forces principales de l’approche filmique. Les sentiments contraires qu’ils font naître méritent toutefois d’y déceler le risque d’une fascination négative.
A écouter également :
Podcast – Cinéma et littérature au XXe siècle. Philippe d’Hugues
Le rôle amplificateur des facteurs non esthétiques
Parallèlement à la puissance de suggestion de l’œuvre filmique, d’autres facteurs non esthétiques viennent renforcer cette puissance. Tout d’abord, la variété des approches permet de toucher le plus grand nombre et d’élargir la diffusion de l’œuvre fondée sur le même épisode historique à raconter. Le film d’animation permet d’aborder la guerre via un média de prime abord enfantin, le film documentaire permet une prise plus directe à la réalité – même si cette promesse d’authenticité peut s’avérer mensongère – tandis que la fiction permet d’user d’un détour pour traiter le sujet. Cette variété des approches permet dès lors une mise en perspective de ces dernières favorisant ainsi l’appréhension nuancée et comparative à la hauteur d’une guerre difficilement résumable à une seule œuvre. Ensuite, cette variété des œuvres créées assure un volume de diffusion – incomparable avec les œuvres plus classiques – amplifié par l’invention de la télévision. Si le film Il faut sauver le soldat Ryan a réalisé 4,2 millions d’entrées au cinéma en France, il est vu par 1 million de spectateurs en moyenne à chaque diffusion. Enfin, un autre facteur non esthétique amplifiant la puissance filmique provient de la capacité du film à adapter des œuvres déjà réalisées – comme des romans – et à leur donner vie.
[1] Annette Becker, La Grande Guerre d’Apollinaire, Tallandier, 2014.
[2] Félix Nussbaum, Le Triomphe de la Mort, musée d’Osnabrück, 1944.
[3] Luc Vancheri, Le cinéma ou le dernier des arts, PUR, 2015.
[4] Ricciotto Canudo, Le manifeste des sept arts, Séguier, 1995.
[5] Carine Freard, « Le tombeau des lucioles : une cruauté poétique », Le mag du ciné, Regards croisés, 2011.