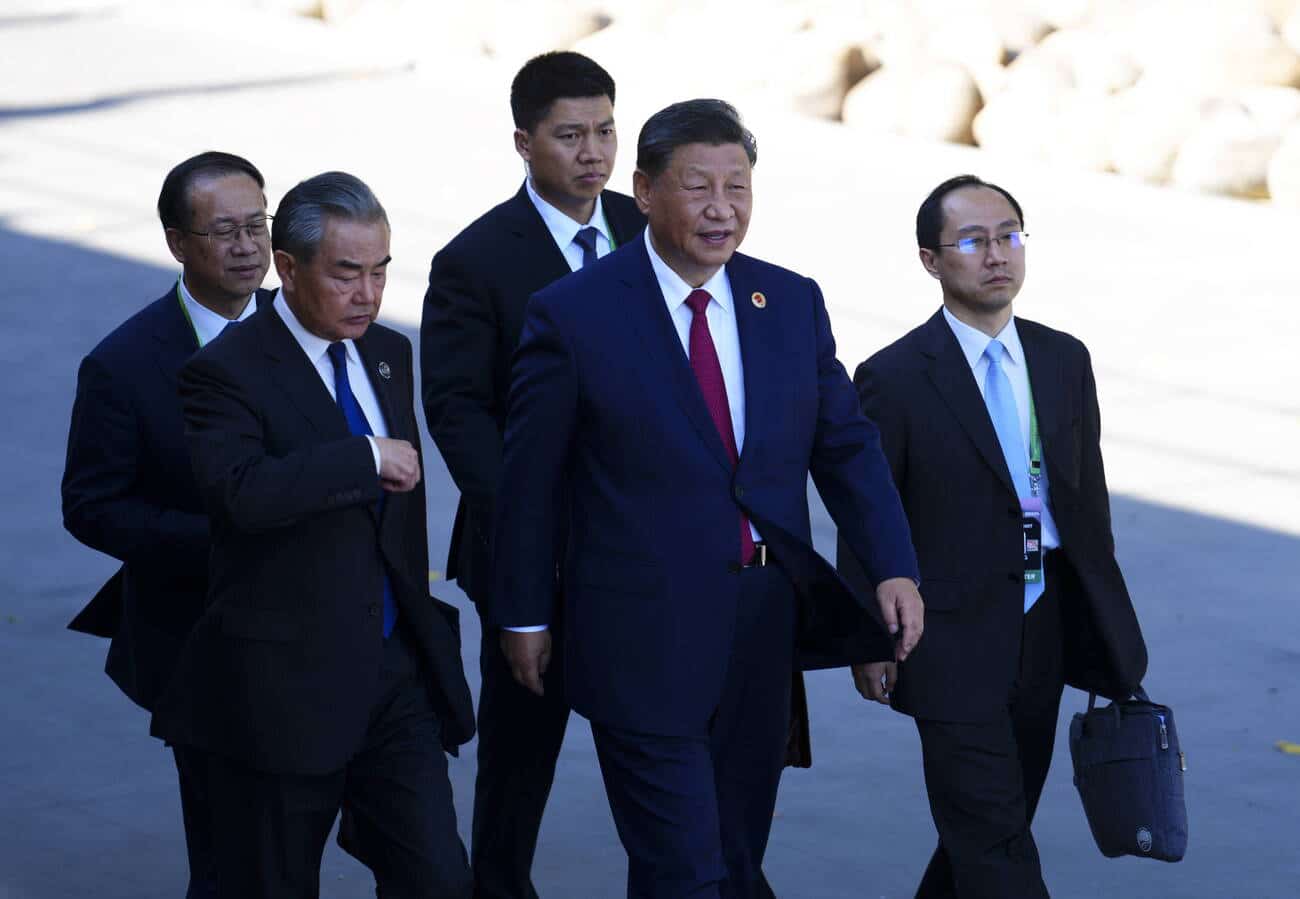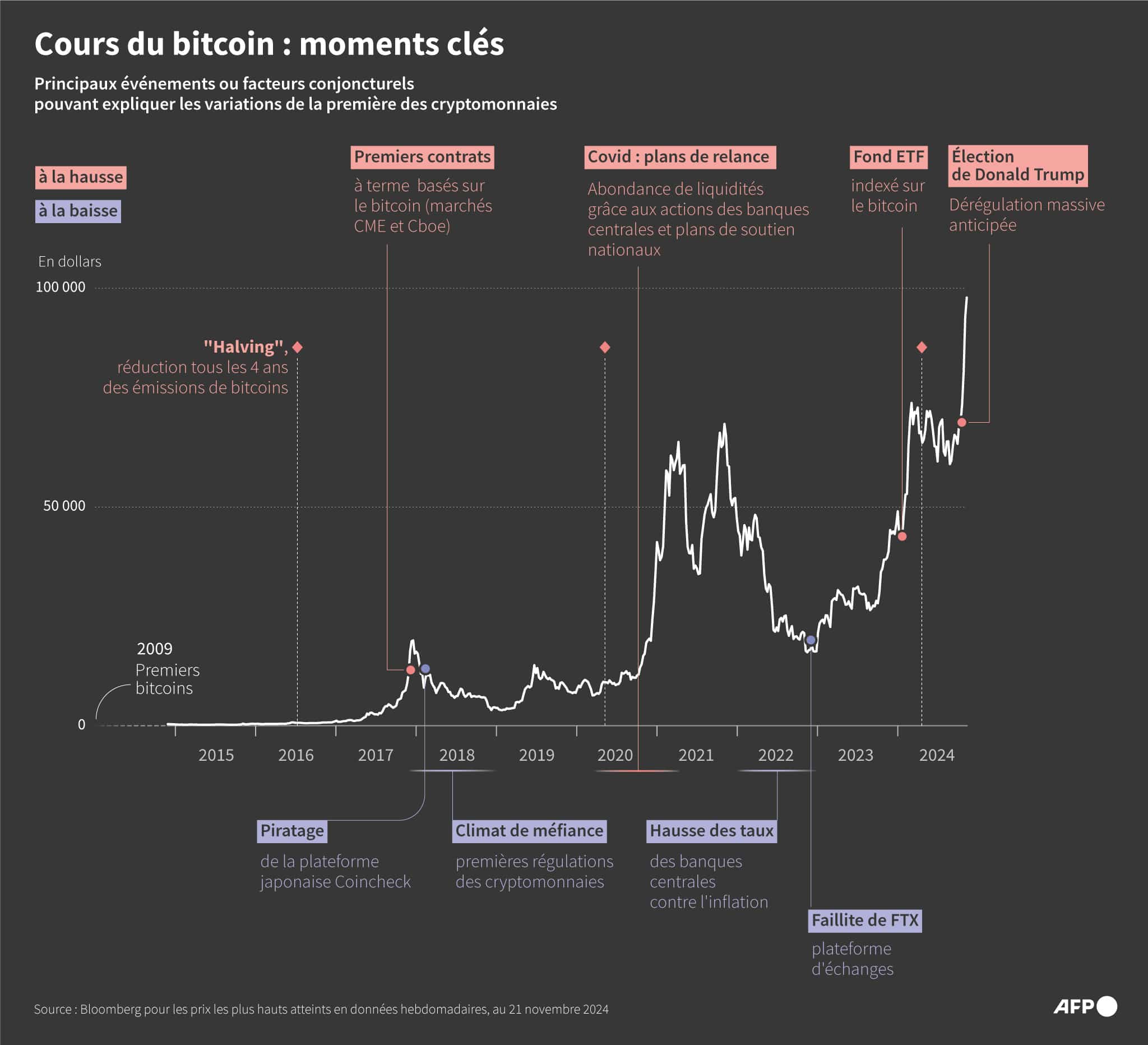En 1925, l’archéologue australien Vere Gordon Childe (1892-1957) lançait l’expression « révolution néolithique » pour désigner l’adoption par les sociétés humaines de la culture de céréales et de l’élevage d’animaux domestiqués afin de sortir de la précarité d’une alimentation fondée sur la chasse et la cueillette. Il y voyait aussi l’origine de la sédentarisation et de la croissance démographique de l’espèce humaine, donc une rupture majeure au sein de la Préhistoire, scindée en deux sous-parties : le Paléolithique et le Néolithique. Si cette vision est aujourd’hui nuancée, gardons-en l’idée du passage d’une logique prédatrice (prélèvement sur le stock fourni par le renouvellement biologique) à une logique productrice (augmentation « artificielle » – au sens étymologique : produit par le travail de l’homme – des ressources disponibles), qui s’applique désormais à toutes les activités humaines, à commencer par l’agriculture, en particulier sous ses formes les plus mécanisées et productives. Toutes, sauf une : la pêche.
Obéissant toujours au principe de prédation, il n’est pas étonnant que la pêche maritime ou ses variantes (chasse aux cétacés et autres espèces marines) soient les premiers domaines où la question de la préservation des stocks naturels se soit posée. Sous le triple effet de l’accélération de la croissance démographique, de l’augmentation de la consommation individuelle de poisson et de l’amélioration des techniques de pêche, les océans ont commencé à se vider, seul cas avéré où les prédictions malthusiennes se révélaient pertinentes.
L’essor de la pêche industrielle
Les premières espèces à subir l’industrialisation de la pêche furent les cétacés, dans ce qui est appelé globalement « chasse à la baleine ». L’intensification de cette chasse apparaît dès le xixe siècle, avec trois caractéristiques que l’on retrouvera plus tard pour les espèces halieutiques :
- Augmentation du nombre d’acteurs attirés par les perspectives d’enrichissement ;
- Invention de navires pouvant traiter les captures sur place, permettant la prolongation des campagnes donc l’accroissement des rendements ;
- Mise au point d’outils de plus en plus efficaces, à l’image du harpon à tête explosive, breveté dès 1870 par un Norvégien.
Lorsqu’Herman Melville écrit son chef-d’œuvre, Moby Dick (1851), les baleiniers de Nantucket, centre historique de la chasse situé près de Boston, sont déjà contraints à de longues campagnes dans le Pacifique, car les baleines ont quasiment disparu de l’Atlantique. Dans les années 1920, le niveau des captures de cétacés (20 à 30 000 par an, deux fois plus qu’avant la Première Guerre mondiale) suscite une réaction du Conseil international pour l’exploration de la mer, qui n’aboutira cependant qu’en 1946 avec la première convention réglementant la chasse. Insuffisante, elle sera suivie d’un moratoire complet sur la chasse commerciale en 1982, même si certains États utilisent encore le prétexte scientifique pour la poursuivre.
À lire aussi : La pêche : entre enjeux de souveraineté et gouvernance partagée
C’est aussi avant la Seconde Guerre mondiale que l’invention du chalut à panneau divergent, permettant de maintenir les ailes du filet écartées pendant qu’il est tracté et augmentant ainsi le volume de prises, accroît sensiblement la productivité de la pêche : les captures passent de 5 millions de tonnes en 1900 à 15 millions en 1948. L’introduction du sonar sur les navires, permettant de mieux repérer les bancs de poissons, puis la mise au point par l’URSS de chalutiers-usines capables de débiter et congeler les poissons sur les lieux de pêche, font entrer définitivement la pêche dans la logique de l’industrialisation et de l’internationalisation, puisque l’URSS devient en 1975 la deuxième flotte mondiale de pêche. En 1976, les captures océaniques atteignent un premier seuil historique à 60 millions de tonnes (Mt) – une multiplication par quatre en moins de trente ans !
Mondialisation et… régulation
La pêche est donc l’un des premiers secteurs à avoir expérimenté les effets de la mondialisation, et la réponse ne doit pas nous surprendre : alors que le principe de la liberté des mers s’était imposé depuis le xviie siècle, le risque de pillage de ressources à portée de main incita les États à réclamer et à imposer des frontières, ce qui peut paraître totalement antinomique avec un espace physiquement ouvert et indifférencié, mais témoigne de ce que Michel Foucher appelle « territorialisation » des océans. La convention de Montego Bay de 1982 crée la notion de Zone économique exclusive (ZEE), qui porte jusqu’à 200 milles marins des côtes (370 km) le droit pour l’État riverain de règlementer l’accès aux ressources halieutiques et sous-marines ; elle est née de la volonté de limiter le « pillage » par des pêcheurs étrangers, tout en évitant une considérable extension de la mer territoriale, espace où la souveraineté des États est totale.
Dans ce même contexte apparurent les premiers signes d’épuisement de certaines espèces : dans les années 1970, les harengs de la Baltique et de la mer du Nord, à l’origine de la prospérité et de la puissance maritime de nombreux États européens, voient leurs stocks s’effondrer, bientôt suivis par la morue de l’Atlantique ; ce poisson si abondant depuis des siècles sur les Grands Bancs de Terre-Neuve menace de disparaître après l’introduction du chalutage à la place des techniques traditionnelles, justifiant un moratoire quasi total sur sa pêche en 1992. Progressivement, des accords de gestion par espèces ou par zone géographique se sont mis en place pour concilier exploitation immédiate et préservation de la ressource à long terme, en laissant le temps aux poissons de se reproduire et d’arriver à maturité par la fixation de quotas de prise révisés régulièrement.
À lire aussi : Etats-Unis / Chine : dominer les océans
Face à la pénurie annoncée, qui se traduit par un « plateau » des captures autour de 60 millions de tonnes entre 1970 et 1980, les pêcheurs se tournent vers les eaux plus profondes, dites mésopélagique ou bathypélagique, entre 200 et 4 000 m, où se trouvent de nouvelles espèces comme le grenadier, qui se révèlent rapidement encore plus fragiles du fait de cycles de reproduction plus longs que les espèces pélagiques. Les captures « sauvages » en mer progressent à nouveau dans les années 1980, mais stagnent à la fin du siècle entre 80 et 90 millions de tonnes. Encore ne s’agit-il là que des prises autorisées et contrôlées, les professionnels évaluant entre 25 % et 1/3 le volume du braconnage, au-delà des TAC (total autorisé de captures) fixé par espèce. De sorte que la situation s’est dégradée à moyen terme : alors que 90 % des prises provenaient de stocks biologiquement durables en 1990, ce n’est plus le cas que pour les 2/3 des captures aujourd’hui.
Élevage : la quadrature du cercle
La tendance s’est cependant inversée récemment, le pourcentage de pêche durable tendant à s’améliorer. Mais on voit bien que le seuil de prélèvement maximum sur les espèces sauvages se situe sans doute en deçà de 80 Mt. Or, la consommation de poissons augmente, du fait de la croissance de la population mondiale, et parce que la consommation dépasse aujourd’hui les 20 kg/an et par personne, deux fois plus qu’il y a trente ans. Cette augmentation accompagne l’élévation du niveau de vie, car le poisson est un mets onéreux, mais paré de multiples vertus diététiques, donc apprécié des populations urbaines développées – en France, la consommation atteint le double de la moyenne mondiale. Elle a donc toutes les chances de se poursuivre, même si la FAO croit pouvoir prédire un ralentissement de son rythme.
Paradoxalement, le poisson est aussi une nourriture « pauvre », apportant la majorité des protéines animales aux populations de PMA comme le Bangladesh, le Cambodge, la Sierra Leone et même de pays émergents comme l’Indonésie. Mais il s’agit pour eux d’une pêche ou d’une aquaculture locale, voire en eaux continentales – la croissance démographique de ces pays peut ainsi expliquer que les captures en eaux continentales ne cessent de croître et atteignent aujourd’hui 12 Mt. Rien à voir donc avec les produits débités, traités, congelés à bord de chalutiers-usines aussi grands que des navires de guerre, issus de la pêche industrielle.
En se fiant au chemin parcouru par l’agriculture, le développement de l’élevage pourrait être une solution d’avenir pour compenser l’impossibilité d’augmenter les prises sans vider les océans en quelques années. L’aquaculture est d’ailleurs presque aussi vieille que l’agriculture, puisqu’on en trouve trace il y a 6 000 ans en Asie, qui est toujours la région dominante pour cette production. Et c’est elle qui permet depuis trois décennies de répondre à la croissance de la consommation de poisson : en 2018, les produits d’élevage font jeu égal avec les captures marines sauvages et fournissent déjà la majeure partie des coquillages et crustacés consommés par l’homme.
Les raisons de l’inquiétude
Pourquoi, alors, s’inquiéter ? C’est qu’il n’est pas si facile d’élever des espèces normalement mobiles. D’une part, la concentration inhabituelle de poissons sur un espace restreint pose des problèmes sanitaires – les élevages de saumons chiliens ont souffert de multiples déboires : virus mortel à la fin des années 2000, prolifération de micro-algues en 2016 – ou de pollution des eaux. D’autre part, la plupart des 75 espèces de poissons adaptées actuellement pour l’élevage sont carnivores, et sont donc nourris avec… des poissons, plus petits, issus de ce qu’on appelle la pêche « minotière » (destinée à produire des farines) : sprats, lançons, capelans, anchois… Pour développer l’élevage, il faudrait donc pêcher encore plus ! Et menacer la survie de ces espèces qui, dans certaines zones océaniques (Pacifique sud-est), sont passées très près de l’extinction quand la pêche minotière s’est intensifiée dans les années 1990, montant à plus de 30 Mt par an – elle est aujourd’hui retombée aux environs de 20 Mt, dont la moitié environ sert à l’élevage halieutique. Avec des conséquences en chaîne mal maîtrisées, car ces espèces intermédiaires dans la chaîne alimentaire permettent aussi la survie de prédateurs plus gros, qui sont souvent pêchés pour la consommation humaine directe et risquent donc, eux aussi, de se raréfier.
C’est pourquoi l’aquaculture progresse aujourd’hui surtout dans les eaux intérieures. Pour développer l’élevage en milieu maritime, il faudra non seulement résoudre la question de l’alimentation, mais aussi multiplier des structures « neutres », associant aux poissons d’autres organismes (oursins, mollusques, algues) capables d’absorber ou de filtrer les déchets. De telles installations sont plus à leur place à quelque distance des côtes, ce qui réduira aussi les conflits d’usage sur les littoraux.
Les accords de gestion des pêches montrent la voie d’une écologie responsable, associant toutes les parties prenantes pour la préservation durable d’une ressource qui fait vivre 60 millions de personnes dans le monde. Il faudra néanmoins mettre fin à certaines aberrations, comme les subventions sur les carburants, qui permettent à des navires-usines d’aller toujours plus loin piller les ressources d’États qui n’ont pas les moyens, juridiques ou navals, de protéger l’accès à leurs eaux. Car certains « acquis » sont irréversibles : si les populations européennes de harengs remontent, la morue de Terre-Neuve, tombée à 1 % de sa biomasse originelle, risque de mettre près d’un siècle à retrouver son abondance passée !