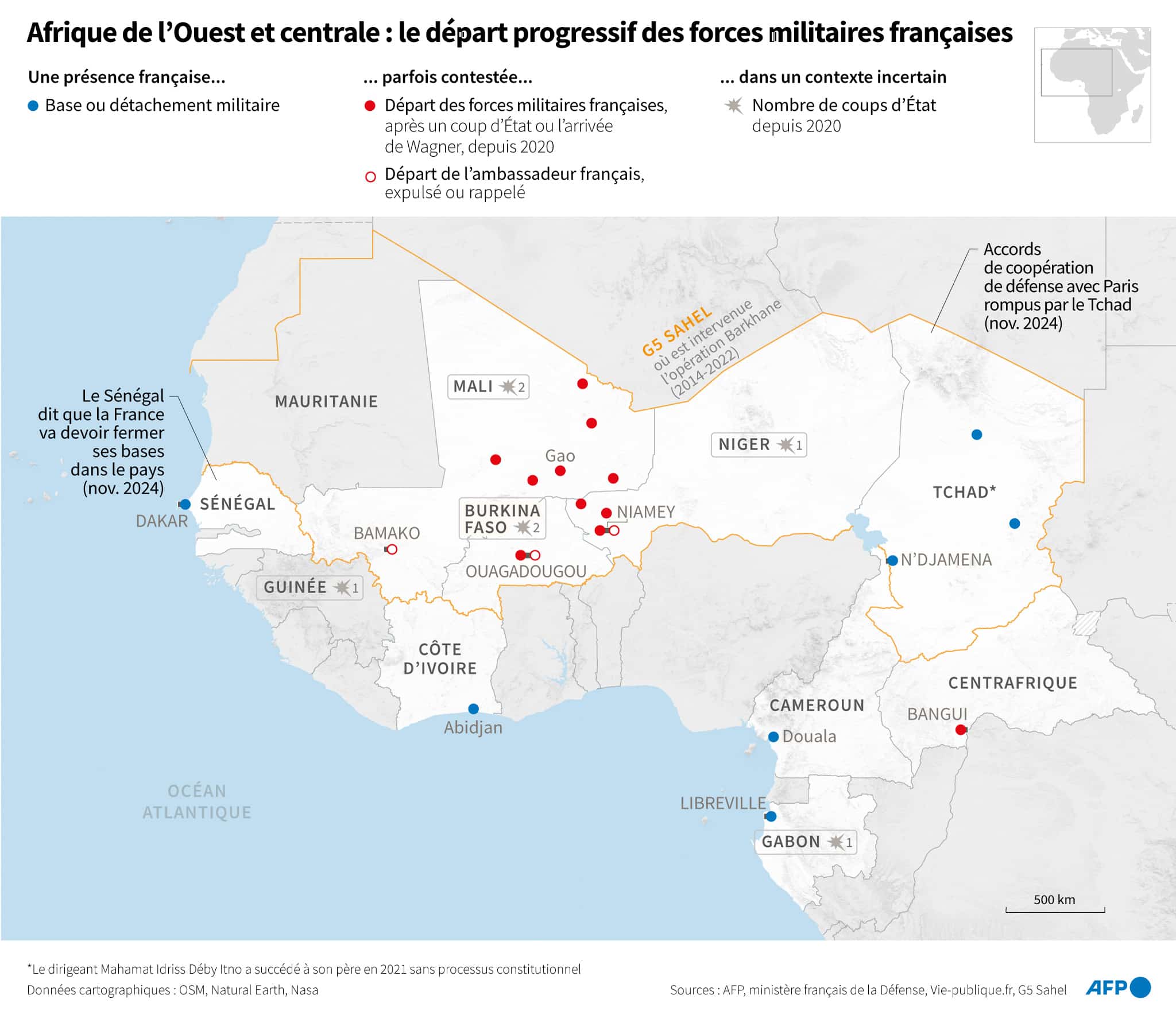Gérard Larcher a évoqué « une souveraineté partagée » pour la Nouvelle-Calédonie, sans que l’on sache ce que cette expression recouvre. Ni lui non plus visiblement, tant ce concept polysémique se révèle faible sur les plans juridiques et politiques.
S’intéresser à l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, c’est s’exposer en permanence à trouver sur son chemin les mêmes vieux serpents de mer. Même si ceux qui leur ont tiré la queue hors de l’eau n’ont souvent pas conscience du fait qu’ils s’y trouvaient depuis des décennies, nous pouvons quand même profiter du fait qu’ils les aient déposés en travers de notre chemin pour les réexaminer. Le dernier en date est ainsi celui de la « souveraineté partagée ».
Retrouvez l’intégralité des Chroniques calédoniennes.
Les chroniques d’Eric Descheemaeker paraissent également dans l’hebdomadaire Actu.nc.
La curieuse formule de Gérard Larcher
Lors de son déplacement du mois dernier en compagnie de son homologue de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat a déclaré qu’« il était illusoire de s’attacher à une conception trop juridique ou trop doctrinale de la notion de souveraineté, car dans notre monde du Pacifique à l’Union européenne, il n’existe que des souverainetés partagées. C’est un choix qui n’est pas nécessairement binaire et qui peut passer par une construction imaginative et originale au sein de la République, si les Calédoniens le souhaitent ».
Avant de se demander ce qu’il convient de penser des propos de M. Larcher, il faudrait d’abord commencer par comprendre ce qu’il entend par « souveraineté partagée ». Or, non seulement ses propos ne l’explicitent pas, mais tout laisse à croire qu’il n’en a lui-même pas grande idée.
« Souveraineté » est un mot polysémique, comme la plupart des concepts juridiques. Il est souvent considéré comme synonyme d’indépendance – comme dans la question consultative de 2018, 2020 et 2021, « souhaitez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la (pleine) souveraineté et devienne indépendante ? » – mais parfois on distingue les deux. Malheureusement, il y a à peu près autant de manières de les distinguer que de personnes s’étant essayées à l’exercice. Globalement, comme indépendance (étymologiquement, le fait de ne pas être suspendu à), souveraineté (étymologiquement, le fait d’être au-dessus) renvoie à l’idée qu’il n’y a personne au-dessus de soi. Dans ces conditions, « souveraineté partagée » apparaît a priori comme un oxymore : cela suggère que chaque partie est à la fois au-dessus et en dessous de l’autre. Mais, là encore, ne nous arrêtons pas aux mots et essayons de voir ce que pourrait recouvrir cette expression. Or, nous pouvons en distinguer au moins cinq sens différents.
Des sens multiples
1o Le premier, c’est une idée qu’on trouve déjà dans l’accord de Nouméa : car, loin d’être une construction « originale », l’idée de souveraineté partagée est en réalité fort ancienne. C’est ainsi qu’elle est définie en 1998 : « Le partage des compétences entre l’État et la Nouvelle-Calédonie signifiera la souveraineté partagée » (préambule, point 5).
Ici, le mot « souveraineté » est simplement synonyme d’exercice des différentes compétences étatiques, ce qui est très loin de son sens normal. En métropole aussi, ces compétences sont partagées entre État central et collectivités locales, mais personne ne parlerait de « souveraineté partagée » entre la République française, la région Auvergne-Rhône-Alpes, le département du Rhône, la communauté urbaine de Lyon, la commune et ses différents arrondissements. Cela est vrai aussi dans un contexte calédonien, même quand on enrobe cette dévolution des pouvoirs de grands mots, comme « État fédéré ».
2o Le deuxième sens, c’est celui de l’État associé : c’est sans doute à cela que M. Larcher fait allusion quand il parle du Pacifique, où se trouvent les cinq États généralement désignés comme tels, deux associés à la Nouvelle-Zélande (Iles Cook, Niue) et trois aux États-Unis (Micronésie, Palaos, îles Marshall). Un État associé est parfois défini comme étant souverain (il a la « compétence de sa compétence ») mais pas indépendant (il a décidé souverainement de se placer sous la protection d’un autre État). Mais là encore, les mots pouvant avoir des sens différents, on pourrait dire à l’inverse qu’il est indépendant (il n’existe personne au-dessus de lui) mais pas souverain (c’est un autre État qui assume les compétences régaliennes). La seconde approche nous paraît meilleure : c’est d’ailleurs pour cela qu’on parle souvent d’indépendance-association, la seconde ne se concevant pas sans la première.
3o Un troisième sens aurait pu, lui aussi, être relié au Pacifique : celui d’une terre gouvernée en commun par deux États différents. Cela a été le cas aux Nouvelles-Hébrides, colonie conjointe (condominium) du Royaume-Uni et de la France jusqu’en 1980. L’idée a refait surface au début des années 2000 à Gibraltar, où les habitants de ce territoire britannique ont rejeté l’idée que le Royaume-Uni « partage » sa souveraineté avec l’Espagne.
4o Le quatrième sens serait celui de l’exercice en commun de certaines compétences. C’est sans doute à cela que M. Larcher fait référence quand il parle de l’Union européenne. Les États membres de l’Union européenne (dont, rappelons-le, la Nouvelle-Calédonie ne fait pas partie) sont tous indépendants, mais ils ont décidé d’exercer certains aspects de leur souveraineté en commun avec les autres États membres.
5o Enfin, l’accord de Nouméa fait allusion, mais sans rien définir ou préciser, à une forme de souveraineté partagée très différente du premier sens que nous avons mentionné : « il convient de faire mémoire de ces moments difficiles, de reconnaître les fautes, de restituer au peuple kanak son identité confisquée, ce qui équivaut pour lui à une reconnaissance de sa souveraineté, préalable à la fondation d’une nouvelle souveraineté, partagée dans un destin commun » (préambule, point 3). Ce à quoi il semble être fait référence ici, c’est une souveraineté du peuple kanak en tant que « peuple d’origine ».
Deux choses sont à noter : d’abord, que cette souveraineté est définie en termes identitaires (reconnaître la souveraineté, c’est restituer l’identité confisquée) ; ensuite, que celle-ci semble destinée à se fondre dans quelque chose de plus grand, une souveraineté « partagée » avec les nouveaux arrivants, dans ce trop fameux « destin commun » dont personne, là encore, ne sait ce qu’il veut dire. Ici, le peuple kanak semble à la fois souverain et non souverain, puisque cette souveraineté, immédiatement donnée, doit être partagée avec d’autres. Inutile de dire que la chose est parfaitement obscure.
Une pensée ancienne
Que penser de tout cela ? D’une, donc, que ce que dit M. Larcher n’est en rien original, c’est un vieux serpent de mer. De deux, que tout dépend de ce qu’on met derrière les mots. De trois, qu’une répartition des compétences, même organisée par la Constitution, n’est pas un partage de souveraineté, sauf à ce que les mots perdent leur sens. De quatre, que l’État associé n’est pas non plus un partage de souveraineté : c’est une dissociation entre indépendance et souveraineté, ce qui n’a rien à voir (même si certains, comme le Palika[1], peuvent trouver utile d’entretenir une confusion entre les deux).
Une souveraineté tribale ?
Reste une cinquième considération : l’idée, ouverte puis immédiatement refermée dans l’accord de Nouméa, qu’il existerait une souveraineté propre aux Mélanésiens de l’île. Elle n’a jamais été poursuivie, tant la tradition juridique française lui est hostile, mais possède un long pedigree dans les anciennes colonies britanniques. L’idée qu’il pourrait exister une souveraineté autochtone tribale est discutée en Nouvelle-Zélande et au Canada, et surtout c’est un principe bien établi aux États-Unis, où l’idée de tribal sovereignty est reconnue depuis très longtemps par l’ordre constitutionnel américain. Ce que cela veut dire est à la fois complexe et controversée, mais – pour simplifier – que les tribus sont « maîtresses chez elles » : sur leurs terres, elles s’administrent comme elles le souhaitent, dans le respect bien sûr d’un certain nombre de principes.
Elles ne sont pas souveraines au sens d’une quelconque indépendance vis-à-vis des États-Unis – leurs terres sont territoire américain et le Congrès détermine les lois fédérales qui s’y appliquent – mais les tribus peuvent signer des accords avec le gouvernement ; elles possèdent leurs terres (même si elles peuvent parfois les vendre) ; et surtout elles ont un pouvoir de justice à la fois civil et pénal sur les affaires qui concernent leurs propres membres sur leurs propres terres (mais pas sur les non-Indiens qui y résident ni sur les membres de la tribu vivant ailleurs).
Ce n’est sans doute pas quelque chose à quoi pensait M. Larcher, mais c’est la seule idée de souveraineté partagée qu’il serait à notre sens intéressant de creuser dans le contexte néo-calédonien. La reconnaissance symbolique pour les grands chefs kanaks serait considérable, peut-être davantage que l’indépendance de « Kanaky », sans menacer en rien la souveraineté française qui n’opérerait tout simplement pas sur le même plan (la souveraineté « tribale » étant une concession donnée par la France aux tribus de s’organiser comme elles le souhaitent tant que cela ne concerne qu’elles). Par ailleurs, pour ne prendre que cet exemple, il serait beaucoup plus cohérent d’avoir une véritable justice tribale, y compris sur le plan pénal, que des assesseurs coutumiers siégeant dans des tribunaux étatiques (et encore, uniquement sur le plan civil), compromis qui n’a aucune logique et ne satisfait visiblement personne.
La forme que pourrait prendre pareille souveraineté serait évidemment complexe dans son détail, et il faudrait s’assurer à la fois que les personnes hors tribu (ou « peuple d’origine ») ne soient pas soumises à son autorité, et réserver aux Mélanésiens qui ne souhaiteraient pas non plus y être soumis la possibilité d’en sortir. Entre les États-Unis, le Canada, la Nouvelle-Zélande, ou même Wallis et Futuna (avec ses rois coutumiers), les sources d’inspiration pourraient être nombreuses. Sans présumer en rien des conclusions, voilà en tout cas un sens de la « souveraineté partagée » qu’il pourrait être réellement intéressant d’examiner plus en profondeur. Les autres sens, en revanche, sont soit sans intérêt, soit dangereux, soit inapplicables à la situation calédonienne.
[1] Le Palika (Parti de libération kanak) est un parti politique néo-calédonien fondé en 1975. Il correspond actuellement aux indépendantistes modérés – ceux qui souhaitent essentiellement que les choses continuent comme aujourd’hui, mais sous un drapeau différent – par opposition aux radicaux de l’UC (Union calédonienne), qui rêvent de se débarrasser à la fois de la présence et de l’héritage européens sur l’île. Les tensions entre les deux « camps » sont devenues telles que le Palika s’est récemment mis en retrait du FLNKS, devenu trop extrémiste à ses yeux.