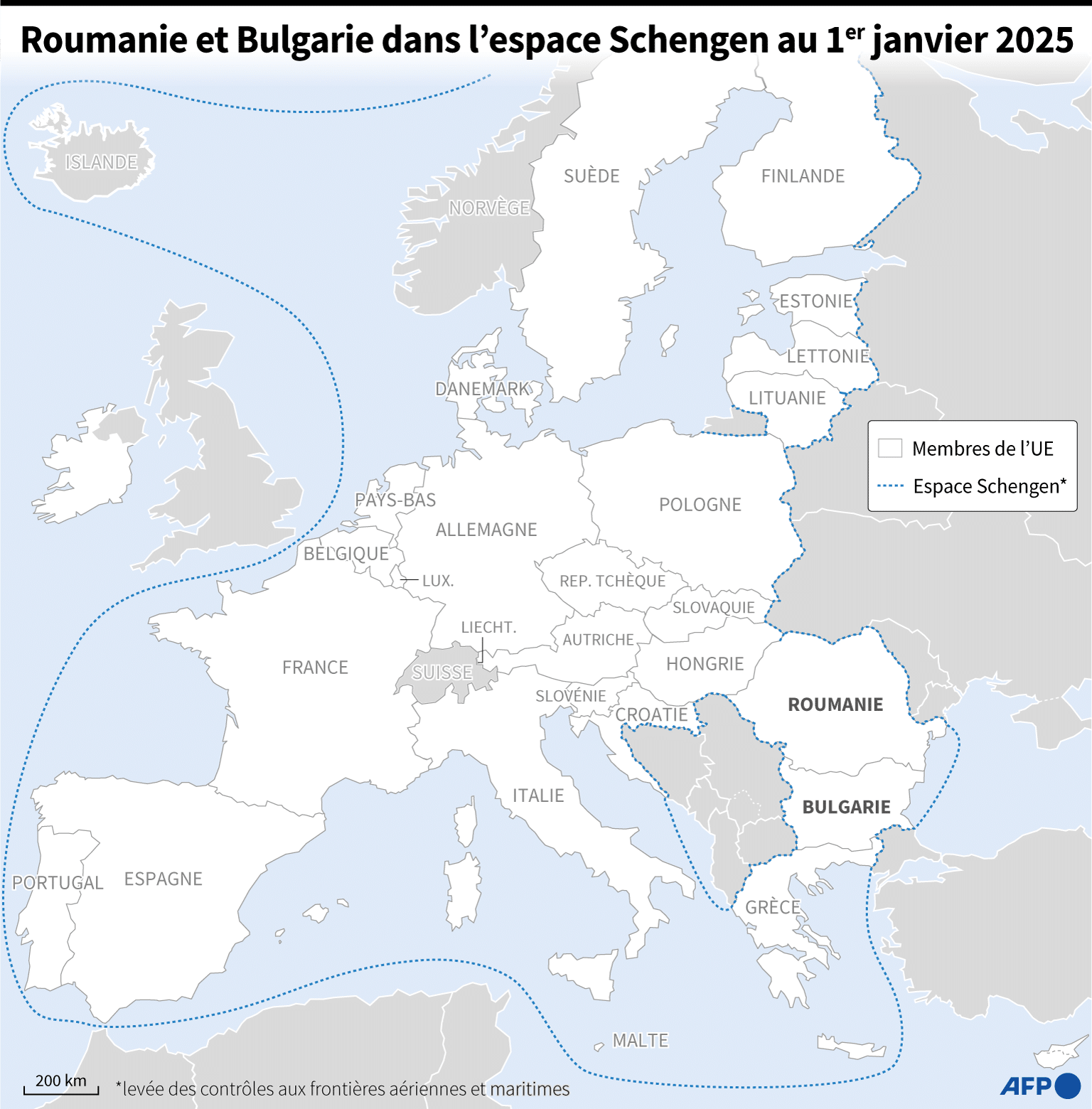L’Organisation du traité de l’Atlantique Nord, plus connue sous son acronyme d’OTAN, constitue le principal outil de défense collective en Europe depuis 1949. Elle a été prédominante tout au long de la guerre froide. Une fois celle-ci terminée, l’émergence de dispositifs autour de l’Union européenne (UE) a pu faire croire un temps à une concurrence. Le nouveau paysage stratégique laisse ces deux institutions affaiblies. Mais cette faiblesse n’est pas simplement due à de simples questions institutionnelles ou de mécanismes imparfaits, ni même au manque d’une volonté politique, comme beaucoup d’observateurs l’analysent souvent : elle tient probablement à un différentiel de regard des Européens sur chacune des institutions, tout comme entre Européens sur les ambitions à avoir. Omettre l’examen de ces perceptions constitue une profonde erreur d’analyse géopolitique : essayons de le faire brièvement.
Signé en 1949 à Washington, le traité de l’Atlantique nord crée une Alliance atlantique qui est d’abord l’outil politique liant les deux rives de l’océan occidental. Il s’agit alors de contourner l’isolationnisme des États-Unis qui les fit rejoindre tardivement le combat des Européens lors des deux guerres mondiales, en 1917 et à la toute fin de 1941. La guerre froide était lancée depuis la fin de 1947 et cette fois, il n’y aurait pas besoin d’organiser un débarquement puisque les troupes américaines seraient déjà sur le territoire européen. Deux facteurs firent évoluer cette situation : la conduite de la guerre de Corée (1950-1953) montra qu’il fallait organiser dès le temps de paix les procédures opérationnelles pour employer les forces. Cela conduisit à la mise en place de l’organisation, à partir de 1951, qui se développa continûment. Ainsi, l’Alliance est-elle l’outil politique, l’OTAN constituant l’organisation militaire. Or, aujourd’hui, l’OTAN fonctionne convenablement quand l’Alliance est très entravée.
L’autre facteur fut l’irruption du fait nucléaire : en effet, l’URSS tira sa première bombe atomique en 1949 et sa première bombe nucléaire en 1953. En 1957, avec l’engin Spoutnik, elle lançait un formidable défi technique et stratégique aux États-Unis et au-delà, à l’Alliance. L’introduction d’une certaine parité modifiait la donne qui devint bipolaire. Les 300 000 GI’s stationnés en Europe devinrent des sortes d’otages qui devaient permettre le couplage entre les deux rives : une attaque soviétique en Europe forcerait l’intervention américaine et donc la possible escalade militaire, jusqu’au seuil nucléaire. L’alliance militaire traditionnelle devint une alliance nucléaire.
Il n’y a pas d’alternative européenne
Les Européens en déduisirent que leur sécurité dépendait de la superpuissance américaine. Ainsi, pour la plupart des Européens (ce qui est très rarement perçu et encore moins compris en France), la défense de l’Europe est assurée d’abord et avant tout par l’Alliance. Celle-ci permet d’avoir une garantie nucléaire et américaine sans avoir les inconvénients de disposer de la bombe ; elle permet de moins payer pour les questions de défense puisque l’essentiel est fourni par les Américains ; enfin, un « pair plus égal que les autres » permet, pour beaucoup, de régler facilement les discordes intra-européennes. Une sécurité garantie, un moindre coût (aussi bien pendant la guerre froide que depuis), une relative harmonie européenne : l’Alliance présente aux yeux des Européens bien des atouts. La discorde gréco-turque n’a par exemple jamais dégénéré, tandis que les derniers présidents américains (G. Bush, B. Obama puis D. Trump) ont reproché de plus en plus vivement aux Européens de ne pas assez payer pour leur défense.
À lire aussi : 70 ans d’OTAN, mais pas beaucoup plus ?
Dans ce paysage mental, la construction européenne vient en second. Certes, l’Union occidentale a bien été créée en 1948, avant l’Alliance. Transformée en Union de l’Europe occidentale en 1955, elle a peu à peu été absorbée par les institutions de l’Union européenne. Celle-ci a développé, au cours des années 1990, un appareil institutionnel conséquent : PESC, PESCO, sans même parler des mécanismes de Fonds européen de défense, des récentes coopérations renforcées ou de l’Initiative européenne d’intervention, lancée en 2018. Les Européens ont décidé tout un tas de choses, par exemple un état-major de l’Union européenne (EMUE) ou des battle groups, ils conduisent même des opérations dont certaines sont militaires, mais rien n’y fait : ils ne paraissent pas convaincus et les effets d’annonce s’évanouissent comme l’eau dans le sable. En fait, les Européens de l’UE ne croient pas vraiment qu’ils puissent conduire une politique de défense autonome, sans même parler d’indépendante. L’essentiel doit être assuré par l’OTAN et les remarques fort désagréables de D. Trump sont perçues comme un mauvais moment à passer.
L’exception française
Dans ce paysage, il y a une exception française. Paris est en effet totalement décalé par rapport à ses pairs. Cela est dû à deux fantasmes, l’un sur l’Alliance, l’autre sur l’UE.
Le premier fantasme tient au rapport français à l’Alliance. En effet, nous vivons encore avec un sentiment d’exception, dû au retrait de 1966 de l’Organisation militaire intégrée (donc de l’OTAN, mais pas de l’Alliance : notre ambassadeur participait toujours au Conseil de l’Atlantique Nord). Le retour à une certaine normalité s’est effectué progressivement à partir de la fin des années 1990 pour s’accélérer brutalement avec N. Sarkozy qui décida de rejoindre l’OTAN en 2008 (seule exception qui demeure : nous ne participons pas au Groupe des plans nucléaires). Pourtant, cette normalisation affecte peu la réalité stratégique : en effet, la France connaît deux différences très profondes avec ses alliés européens. Elle dispose de la bombe nucléaire qui lui garantit une indépendance complète, ce qui constitue une exception en Europe (hormis le cas britannique, sur lequel nous reviendrons, mais qui a logiquement changé de statut avec le Brexit). Dès lors, elle n’a pas réellement besoin de l’OTAN pour assurer sa sécurité ultime. Elle a besoin de l’Alliance pour le système politique qu’elle constitue et qu’elle n’a jamais quittée, même sous de Gaulle. Et si elle s’est rapprochée de l’Alliance au tournant des années 2000, ce sont plus pour des raisons opérationnelles contingentes. À l’époque en effet, l’Alliance constituait le cadre général des interventions extérieures (en Bosnie puis au Kosovo et en Afghanistan). Or, ce cadre s’est profondément amenuisé puisque l’OTAN ne conduit plus d’opérations. Il n’est donc plus besoin comme avant de participer à l’élaboration des décisions, notamment au SHAPE à Mons. Au fond, le retour dans la structure intégrée s’est effectué à contretemps. À un moment, sur les 35 000 militaires français engagés en posture opérationnelle, seulement deux l’étaient sous badge de l’OTAN. Aujourd’hui, cette part a évolué puisque l’on compte les 300 hommes participant aux missions d’entraînement effectuées dans les pays baltes au titre d’Enhanced Forward Presence, qui n’est selon l’Alliance ni une mission ni une opération, mais une « posture opérationnelle ».
À lire aussi : A quoi sert l’OTAN pour les Etats-Unis ?
Voici en effet l’autre trait distinctif français : un engagement opérationnel marqué, y compris dans des missions de combat, sous des cadres différents au cours des dernières décennies : ONU, OTAN, UE, coalition ad hoc, action indépendante au titre d’accords de défense. Cet engagement, dû à un système institutionnel particulier, mais aussi une longue habitude historique, nous différencie profondément de nos alliés européens (là encore, hormis les Britanniques, même s’ils ont baissé de pied au cours de la présente décennie). Certains d’entre eux participent, de façon mesurée, précautionneuse et encadrée, à des missions (par exemple les missions de l’UE, qui sont très souvent des missions de formation). Il s’ensuit une culture opérationnelle finalement plus proche des Américains, voire des Turcs, que des Européens bon teint.
Dès lors, malgré la réintégration de l’OTAN, l’exception française demeure, surtout quand la plupart des alliés européens de l’Alliance continuent de regarder la Russie comme le danger principal, quand la France regarde avec beaucoup plus de préoccupation se qui se passe au Proche-Orient, en Méditerranée ou en Afrique, zones que l’Alliance considère avec réticence.
S’ajoute à cela un deuxième fantasme, celui de l’Europe (de l’UE) comme multiplicateur de puissance. Depuis 1918, la France ne s’est jamais vraiment consolée de ne plus être une superpuissance. Elle a cru, pendant l’entre-deux-guerres et jusqu’à la fin des guerres de décolonisation, que l’empire serait ce multiplicateur de puissance : relisez l’appel du 18 juin pour comprendre à quel point cette perception était forte. En 1962, la France a compris que c’était une illusion. Elle accélère alors son investissement européen, perçu comme le multiplicateur de puissance qui manquait. Pour de Gaulle, l’Europe en construction devait être sous forte influence française. Ce rapport ambigu à la puissance perdue (symbolisée par les trois moments douloureux que sont juin 1940, Diên Biên Phu et Suez) explique l’espoir en une Europe « puissance par procuration » qui anime les élites françaises depuis plusieurs décennies. Mais ce rêve de puissance n’est partagé par aucun de nos partenaires, sauf peut-être, là encore, les Britanniques (et pas dans le cadre européen). L’exception française persiste et suscite incompréhension.
Ainsi, l’expression « Europe de la défense » fait florès en France. Elle ne veut pas dire grand-chose, mais son ambiguïté convient bien à tous, ce qui explique sa répétition ad nauseam. Elle présente juste un problème : elle est intraduisible et totalement incompréhensible par nos partenaires qui parlent tous anglais. Si l’on dit Defense of Europe, ils répondent très logiquement NATO. Si l’on dit European defense, ils vous regardent avec curiosité, ne voyant pas très bien ce que vous signifiez puisque, pour eux, l’UE est d’abord une machine économique.
À lire aussi : Podcast ; L’OTAN au XXIe siècle. Entretien avec Olivier Kempf
Les Français arrivent donc dans l’Alliance comme dans l’UE pleins de bonne volonté, pétris de certitudes dont ils ne se rendent pas compte, et en profond décalage psychologique et stratégique avec leurs interlocuteurs. Il ne faut pas s’étonner dès lors si les rapports sont compliqués et assez inefficaces. Nous n’avons pas la même perception des intérêts stratégiques que nos partenaires. À cause d’un manque de travail en profondeur sur le diagnostic stratégique…
La Grande-Bretagne est une île
Londres partage avec Paris beaucoup de traits stratégiques communs : un certain nombre de guerres (victorieuses) conduites ensemble depuis un siècle et demi ; une même tradition démocratique ; le même souvenir d’une puissance impériale qu’il a fallu abandonner ; la pratique d’interventions militaires, y compris en solo ; la possession de la bombe nucléaire. Mais alors que Paris a fantasmé sur l’Europe, Londres fantasme sur le lien avec l’ex-colonie, sur la résistance anglaise pendant la campagne d’Angleterre en 1940, sur la special relationship, sur le grand large… Les Britanniques méprisent les Américains, mais ont l’illusion qu’ils savent les manipuler. Ils se présentent donc comme leurs factotums en Europe. Pour Londres, l’OTAN constitue un formidable multiplicateur de puissance, celui où ils vont instrumentaliser la puissance américaine, peu au fait des subtilités européennes et déléguant volontiers à une puissance de confiance les tâches ancillaires de l’organisation. Le lecteur aura compris qu’avec le Brexit, le Royaume-Uni défend plus que jamais l’Alliance et son organisation qui constituent pour lui une organisation paneuropéenne reconnue par ses alliés.
L’Allemagne mentalement otanienne
L’Allemagne a capitulé en 1945. Elle a longtemps été occupée et n’a retrouvé les attributs de la souveraineté qu’en 1955 quand, à la suite de l’échec du projet de Communauté européenne de défense (CED), elle a rejoint l’Alliance et l’OTAN. Autrement dit, pour l’Allemagne, démocratie, souveraineté et Alliance atlantique sont quasi équivalentes. Tout au long de la guerre froide, elle s’est ensuite préparée à ce que l’affrontement soit sur son sol et qu’elle soit la première victime de l’affrontement, avec des conséquences encore plus dévastatrices qu’en 1945, lors de l’année zéro. Le pont aérien pour Berlin en 1948, le Ich bin ein Berliner de 1963 et même la crise des euromissiles ont été vus comme les manifestations de l’alliance indéfectible entre les États-Unis et la RFA. Accessoirement, une grande partie des troupes américaines en Europe sont stationnées en Allemagne qui y trouve un intérêt bien compris. Aussi l’Allemagne est-elle profondément désarçonnée devant les agressions verbales de D. Trump et sa critique de l’Alliance. Elle y voit une remise en cause extrêmement violente de ses fondements psycho-stratégiques et ne souhaite qu’une chose : revenir à un statu quo qui lui permettra de perpétuer tranquillement son mode de vie confortable et rentier, à l’abri du parapluie américano-otanien.
Autres puissances européennes
Les autres puissances européennes considèrent l’OTAN avec faveur, pour des raisons diverses : outre le sentiment commun de bénéficier de la protection américaine à peu de frais et d’accéder grâce à l’Alliance à une sorte de relation spéciale (ce qui reste à mesurer), ils peuvent y trouver :
- La présence de bases alliées qui évitent d’affecter des militaires à l’étranger et d’accueillir au contraire des militaires étrangers à fort pouvoir d’achat sur son territoire (Italie, Pays-Bas, Belgique, voire Espagne) ;
- Équilibrer les trois poids lourds européens (Berlin, Londres et Paris), ce qui est fort intéressant quand on est une petite puissance (Portugal, Pays-Bas, Danemark …) ;
- Affirmer une position originale vis-à-vis de l’UE en matière de défense (Norvège, Pays-Bas) ;
- Obtenir une garantie forte de sécurité face au voisin russe (pays baltes, Pologne, Roumanie) ou au rival (cas turco-grec) ;
- Intégrer le club « occidental » européo-américain (Tchéquie, Slovaquie, Hongrie, Slovénie, Croatie, Albanie, Pologne, pays baltes).
Ainsi, bien peu d’analystes et même de praticiens ont conscience de ces différences de perception entre Européens. Les attentes envers l’Alliance sont distinctes avec des objectifs variés. Or, l’analyse géopolitique moderne n’a cessé de mettre en avant le rôle des perceptions dans la construction des dispositifs géopolitiques. Il est fort curieux que ce travail n’ait pas été fait systématiquement et ne contribue pas automatiquement à la définition des lignes politiques nationales. Le cas de l’Alliance atlantique est pourtant typique de ces objets communs qui suscitent des attentes fort différentes des alliés. Tout ne se résume pas à l’intérêt ou plus exactement, l’intérêt se détermine en grande partie par les perceptions de l’environnement. Mieux comprendre les attentes des autres, mais aussi nos attentes inconscientes constituerait pourtant une voie rapide d’amélioration de nos positions.