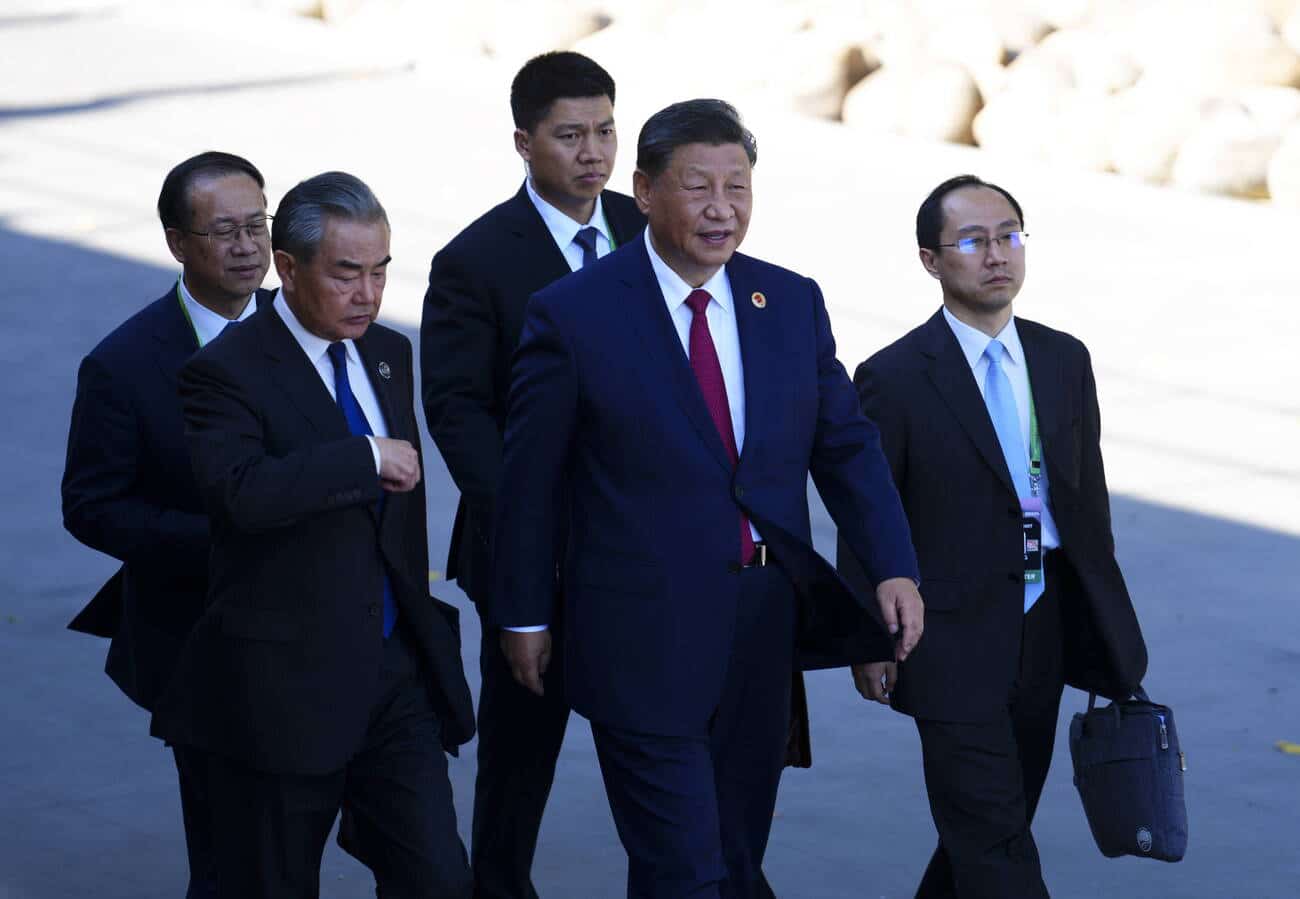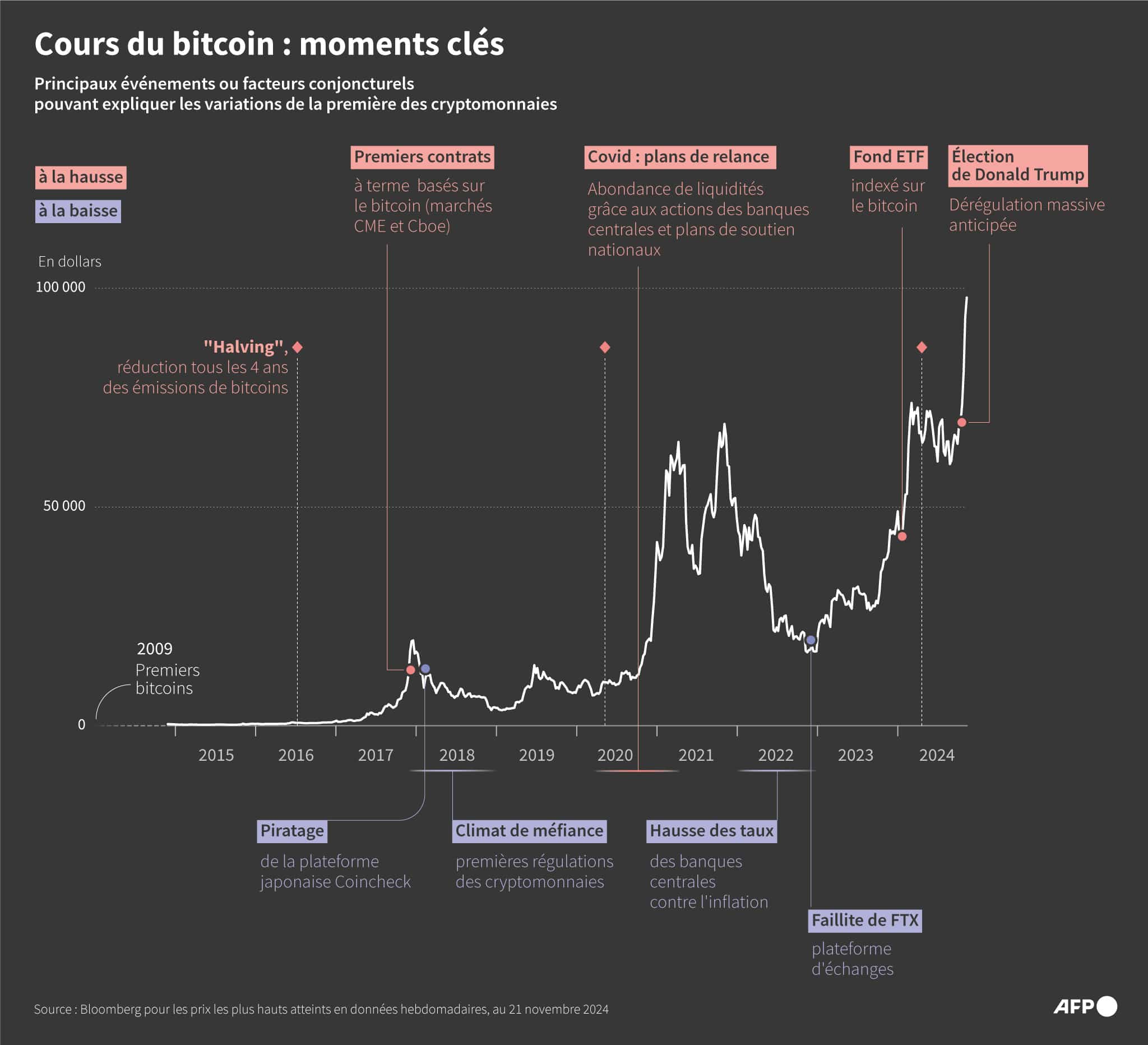Désindustrialisation, chômage de masse, perte de compétitivité, le décrochage français n’est pas provoqué par la mondialisation ou la concurrence internationale, mais par le choix d’un modèle politique et social qui a conduit à des impasses. Les deux historiens de l’économie, Michel Hau et Félix Torrès, analysent ces quarante dernières années pour mieux comprendre la situation d’aujourd’hui.
Propos recueillis par Jean-Baptiste Noé.
Félix Torres, historien, docteur en anthropologie, spécialiste de l’histoire économique et de la mémoire d’entreprise. Il dirige notamment le cabinet d’historiens-conseil Public Histoire. Il vient de publier, avec Michel Hau, Le Décrochage français. Histoire d’une contre-performance politique et économique. 1983-2017 (Puf, 2024).
Jean-Baptiste Noé : En lisant l’ouvrage Le décrochage français que vous venez de publier avec Michel Hau au PUF, on a le sentiment sur cette période d’une grande unité d’action entre la gauche et la droite. Si alternance il y a entre partis politiques, elle n’existe pas vraiment sur le plan des politiques économiques, sinon sociales avec une évolution générale plus ou moins analogue. Des différences de degré sans doute, mais pas forcément de nature. La politique du pays procède d’un modèle social basé sur l’endettement croissant, l’impôt, l’étatisation…
Félix Torres : Tout à fait. La question est celle de l’évolution ou de la non-évolution structurelle du modèle social français au regard du nouveau contexte économique des années 1980-2000 et au-delà dans lequel il se situe. Nous avons voulu saisir en historiens la plus que trentaine d’années qui vont de 1984 – le tournant de la rigueur – à 2017 – la fin de la présidence de François Hollande et l’arrivée au pouvoir d’Emmanuel Macron – dans la moyenne durée. C’est-à-dire étudier une temporalité qui n’est pas la courte durée du temps présent, où les événements se bousculent sans hiérarchie et recul, ni non plus la longue durée, qui tend à lisser les courbes et les perspectives, devenues presque « inévitables ». Séquencer, périodiser, essayer de hiérarchiser les causalités structurantes à l’œuvre, c’est le travail même de l’historien ! Cette moyenne durée de 30-40 ans, qui commence en fait en 1973, l’année du choc pétrolier, un changement de paradigme que nous avons traité avec Michel Hau dans un ouvrage précédent en 2020, Le virage manqué combine une mutation d’ordre économique, la globalisation économique de la planète et la réponse-adaptation qu’opèrent notre économie et notre État-providence, héritiers du modèle social construit en 1944-1945 et des Trente Glorieuses de la croissance, qui s’achèvent précisément en 1973.
Il y a une quasi-incongruité à dire que la mondialisation a été le phénomène majeur de l’époque qui suit, plus précisément la seconde mondialisation, après la 1re, entamée au milieu du XIXe siècle qui avait été brisée par la guerre de 14-18, la crise des années 30 et le recul général des échanges qu’ils ont entraîné, avec notamment la montée des protectionnismes. Il faudrait d’ailleurs parler de globalisation (comme le font tous les pays, ceux de langue latine inclus) que de mondialisation qui recèle une dimension seulement territoriale. Or la globalisation, c’est la mise en relation de tous les acteurs et parties du globe, ce qui les transforme fatalement, à la différence de la mondialisation qui laisse entendre que l’on se contenterait d’étendre des échanges de productions. Cette globalisation qui débute dans les années 1970-1980 (donc avant la chute du mur de Berlin et l’effondrement de l’URSS) repose sur l’ouverture générale du monde avec l’abaissement continu des barrières douanières (ce sont les fameux rounds des GATT) et la déréglementation des économies corsetées d’après-guerre à partir de la dérégulation lancée par le président Jimmy Carter en 1978.
Nous avons en France une belle école géographique et économique qui analyse depuis longtemps le phénomène de la mondialisation/globalisation, mais elle n’est guère lue par nos décideurs et le phénomène qu’elle analyse est donc mal expliqué à l’opinion publique.
Nous avons en France une belle école géographique et économique qui analyse depuis longtemps le phénomène de la mondialisation/globalisation (Olivier Dollfus, Pierre-Noël Giraud, Christian Grataloup, Zaki Laïdi, Jacques Lévy, Charles-Albert Michalet…), mais elle n’est guère lue par nos décideurs et le phénomène qu’elle analyse est donc mal expliqué à l’opinion publique. Le premier rapport public sur le sujet en 1993 est celui du sénateur Jean Arthuis (ministre de l’Économie trois ans après), très hostile à la mondialisation, à laquelle il attribue les problèmes de l’économie française et son chômage de masse. 1994, c’est tout de même bien tardif. Cette hyperglobalisation qui saisit la planète, déjà affectée par la crise financière de 2008 va durer jusqu’au milieu des années 2010 : Brexit, présidence de Donald Trump, montée des mesures protectionnistes et des risques géopolitiques, etc. Nous sommes entrés dans un autre monde. Est-ce une démondialisation, un nouveau mode de globalisation plus géopolitique et conflictuel que par le passé, c’est un autre sujet !
Confrontée à la lame de fond de la globalisation, la France a durablement souffert : crise économique, désindustrialisation (plus marquée chez nous que chez nos voisins européens), chômage de masse (idem), déficit chronique du commerce extérieur, fin d’un budget en excédent (à partir de 1978), essor de la dette, territoires et banlieues en déshérence, etc. Les Trente Glorieuses, expression a posteriori tirée du titre du livre de Jean Fourastié (toujours en 1978…) sont bien révolues. Face à ce phénomène majeur, ce cycle économique particulier, on assiste à une étonnante suite de séquences politiques à partir des élections législatives de 1978, les dernières auxquelles une majorité sortante est reconduite : quatre présidents de la République après Valéry Giscard d’Estaing, François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande, mais aussi trois cohabitations et quinze Premier ministres, de Pierre Mauroy à Bernard Cazeneuve, soit une conduite des affaires de deux ans en moyenne… Aucune majorité sortante n’est reconduite, les présidents réélus l’étant contre leur Premier ministre… On souligne chez nous la longévité des grandes figures politiques du continent : Margaret Thatcher, Helmut Kohl, Tony Blair, Angela Merkel… sans parler d’autres dirigeants. En oubliant de signaler que s’ils ont duré au pouvoir, c’est parce qu’ils ont été réélus à plusieurs reprises par des électeurs satisfaits de leur action et de leurs résultats. Chez nous, la sortie récurrente des sortants traduit une « déconfiance » systématique qui nourrit la désaffection démocratique et la montée du populisme, notamment chez des classes populaires amères et désabusées…
Dans ce véritable décrochage politique, les deux dates charnières sont pour nous 1981 et 1983-1984. La défaite de « VGE » à l’élection présidentielle, redoublée par celles de Raymond Barre et d’Édouard Balladur en 1988 puis en 1995 signent l’échec du courant libéralo-centriste (orléaniste dirait René Rémond) à s’imposer dans le paysage politique hexagonal au profit du courant néo-gaulliste incarné par Jacques Chirac, puis Nicolas Sarkozy. La potion amère de l’adaptation nécessaire (mais toujours douloureuse) de l’économie française aux temps nouveaux ne sera pas administrée comme ailleurs par des « conservateurs » bon teint, mais par les socialistes eux-mêmes, revenus à partir de 1983-1984 du fiasco du Programme commun. Divisée, au pouvoir de façon fractionnée, la droite qui gouverne moins que la gauche durant cette période est poussée par l’habileté de François Mitterrand à mettre en avant la défense des « acquis sociaux », une sorte de social-démocratie molle que va incarner la formule de la « fracture sociale » lors de l’élection présidentielle de Jacques Chirac en 1995…
La potion amère de l’adaptation nécessaire (mais toujours douloureuse) de l’économie française aux temps nouveaux ne sera pas administrée comme ailleurs par des « conservateurs » bon teint, mais par les socialistes eux-mêmes, revenus à partir de 1983-1984 du fiasco du Programme commun.
J.-B. N. : Quand on lit Le décrochage français, on a l’impression que la gauche a été souvent plus libérale que la droite, Pierre Bérégovoy a déréglementé et mis en œuvre la désinflation compétitive, Lionel Jospin a continué à privatiser avec sa fameuse formule « L’État ne peut pas tout »… À une droite contrariée s’oppose une gauche socio-libérale qui n’assume pas ses choix dans un monde qui bascule…
F.T. : C’est le (durable) paradoxe politique français. La gauche mitterrandienne prend congé du Programme commun et de l’espérance socialiste sans l’assumer pour ne pas perdre son électorat et endosse le courant de déréglementation et de privatisation qui s’impose en Occident dans les années 1980-1990… Le tournant de 1983-1984 c’est aussi celui du ralliement à l’Europe sur le modèle allemand, aux conditions voulues par Helmut Kohl pour sauver le franc… S’ensuivront le Grand marché unique, l’euro, la discipline budgétaire et son déficit de 3% du budget (défini par François Mitterrand). Ils sont nécessaires pour insérer la France dans l’économie ouverte mondiale autour de figures comme Jacques Delors, Jean Peyrelevade, Pascal Lamy…
Malheureusement, le courant socialiste assume mal cette évolution, à l’image de Jacques Delors, président de la Commission européenne pendant les dix années décisives qui vont de 1985 à 1995, mais qui se dérobe (sans avoir à affronter le jugement des électeurs !) à l’élection présidentielle de 1995. Ou de Lionel Jospin, Premier ministre de 1997 à 2002 qui refuse de cosigner le manifeste Blair-Schröder de 1999 visant à moderniser le programme de la social-démocratie, avant de se retirer de la vie politique après son échec de 2002 au premier tour. Jusqu’à François Hollande, jugeant impossible de se représenter en 2017 après son premier mandat… Cette ambivalence et ce refus de procéder au nécessaire aggiornamento de leur démarche politique et sociale se paiera de revers électoraux cinglants après chaque exercice du pouvoir : défaites de 1986, 1993, 2002, 2017… Au-delà, l’entrée mal assumée dans le monde ouvert qu’incarne la construction européenne va perdurer, la France prenant sans cesse des libertés budgétaires dans un cadre monétaire collectif qui lui apporte la stabilité de sa monnaie, devenue commune.
Gauche et droite ont convergé dans une série de réformes transpolitiques passées telles une lettre à poste auprès de l’opinion publique, car spécialisées et très techniques comme la disparition en 1988 du monopole des agents de change (instauré par Henri IV, puis réaffirmé par le Premier consul Napoléon Bonaparte !). C’est ce que l’on a appelé les « 3D » : désintermédiation, décloisonnement et déréglementation, en bref le Big Bang du marché financier français à la façon de celui de Londres au même moment. Cette déréglementation est préparée par les premières réformes de René Monory à la fin des années 1970 sous le gouvernement de Raymond Barre et par une série de rapports de figures en vue de la place de Paris détaillant les grandes mesures à prendre. La direction du Trésor du ministère des Finances orchestre cette réforme, car l’essor régulier de la dette française impose de négocier au mieux celle-ci sur le marché financier national et international. L’une des mesures emblématiques de cette révolution financière est la création du CAC 40 fin 1987, c’est-à-dire la réunion des 40 premières valeurs boursières françaises, un indice qui allait prendre son envol au cours de la décennie suivante.
D’où une deuxième révolution capitalistique, elle aussi passée plus ou moins inaperçue, celle qui voit l’émergence de grands groupes qui passent à la conquête du grand large, selon l’expression du regretté Michel Drancourt. Ce sont soit des groupes anciens, privés ou privatisés (Air liquide, Lafarge, L’Oréal, Michelin, Saint-Gobain…) qui changent de rythme et de dimension en reconfigurant leur périmètre d’activité ; soit des nouveaux ensembles qui s’imposent dans les secteurs qu’ils ont choisi : Airbus, AXA, Cap Gemini, LVMH, Sodexho…) ; soit ceux que l’on pourrait qualifier de « born again », c’est-à-dire des groupes complètement métamorphosés (Danone ex-BSN, Kering ex-PPR, Schneider devenu Schneider Electric, Vinci…). La révolution financière leur donne les outils et le carburant pour se transformer et de partir à la conquête du monde, à la condition d’avoir les résultats adéquats… Certains n’y arriveront pas : Alcatel Alsthom, Arcelor, Péchiney… J’ajouterai que ce déploiement de la grande entreprise française à partir du milieu des années 1980 est moins un mouvement de délocalisation des sites de production qu’une conquête de parts de marché européennes et mondiales face à un marché français devenu mature.
J.-B. N. : Vous prenez notamment l’exemple de l’automobile qui a longtemps été un des fleurons industriels français : 10 % des emplois industriels de l’Hexagone à un moment. Après un âge d’or, elle pâtit de la hausse des coûts, notamment de production, obligeant certaines comme Renault à délocaliser, de la concurrence internationale, d’un positionnement trop milieu de gamme au regard des concurrents allemands…
F.T. : Les facteurs du déclin automobile français sont multiples et l’on peut élargir ce qui lui arrive à l’ensemble de l’industrie française. Dans le « monde plat » (expression de l’essayiste américain Thomas Friedman), c’est-à-dire ouvert, où les tarifs douaniers sont devenus presque résiduels et le coût du transport secondaire avec la conteneurisation du transport maritime. L’impératif, c’est être compétitif face à des concurrents qui surgissent partout, des pays développés – notamment nos voisins européens ! – et des nouveaux pays industrialisés, les « NPI », notamment d’Asie. Or nous sommes un pays développé, aux coûts de production élevés avec un modèle social généreux. Comme le résume très bien Henri Lachmann, l’ancien PDG de Strafor Facom, puis de Schneider Electric : « High cost, high prices » ! Quand vos coûts de production sont importants – ce qui est normal dans la 6e ou 7e économie mondiale qu’est la France –, il faut pratiquer des prix élevés, aller sans cesse vers l’innovation, le haut de gamme et une meilleure productivité, sauf à être rattrapé par les outsiders pratiquant des prix plus bas, en disposant des capacités d’autofinancement nécessaires pour investir, grandir, exporter, s’internationaliser…
Or les entreprises françaises courent avec des semelles de plomb, notamment fiscales : cotisations sociales (le financement de l’État-providence instauré en 1944-1945 reposant majoritairement sur les entreprises, à la différence des autres pays) ; impôts de production décorrélés des bénéfices des entreprises, plus ou moins ignorés ailleurs et que ne payent pas nos concurrents étrangers) ; impôt sur les sociétés (jusqu’à récemment supérieurs au reste de l’Europe). L’économiste Henri Lagarde a calculé que quand il était chef d’entreprise chez Thomson Electroménager dans les années 2000, à rapport qualité-prix égal, ses produits étaient systématiquement 10 à 15% plus chers que ceux de ses concurrents allemands. Que faire dans ces conditions de handicap structurel ?
L’économiste Henri Lagarde a calculé que quand il était chef d’entreprise chez Thomson Electroménager dans les années 2000, à rapport qualité-prix égal, ses produits étaient systématiquement 10 à 15% plus chers que ceux de ses concurrents allemands. Que faire dans ces conditions de handicap structurel ?
Cette fiscalité qu’il faut bien qualifier d’aberrante dans la moyenne durée rend compte selon nous principalement du caractère structurel du décrochage français, associant déficit chronique du commerce extérieur et désindustrialisation, soit 2 à 3 millions d’emplois industriels perdus (sachant que chacun d’entre eux en entraine 2 ou 3) avec leurs terribles conséquences sociales : chômage massif, désertification de territoires entiers, banlieues en déshérence, grippage de l’ascenseur social… La France est, dans toute l’Europe, le pays où la part de l’industrie dans l’emploi et dans le PIB est la plus faible, hormis la Grèce ! Il faut expliquer un décrochage industriel aussi massif sans se contenter d’explications de type culturel ou de l’exhortation actuelle à se réindustrialiser et à accueillir des investissements étrangers… Comment préparer l’avenir si l’on n’a pas compris le passé dont il procède ?
J.-B. N. : Je vous ferai une réponse de keynésien pour provoquer le débat. Puisque nous sommes 15 % plus chers que les Allemands, augmentons les tarifs douaniers comme ça les Allemands seront aussi chers que nous et nous pourrons ainsi financer notre modèle social…
F.T. : C’est la chimère du protectionnisme dans un seul pays ! Rappelons qu’au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les pays du bloc socialiste ont fonctionné de manière autarcique par rapport au reste du monde, avec l’effondrement final que l’on sait. Nombre de pays non alignés comme le Mexique, le Costa Rica, le Brésil, l’Inde ont pratiqué une politique plus ou moins rigoureuse d’import-substitution, l’industrialisation par substitution aux importations (ISI), bien analysée par des économistes comme Paul Krugman : on produit chez soi grâce à des barrières tarifaires tout ce que l’on peut, on importe le reste… Mais ce barrage contre les flux de l’échange n’est pas tenable dans le temps, du fait d’un marché intérieur trop restreint et de la propension des « bourgeoisies nationales » concernées à préférer rentes et autres subventions…
Il y a en France la nostalgie du temps lointain où, sous Louis XIV et Napoléon, nous étions le pays le plus peuplé d’Europe (hors la Russie), avec une population passée de 22 à 30 millions d’habitants. L’équilibre d’un « monde plein » entre population et ressources économiques pouvait laisser croire à la possibilité d’un pré carré colbertiste : tout fabriquer et vendre chez soi et pour soi… Ce « produisons français » a été redoublé par le souvenir des Trente glorieuses d’après-guerre, celui d’une économie de reconstruction et de rattrapage de productivité fonctionnant de façon semi-fermée et administrée par l’État. C’est le cercle vertueux fordiste : les ouvriers de Billancourt et de Sochaux achètent des voitures Renault ou Peugeot, ce qui alimente la prospérité et la prospérité de leur entreprise, et ainsi de suite… Mais l’ouverture générale du monde et la crise de 1973 mettent fin à ce paradigme en vase clos ou semi-clos. Ajoutons que la deuxième mondialisation qui débute à cette époque permettra un fantastique essor des échanges et de la richesse des nations sur la planète, selon la logique de l’avantage comparatif chère à Adam Smith et Ricardo, un démenti cinglant à toutes les théories de « la dépendance » et autre « échange inégal ». Ajoutons que si le libre-échange impacte les populations des secteurs et des territoires vulnérables (d’où le néoprotectionnisme actuel), notamment outre-Atlantique, le recours au protectionnisme est source d’appauvrissement interne et de tensions externes, c’est-à-dire de rétorsions frappant les producteurs nationaux…
La France entre dans cet échange généralisé, mais sans adapter structurellement son appareil productif en termes de compétitivité avec la fiscalité qui l’accompagne. Dans un continent européen qui affiche un excédent commercial structurel – et c’est sa force -, un seul pays souffre d’un déficit en termes d’échanges de biens, le nôtre. En bref, nous sommes déficitaires au sein d’une zone excédentaire… Cherchez l’erreur ! Beaucoup d’économistes considèrent trop le marché national comme fonctionnant de manière autonome, alors qu’il évolue en osmose et en compétition avec le reste de l’Europe et du monde. L’appel récurrent à un protectionnisme façon ligne Maginot traduit la frilosité d’une partie de nos élites et de nos compatriotes face aux vertus de l’échange, à la créativité et au dynamisme de nos entreprises. Que l’on se rappelle l’épisode assez ridicule des magnétoscopes japonais bloqués à Poitiers en 1982…
Dans un continent européen qui affiche un excédent commercial structurel – et c’est sa force -, un seul pays souffre d’un déficit en termes d’échanges de biens, le nôtre. En bref, nous sommes déficitaires au sein d’une zone excédentaire… Cherchez l’erreur !
Dans Le décrochage français, nous préconisons de nous inspirer, au-delà du seul miroir allemand, des « pays phénix » du nord de l’Europe et de l’arc rhéno-alpin, Pays-Bas, Danemark, Finlande, Suède, Suisse, Autriche, mais aussi le Canada, l’Australie et la Nouvelle-Zélande, qui ont su s’adapter à la compétition mondiale en se spécialisant, en augmentant la formation de leur main-d’œuvre, en adaptant leur modèle social. Parce qu’ils sont de taille petite ou moyenne – c’était aussi le cas des principautés du Saint Empire romain germanique avant l’unification allemande –, ils savent depuis toujours qu’il est impératif de vendre hors de ses propres frontières.
J.-B. N. : Voilà qui nous renvoie au modèle social français. La réforme des retraites, cela fait quasiment 40 ans qu’on en parle, la Sécurité sociale fonctionne mal, les coûts augmentent et la qualité diminue, les gens se plaignent, mais il est difficile de réformer malgré ses dérives notre modèle social national…
F.T. : C’est la question de l’État-providence à la française né en 1944-1945 dans l’élan généreux du CNR et ce via un consensus entre Gaullistes et Communistes pour aller vite. Cet État-providence inspiré du modèle assuranciel bismarckien et du Welfare State du rapport Beveridge de 1942, financé principalement par les entreprises s’est élargi au fil des ans, en prestations et en catégories d’assurés. C’est l’une des thèses du Décrochage français : il a subi un gonflement radical dans les années 1980-1990, en prenant en charge tous les laissés pour compter de l’échec économique et social évoqué plus haut. La logique d’assistance a pris le pas sur la logique assurancielle initiale, la demande de financement croissante a glissé des assurés vers les contribuables, le tout sous la férule grandissante d’un État providence, un terme et une notion apparus dès 1848 sous la plume de Lamartine et d’Emile de Girardin au cours de la Seconde République.
Confrontés à des problèmes analogues à la France durant ces années 1980-1990, les pays « phénix » que j’évoquai plus haut ont procédé aux adaptations nécessaires de leur État-providence, avec leurs modalités et temporalités propres. Ils ont écroulé le montant de leurs prélèvements obligatoires sur les entreprises, aujourd’hui bien plus faibles qu’en France. Ils ont fortement baissé le coût de fonctionnement de leur État central et de leurs collectivités territoriales. Ils ont supprimé la quasi-totalité de leurs niches fiscales et augmenté leurs taux moyens de TVA. Tout en renforçant légèrement l’impôt sur le revenu, à la fois plus générale que chez nous et plus progressif pour les gros revenus, donc notamment les chefs d’entreprise, ce qui explique le large consensus sur la fiscalité dans ces pays… et leurs performances moyennes supérieures aux nôtres. Pour la petite histoire, toutes ces mesures en faveur de l’offre ont pris en compte le contre-exemple français de 1981-1983 et les dérapages de plan de relance favorisant la demande. Pour le pire comme pour le meilleur, notre pays, contrairement à son égocentrisme invétéré, n’évolue pas seul au monde !
J.-B. N. : La critique de l’économie de la demande pratiquée chez nous au détriment de celle de l’offre est l’un des thèmes clés du Décrochage français. Vous montrez notamment comment celle-ci profite aux pays et entreprises étrangères.
F.T. : Fatalement, dans une économie ouverte, si l’on charge trop ses propres producteurs, si l’on ne cultive pas la compétitivité des entreprises nationales, on déploie un tapis rouge devant les compétiteurs voisins ou éloignés. Ce fut notamment le cas des deux plans de relance du premier gouvernement Chirac en 1974-76 et des gouvernements Mauroy de 1981-1983, tout comme des 35 heures du gouvernement Jospin à la fin des années 1990 qui ont renchéri mécaniquement le coût unitaire du travail. On favorise en France la consommation au détriment de la production depuis le célèbre débat ayant opposé à l’automne 1944 Pierre Mendès France, ministre de l’Économie et partisan de la rigueur au moins intransigeant René Pleven, ministre des Finances. Il avait été tranché à l’avantage de celui-ci par le général de Gaulle en faveur d’une politique de stimulation de l’économie à partir de l’accroissement d’une demande jugée (toujours structurellement) sous-développée. L’idée que le peuple est toujours trop pauvre a dominé les élites politiques françaises marquées par le courant socialisant à partir de la crise économique des années 1930. À l’État de redistribuer aux plus défavorisés. Les experts pensent que ce sera bénéfique, car les classes populaires et moyennes achèteront Français. Or tout change quand l’économie de la France s’insère dans le marché européen et mondial, ce dont ne prennent pas assez conscience nos élites. Classe ouvrière et classes populaires en subiront les conséquences quand s’enclenchera la spirale infernale de la désindustrialisation et des bas salaires. Ce sont elles qui payent les pots cassés de politiques économiques erronées.
Un virage a lieu à partir de 2014 avec le CICE (Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi). Ce dernier signifie l’entrée bienvenue dans une économie de l’offre favorisant l’amélioration des conditions de production. Le CICE est issu du rapport de Louis Gallois en 2013 (précédé par celui de l’Institut de l’entreprise sur le même thème) quant à l’indispensable « choc de compétitivité » à opérer en faveur des producteurs nationaux. D’où au cours des années suivantes le recul du chômage de masse, en particulier chez les jeunes arrivant sur le marché de l’emploi, cette plaie qui rongeait l’économie et la société françaises depuis des décennies. Il est triste de constater le temps qu’il a fallu à la notion-clé de « compétitivité » pour passer dans les faits. On aurait pu pousser beaucoup plus loin le montant du CICE et les crédits d’impôt qui l’ont prolongé plus loin. Et désolant du fait qu’aucun débat public n’ai suivi les conséquences structurelles bénéfiques du CICE, sur le mode : « Peut-on faire mieux ? » « Faut-il aller au-delà ? À quelle échelle ? ». Car la France souffre toujours d’un chômage excessif par rapport à ses voisins et la balance de notre commerce extérieur est toujours dans l’état calamiteux que l’on sait. Notre pays aime les idées, mais faire bouger les lignes en procédant aux ajustements nécessaires prend hélas un temps infini.
La majorité des Français ont profité de la globalisation et ont vu leur pouvoir d’achat augmenter grâce à des produits compétitifs fabriqués partout sur le globe et arrivant très vite sur le marché, sauf… les classes populaires frappées par la désindustrialisation que va sans cesse compenser l’État-providence à coup de mesures d’assistance. L’économiste et entrepreneur du début du XIXe siècle Jean-Baptiste Say disait que la production produit et la consommation détruit. Nous avons changé d’époque, mais il faut toujours produire avant de consommer. Ce qui signifie disposer d’un secteur productif fort. Tout décideur politique devrait sans cesse se poser la question essentielle : est-ce que les entreprises de mon pays sont en situation de compétitivité par rapport aux entreprises du reste du monde ? Adoptons-nous, que ce soit au niveau de la France et de l’Europe les mesures adéquates pour que la marge opérationnelle de nos entreprises soient suffisantes ?
La majorité des Français ont profité de la globalisation et ont vu leur pouvoir d’achat augmenter grâce à des produits compétitifs fabriqués partout sur le globe et arrivant très vite sur le marché, sauf… les classes populaires frappées par la désindustrialisation que va sans cesse compenser l’État-providence à coup de mesures d’assistance.
Une politique de l’offre signifie la réduction de la fiscalité, c’est-à-dire du poids de l’État via le taux de prélèvements obligatoires sur l’économie et les entreprises nationales. Est-ce que le tissu industriel et économique, de la plus petite PME au plus grand groupe se trouve en situation de compétitivité ? Dispose-t-il des marges nécessaires pour compéter avec ses voisins proches et lointains, est-il capable d’emprunter, investir, se développer, améliorer sa formation de manière suffisante ? Un allègement de la fiscalité des entreprises suppose à terme une baisse des dépenses publiques, mais aussi un transfert vers la fiscalité sur la consommation, relativement faible en France, la production étant au contraire surtaxée au profit des produits importés. L’allègement des charges n’est pas synonyme de « cadeau » aux entreprises comme on le dit trop souvent. En ce sens, face aux plus de 100 milliards d’euros d’aides (termes recouvrant des réalités très diverses), il conviendrait de les supprimer graduellement en baissant d’autant les charges pesant sur les entreprises. Ce n’est pas aux fonctionnaires de l’État d’attribuer celles-ci selon des critères divers, c’est aux entreprises de faire le meilleur usage compétitif micro-économique de cette marge retrouvée. La politique de l’offre est la seule qui crée des emplois viables et pérennes. Les bénéfices d’aujourd’hui sont les emplois de demain. Toutes les mesures de réindustrialisation actuelles et futures n’aboutiront que si elles répondent au critère d’une fiscalité compétitive.
J.-B. N. : Mais peut-on réformer en France l’État ? Il y a beaucoup de récriminations contre les services publics, la SNCF, les urgences hospitalières, l’Éducation nationale, mais personne ne souhaite renoncer au rôle omnipotent de la puissance publique…
F.T. Il y a en France une injonction sans fin du « toujours plus » de moyens plutôt que du « toujours mieux ». Ne parlons même pas du « un peu moins, mais mieux » ! En échange d’un consentement à l’impôt et à l’omniprésence de la puissance publique, les citoyens adressent à celle-ci de demandes de créances infinies fatalement mal satisfaites. L’individualisme de la société actuelle se conjugue avec un dialogue, sinon un face-à-face exclusif avec l’autorité publique, incarnée par un seul homme, le président de la République… Une voie pour y remédier serait peut-être celle ébauchée par Yves Cannac, haut-fonctionnaire et chef d’entreprise, cité dans Le décrochage français. Dans son best-seller publié en 1981 Le Juste Pouvoir, il développait une réflexion originale sur les deux chemins de la démocratie, sous-titre de l’ouvrage. En s’attachant à la dérive contemporaine de ce que certains nomment le « tout à l’État », à savoir la tentation d’un Pouvoir qualifié d’« hégémonique », véritable Léviathan moderne ; malgré ou à cause de ses intentions bienveillantes. Il invitait à se méfier de la capacité du « Pouvoir à dépenser notre argent pour nous, à notre place », alors qu’il faudrait au contraire cultiver « la démocratie civile », distincte du libéralisme anglo-saxon : « Il ne s’agit pas de réduire l’État à quasiment rien, mais à sa juste mesure… entre la Société et son Pouvoir, l’une rendue à ses œuvres, l’autre ramené à sa mesure, établir un nouveau dialogue, une nouvelle raison, une nouvelle alliance ».
L’épidémie du Covid-19 avait révélé que la proportion des emplois administratifs dans les hôpitaux français étant nettement plus élevée que dans leurs équivalents allemands, au détriment d’emplois opérationnels, médecins, infirmières… Un hôpital n’est ni une administration, ni une entreprise : aux côtés du soin et du volet de la gestion, il doit se donner des axes de développement et de progression. Dans la crise que connaît le monde hospitalier, il faudrait diversifier le recrutement de ses dirigeants, aujourd’hui dévolu aux élèves d’une école spécifique d’administrateurs à Rennes – qui fatalement, reproduiront une logique administrative –, placer les médecins à la direction des établissements en les formant à la direction de projet et à la gestion…
Dans le domaine des entreprises, on ne peut pas dire que la gestion par l’État et ses administrateurs délégués donne absolument des résultats probants dans la durée. Que l’on se rappelle la dérive du champion nucléaire Areva entre 2000 et 2015 et la perte de 15 milliards d’euros qu’il a laissée avant son démantèlement. Il était le fruit d’une renationalisation déguisée, celle du talentueux constructeur des îlots nucléaires Framatome, qui relevait auparavant des groupes privés Schneider, puis Alcatel Alsthom. Entreprise largement autonome durant les années 1950-70, EDF avait équipé électriquement la France avant de réussir en moins d’une décennie le grand programme nucléaire que lui avaient confié en 1974 Georges Pompidou et Pierre Messmer. La perte d’indépendance progressive d’EDF associée aux injonctions contradictoires de l’État en matière de tarifs de l’électricité et de nouveaux équipements nucléaires ont affaibli sa position. On peut aussi s’interroger sur le service public façon SNCF. Il fonctionne en situation de quasi-monopole, sa politique de tout-TGV et délaissement des lignes secondaires (et de banlieue), ses pertes récurrentes compensées par l’État, son modèle social conflictuel… Le transport aérien a été dérèglementé à partir des années 1990 et il ne se débrouille pas trop mal, entre compagnies (et aéroports) concurrents et acteurs low-cost.… Un peu de concurrence, bien plus de concurrence, assouplirait sûrement les relations entre les services publics et les usagers, c’est-à-dire les citoyens.
Dans le domaine des entreprises, on ne peut pas dire que la gestion par l’État et ses administrateurs délégués donne absolument des résultats probants dans la durée. Que l’on se rappelle la dérive du champion nucléaire Areva entre 2000 et 2015 et la perte de 15 milliards d’euros qu’il a laissée avant son démantèlement. Il était le fruit d’une renationalisation déguisée, celle du talentueux constructeur des îlots nucléaires Framatome, qui relevait auparavant des groupes privés Schneider, puis Alcatel Alsthom.
J.-B. N. : L’historien que vous êtes est-il optimiste ou pessimiste pour les années à venir ?
F.T : Quand le temps du recul sera venu, Michel Hau et moi consacrerons peut-être un livre aux dix années de présidence d’Emmanuel Macron qui ont suivi ces quarante années désespérantes qui vont du Virage manqué (1973-1983) au Décrochage français (1984-2017). Le titulaire actuel de l’Élysée a poursuivi la politique de l’offre initiée sous François Hollande dont il était l’un des artisans, mais sans s’atteler à la refonte nécessaire de l’État-providence à la française, noyant nos problèmes structurels sous l’explosion de la dette…
Je terminerai par une note d’ordre géopolitique. Nous avons changé de monde à partir de 2015, en entrant dans une nouvelle globalisation qui n’est plus plane et apaisée, mais rugueuse, agressive, conflictuelle… Transition écologique et énergétique, guerre en Ukraine et confrontation des blocs, renforcement de nos moyens de défense au sein d’une défense européenne, les défis sont immenses… Ce qui signifie des moyens pour préparer une économie de guerre, disposer par exemple de deux PANg (porte-avions nucléaires de nouvelle génération) au lieu d’un seul avec sa période de carénage, d’une douzaine de SNA (sous-marins nucléaires d’attaque) et plus partout sous les océans… La France et l’Europe ont plus que jamais besoin d’une économie française forte !
A lire aussi:
La propagande des idées : pourquoi le Taylorisme s’est imposé en France ?