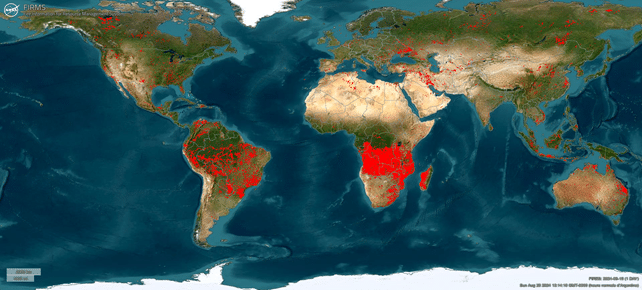Sitôt président, Lula a choisi de reprendre ses habits de dirigeant populiste. Il renoue ainsi avec une partie de l’histoire du Brésil, mais il se coupe aussi d’une partie de ses soutiens.
Article paru sur IstoéBrésil.
Le troisième mandat de Lula a commencé il y a moins de deux mois. Pourtant, avant même l’investiture (le 1er janvier) de nombreuses personnalités de la gauche modérée et du centre qui avaient soutenu le candidat ont commencé à prendre leurs distances. Lula semble avoir choisi ce que l’on peut désigner sous l’expression de populisme économique comme axe de la politique que conduira son gouvernement. Il préconise et annonce des mesures qu’il s’était bien gardé de mettre en œuvre lors de son premier mandat (2003-2006) [1]. En 2022, Lula a réussi à mener campagne pendant plusieurs mois sans présenter la moindre esquisse d’un programme économique. Il n’est donc pas contraint par des engagements précis. Depuis janvier dernier, il contredit à longueur de discours et de réunions les économistes libéraux ou modérés qui lui avaient accordé leur soutien à la veille de l’élection.
Lula ne parvient pas à dépasser le vieux discours manichéen de la gauche.
Lula revient sans hésiter à de vieilles recettes prisées par la gauche. Pour sortir le Brésil d’un rythme de croissance médiocre, réduire les inégalités et lutter contre la pauvreté, le chef de l’Etat préconise des solutions simplistes et miraculeuses, manifeste une claire aversion pour la responsabilité budgétaire et la bonne gestion des comptes publics. Il veut renouer avec les pratiques de Dilma Rousseff, présidente à partir de 2011 et destituée en 2016. Cette dernière imaginait relancer l’économie en augmentant sans fin les dépenses publiques, en renforçant les entreprises nationalisées devenues fer de lance d’une stratégie de réindustrialisation, en forçant la Banque Centrale à adopter une politique monétaire discrétionnaire pour favoriser la baisse des taux d’intérêt. Cette politique a débouché sur une crise financière et une récession historique à partir de 2015. Le chômage et l’économie informelle se sont développés. Aucune solution structurelle au problème de la pauvreté n’avait été apportée.
Un populisme de gauche assumé.
Pendant la campagne du second tour qui a précédé la victoire du 30 octobre dernier, dans ses discours, le candidat du Parti des Travailleurs s’est révélé plus populiste que jamais. Face au candidat Bolsonaro, sa position de candidat du second tour était plus confortable qu’en 2002. Pour parvenir à rallier des électeurs des classes moyennes et des milieux économiques, il avait alors dû rompre clairement avec le discours radical de la gauche révolutionnaire. Vingt ans plus tard, il représente l’alternative à une gestion calamiteuse. Il affronte un rival qui a manifesté pendant quatre ans un rejet profond de la démocratie. Lula s’affiche donc comme un recours. Le candidat prétend rassembler cette large majorité d’électeurs qui croient en la démocratie et veulent la défendre face aux menaces de rupture institutionnelle de l’extrême-droite. Le discours et la stratégie de campagne respectent pourtant un subtil équilibre entre la nécessité d’apparaître comme l’homme du renouveau démocratique et le ressentiment qui anime le leader et sa formation politique [2]. Pendant toutes les semaines qui précèdent le 30 octobre, jamais Lula ne s’explique sur le désastre que fut le gouvernement Dilma Rousseff, jamais il ne reconnaît les crimes dont ses proches et lui-même ont été accusés par la Justice. Il se contente d’insister sur la forte croissance et l’amélioration des revenus qui ont caractérisé les années 2003-2010, lorsqu’il dirigeait le pays et… lorsque les cours des matières premières étaient au zénith. A la veille du second tour, il est parvenu à rallier autour de sa candidature de nombreux leaders de formations politiques tous préoccupés par l’éventuelle réélection de Bolsonaro. Pourtant, avant même le second tour, la stratégie de communication du candidat reste celle du leader du Parti des Travailleurs qui ne parvient pas à dépasser ni le vieux discours manichéen de la gauche, ni la culture économique de son camp, ni les rancœurs suscitées par une expérience carcérale encore récente.
À lire également
Le Brésil : l’autre géant américain
Lula revient à la statolâtrie quasi-mystique de la gauche brésilienne.
Pendant cette campagne, le leader de gauche a ainsi annoncé à plusieurs reprises que s’il est élu, il légifèrerait sur la presse, imposerait un code de conduite aux journalistes et aux médias. Il a accusé à mi-mots les grands moyens d’information d’avoir trop parlé de ses démêlés avec la Justice, de sa condamnation et de son incarcération. Les attaques proférées concernaient aussi les Juges. Les grands médias nationaux et l’institution judiciaire qui a fini par le mettre en prison étaient finalement les représentants de cette « élite » que le candidat désignait comme « adversaires du peuple », un peuple dont il dit depuis des lustres être le représentant authentique. Déjà le candidat remettait en cause la responsabilité budgétaire et demandait lors de ses meetings, « pourquoi les gens devaient souffrir pour garantir la prétendue discipline budgétaire dans ce pays ? » Et de répéter que des gouvernements successifs ont dû abandonner la politique sociale pour respecter les normes d’ancrage budgétaire sans toucher aux intérêts du système financier.
Ce discours est revenu depuis la victoire et l’investiture à de très nombreuses reprises. Le Président ne se soucie guère de l’inflation qui reste élevée. Il semble même la considérer comme un mal supportable. Il affirme que l’objectif officiel de hausse des prix que les autorités monétaires doivent faire respecter devrait être relevé, que la politique anti-inflationniste de la Banque Centrale est une honte parce qu’elle conduit à des taux d’intérêt très élevés, que l’autonomie récente dont jouit l’institution (depuis 2021) est une bêtise. Il insiste encore sans cesse sur l’incompatibilité qui existerait entre une politique budgétaire sérieuse et la responsabilité sociale. La critique du monde de la finance et des rentiers qui chercheraient à pousser les taux d’intérêt à la hausse devient un refrain quasi-permanent. Interviews et discours officiels sont autant d’occasion d’accuser les riches et les capitalistes qui seraient les grands responsables de la crise économique et des drames sociaux qui affectent le pays. Ces riches seraient même à l’origine du vote pro-Bolsonaro lors de l’élection récente et des mouvements insurrectionnels qui ont suivi la victoire de Lula (en réalité, le vote Bolsonaro est plutôt un vote de classes moyennes).
Le Président ne se contente de préconiser la rupture avec toute discipline budgétaire et monétaire. Il revient à la statolâtrie quasi mystique de la gauche brésilienne. Il veut redonner à l’Etat un rôle central dans la réindustrialisation du pays. Celle-ci relève de l’initiative de grandes entreprises publiques qui auront, à nouveau, la responsabilité de développer les filières manufacturières nationales. Les privatisations ne sont plus à l’ordre du jour. Bien au contraire. Plusieurs projets en cours seront abandonnés. On peut même imaginer des nationalisations. Ce mouvement ne touchera certes pas toutes les entreprises privées brésiliennes qui dépendront des financements à taux d’intérêts bonifiés fournis par la Banque Nationale de Développement restaurée dans sa mission centrale de promoteur d’investissements à des conditions échappant aux lois du marché.
Depuis le 1er janvier dernier, dans toutes ses interventions concernant la politique économique, Lula annonce un retour à l’époque de Dilma Rousseff. Il ne cesse d’utiliser la vision manichéenne opposant les riches et les pauvres, la misère des seconds étant évidemment la conséquence de la prospérité des premiers. Tous les discours du chef de l’Etat sont autant d’illustrations de ce populisme de gauche si présent dans l’histoire latino-américaine.
À lire également
Bilan de quatre années de présidence Bolsonaro au Brésil
La terre du populisme
Depuis l’existence d’Etats indépendants sur la région, l’Amérique du Sud a fait à maintes reprises l’expérience de régimes politiques populistes [3]. La plupart de ces expériences gouvernementales ont été conduites et incarnées par des leaders charismatiques et messianiques, annonçant une rupture profonde de l’ordre social (et se proclamant souvent de gauche). Pour les leaders et mouvements populistes, la notion d’élite désigne d’abord des agents économiques et le changement à promouvoir est d’abord d’ordre économique. Le discours du chef qui a créé un lien personnel avec les masses est un discours de défense de la nation. Il s’agit de préserver ou de restaurer une souveraineté populaire menacée par une élite locale alliée à des forces étrangères. Cette rhétorique anti-impérialiste interprète les difficultés sociales qui accablent le peuple et les contraintes économiques qui pèsent sur la nation comme des conséquences de l’action maléfiques d’acteurs extérieurs. Le leader populiste prétend être le sauveur de la patrie menacée, celui qui sait écouter les revendications et attentes longtemps étouffées des masses. La construction de ce peuple imaginaire permettait de gommer toutes les contradictions entre les multiples groupes d’intérêts existants au sein de la société.
Dans le discours populiste des décennies récentes, l’élite et ses alliés étrangers sont les acteurs du monde de la finance, des multinationales ou d’entreprises plus modestes : tous ces opérateurs forment une « oligarchie » qui pille les ressources du pays aux dépens du peuple. Les populistes cherchent donc à mobiliser ledit peuple contre les institutions financières (banques, fonds d’investissement, fonds de pension, bourses, etc..), les firmes internationalisées et les institutions multilatérales comme le Fonds Monétaire International (FMI) ou la Banque mondiale. L’horreur, c’est la mondialisation. Pour s’opposer à celle-ci et aux forces du marché, il faut renforcer l’intervention de l’Etat, revenir au nationalisme économique et mettre en œuvre un protectionnisme commercial.
L’expérience sud-américaine permet de caractériser les politiques économiques conduites par les leaders et partis populistes après qu’ils aient accédé à la tête de l’Etat. En général, les dirigeants affichent un objectif de croissance forte et inclusive et recourent pour cela à l’expansion de la dépense publique. Ils ignorent ou négligent les contraintes économiques et les objectifs de stabilisation. L’urgence de la lutte contre la pauvreté, le lancement de programmes de redistribution (basés souvent sur des mesures d’assistance) sont toujours des priorités. Aux frustrations sociales et économiques, les expériences de gouvernements populistes apportent des réponses qui renforcent le poids du secteur public et de l’Etat. La défense des « intérêts du peuple » implique qu’aucun obstacle ne se dresse sur le chemin des pouvoirs en place, que ces obstacles tiennent aux contraintes d’équilibre économique, aux impératifs de confiance des investisseurs et épargnants, qu’ils soient érigés par des agences réglementaires autonomes, des banques centrales indépendantes, ou qu’ils résultent d’accords internationaux.
Les populismes sud-américains font fuir les investisseurs étrangers et nationaux.
Pour doper la croissance et favoriser une redistribution, les mesures privilégiées sont la progression des salaires réels, l’accroissement des transferts sociaux aux populations les plus pauvres et le développement des investissements publics. A ces dispositions vient souvent s’ajouter la mise en œuvre d’une politique monétaire discrétionnaire. Lorsque les décideurs politiques le peuvent (si la Banque centrale n’est pas autonome ou indépendante), ils font fonctionner à volonté la planche à billets pour dynamiser la production et l’emploi à court terme, même si cela contribue à l’inflation. Il n’est pas rare qu’une réforme de la fiscalité (touchant principalement les entreprises de tous types, les ménages les plus aisés ou même les classes moyennes), soit engagée pour accroître les recettes de l’Etat et limiter l’ampleur du déficit budgétaire.
Très souvent, à ces volets conjoncturels s’ajoutent des mesures structurelles. La restructuration du secteur productif et des institutions financières s’appuie sur un programme de nationalisations d’opérateurs dits stratégiques, notamment ceux contrôlés par des acteurs étrangers. Lorsque ces opérateurs ne sont pas nationalisés, il est fréquent qu’ils subissent de nouvelles contraintes en matière de fiscalité, d’acquisitions d’équipements ou d’intrants (politiques de contenu national) ou de rapatriement de profits. Les promesses formulées hier pour attirer ces investisseurs sont oubliées, remplacées par des politiques qui les ponctionnent au service du budget national ou des entreprises du pays. Souvent, la protection du marché national est renforcée afin de réduire les échanges extérieurs et défendre le projet de croissance forte, de privilégier les fournisseurs locaux et de pro-téger l’économie nationale dont la compétitivité s’affaiblit (en raison notamment de la hausse des salaires réels). Faut-il le préciser ? L’environnement économique et juridique ainsi créé fait en général fuir les investisseurs étrangers…et freine les ambitions des entrepreneurs nationaux. Dans les pays très endettés, les gouvernements populistes ont souvent cherché à élargir leurs marges de manœuvre budgétaires en répudiant la dette souveraine. Ainsi, les charges de la dette qui alourdissaient les dépenses disparaissaient. Le déficit courant était réduit. Les créanciers nationaux et étrangers apprenaient brutalement qu’ils ne seraient pas remboursés. Ayant fait défaut, ces Etats ont été contraints d’équilibrer leurs budgets en recourant à un financement monétaire (planche à billet), ce qui a nourri l’inflation.
Ces orientations sont ceux de la plupart des régimes populistes que l’Amérique du Sud post-coloniale a connu. Les exemples historiques abondent, du Brésil de Getúlio Vargas (entre 1930 et 1945, puis entre 1951 et 1954) en passant par le Chili d’Alessandri, d’Ibanez (années 20 et 30) ou celui d’Allende (1970-1973) ou les innombrables expériences de la Bolivie, de l’Equateur ou du Pérou. Il y a aussi la longue trajectoire du péronisme en Argentine [4]. Les résultats sur le plan économique ne sont pas vraiment convaincants [5] mais le péronisme aura permis à ses leaders de bénéficier d’une longévité au pouvoir particulièrement remarquable.
À lire également
L’armée brésilienne dans la lutte contre la criminalité
L’empreinte de Getúlio Vargas.
En septembre dernier, onze candidats étaient en lice pour le premier tour de l’élection présidentielle brésilienne. Dans tous les sondages, Lula et Bolsonaro apparaissaient comme favoris. Ils étaient suivis de loin par Simone Tebet, la sénatrice de l’Etat du Mato Grosso do Sul. Leader du MDB, la parlementaire était alors la seule représentante crédible d’un centre qui n’était pas parvenu à s’unir. Dans cette compétition électorale très polarisée, elle voulait incarner une troisième voie entre le risque que représentait une réélection de Bolsonaro pour la démocratie et celui qui existait avec la victoire du populiste Lula. La sénatrice attaquait donc ses deux rivaux. Lors d’un débat à São Paulo, Simone Tebet s’en prit au candidat de la gauche. A ses yeux, si ce dernier l’emportait, il monterait et dirigerait un gouvernement populiste et chercherait avant tout à garantir la perpétuation du PT au pouvoir. Madame Tebet avait alors lâché des propos que de nombreux analystes considèrent aujourd’hui comme prémonitoires : « Lula va vouloir entrer dans l’histoire, il ne changera pas, il restera l’homme qu’il a été dans le passé. Il cherchera à être populiste pour devenir une sorte de Perón, ce que la dynastie Perón fut dans le passé. Il va multiplier les projets populistes pour assurer la perpétuation du Parti des Travailleurs au pouvoir sur les huit prochaines années ».
Depuis son élection, au niveau des discours comme des initiatives politiques concrètes (composition du gouvernement, alliances au Congrès, etc..), Lula semble effectivement tout faire pour ne pas démentir la sénatrice. Il a choisi une stratégie clairement populiste. Contrairement à la prophétie de Madame Tebet, ce n’est pas la référence Perón qui semble l’inspirer. Il sait bien que le long affaiblissement de l’économie argentine n’exerce guère de fascination sur la majorité des Brésiliens. Sa référence est bien plutôt celle de Getúlio Vargas, le leader autoritaire qui a dirigé et profondément transformé le Brésil au cours d’une longue période de quinze ans de pouvoir (1930-45) puis pendant les quatre ans d’un troisième mandat (1951-1954).
Porté à la tête du pays en 1930 par un soulèvement militaire puis un coup d’Etat (déposition du Président élu Washington Luis), Vargas fut le premier dirigeant du pays à construire et à imposer avec force la notion de « peuple brésilien ». Il a très tôt réussi à convaincre tous les habitants d’un pays-continent extrêmement hétérogène et inégalitaire qu’ils appartenaient tous à une seule famille. Quelle que soit leur région d’origine, qu’ils fussent travailleurs des villes, bourgeois capitaines d’industrie, femmes, noirs, immigrants européens, paysans du sertão nordestin, pêcheurs du littoral, grands éleveurs des plateaux centraux ou commerçants informels des favelas : tous étaient des composantes du peuple brésilien. A partir de 1930 et après l’instauration d’un nouveau régime politique, le discours officiel ne cesse de se référer au mythe d’une race brésilienne. Il cultive la fable d’une démocratie raciale. Sur le terrain économique, le régime populiste se réclame d’un nationalisme radical. A toutes les composantes du « peuple brésilien » rassemblées dans le culte d’une identité célébré par son régime, le leader oppose les forces étrangères, la finance internationale, les firmes occidentales. Il veut industrialiser ce pays encore agraire en le soustrayant à l’influence de ces agents maléfiques. Pour ce faire, il convient de conférer à l’Etat un rôle central d’investisseur, de planificateur, de pilote de la croissance. Vargas lance une industrie lourde, multiplie les nationalisations, prend le contrôle du secteur bancaire, exerce une tutelle bureaucratique sur de nombreuses activités du secteur privé, favorise la concentration des entreprises et mène une politique de grands travaux [6].
Le régime de Vargas : la référence incontournable de la gauche.
Ce régime est aussi le promoteur d’un ordre social nouveau. Il crée et accroît les droits des travailleurs du monde urbain. Une législation assurant au salarié un protection sociale est adoptée et mise en œuvre. Le cadre juridique du contrat de travail est défini. En parallèle, le pouvoir encourage l’essor d’un syndicalisme de corporations contrôlé par l’Etat et chargé de discipliner les travailleurs. Tout mouvement revendicatif spontané et non encadré par les organisations corporatives officielles est sévèrement réprimé. Cette politique satisfait une bourgeoisie industrielle qui est encouragée à développer ses activités. Le régime Vargas favorise l’intégration sociale de nouveaux groupes urbains jusqu’alors laissés pour compte. Il permet aussi l’émergence d’un patronat national. Pour autant, il ne cherche pas à rompre avec une société marquée par le racisme, les fortes inégalités entre classes sociales, le clientélisme politique, le poids des élites agraires. Les contradictions existantes entre les multiples composantes de la société sont dissoutes par le verbe et la mystique du « peuple brésilien » dont G. Vargas est le leader éclairé. Le système fonctionne jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il permet même au Brésil de connaître une forte croissance dans un monde où, après la grande crise de 1929-30, tous les pays pratiquent le protectionnisme. Pour la majorité des Brésiliens nationalistes et partisans du progrès social, la longue dictature de l’Estado Novo que Vargas finit par instaurer restera dans les mémoires comme une période faste.
En ce début de troisième mandat, l’expérience Vargas est encore une référence incontournable pour la gauche que Lula a ramené au pouvoir. Le président rêve sans doute de laisser dans l’histoire une marque aussi profonde que celle de son illustre prédécesseur. Il retient probablement que la politique populiste de l’Estado Novo a permis au régime de de durer. Il sait pourtant que son retour aujourd’hui évoque davantage le dernier mandat de Vargas que les temps fastes d’avant la Seconde Guerre mondiale. Comme celui d’aujourd’hui, le Brésil du début des années cinquante vivait des transformations considérables. Ce n’était plus le pays que Getúlio Vargas avait pris en main en 1930. Ce pays nouveau était précisément celui que le régime autoritaire de l’Estado Novo avait fait surgir : une puissance industrielle émergente, une société possédant une identité nationale mieux définie et de plus en plus urbanisée. En 1951, l’ancien dictateur ne bénéficie plus de l’adulation illimitée des milieux économiques, des classes moyennes, des formateurs d’opinion et des grands médias. Depuis 1945, ces secteurs de la société brésilienne sont de plus en plus influencés par les idées libérales, aspirent à un régime démocratique plus ferme, veulent une économie plus ouverte.
Vargas jouit encore d’un crédit considérable auprès des travailleurs salariés des villes, une masse de plus en plus importante. Cette base d’appui sera à l’origine d’un profond mouvement exigeant dès la fin des années quarante le retour du vieux leader populiste à la tête du pays. Lors de la campagne présidentielle de 1951, Vargas aurait peut-être pu se contenter d’apparaître comme un leader consensuel s’appuyant sur ses réalisations passées pour renforcer son crédit politique. Il aurait pu annoncer qu’il acceptait désormais les règles du jeu de la démocratie et affaiblir ainsi ses opposants. Vargas perçoit que le pays a changé. Il sent surtout que le culte qui lui était voué autrefois n’existe plus au sein d’une nation divisée. Persuadé qu’il ne pourra pas rallier des adversaires de plus en plus offensifs, le candidat décide de renforcer le clivage existant entre « gétulistes » et « anti-getulistes ». Il ne cesse de railler ses adversaires qu’il qualifie « d’adversaires du peuple ». Dès la campagne qui conduira à sa victoire, il évoque les « puissants », le terme désignant tous ceux qui l’ont écarté du pouvoir en 1945 et ne souhaitent pas qu’il revienne à la tête du pays. Il s’affirme constamment comme le candidat du « peuple ».
Dès que le vieux leader est investi pour la troisième fois à la Présidence, les milieux économiques, la bourgeoisie urbaine et les classes moyennes montantes manifestent leur crainte de la restauration d’une république autoritaire appuyée sur les syndicats de salariés. Cette inquiétude est utilisée par Vargas qui ne cesse de se proclamer leader du monde du travail. Au cours des multiples initiatives de communication qu’il engage (programmes de radio, meetings, cérémonies officielles, etc…), le Président s’adresse au « peuple brésilien », c’est-à-dire au monde du salariat dont les effectifs progressent. Les discours du chef de l’Etat commencent par une expression significative : « Travailleurs du Brésil ». Le régime de ce Président élu devient au fil des années impopulaire parce qu’autoritaire, policier. Il fonctionne dans une société où la presse commence à devenir un média de masse et à exercer une fonction critique. Le conflit entre le pouvoir et de larges secteurs de la population s’amplifie. La fin tragique de Getúlio Vargas sera exploitée par ses partisans [7]. La dimension dramatique de l’évènement permet de ne pas évoquer la dérive anti-démocratique de plus en plus marquée du régime.
L’héritage et l’influence politique du gétulisme est considérable. Il y a l’ébauche d’un système de protection sociale et une législation du travail. Le système de corporations syndicales placées sous la tutelle de l’Etat, un capitalisme dépendant du bon vouloir du politique, le clientélisme et l’orientation des politiques publiques par des intérêts privés organisés : tous ces traits sont loin d’avoir disparu. La gauche du XXIe siècle semble même considérer qu’un gétulisme actualisé soit la seule voie possible pour Lula revenu au pouvoir. Pourquoi le Président élu en octobre dernier reste-t-il accroché à ces vieilles références ? Pourquoi mise-t-il sur un populisme économique et social inspiré par le getulisme. Le second post de cette série tentera de fournir des réponses à ces questions.
[1] A l’époque, Antônio Palocci, le Ministre de l’Economie se vantait de suivre avec la plus grande rigueur la politique économique qu’avait engagé F.H. Cardoso, le prédécesseur de Lula.
[2] Lula a choisi comme candidat à la vice-présidence un homme de centre-gauche, Geraldo Alckmin, une personnalité qui a fait toute sa carrière politique dans les rangs du Parti Social-Démocrate brésilien (PSDB). Alckmin est un modéré. Il a été plusieurs fois gouverneur de l’Etat de São Paulo et candidat rival de Dilma Rousseff à l’élection présidentielle de 2010. En formant ce ticket, Lula cherchait sans doute à attirer des voix du centre. Il voulait surtout faire croire que sa victoire ne serait pas exclusivement celle de la gauche, celle du PT mais celle d’un vaste camp prodémocratie. Cela ne l’a pas empêché durant toute sa campagne de renforcer un discours populiste et messianique.
[3] Le populisme est une approche et un traitement des réalités socio-politiques à partir d’un supposé conflit entre un « peuple » et une « élite ». La société est divisée en deux groupes artificiels « le peuple » et « les élites ». Les populistes placent la prétendue lutte du peuple contre les élites au centre de leur vision du monde, de leur action politique et de leur style de gouvernement. Ils dépeignent généralement « le peuple » comme un bloc homogène, une majorité souffrante, intrinsèquement bonne, vertueuse, authentique, homogène, ordinaire et commune, dont la volonté collective est incarnée par un leader messianique. Il revient à ce leader de lutter contre l’élite insensible et cupide, bloc homogène mais elle est dissemblable en tous points du peuple qu’elle manipule et opprime.
[4] Le modèle populiste argentin a commencé à être implanté par le général Perón à partir de 1946. Il a été repris, maintenu ou renforcé dans les années 1970 sous le gouvernement Martinez, puis sous l’Administration Menem (entre 1989 et 1999). Au début du XXIe siècle, le péronisme renaît sous la férule de la famille Kirchner (entre 2003 et 2015). Il inspire officiellement le gouvernement argentin depuis l’élection en 2019 du Président Fernandez. L’Argentine est sans doute le pays de la région (ou du monde ?) qui a connu la plus longue expérience du populisme.
[5] Selon les données du Maddison Project Database, lorsque Perón est arrivé au pouvoir, l’Argentine était le neuvième pays du monde en termes de revenu par habitant. Le pays se classait alors devant la France, la Belgique, la Norvège ou les Pays-Bas. En 2018, toujours en considérant le revenu moyen par habitant, l’Argentine occupait la 64e place du classement mondial. Entre 1950 et 2018, le revenu moyen a progressé de 133% en Argentine, contre 354% en moyenne au niveau mondial.
[6] La référence du régime, c’est la politique engagée en Italie depuis 1931 par le régime fasciste italien. Comme Mussolini, Vargas défend une politique commerciale de quasi-autarcie. Il faut donner la préférence aux entreprises nationales. Comme son mentor européen, il défend le principe d’une subordination de l’économique au politique. Le gouvernement Vargas investit des ressources qu’il ne possède pas. Il finance cet effort par l’augmentation de la pression fiscale, par l’endettement et l’inflation. Le régime économique du Brésil au début des années quarante est un capitalisme altéré dans lequel une large part de l’activité est de près ou de loin entre les mains de l’Etat.
[7] En 1954, sur le point d’être destitué, Getúlio Vargas se suicide. Dans la lettre-testament qu’il laisse, les « puissants » sont dénoncés comme responsables d’une mort qu’ils auraient provoqué par haine du « peuple des travailleurs ». Le « getulisme » reste encore une référence incontournable pour tous les nationalistes brésiliens et pour la gauche du pays.