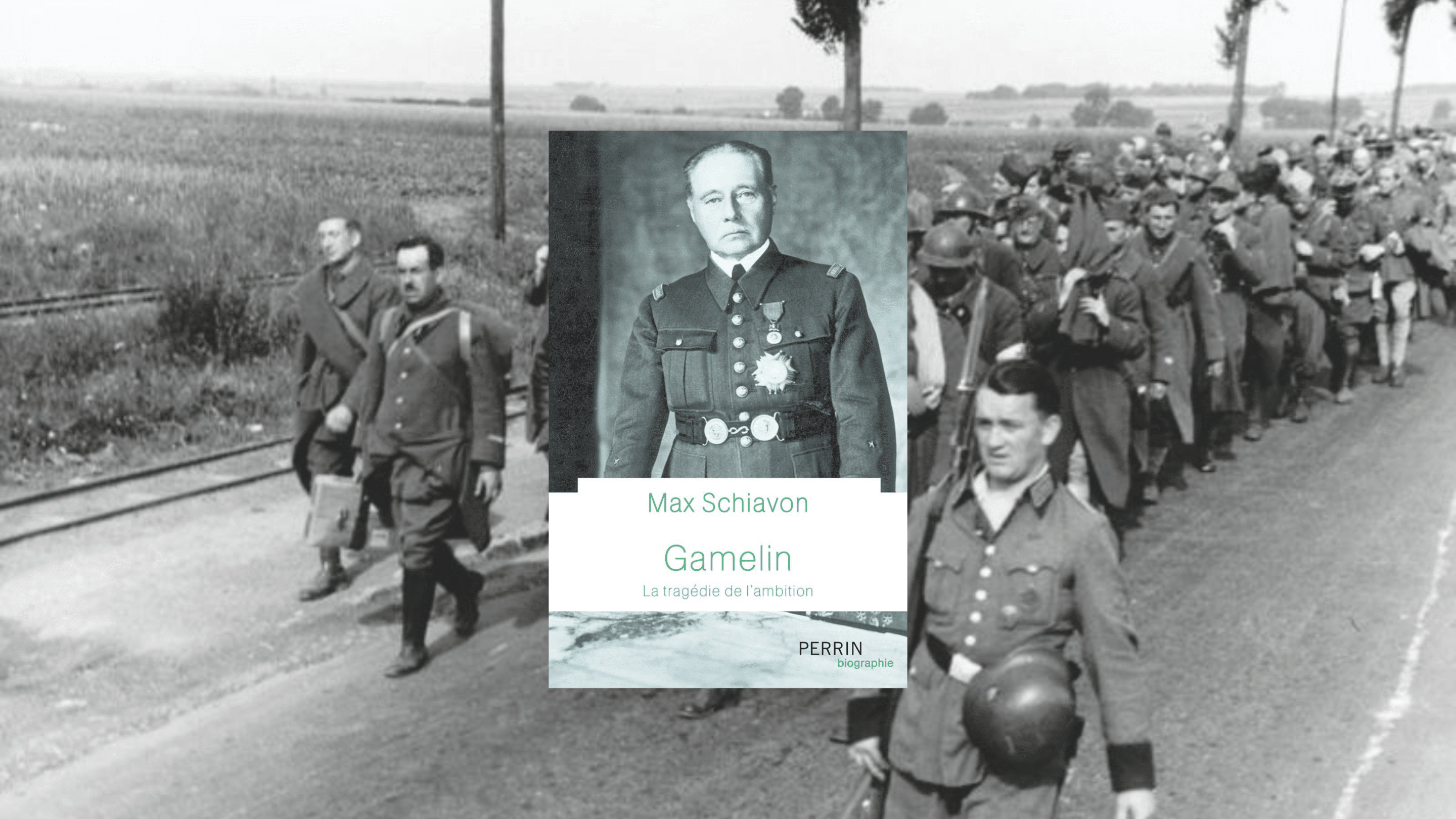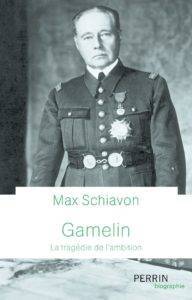À la différence du maréchal Pétain, le général Gamelin a suscité peu d’études, alors que l’on peut estimer qu’il porte une part de responsabilité dans l’effondrement de l’armée française face au blitzkrieg, en mai 1940. Cet ouvrage est la seconde biographie que lui consacre un historien ; la première date de 1976.
Max Schiavon, Gamelin. La tragédie de l’ambition, Paris, Perrin, 2021, 521 p.
Max Schiavon a déjà dédié plusieurs études à des généraux oubliés — André Corap, Charles Huntziger, Alphonse Georges — et ses recherches alimentées à des archives militaires et à des fonds privés ont dessiné ainsi les contours d’une question fondamentale, celle de la défaite de 1940. Un détour par la biographie de Mussolini a posé la question de l’occasion manquée d’une alliance ou d’une neutralisation de l’Italie qui aurait, certes, amélioré la position de la France face à l’Allemagne. Avec la biographie du général Gamelin, il s’attaque au cœur du sujet.
Le portrait qu’il dresse de Maurice Gamelin confirme le jugement de beaucoup de ses contemporains. Comme le dit, entre officiers d’état-major, le capitaine Henri Zeller en accueillant le capitaine André Beaufre, un jour de 1932, « le général Gamelin, c’est une nouille ». Le jugement est primaire, mais à l’évidence le futur général en chef de l’armée en guerre n’a jamais été un baroudeur ni un meneur d’hommes. Ce fut un sujet brillant à l’écrit, de commerce plaisant, aux exposés agréablement didactiques, qui a raflé d’abord les premières places d’examens et de concours avant de commander de belles unités dans des circonstances qui lui ont permis de montrer, sans risques, son talent. Il excelle dans le jugement prudent et balancé. Il ne dira pas « je veux, j’ordonne », mais « il conviendrait peut-être ».
À lire également
Nouveau Numéro : Mer de Chine, Taïwan prochaine prise ?
Une belle carrière militaire
En 1931, Gamelin devient chef d’état-major de l’armée de terre ; en 1935, il cumule ces fonctions avec la présidence du Conseil supérieur de la Guerre qui assiste le ministre, bénéficiant du soutien indéfectible d’Édouard Daladier, deux fois ministre de la Guerre ou de la Défense et président du Conseil à trois reprises, entre 1933 et 1940.
Pourtant, au moment où Gamelin accède à de telles responsabilités, ceux qui l’approchent, militaires et politiques, savent à quoi s’en tenir. En 1933, le général Corap le juge en ses carnets : « Esprit spéculatif, il ne s’intéresse nullement aux réalités, aux choses concrètes. En outre conciliateur et opportuniste à outrance[1]. » Comment est-il parvenu au sommet et comment s’y est-il maintenu jusqu’au désastre quand la plupart pressentent qu’il ne fera pas le poids devant l’épreuve ? Max Schiavon fournit des éléments d’explication : craignant toujours qu’un homme providentiel surgisse de l’armée, la IIIe République a préféré, à tout homme de caractère, un militaire indécis pourvu qu’il l’assure de ses sentiments « républicains » — autrement dit, de sa docilité à l’égard des politiques. Lorsque la tension internationale devient dramatique, puis lorsque la guerre est déclarée, la responsabilité de Daladier dans ce choix est patente ; il lui est plus commode de travailler avec un homme enclin au compromis qu’avec un officier qui ne transigerait pas avec les exigences d’une armée combattante.
Pourtant, les années 1930 n’étaient pas dépourvues de militaires capables de réflexion critique. « Contrairement à une croyance largement répandue, il existe dans l’entre-deux-guerres de nombreux « penseurs militaires indépendants » ; les centaines d’articles publiés dans les revues spécialisées en témoignent[2]. » Mais les promotions dépendaient moins de la rectitude de la pensée que des appuis bien placés et de la faveur des puissants à laquelle on sacrifiait, certains dont on ne l’aurait pas attendue.
« Ainsi la lettre d’un lieutenant-colonel encore peu connu, un certain Charles de Gaulle [écrite à l’occasion de la nomination de Gamelin aux fonctions de commandant en chef] : « Je me permets de vous adresser mes très respectueuses félicitations. C’est avec une pleine confiance que l’armée tout entière vous voit confier dans une période bien grave les fonctions les plus hautes et les plus lourdes responsabilités. » Or, l’intéressé n’ignore pas qu’au contraire la nomination de Gamelin est très controversée[3]. »
Maurice Gamelin ne saisit aucune des occasions d’endiguer la politique de transgression graduée qu’a menée l’Allemagne avant-guerre. En 1939, il soutient toujours que « l’ordre prime la vitesse[4] », et s’accommode d’une structure boiteuse du commandement. « Là où il aurait fallu l’unité, la simplicité, la méthode, on trouvait la variété, la complication, la dispersion des efforts et des attributions équivoques[5]. » Pas davantage de réactions durant la drôle de guerre qui mobilise des millions d’hommes que le généralissime laisse sans entraînement ni objectifs et démoralisés.
Le 20 mai 1940, alors que les jeux sont faits et que le général Weygand arrive pour le remplacer, Gamelin lance à la cantonade : « En somme, je ne vous laisse pas une si mauvaise situation[6]. » À l’automne, il rejoint à Riom les inculpés d’un procès destiné à juger des responsables de la guerre et de la défaite. Alors que la justice traîne, Pétain le condamne, ainsi que Blum, Daladier, Mandel et Reynaud, à la détention au fort du Portalet, en vallée d’Aspe (Pyrénées), une villégiature assez rude que le maréchal fréquentera aussi cinq ans plus tard.
En 1943, les prisonniers partent comme otages en Allemagne et Gamelin passe le reste de la guerre au château d’Itter, proche de Dachau. Cette captivité lui permettra de bénéficier du statut de déporté à la libération. En 1946, devant une commission parlementaire qui cherche à définir quels sont les responsables d’une épreuve de cinq ans, il refuse toujours d’être mis en cause. Quant Antoine Pinay s’exclame : « Mais vous étiez tout de même l’autorité supérieure qui coiffait tout cela ! », il rétorque : « Moi, je ne connaissais les ordres que quand ils étaient donnés. À la bataille, a écrit le maréchal Joffre, la parole passe aux exécutants[7]. »
S’il n’est pas davantage inquiété, le général achève cependant sa vie dans la solitude. Il meurt le 18 avril 1958. Alors que sont en place les stratagèmes qui aboutiront au pronunciamiento d’Alger le 13 mai, le général de Gaulle prend le temps de venir au Val-de-Grâce saluer sa dépouille et Jacques Chaban-Delmas, ministre intérimaire de la Défense nationale, ordonne la saisie de ses papiers.
La fin de l’ouvrage abandonne le lecteur à sa perplexité. Le destin d’une nation peut-il donc être confié à des mains si légères ? Si Max Schiavon donne de son personnage une image plus critique que celle que dessine l’ouvrage récent de Simon Catros, il assigne aux hommes politiques les erreurs qui leur reviennent[8]. « Tous les éléments présentés montrent à l’évidence un gouffre vertigineux entre ce qu’il [Gamelin] aurait dû être et ce qu’il a été. […] Mais c’est malgré tout Daladier qui porte les plus grandes responsabilités dans ce désastre[9]. »
L’ouvrage présente un grand nombre de notes qui complètent utilement les différents chapitres. Saluons ce choix des éditions Perrin ; il n’est pas courant qu’un éditeur résiste à la tentation d’élaguer un ouvrage en taillant dans l’appareil critique.
À lire également
Faire face a la défaite #3 : tirer les leçons de la défaite
[1] Gamelin. La tragédie de l’ambition, p. 98.
[2] Ibid., p. 103.
[3] Ibid., p. 109.
[4] Ibid., p. 205.
[5] Propos du général Colson rapportés p. 173.
[6] Ibid., p. 338.
[7] Ibid., p. 363.
[8] Simon Catros, La Guerre inéluctable, Les chefs militaires français et la politique étrangère, 1935-1939, Presses universitaires de Rennes, 2020.
[9] Gamelin. La tragédie de l’ambition, p. 375.