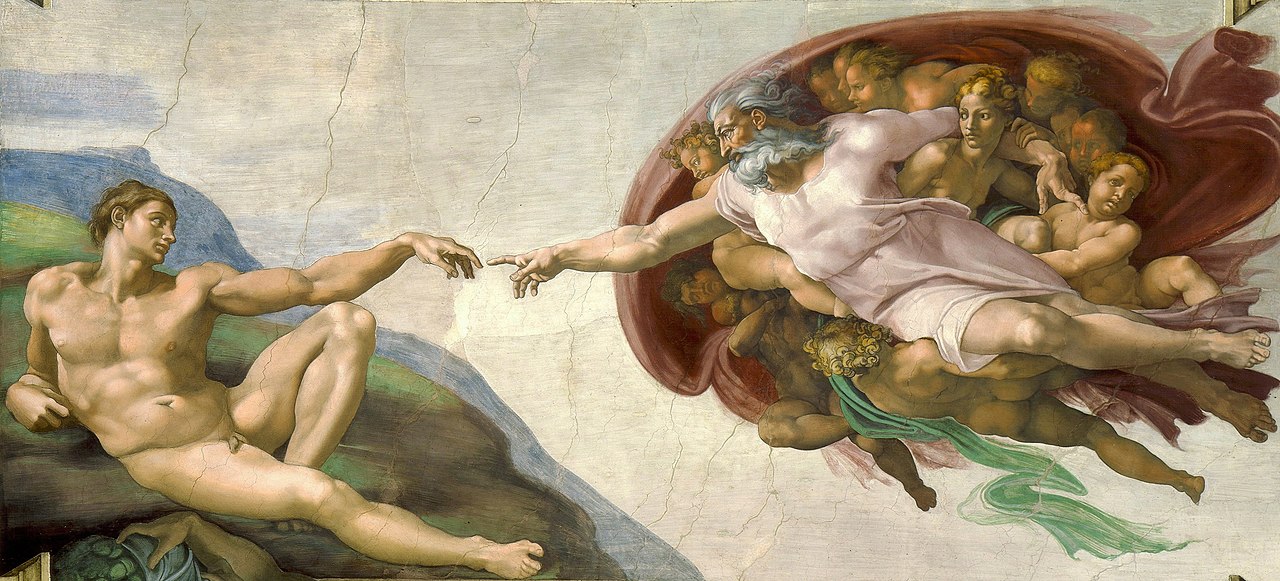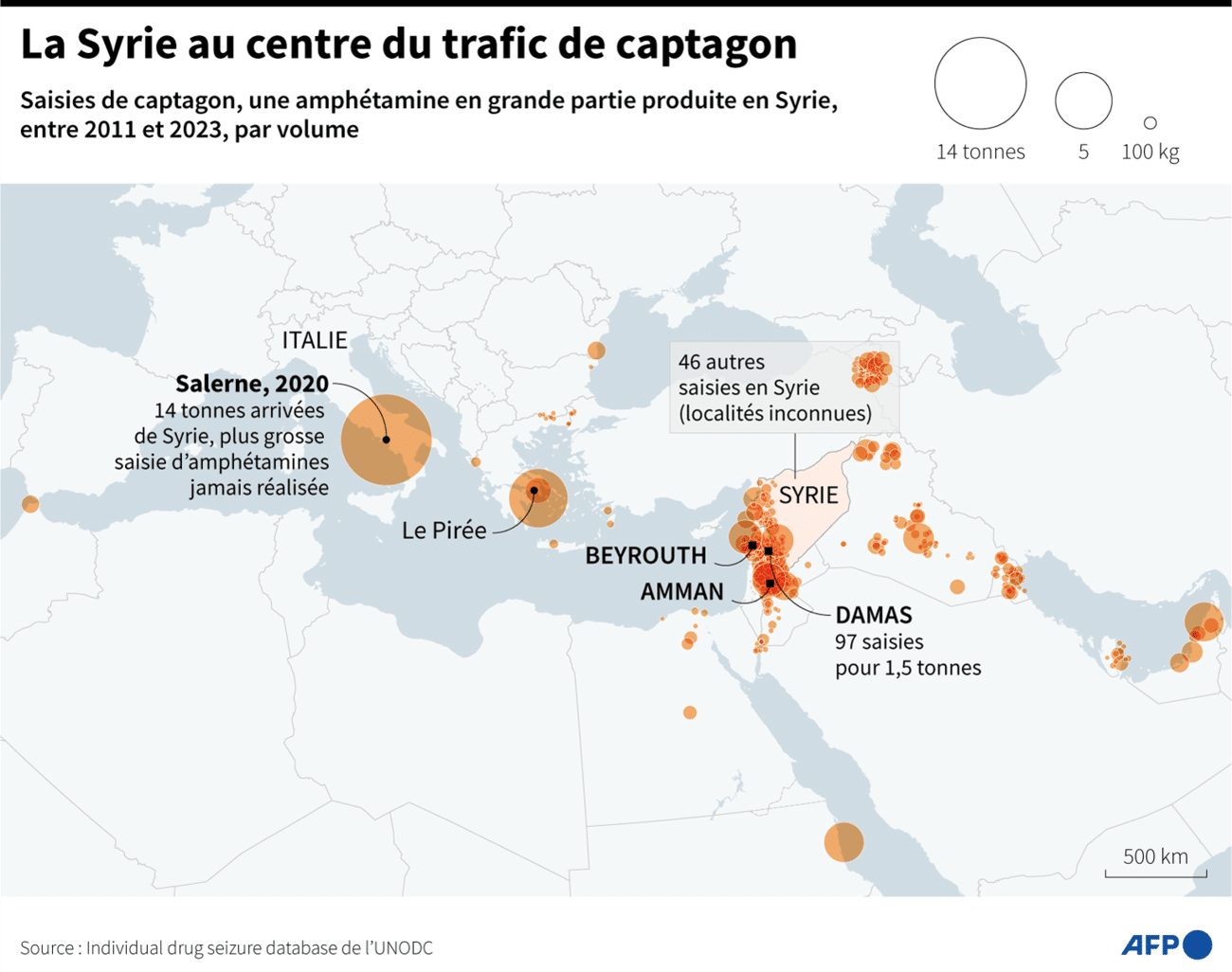Walter Bruyère-Ostells est professeur d’histoire contemporaine à Sciences-Po Aix. Spécialiste des circulations combattantes (mercenaires, volontaires armés), il a notamment publié Dans l’ombre de Bob Denard. Les mercenaires français de 1960 à 1989 (Nouveau Monde Éditions, « Poche Histoire », 2016) et Le COS. Histoire des forces spéciales françaises (Perrin, 2022).
Propos recueillis par Jean-Baptiste Noé
Les mercenaires posent la question du rapport entre le légal et l’illégal, le moral et l’immoral. Le mercenaire a une connotation négative, qui délégitime son action. Peut-on distinguer un bon mercenaire d’un mauvais ?
Il y a une différence de nature, qui relève plus de systèmes de représentation, ce que j’avais essayé de montrer dans mon livre Les Volontaires armés, ces Français engagés pour des causes étrangères depuis 1945. Il y a un regard bienveillant, voire sympathique, pour les gens engagés aux côtés des Kurdes et un regard au contraire très négatif pour ceux qui ont rejoint Daech. Donc cela relève vraiment des représentations collectives qui, depuis de longues décennies, construisent un regard négatif et péjoratif à travers le terme de mercenaire. Pour moi, le mercenaire et le volontaire armé sont deux catégories différentes. « Mercenaire », même si ce n’est pas toujours le cas, renvoie tout de même à une dimension financière plus claire de l’engagement, alors que le volontaire armé répond davantage à une motivation idéologique. La vraie difficulté est d’identifier la hiérarchie entre les différentes motivations, souvent mêlées, à l’engagement.
Et donc à ce titre, les Français qui vont combattre au côté de Daech, vous les placez plutôt dans les volontaires armés ?
Oui, pour ma part je les classe comme des volontaires armés, puisque le moteur principal de leur départ puis potentiellement de leur participation à des combats, c’est bien une dimension idéologique et religieuse, en l’occurrence pour ce cas-là, qui domine sur la dimension financière ou d’acquisition de position prééminente dans une société, même si ça peut arriver in fine.
A lire également :
Les limites de la contre-influence française sur le continent africain.
Peut-on dresser une typologie du mercenaire au cours des quarante dernières années ?
Les causes d’engagement sont très liées au contexte, c’est-à-dire qu’il y a des gens qui par leur trajectoire personnelle, par leur appétence pour l’aventure, etc. sont des « clients », si je puis dire, prédisposés à devenir des volontaires. Et le contexte est très important pour comprendre les causes qui sont rejointes. Typiquement, pendant la guerre froide, on voit des volontaires armés soit s’engager dans une logique tiers-mondiste, ou de sympathie socialiste avec quelqu’un comme Régis Debray ou a contrario par anticommunisme, par engagement occidental. C’est le cas d’hommes qui vont devenir des mercenaires – sans se revendiquer ainsi au moment de leur engagement au Katanga – à l’instar de Bob Denard. Aujourd’hui, dans le monde post-guerre froide, on voit une diversification des causes d’engagement. L’islamisme est cependant un moteur important à travers le monde du Moyen-Orient à l’Amérique du Nord en passant par l’Europe, sans oublier une partie de l’Asie du Sud et du Sud-Est. Dans les années 1990, dans les conflits de l’ex-Yougoslavie ou encore même à la limite avec les Kurdes dans les années 2010, d’autres dimensions identitaires motivent des engagements. Le volontariat armé éclaire les grandes transformations géopolitiques.
Vous évoquez ces personnes qui partent pour des raisons idéologiques. Cela interroge la notion de nation et celle de peuple en arme, issue de la Révolution. Voilà donc des personnes qui ne se battent pas en fonction de leur pays d’appartenance, mais en fonction d’une idéologie de rattachement ?
Il y a deux façons de répondre. La première, purement historique. Le peuple en arme bien entendu est une construction de la Révolution française, mais celle-ci a déjà eu une dimension transnationale dans son discours. L’adhésion aux valeurs de la Révolution est essentielle et donc des étrangers s’engageaient dans les armées françaises. À ce titre, le nom de Francisco de Miranda est ainsi gravé sur l’Arc de Triomphe. Donc il y a toujours eu une dimension transnationale. Cela dit, vous avez raison, c’est ensuite avec la construction des États-nations au xixe siècle, que s’est tissé le lien entre service militaire et nations. Aujourd’hui, la dimension transnationale dans les relations internationales est beaucoup plus puissante avec la mondialisation. Donc cette possibilité d’engagement, vous dites contre sa nation, en tout cas au-delà de sa nation, est beaucoup plus forte parce que l’idée des frontières, l’idée des nations, a été affaiblie par la mondialisation depuis les années 1970 et a fortiori de façon beaucoup plus forte depuis les années 1990.
Les mercenaires sont-ils militairement parlant réellement utiles ?
Dans les années 1960, on voit que oui. Typiquement dans les grandes phases successives de la crise du Congo (1960-1967), on voit que les mercenaires ont joué un rôle significatif sur l’évolution des combats. La résistance du Katanga pendant plus de deux ans doit beaucoup aux mercenaires, et même chose pour l’extinction des maquis procommunistes de l’est du Congo (1964-1965) où les mercenaires sont encore des acteurs clés. Après, sur le temps long, les mercenaires sont rarement décisifs, d’autant qu’ils ne sont utilisés que par des États qui ne peuvent pas avoir des moyens directs d’action et cette action indirecte, comme toute action indirecte, a un résultat qui est moins tangible qu’une action militaire conventionnelle.
Wagner, dont on parle beaucoup, a-t-il une utilité stratégique et militaire ou bien est-on là dans le domaine de la communication, qui est certes importante dans une guerre ?
Je ne sais pas si on peut dire que c’est que de la communication. Ce serait forcer un peu le trait. Mais, de fait, le résultat militaire apporté par Wagner, sa plus-value, pour l’instant, est relativement faible. Là où ce groupe joue quand même un rôle, peut-être pas stratégique, où c’est un levier sur le plan militaire, c’est que sa présence peut motiver ou remotiver d’autres acteurs ; typiquement, c’est ce qui a pu se passer en Crimée ou dans le Donbass. Et puis il y a une vraie dimension politique – et là je pense plutôt aux États africains – à déployer ces gens-là, même si l’efficacité opérationnelle n’est pas forcément au rendez-vous (au Mozambique par exemple). En revanche, le signal politique adressé par Moscou avec ces déploiements – je pense à la Centrafrique ou au Mali – produit de réels effets.
A lire également :
Les nouvelles formes de la guerre
Peut-on faire une autre distinction qui serait l’usage de mercenaires pour les pays pauvres et d’autres par les pays riches ? Vous citiez l’Afrique, mais les États-Unis en font usage aussi. Est-ce avec le même objectif ou cela s’inscrit-il dans un cadre différent ?
Je ne suis pas sûr que l’on puisse faire la distinction entre pays pauvre ou pays riche, en tout cas pas forcément aujourd’hui si on parle des SMP, parce que le monde des SMP anglo-saxonnes a été très normé ces dernières années, par l’autorégulation post-Blackwater (documents de Montreux…) et aussi parce qu’elles sont soumises au regard des opinions publiques occidentales. Que les SMP soient utilisées dans un pays du Nord ou dans un pays du Sud, cela ne change pas les critiques qui pourront s’exercer à leur encontre.
Voyez-vous une évolution notable au cours des vingt dernières années dans l’usage des mercenaires et des SMP ?
Ce que je vois, c’est un système à deux vitesses. Des sociétés militaires dont les sièges sont dans des pays occidentaux qui sont d’abord écartées du cœur du combat, qui ne participent plus à l’action offensive et sont dans la forme d’autorégulation que l’on vient d’évoquer. En revanche, cela crée un autre type de mercenaires dont certains avaient besoin et qui n’existe plus dans l’offre occidentale. Il y a donc un glissement vers les Sud d’une offre de SMP avec moins de contraintes éthiques, peut-être pas le même niveau d’expertise sur le plan militaire, mais qui sont très actives sur les théâtres de crise (Black Shield pour les EAU ou encore Sadat pour la Turquie). Les grandes sociétés occidentales font une partie des bénéfices dans la sécurité dans le monde occidental et pas forcément de la gestion purement militaire sur des théâtres de crise dans les Sud.
Justement, sur les questions de sécurité, les SMP ne font-elles pas dans les pays du Sud ce que devrait faire l’État normalement, c’est-à-dire assurer la sécurité ? Et face à cette défaillance, elles apportent un service qui est de pallier la faiblesse des États.
Je crois que, de toute façon, le mercenaire, quelle que soit sa forme, se caractérise par la fourniture d’une capacité militaire qu’un État ne peut pas apporter directement. En Occident, c’est pour des questions de financement – l’État externalise, car il n’a plus les moyens de le faire lui-même. Dans les États non occidentaux, certains n’ont pas les moyens militaires pour faire respecter leur souveraineté : les SMP viennent alors combler les carences d’États qui sont plus ou moins déliquescents.
Vous avez étudié le cas des Français partis combattre à l’étranger. A-t-on ce même phénomène pour d’autres pays européens ?
Cela dépend à quel moment on se place. Aujourd’hui, si on se place d’un point de vue des volontaires armés, je ne pense pas qu’il y ait de grosse différence mis à part le volume. Les phénomènes transnationaux, par exemple autour de l’islam, concernent tous les pays européens dans lesquels il peut y avoir de jeunes musulmans. On voit que la Belgique a fourni beaucoup de djihadistes à l’échelle de ce pays.
En revanche, sur un plan plus général, il y a sans doute une distinction entre des États dans lesquels il y a une culture militaire plus forte, qui ont de grandes armées et qui jouaient un rôle d’exercice de tutelle coloniale dans son passé récent faisant que dans ces pays-là il y a peut-être une tradition un peu plus forte d’engagement ; et donc là on va avoir une distinction entre la France et d’autres pays typiquement ceux du nord de l’Europe ou même l’Espagne. Des États comme la France ou la Grande-Bretagne continuent d’exporter davantage de combattants parce qu’il y a plus de gens qui ont un savoir-faire militaire et parce que dans le système de représentation collectif, les exercices de la puissance nationale peuvent se faire évidemment de façon directe en servant dans les armées, mais aussi de façon indirecte en s’engageant à titre personnel.
Vous évoquiez le fait que la présence des mercenaires manifestait une déliquescence des États du Sud. Mais le fait que des Français partent combattre pour d’autres pays, n’est-ce pas aussi la manifestation de la déliquescence de la nation française et la démonstration que certains Français ne se sentent aucun lien avec le pays où ils sont nés ?
Oui, forcément cela renvoie à la question de la communauté nationale, mais très souvent, à mon sens, même si c’est inconscient, ce n’est pas le moteur premier de l’engagement des personnes. Il y a quand même d’abord des facteurs très personnels (contextes familiaux…), des conditions socio-économiques – facteur extrêmement important – et ensuite il y a la question, à un moment, d’un engagement idéologique, quelle que soit la cause. Vous pouvez le comprendre ou le lire dans une logique de cause à effet : en France, l’engagement patriotique n’est pas suffisamment affirmé, valorisé dans la communauté nationale (contrairement aux États-Unis par exemple) et donc ceux qui cherchent cet engagement vont le trouver dans une autre voie. Pour ma part, je ne crois pas qu’on puisse établir, dans le cas français, un lien direct entre niveau d’engagement pour des causes transnationales et absence ou faiblesse collective de sentiment patriotique.
A lire également :
Mayotte : l’arme migratoire pour déstabiliser le territoire. Entretien avec Estelle Youssouffa