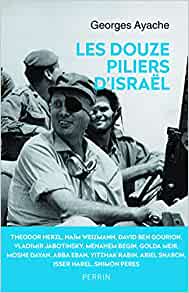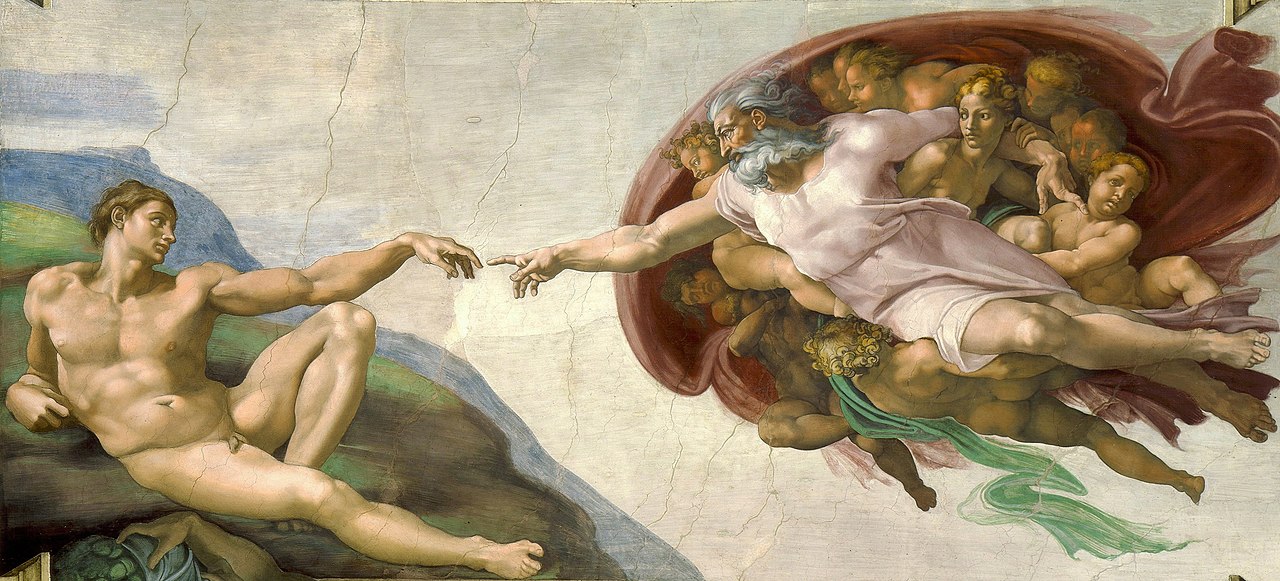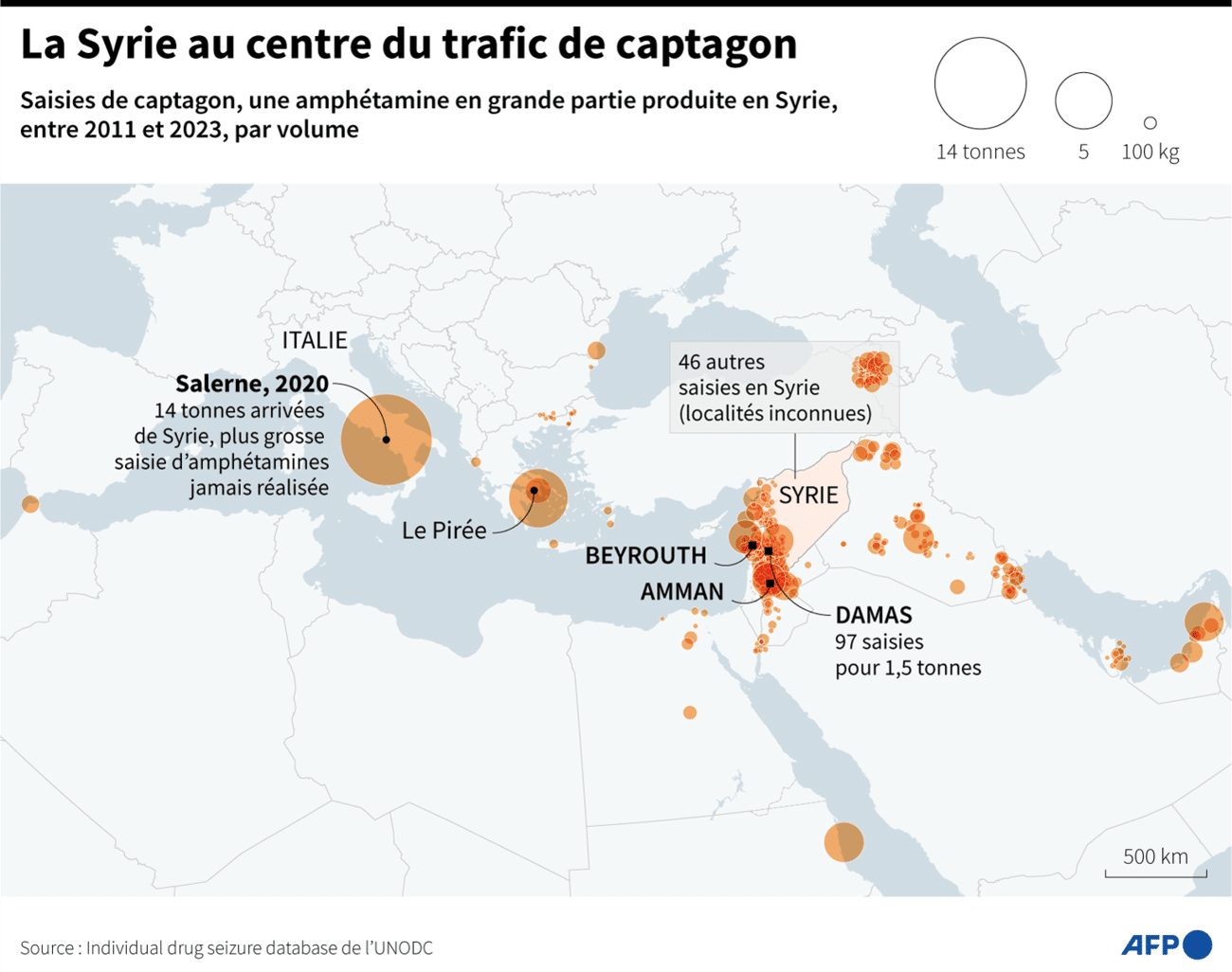De Theodor Herzl à Shimon Peres, douze personnalités ont façonné l’État d’Israël. Marquée par la détermination et le pragmatisme, l’histoire de sa construction demeure au cœur des controverses géopolitiques depuis un siècle. Fin connaisseur de la question, Georges Ayache apporte une analyse précise des piliers de l’État hébreu qui marquent l’histoire du pays.
Entretien avec Georges Ayache. Propos recueillis par Etienne de Floirac.
Selon vous, douze personnalités ont fait naitre puis grandir l’État d’Israël. Quels conditions et impératifs ont guidé vos choix ?
Le choix est évidemment subjectif et aurait pu faire la place à d’autres personnalités décisives. J’ai pris cependant le parti de me limiter à ceux qui, à mon sens, possédaient les qualités humaines et politiques, le charisme en particulier, pour être considérés comme les Pères fondateurs d’Israël.
Comme l’eut dit David Ben Gourion en 1916 : « une patrie on ne la prend pas, on ne l’obtient pas comme un cadeau, on ne l’acquiert pas par des concessions ni des traités politiques. On ne la saisit pas non plus par la force brute. Une patrie, on la construit à la sueur de son front. » Est-ce cela l’histoire de l’État hébreu ?
Ben Gourion fait partie des trois « grands », avec Herzl et Weizmann, sans qui Israël n’eut jamais vu le jour. Herzl fut le concepteur du projet avec son manifeste sur « L’État des Juifs ». Weizmann fut l’homme de la percée décisive avec la Déclaration Balfour de 1917. Mais Ben Gourion fut celui qui pensa et organisa concrètement l’État hébreu. Des trois, il fut le plus réaliste, le plus politique. Il s’orienta très tôt vers le projet d’un État en des temps où beaucoup, dont Weizmann, se fussent satisfaits d’accommodements avec les Anglais, la puissance mandataire sur la Palestine. Il fut aussi un des premiers à penser que l’État juif ne se créerait ni ne se développerait dans la sérénité et que l’hostilité arabe serait pérenne. Logique avec lui-même, il fut donc celui qui pensa la sécurité du nouvel Etat et créa une armée classique alors même que beaucoup, même parmi les militaires, raisonnaient en termes de simple autodéfense. Il est évident que, dans l’immédiat après-guerre et grâce à Ben Gourion, les sionistes étaient beaucoup mieux préparés à affronter les tempêtes qui allaient s’ensuivre. Les mieux préparés, mais aussi les plus déterminés, car ils n’avaient d’autre choix que de survivre. Une telle préparation devait d’ailleurs caractériser les premières décennies de l’État, son « âge d’or », non seulement par rapport à la guerre, mais par son rapport général au monde.
Comment définiriez-vous le sionisme et dans quelle mesure son fruit politique et son principal objectif est l’établissement de l’État d’Israël ?
Le sionisme est une théorie reposant sur une idée simple : le retour des Juifs sur leur terre ancestrale, Sion rebaptisée « Palestine » par l’occupant romain après leur dispersion (Diaspora). Des siècles durant, ce retour avait paru irréaliste : parce que les Juifs exilés tentaient tant bien que mal de trouver leur place dans une Europe où ils pensaient avoir trouvé asile ; également parce que les juifs religieux ne croyaient pas qu’un tel retour fût possible, voire souhaitable, avant l’apparition du Messie tant espéré.
Il aura fallu que les persécutions religieuses dirigées contre eux atteignent un degré suffisamment intolérable pour que l’idée d’un retour sur la terre originelle fasse son chemin. Les pogromes en Europe centrale et de l’Est y furent certes pour beaucoup, mais l’antisémitisme galopant en Europe de l’Ouest en fut le catalyseur. À cet égard, Theodor Herzl ne fut pas l’inventeur du sionisme et certains groupes comme celui des Amants de Sion l’avaient même précédé sur cette voie. Mais il fut celui qui sut donner le retentissement médiatique et l’impulsion politique à un sionisme jusque-là relativement confidentiel.
Le sionisme se développa donc aussi au regard des persécutions antisémites avec l’objectif de trouver un refuge, un havre de paix, au peuple juif. Il y eut même au début des débats enflammés sur le fait de savoir si ce refuge devait être la Palestine et ces débats n’étaient pas encore tranchés à la mort de Herzl en 1904. Ce furent en définitive la Première Guerre mondiale et le travail de lobbying incessant de Weizmann qui incitèrent les Anglais à trancher en faveur d’un « foyer national juif » en Palestine : ce qui était une décision historique qui faisait passer le sionisme du rêve à un début de réalité politique. Une réalité qui atteindra pleinement son objectif avec la création de l’État d’Israël en 1948.
Le sionisme est-il un corollaire obligatoire du fait d’être juif ?
Absolument pas ! On peut parfaitement être juif sans être sioniste, contrairement à ceux qui aujourd’hui pratiquent l’amalgame entre antisionisme et antisémitisme. Les religieux juifs furent d’emblée hostiles au sionisme, même après la création de l’État d’Israël pour certains. Il y eut aussi des juifs laïcs antisionistes qui s’estimaient suffisamment bien intégrés dans les pays où ils vivaient et faisaient partie de l’élite bourgeoise et intellectuelle, en France par exemple ou en Grande-Bretagne. À leurs yeux, le sionisme était non seulement utopique, mais dangereux.
L’hostilité de ces élites juives occidentales au sionisme comportait un dénominateur commun : la hantise d’être taxés de « double appartenance » alors même qu’ils s’estimaient parfaitement intégrés. Le Parlement britannique comptait d’ailleurs à la fin du XIXe siècle plusieurs députés d’ascendance juive et le gouvernement français un ministre, Adolphe Crémieux. En France d’ailleurs, même l’Affaire Dreyfus ne parviendra pas à contrebattre la conviction d’être intégré, au contraire même : le dreyfusisme les confortant dans la certitude que le pays acceptait majoritairement les juifs. Il n’est guère étonnant que les institutions juives de France aient longtemps conservé une attitude très mitigée envers le sionisme.
Herzl lui-même était loin de se sentir sioniste dans ses années de jeunesse ! C’est à peine d’ailleurs s’il se sentait juif dans la mesure où il ne concevait alors son avenir qu’à travers les milieux viennois chrétiens où il entendait faire carrière. Les principales personnalités juives autrichiennes de l’époque pensaient en des termes identiques, du dramaturge Arthur Schnitzler au compositeur Gustav Mahler – ce dernier n’hésitant pas à se convertir au catholicisme pour accéder au poste prestigieux de directeur musical de l’Opéra de Vienne – parmi tant d’autres.
Benjamin Netanyahou peut-il s’apparenter au treizième pilier de votre ouvrage ?
Je ne pense pas et ce, pour des raisons purement historiques. J’ai entendu limiter mon propos aux Pères fondateurs de l’État d’Israël, à ceux qui l’ont conçu puis créé. Les douze personnalités retenues dans mon livre, de Theodor Herzl, le « fondateur » à Shimon Peres, le « dernier des Mohicans », répondent toutes à de tels critères. Ce qui n’est pas le cas de Benyamin Netanyahou qui, au-delà de l’appréciation politique qu’on peut porter sur lui, incarne la génération d’après. Il est moins un pilier qu’un continuateur, de même que tout le personnel politique israélien actuel.
La génération des Pères fondateurs, celle qui a connu la création de l’État d’Israël puis les premières guerres avec les Arabes, s’est éteinte physiquement avec Peres. Elle était déjà passée de mode avec la mort de Ben Gourion et morte politiquement avec l’assassinat tragique d’Yitzhak Rabin en 1995 puis la disparition d’Ariel Sharon à la suite de son attaque cérébrale de 2006.
Vous êtes également spécialiste de l’histoire des présidents américains. Les États-Unis de Joe Biden constitueront-ils toujours le premier protecteur de l’État hébreu ?
À ce stade, nul ne peut encore le savoir avec certitude. Il demeure malgré tout une constante dans l’histoire américaine : les Démocrates, qui drainent traditionnellement la majeure partie de l’électorat juif américain, ont souvent donné paradoxalement des présidents peu favorables à Israël. Franklin D. Roosevelt n’aurait sans doute pas été favorable à la création de l’État hébreu, s’il avait vécu jusque-là. John F. Kennedy ne manifesta jamais une empathie débordante envers Israël, indépendamment du fait que son père Joe était foncièrement antisémite. Chacun se souvient surtout des préjugés pro-palestiniens et de l’animosité marquée de Jimmy Carter envers Israël. Quant à Biden, même s’il ne reviendra sans doute pas sur certaines mesures de son prédécesseur (le déplacement de l’ambassade américaine à Jérusalem par exemple), il est fort possible que, poussé par la gauche de son parti, son appréciation générale de la situation soit plus mitigée : le test majeur, à cet égard, sera la nouvelle attitude de Washington vis-à-vis de l’Iran.
De toute façon, quel que soit son besoin d’une aide américaine, Israël n’a jamais eu besoin de protecteur en tant que tel : surtout s’agissant d’un pays parfois prompt à abandonner en rase campagne ses alliés d’hier, des Sud-Vietnamiens aux Chinois de Taïwan (sacrifiés à l’ONU dans les années 1970 sur l’autel du rapprochement avec Pékin). D’où le comportement parfois unilatéral d’Israël vis-à-vis de l’opinion internationale que Golda Meir avait justifié par anticipation : « Je préfère vos condamnations à vos condoléances … ».
Quel est votre avis sur l’avenir d’Israël et sur sa capacité à pacifier les relations qu’elle entretient avec les pays arabes du Golfe, comme l’ont récemment montré les accords d’Abraham ?
Le principal danger d’Israël est d’ordre démographique et c’est pourquoi, d’ailleurs, toute autre issue qu’une solution à deux États paraît suicidaire à terme. La chance d’Israël, en revanche, est que les Palestiniens, selon le mot de l’ancien chef de la diplomatie Abba Eban, « n’ont jamais manqué l’occasion de laisser passer l’occasion ». Aujourd’hui, on peut penser effectivement que l’heure des Palestiniens, du point de vue politique, est passée et que même les pays arabes s’en sont lassés. Les Palestiniens n’auront jamais compris, en fin de compte, que le monde avait changé et que les enjeux s’étaient déplacés. À chaque fois qu’un nouveau pays arabe « normalise » ses relations avec Israël, la question palestinienne est un peu plus enterrée. À cet égard, le pas décisif sera l’éventuelle normalisation des relations avec l’Arabie saoudite de MBS. C’est alors qu’Israël aura toutes les cartes en mains pour proposer un règlement durable. Saura-t-il jouer la bonne carte ? Nul ne le sait pour l’heure.
A lire aussi : Israël : le renseignement, une question de survie