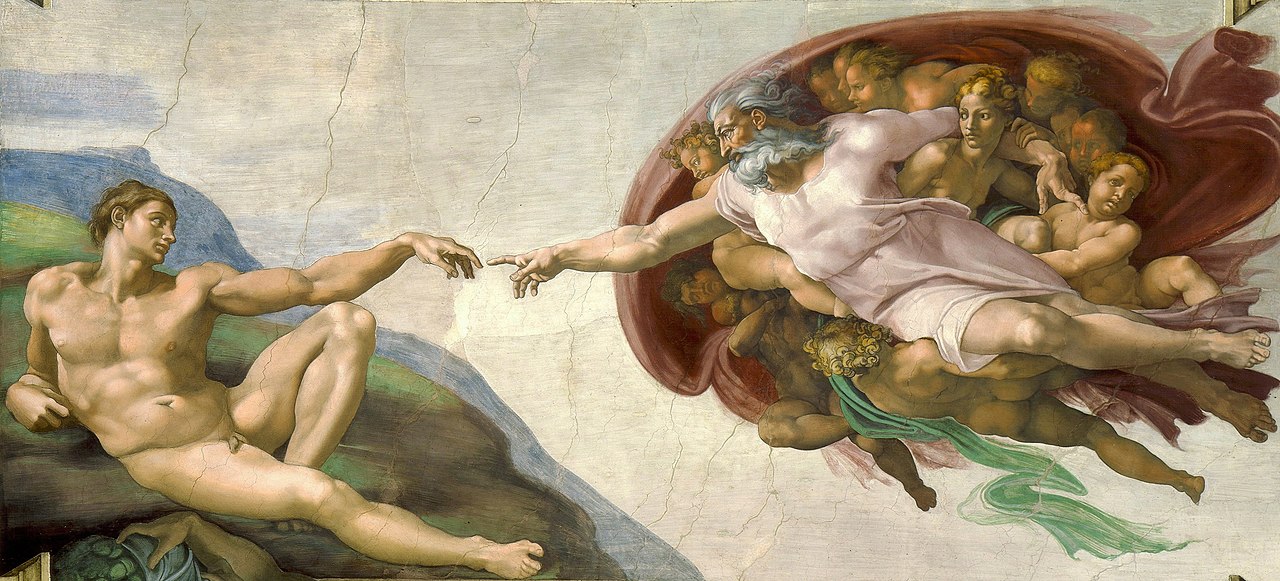Dans le paysage géopolitique français, Pierre Conesa détonne. Par sa formation, agrégation d’histoire et ENA. Par ses activités, autrefois haut fonctionnaire à la Défense, aujourd’hui consultant en intelligence économique. Par ses écrits qui concernent le djihadisme, les dysfonctionnements de la vie politique ou… le paradis. Par son franc parler surtout. Avec Conflits, il n’a pas pratiqué la «langue de bois».
Vous considérez-vous comme un géopoliticien?
Le terme de géopolitique a l’avantage d’ouvrir la voie au comparatisme. Comme géopoliticien vous vous intéressez à toute la planète; si vous être universitaire dans une discipline classique, vous vous spécialisez à l’extrême. La géopolitique ouvre les perspectives, elle permet de comparer et de relativiser, c’est la démarche que j’ai adoptée au risque de me tromper ou d’être critiqué.
Quelle serait votre définition de la géopolitique?
L’articulation entre l’histoire et la géographie d’un espace donné. Je suis agrégé d’histoire, la géographie m’a beaucoup apporté ainsi que les voyages à travers toute la planète. Cette définition planétaire est donc marquée par mon expérience.
Comment évolue la géopolitique?
La guerre froide a appauvri l’analyse géopolitique car elle obéissait à la logique «Tout ce qui n’est pas avec nous est contre nous»: on mettait chacun dans une case, rouge ou bleue. C’est ainsi que nous avons raté l’analyse de la décolonisation ou du nationalisme arabe en mettant dans le camp communiste tous les mouvements de libération.
Ce système de pensée s’effondre en 1991. «Nous allons vous rendre le pire des services, nous allons vous priver d’ennemi» avait prédit en 1989 Alexandre Arbatov. Que peut faire un stratège quand il n’a plus d’ennemi? C’est comme une entreprise sans marché. Il faut soit licencier, soit trouver de nouveaux débouchés. En l‘occurrence inventer des ennemis. Les stratèges américains ont passé toutes les années 1990 à se trouver de nouveaux ennemis: d’où leurs analyses sur le choc des civilisations, entre autres.
Dans le même esprit, les rapports de la CIA analysaient les menaces à venir, en général en se trompant beaucoup. Il serait amusant de reprendre ces rapports anciens et de voir ce qui s’est effectivement produit.
Nous l’avons fait dans Conflits.
C’est bien. Je me souviens qu’en 2001 la publication annuelle de l’IFRI, «Politique étrangère» (par ailleurs excellente), ne parlait absolument pas du radicalisme et du terrorisme islamistes, elle se voulait sereine et sérieuse. Mais ce sont les voyous et les révoltés qui font l’histoire, pas les honnêtes gens. Les seconds devraient s’efforcer de comprendre les premiers plutôt que de s’autocongratuler et de chercher à tout prix le consensus. Pour faire consensus on rabote tout ce qui gêne et, à force de raboter, on se retrouve avec une savonnette. Peu utile pour la prospective.
Les crises sont faites pour surprendre…
Oui, car sinon nous prendrions les mesures qui les empêcheraient d’apparaître. Ce que nous savons faire c’est prolonger les courbes. Nous aurions très bien pu rédiger un rapport prospectif sur «L’URSS en 2025». Repérer les signes de rupture, voilà le véritable talent.
Après la guerre du Kosovo, l’état-major a effectué, comme d’habitude, un retour d’expérience: il s’agit de voir comment les combats se sont déroulés, ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné pour les corriger. Mais les experts réfléchissent à la façon de mieux gagner la guerre précédente. En fait, c’est le vaincu qui renouvelle la stratégie, pas le vainqueur. Regardez, c’est Daech qui a modifié la communication de guerre, la pratique des attentats… Si je vous dis qu’al-Adnani est un formidable stratège qui a réussi à nous prendre à revers partout, vous penserez que je suis fou. Comme si je vous avais dit dans les années 1950-1960 que Giap était le véritable stratège.
Lire aussi : Myriam Benraad, L’État islamique pris au mot
Quelle est la force de daech?
Elle a rompu avec quelques principes d’Al-Qaïda. Cette dernière communiquait en arabe et en anglais. Daech a compris que la communauté musulmane est mondialisée, elle communique donc en onze langues. Al-Qaïda disait: «Deviens un bon musulman, tu viendras faire le djihad.» Daech dit: «Viens faire le djihad, djihad, djihad tu deviendras un bon musulman.» La communication de Daech va de combattant à sont restés: «Regardez, j’ai une kalachnikov, un 4×4, une maison et une femme»…
Et puis Daech désigne comme principale cible les chiites et non les Occidentaux – 80% à 90% des victimes des attentats sont des musulmans. Elle ne nous visait pas au départ. C’est nous qui sommes intervenus, nous faisant les défenseurs des «mauvais musulmans», y compris les monarchies du Golfe que méprisent les islamistes.
Il ne fallait pas intervenir?
En fait nous ne cherchons plus à comprendre la mécanique des crises. À l’époque de la guerre froide nous étions obligés de faire un effort d’analyse car l’autre camp, les communistes, risquaient de profiter de nos erreurs. Depuis, nous commençons par nous demander si ces crises nous importent. Le cas exemplaire est la Somalie: nous commençons par y aller pour des raisons humanitaires, nous constatons que la situation est beaucoup plus compliquée que nous le croyions, puis nous nous disons que la Somalie n’est pas très importante, et nous partons. Elle fait partie d’un monde inutile dont, en réalité, nous nous moquons.
La vraie question à se poser est: Quel est le monde utile? Cela se juge en fonction d’intérêts objectifs (le pétrole, par exemple) et de ressources symboliques. Mais nous nous contentons pas de cela, nous nous considérons comme responsables de la sécurité internationale. Au nom de quoi? En ce qui concerne la Libye, les pays qui ont voté à l’ONU pour l’intervention ne représentaient que 9% de la population mondiale, et pourtant la presse parlait de «communauté internationale».
Donc intervenir ou pas? Cela dépend: il y a des crises sur lesquelles nous avons peu de moyens d’action et dont nous ferions mieux de ne pas nous mêler.
J’ajoute que depuis 1991 se produit un phénomène de militarisation des crises. On a commencé par envoyer des troupes pour s’interposer, par exemple dans l’ex-Yougoslavie. Puis nous avons constaté que cette décision ne calmait ni les Serbes, ni les Croates, ni les Bosniaques. Il a fallu aller plus loin, envoyer plus d’hommes, bombarder. La militarisation c’est le doigt dans l’engrenage de l’enlisement. En Libye nous avons renversé le régime sans aucune analyse de la crise et depuis c’est le chaos.
Lire aussi : L’Islam au Maghreb : cultures et politiques
Tout cela est justifié par notre conception des droits de l’homme.
Sans doute, mais le reste du monde ne nous en demande pas tant. Nous prétendions intervenir en Afghanistan pour affranchir la femme afghane. Quelle prétention! Cela voulait dire entrer dans tous les foyers afghans, changer d’un coup des mentalités séculaires. Un autre exemple encore plus cocasse. Je me suis rendu il y a quelque temps dans une république d’Asie centrale ex-soviétique. L’ambassadeur de France m’a confié qu’il venait de recevoir une directive du ministère lui demandant d’aller interroger les autorités locales sur le droit des LGBT dans ce pays. Imaginer la tête du ministre des Affaires étrangères local interrogé par un ambassadeur sur le droit des transexuels de son pays!
Revenons à daech. Il a perdu Mossoul, bientôt Raqqa. N’est-il pas vaincu?
Le problème est de savoir comment il va penser sa survie. La territorialisation permettait d’offrir aux jeunes qui le rejoignait un espace où ils pouvaient vivre totalement le «vrai» islam, un islam non corrompu, égalitaire où chacun recevait selon ses besoins. Un vrai projet révolutionnaire contre le monde entier.
Une des solutions pour Daech est de s’installer dans d’autres régions où il est déjà présent. Une autre de prendre les armes chez nous et de tuer autant de mécréants que possible.
Pensez-vous qu’ils peuvent trouver des relais dans nos pays?
Je suis persuadé que la grande majorité des musulmans sont très éloignés des islamistes. D’ailleurs de nombreux intellectuels musulmans et même des gouvernements de pays arabes nous engagent à être beaucoup plus fermes contre eux, ils sont beaucoup plus sévères que nos autorités.
Cela dit, il faut tenir compte de deux faits. D’abord la diffusion du salafisme encouragée par l’Arabie Saoudite. Je sais que certains distinguent entre le salafisme quiétiste et le salafisme djihadiste et expliquent qu’on ne peut pas et qu’on ne doit pas agir contre le premier, ce serait une affaire de liberté religieuse. Mais un salafiste, même quiétiste, est raciste, antisémite, homophobe, misogyne et sectaire. Si vous trouvez qu’il n’y a pas dans notre loi de quoi condamner le salafisme! Le salafiste quiétiste c’est Hitler en 1934. Un nazi quiétiste!
Le deuxième phénomène inquiétant est la montée des organismes qui se consacrent à la lutte contre ce qu’ils appellent «l’islamophobie». Que je sache, c’est un curé qu’on a égorgé dans une église et pas un imam dans une mosquée. Quand je faisais le rapport sur les politiques de déradicalisation en 2014, j’avais appelé le CCIF [simple_tooltip content=’Comité contre l’islamophobie en France.’](1)[/simple_tooltip]. Mon interlocuteur m’avait répondu: «Cela ne nous concerne pas.» Les dérives de l’islam radical, cela ne les concerne pas? Ils sont prêts à défendre tous les musulmans y compris les criminels? En réalité ce sont des imposteurs. Après l’assassinat du père Hamel, le CCIF avait réagi par un communiqué appelant à la vigilance contre les actes islamophobes, sans un mot pour condamner la radicalisation.
J’avais pourtant rencontré en faisant ce rapport de nombreux imams qui alertaient sur la montée du salafisme djihadiste. Encore une fois le djihadisme est le fait d’une minorité.
Pour que ce danger s’éloigne, faut-il que l’Arabie Saoudite disparaisse?
Je pense en effet que la solution passe par le Golfe. Le salafisme c’est le wahhabisme, c’est-à-dire l’islam saoudien encouragé par un curieux mélange entre un soft power à l’américaine et un système totalitaire à la soviétique. Nous devrions être beaucoup plus fermes envers l’Arabie qui finance l’expansion du salafisme dans le monde entier.
Il est vrai qu’il y a l’argent du pétrole, un moyen de pression considérable pour les pays du golfe Persique. Voilà pourquoi on laisse l’Arabie se conduire de façon inacceptable, à Bahreïn réprimer une révolution démocratique, au Yémen mener une guerre de bombardements odieuse ou pire dans l’affaire des réfugiés.
Mais il faudra bien un jour mettre en balance les ventes d’armes et les victimes des attentats, et déterminer ce qui est le plus important. Et puis la situation est favorable: l’Arabie a créé un monstre, Daech, qui se retourne contre elle. Nous pourrions très bien laisser le docteur Frankenstein gérer sa créature, or nous nous battons contre Daech sans l’aide d’aucune troupe saoudienne et nous nous étonnons de subir des attentats!
La seule question qui me préoccupe est de savoir quel dirigeant saoudien sera capable de soumettre sa hiérarchie religieuse. Alors, et alors seulement, l’Arabie Saoudite sera capable de se transformer. Pour l’instant les transformations toujours annoncées ressemblent au moonwalk de Michael Jackson: le danseur donne l’impression d’avancer mais ne bouge pas, à chaque crise correspond un renforcement des religieux wahhabites.
Le salafisme est donc notre ennemi principal?
Oui. Il existe un autre grand perturbateur international, le parti républicain des États-Unis et plus précisément les néo-conservateurs qui, d’ailleurs, ne sont pas seulement républicains. Ils ont voulu reconstruire le monde après 1991, et on voit le résultat.
Comment définissez-vous l’ennemi? Quelle différence avec l’adversaire, le rival, le concurrent?
L’ennemi est celui avec lequel la seule solution est le recours à la violence. On trouve toujours des raisons pour justifier ce recours à la violence.
Vous voulez dire, comme vous l’avez expliqué dans l’un de vos livres, que nous fabriquons nos ennemis?
Ce qui m’a intéressé c’est la façon dont se forme l’ennemi. Dans les monarchies anciennes les choses étaient simples: le souverain le désignait, ses troupes le combattaient. Dans les démocraties la guerre doit être démocratique, je veux dire qu’il faut convaincre l’opinion de la justesse du conflit.
Et comment le fabrique-t-on?
Les arguments diffèrent selon le type de conflit. Pour un conflit territorial on mobilise l’histoire ou la géographie – ce sont les ennemis héréditaires ou les frontières naturelles. On peut aussi mobiliser la religion ou l’idéologie.
Vous parlez du rôle des think tanks.
Oui, les think tanks américains en particulier, mais aussi beaucoup d’autres organisations. Chacune forge une image de l’ennemi, ces différentes représentations s’empilent et contribuent à désigner l’ennemi et les raisons que nous avons de le craindre et de le détester.
Il existe des clichés en sens inverse.
Oui, ainsi les États-Unis dits «pacifiques» alors qu’aucun pays n’a plus fait la guerre qu’eux depuis 1945. Ces clichés s’agrègent et constituent le fondement de nos idéologies. Un cas intéressant est celui du dictateur riche. Comme dictateur, il est condamné. Comme riche, il est loué, surtout s’il utilise cet argent pour moderniser le pays, et pour nous acheter des armes. Si Kadhafi avait tenu quelques semaines de plus, nous lui aurions vendu des avions et des tanks !