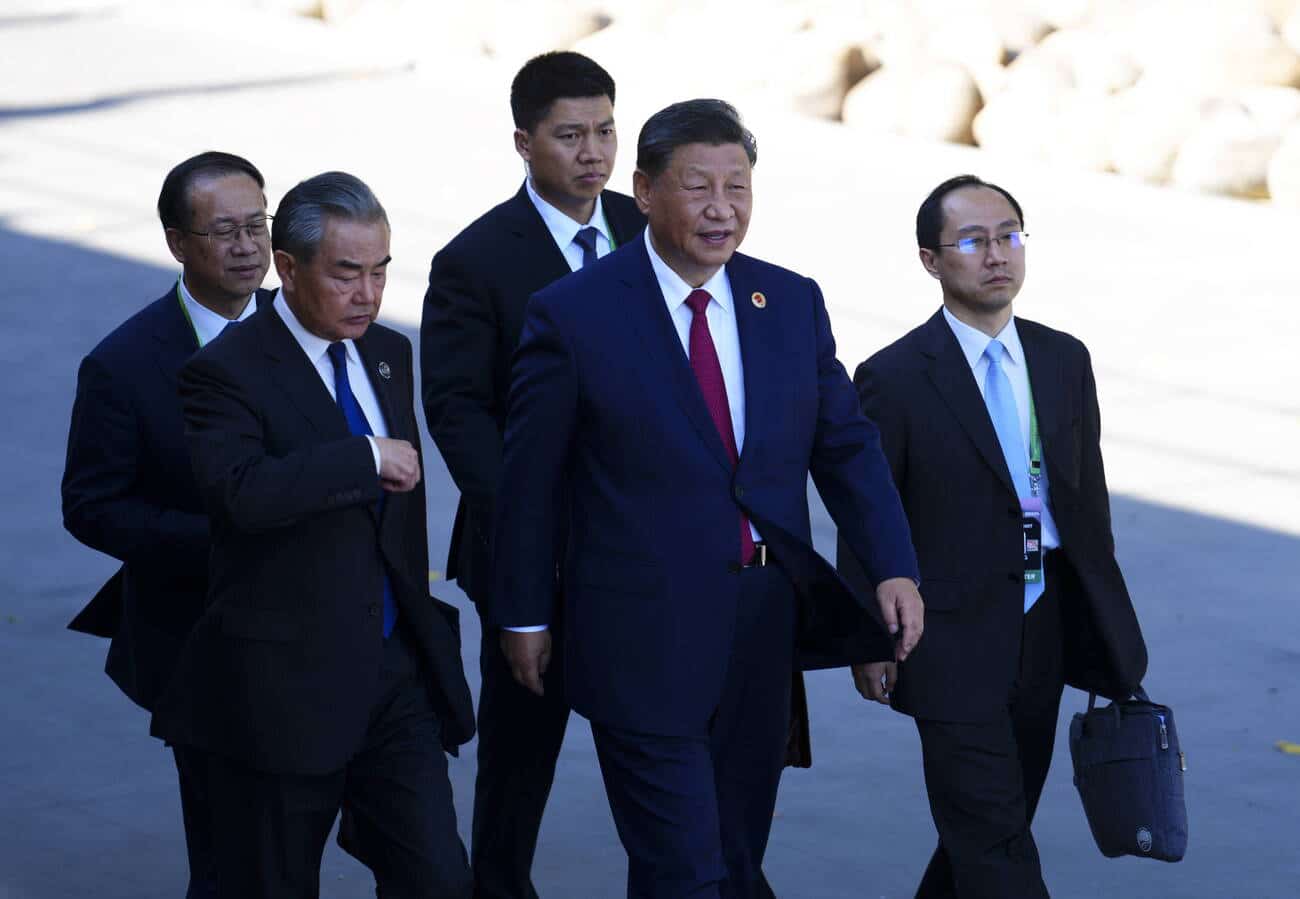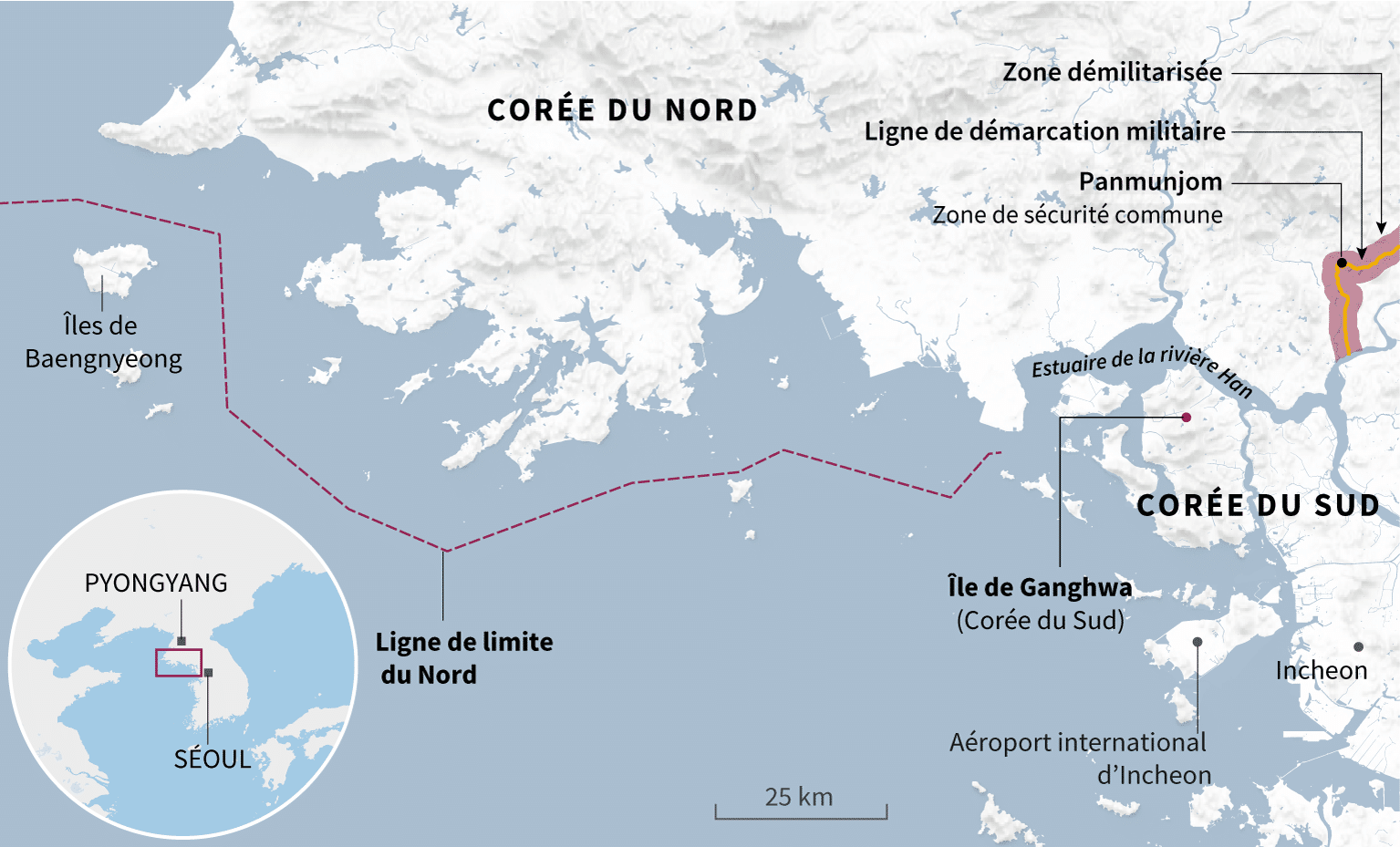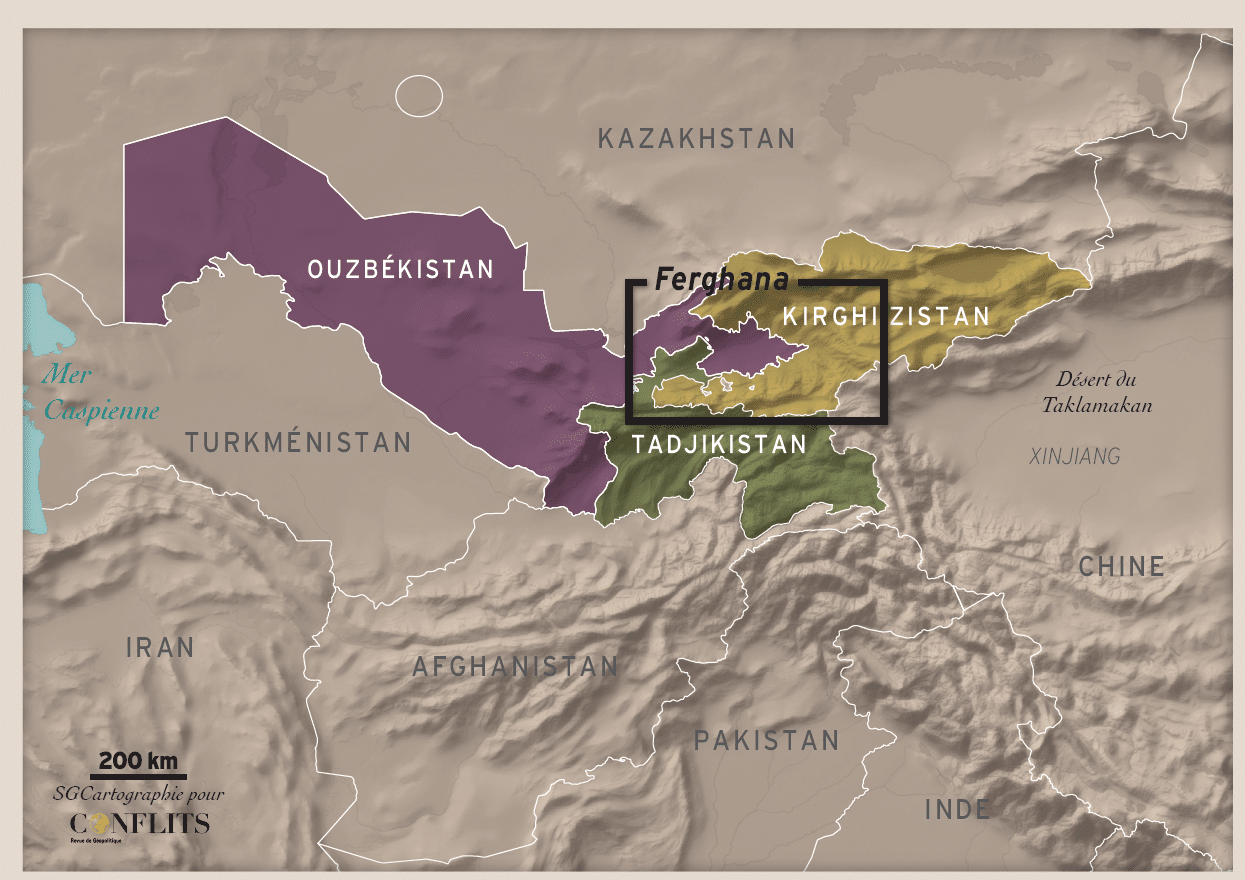Le 10 novembre, l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont mis un terme à la phase active du conflit du Karabagh par un cessez-le-feu signé sous l’égide de la Russie. Les développements et séquelles que se déroulent depuis lors ont de quoi rendre les observateurs aussi perplexes que les opérations militaires telles qu’elles se sont déroulées.
Étrange défaite arménienne, incertaine victoire azerbaïdjanaise
La défaite de l’Arménie et du Karabagh fait vraiment songer à cette « étrange défaite » qu’évoquait Marc Bloch au sujet de la débâcle de l’armée française en 1940 : certes il y a eu les drones turcs et israéliens, certes il y a eu l’engagement massif de mercenaires djihadistes, mais cela n’explique pas tout, tant s’en faut. Dans un texte récemment publié, un mystérieux analyste politique russe, Evgeny Krutikov – peut-être un pseudonyme – pose toute une série de bonnes questions dont les réponses intéresseront nombre d’experts politiques et militaires : pourquoi l’essentiel de l’armée professionnelle arménienne n’a jamais quitté le territoire arménien pour voler au secours de l’Artsakh ? Pourquoi les troupes stationnées au nord de l’Artsakh n’ont-elles pas été transférées sur le front Sud quand celui-ci s’effondrait ? Pourquoi les troupes arméniennes n’ont-elles jamais entrepris de contre-offensive quand cela était possible, c’est-à-dire quand l’armée azerbaïdjanaise fut mise en grande difficulté lors de sa tentative avortée de prendre Berdzor ? Pourquoi enfin Chouchi fut-elle quasiment abandonnée alors que les petits détachements azéris démunis d’équipements lourds qui tentaient de prendre la ville étaient systématiquement anéantis, notamment à Karin Dag ? Si les réponses détaillées à ces questions ne seront sans doute pas connues avant longtemps, il est cependant presque certain qu’elles mettront en cause la gestion du conflit par les dirigeants politiques et militaires de l’Arménie et de l’Artsakh et leurs décisions probablement calamiteuses.
Une victoire ambiguë
Reste que si la défaite de l’entité arménienne – Arménie et Karabagh – est bien certaine, la nature de la victoire de l’Azerbaïdjan est ambiguë. Cette victoire est certes incontestable d’un point de vue militaire. Pour la construire, Ilham Aliev s’est très largement appuyé sur les capacités militaires et logistiques turques à tel point qu’on a pu croire – l’auteur de cet article le premier – à une prise en main quasi totale d’Ankara sur la conduite des opérations azerbaïdjanaises et même à une mise sous tutelle turque de l’Azerbaïdjan. Mais l’interprétation simple d’un conflit par procuration entre la Turquie et la Russie pour séduisante qu’elle ait pu paraître semble désormais trop simple. Car au final, c’est bien la Russie et la Russie seule qui a « offert » une médiation et qui a permis un cessez-le-feu dont les clauses tout comme la mise en œuvre pratique ne manquent pas d’étonner au moins sur deux points : le large déploiement de forces russes de maintien de la paix sur la nouvelle ligne de contact entre le territoire résiduel de l’Artsakh, avec un centre de commandement à Barda en Azerbaïdjan, et la libre circulation garantie par l’Arménie – et assortie d’une nouvelle route – « entre les régions orientales de la République d’Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhitchevan » – sous le contrôle des gardes-frontières du Service fédéral de sécurité de Russie.
L’Arménie, protectorat russe
La question qui se pose est de savoir quels desseins de Vladimir Poutine transcrit ce texte et ce qu’en pensent les exécutifs arménien et azerbaïdjanais. Côté arménien, il est probable qu’à l’heure actuelle, on n’en pense pas grand-chose. Accablé par la défaite, Nikol Pachinian se voit désormais contester par la rue et par de nombreuses formations politiques qui n’auraient sans doute guère fait mieux que lui. S’il semble toujours soutenu par une majorité d’Arméniens, les défections de ministres s’enchaînent – notamment celles des poids lourds qu’étaient le ministre des Affaires étrangères et surtout le ministre de la Défense. L’instabilité politique promet d’être telle que Vladimir Poutine a cru devoir voler au secours du Premier ministre arménien qu’il n’apprécie pourtant guère : dans une interview récente qu’il conviendrait de lire et de relire attentivement, le maître du Kremlin – réfutant les accusations de « trahison » formulées par l’opposition arménienne à l’égard de Pachinian – a considéré comme « suicidaire » que le pouvoir puisse tomber dans les mains de personnes qui refuseraient les termes du cessez-le-feu en ajoutant que « un pays en guerre ou menacé de la reprise des hostilités ne peut pas se permettre de se comporter d’une telle manière, y compris dans le domaine de l’organisation du pouvoir. Il ne peut pas diviser sa société de l’intérieur. C’est inadmissible, contre-productif, et hautement dangereux ». Dans ses propos, Poutine a également lourdement insisté, et comme à regret, sur le fait que « l’Arménie n’a jamais reconnu l’indépendance et la souveraineté du Haut-Karabagh » tout en ajoutant que la Russie n’avait pas abandonné et n’abandonnerait pas l’Arménie. En clair, la Russie considère à juste titre que nul ne peut être plus royaliste que le roi et que si l’Arménie avait reconnu l’Artsakh, cela aurait pu changer le cours des évènements diplomatiques de ces vingt dernières années. La Russie indique également que le pays de l’Ararat est plus que jamais son protectorat – même si ce protectorat est vu par Moscou comme bienveillant – dont la sécurité et les frontières sont désormais assurées par les services du FSB et par l’armée russe.
Est-ce à dire que le sort du Karabagh est également réglé ? La réponse est non selon le même Vladimir Poutine qui rappelle que le statut final du territoire sera déterminé par de futures négociations dans le cadre du groupe de Minsk dont il ne semble pas souhaiter s’affranchir. Dans un entretien séparé avec ses ministres de la défense et des affaires étrangères, Poutine semble au contraire vouloir associer très largement la communauté internationale au règlement du conflit en demandant à ce qu’un contact étroit soit maintenu non seulement avec le groupe de Minsk, mais aussi avec la Croix-Rouge, les agences de l’ONU pour les droits de l’Homme et pour les réfugiés et même avec l’UNESCO pour ce qui est du patrimoine architectural arménien désormais en péril dans les terres conquises par l’Azerbaïdjan.
A écouter aussi : Fenêtre sur le monde. Conflit au Haut-Karabagh
Balkanisation ou intégration régionale : quel modèle demain pour le Sud-Caucase ?
Les propos tenus par ailleurs par le président russe selon lequel « si les conditions appropriées sont créées pour une vie normale et que les relations entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, entre les gens de la vie quotidienne, en particulier dans la zone de conflit, sont rétablies, cela créera un environnement pour déterminer le statut du Karabagh » semblent venir en soutien des diverses provisions de l’accord de cessez-le-feu prévoyant quasiment une libre circulation régionale des Arméniens et des Azerbaïdjanais. Ce point, répété selon diverses modalités au long de l’entretien, est sans doute l’un des plus cruciaux et peut mener à termes à deux modèles fort différents l’un de l’autre dont il est difficile à ce stade de dire lequel a la préférence de leur instigateur russe et surtout lequel il sera capable d’imposer : la balkanisation ou l’intégration régionale.
Le premier modèle est celui qui vient tout de suite à l’esprit : un Sud-Caucase bardé de check-points russes que ce soit en Arménie, au Karabagh ou en Azerbaïdjan et une intrication de bantoustans de plus en plus morcelés – aujourd’hui le Karabagh, demain le Zangézour, après-demain le Nakhitchevan et pourquoi pas le pays lezguien ou le pays talish au Nord et au Sud de l’Azerbaïdjan, auxquels il faudrait ajouter, pour compléter le tableau, l’Abkhazie, l’Ossétie du Sud et éventuellement l’Adjarie côté géorgien ; Avec pour chaque fief un Kadirov local directement inféodé à Moscou. Le second modèle, plus ambitieux, consisterait au contraire à effacer progressivement les frontières nationales pour placer l’ensemble de la région dans le giron d’une pax russiana, voire pour la réintégrer directement au sein de la Fédération russe.
Les deux modèles ne sont pas équivalents – tant s’en faut – ni du point de vue de Moscou, ni de celui des intéressés, ni même de celui des acteurs tiers. Évidemment, l’intégration régionale n’est certainement pas pour demain et nécessiterait certainement de passer par la balkanisation préalable de la région. Pour transiter vers l’intégration régionale, il faudrait sans doute au moins une génération afin que passent faucons et dictateurs et que la Russie mette en place de part et d’autre des leaders malléables et assez peu soucieux de leurs intérêts nationaux ; européens en quelque sorte… À ce jeu-là, les Arméniens ne seraient pas nécessairement gagnants étant donnée leur faible importance démographique vis-à-vis des quelque dix millions d’Azerbaïdjanais. L’avantage pour la Russie de ce modèle serait de la dispenser du maintien lourd et coûteux de forces d’interposition. Ce modèle idyllique, peut-être même irénique, pourrait satisfaire Turcs et Européens, et même les Iraniens, pour peu qu’ils puissent accéder économiquement à ce Sud-Caucase dès lors dépourvu de toute consistance politique.
Ilham Aliev, otage du rapport de force russo-turc
Mais pour l’heure, c’est plutôt le premier scénario qui prévaut, où la région retrouve sa conformation historique de limes, hérissé de mille et une frontières infranchissables. Ce scénario constitue peut-être un moindre mal pour les Arméniens et, pour les mêmes raisons, ne fait clairement pas le jeu de la Turquie. Ankara peut en effet difficilement y trouver plus qu’une influence locale. Avec des chars d’assaut, des lance-missiles et des dispositifs de contre-mesure électronique, l’actuel déploiement de troupes russes au Karabagh va bien au-delà de ce qu’on pouvait attendre d’une simple force d’interposition et semble précisément destiné à mettre en place un tel glacis pour prévenir toute nouvelle velléité belliqueuse de Bakou ou d’Ankara. À ce sujet d’ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure le dictateur azerbaïdjanais a donné son assentiment au cessez-le-feu et à ce déploiement russe qui permet à Moscou de remettre un pied botté au Karabagh et qui fait de l’Azerbaïdjan aussi un protectorat putatif de la Russie. Les rumeurs alléguant de concentration de troupes turques à Igdir, en Turquie, mais à quelques kilomètres de l’Arménie, attestent sans doute du fait que l’éviction de la Turquie du « jeu » caucasien n’était pas un développement prévu par Erdogan. Reste qu’il est difficile de déterminer si ce déploiement a été provoqué par celui de la seule Russie au Karabagh ou le contraire. Reste aussi à savoir si la Turquie a été délibérément flouée par Aliev ou si ce dernier a été mis devant le fait accompli russe. Selon le blogueur Semyon Pegov – généralement bien informé – c’est bien ce deuxième cas de figure qui s’est accompli, par lequel Moscou a transformé une victoire militaire turque en victoire politique russe. D’où certainement le mandat rageur demandé par Erdogan – et voté par l’Assemblée nationale le 17 novembre – pour autoriser le déploiement de troupes turques en Azerbaïdjan.
La France au défi de l’éviction
Quoi qu’il en soit, les grands perdants de ce jeu caucasien – outre l’Arménie et la Karabagh – sont la France, et dans une moindre mesure l’Union européenne et les États-Unis. Dans une moindre mesure, car voilà bien longtemps que l’Union européenne ne fait plus semblant d’avoir des ambitions d’intégration régionale, ni même l’espoir de constituer un modèle de développement. Quand on n’est pas même capable d’assurer ses propres intérêts économiques ou territoriaux – confer la situation chypriote – c’est surtout la gestion de l’effacement politique qui constitue l’agenda du moment. Même analyse pour les États-Unis qui semblent avoir renoncé sous Trump à jouer un rôle déterminant dans la conduite des affaires du monde, mis à part peut-être vis-à-vis de la défense des intérêts israéliens d’une part et d’autre part vis-vis de l’irrésistible montée en puissance de la Chine dont ils continueront de tenter l’endiguement. On ne voit pas que cette tendance lourde puisse changer à moyen terme avec Biden.
C’est donc la France et la France seule qui essaie de revenir dans un jeu caucasien dont elle s’est exclue elle-même par l’incapacité à promouvoir une vision – sans doute même à la concevoir – et par la politique d’impartialité qui a servi de masque à cette incapacité. Paris entend désormais ressusciter le Groupe de Minsk, notamment via des considérations humanitaires et culturelles. L’UNESCO présidée par la Française Audrey Azoulay semble cette fois avoir entendu les menaces que font peser sur le patrimoine arménien du Karabagh et des environs l’occupation azerbaïdjanaise et la politique d’effacement ou d’albanisation menée par Bakou. Ce n’avait pas été le cas en 2002-2004 quand l’Azerbaïdjan avait détruit au bulldozer la nécropole médiévale arménienne de Djoulfa au Nakhitchevan. On a par ailleurs vu le président Macron recevoir les organisations humanitaires des Français d’origine arménienne dès le 12 novembre puis honorer de sa présence le phonéton annuel organisé par ces associations ce 21 novembre, tout en ne dérogeant pas d’un pouce de la conception azerbaïdjanaise du droit international qui considère le Haut-Karabagh comme partie de l’Azerbaïdjan. Derrière ces démonstrations outrées d’amitié, il y a en vérité moins la crainte d’une perte d’influence de la France au Sud-Caucase que celle de petits arrangements entre « amis » turcs et russes et de leur renforcement mutuel qui s’ensuivrait. Du reste le Président Macron a été assez clair sur le modèle qu’il veut éviter en déclarant : « nous comprenons que les Russes discutent avec les Turcs d’une formule possible, dont nous ne voulons pas, qui reproduirait le processus d’Astana pour diviser leurs rôles dans cette région sensible » avant d’ajouter « nous ne pouvons pas avoir d’un côté Minsk et de l’autre Astana. À un moment donné, les Russes doivent faire un choix ». La référence aux arbitrages russo-turcs en Syrie est limpide et constitue clairement le repoussoir de la politique étrangère française.
On se demande bien cependant sur qui la France entend désormais miser pour revenir dans le jeu. Car si en Syrie, notre diplomatie avait parié sur le mauvais cheval des djihadistes anti-Assad, au Caucase elle s’est abstenue de soutenir l’Arménie, « l’amie qu’on a laissé tomber » comme le titrait récemment le Nouvel Observateur. Il est possible qu’Erevan soit désormais circonspect quant aux suspectes démonstrations d’amitiés de Paris. Très curieusement, c’est peut-être bien la Russie qui offrira un strapontin à la France, préoccupé qu’est Moscou de contenir le développement de l’influence politique turque dans la région. De manière générale, Moscou joue en effet un jeu trouble visant à provoquer l’explosion de l’OTAN en poussant la Turquie à des positions de plus en plus inacceptables tout en tentant d’endiguer sa montée en puissance. Et la France – qui présente l’avantage de considérer l’OTAN comme « en état de mort cérébrale » pourrait être utile à Poutine dans cette visée d’endiguement.
Pour Paris, la question sera alors de savoir lequel de Moscou et d’Ankara constitue le moindre mal. On peut supposer – on peut même espérer – que Paris sache reconnaître que le Caucase devrait rester en toute légitimité une zone d’influence russe plutôt que de devenir une nouvelle zone d’influence turque. Il ne s’agit pas de savoir qui on « aime » le plus – comme voudrait nous le faire croire l’État profond dénoncé à plusieurs reprises par le Président Macron – mais qui constitue la menace la plus pressante pour l’Europe et la France. Dans un entretien donné récemment au Grand Continent, le locataire de l’Élysée a évoqué la nécessité « d’encercler » la Russie et la Turquie. Espérons que la France réalise qu’il sera sans doute moins utopique d’encercler les possessions du Sultan que l’Empire du Tsar.