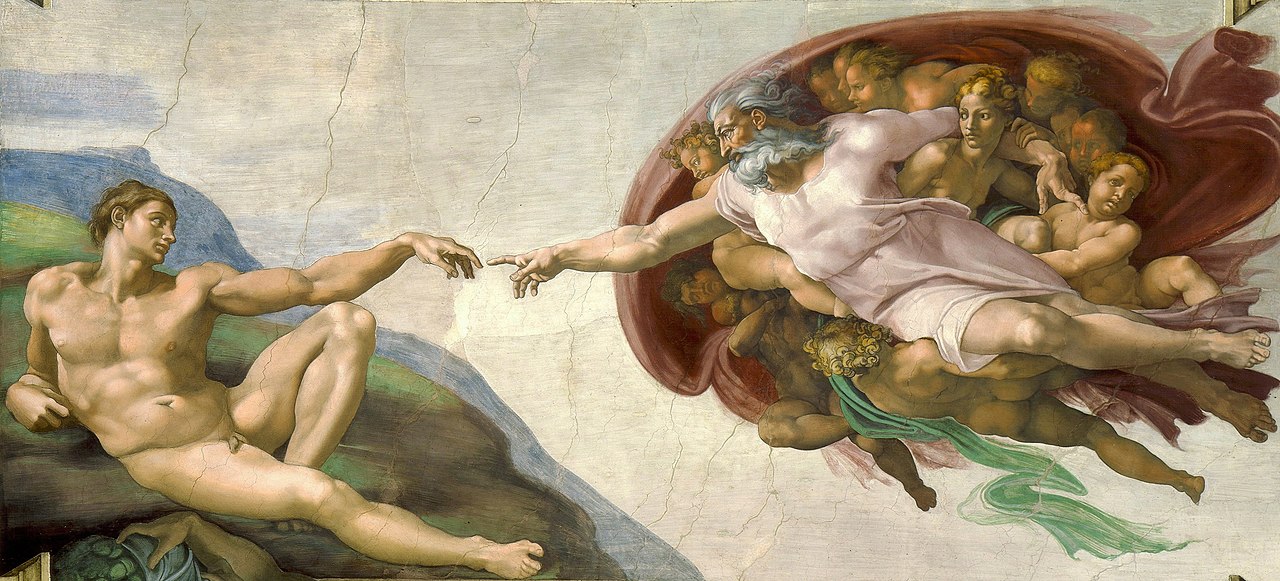Ancien ministre, président de la Fondation Charles de Gaulle, Hervé Gaymard a présenté la dernière édition du premier essai de Charles de Gaulle, La Discorde chez l’ennemi (Perrin, Tempus, 2023). L’occasion de l’interroger sur les grandes lignes de la pensée stratégique du général de Gaulle et de son actualité.
Propos recueillis par Tigrane Yégavian.
Dès son premier livre, La discorde chez l’ennemi, que vous venez de rééditer, Charles de Gaulle affirme d’emblée : « à la guerre, à part quelques principes essentiels, il n’y a pas de système universel, mais seulement des circonstances et des personnalités ». Voyez-vous dans cette citation du futur général une marque artistique ?
Je pense qu’il faut surtout y voir une défiance précoce de De Gaulle à l’égard de tout esprit de système. De ses nombreuses lectures théoriques faites en captivité, de Gaulle tire paradoxalement des leçons de modestie et un refus d’intellectualiser le conflit, leçons que l’on retrouve dans sa correspondance avec ses pairs de l’époque, et que son séjour à l’école de Guerre n’infléchit pas. Je lisais récemment des lettres à Lucien Nachin concernant Ardant du Picq : « On croit ou plutôt l’on veut trop souvent aujourd’hui prêter au matériel ou à l’organisation une vertu qu’ils n’ont pas. Le problème moral, l’amitié, l’angoisse de la tempête qui remplissent forcément le cœur du combattant demeurent le fond de l’affaire ». De Gaulle a connu les tranchées, l’angoisse de l’orage d’acier, il en sort marqué, plus qu’on ne l’a parfois imaginé.
Par ailleurs, Napoléon ne disait-il pas que la guerre « était un art très simple, et tout d’exécution ». Il s’agit de la personnalité la plus fréquemment citée dans le Fil de l’épée. S’il croît à certains préceptes de base, je pense que de Gaulle a très vite le sentiment qu’un chef de guerre doit avant tout savoir s’adapter, changer de pied, et convaincre rapidement du bien-fondé de sa vision. N’oublions pas que son épreuve initiatique, comme combattant, est le désastre de l’été 1914, puis le sursaut de la Marne : Joffre, militaire qu’il voit comme un « colonial », responsable d’une tactique mûrie de longue date, sait, avec l’aide de Galliéni, voir l’avancée excessive de l’aile gauche allemande de Von Kluck, et trouver la force d’engager ses troupes pour sauver la possibilité de poursuivre le conflit. La France a échoué sur ce qui était prévu, et remporté ses premiers succès dans une initiative imprévue, mais dans laquelle elle a su engager toutes ses forces. Pour de Gaulle, tout jeune Saint-Cyrien, cette leçon est sans doute porteuse.
Dans quel contexte a été rédigé La discorde chez l’ennemi ?
Début mars 1916, de Gaulle est laissé pour mort sous Douaumont, au tout début de ce qui sera la bataille de Verdun, cité à l’ordre de l’armée par Philippe Pétain. Il est en fait blessé et entame alors une longue captivité, entrecoupée de tentatives d’évasion audacieuses, mais manquées. Comme officier, il bénéficie cependant de certains privilèges, comme l’accès à la bibliothèque (c’est alors qu’il lit un auteur comme Von Berhardi) et à la presse, évidemment censurée. Afin de rester mobilisé et de ne pas sombrer dans l’inaction, il élabore pour ses camarades d’infortune des conférences dans lesquelles il tente d’éclairer l’évolution du conflit à travers les informations glanées ou supposées de ses lectures. Et finalement, ces lectures l’amènent à appréhender la complexité du système de décision allemand, à présupposer la tension entre l’état-major et l’Empereur, et à pressentir la logique délétère qui va conduire l’Allemagne à la défaite. Parmi ses compagnons de captivité, le journaliste Rémy Roure, qui connaît un petit éditeur spécialisé dans les questions militaires, Berger-Levrault. Roure sera le premier, en 1924, à exalter dans la presse la qualité de l’ouvrage et de son auteur.
En 1923, au sortir de l’École de Guerre, où il a fait une impression mitigée, de Gaulle reprend ses notes pour en écrire un livre, extrêmement construit, où, de manière très précoce, il trouve son ton, sa manière d’embrasser l’histoire en dégageant des lignes de force. Cet ouvrage est essentiel, car il démontre le processus de maturation intellectuelle à l’œuvre chez lui. La captivité l’a éloigné de l’homme du Pont de Dinant, furieusement désireux de se battre, et qui aurait pu rencontrer, dans les premières semaines de 1914, une mort à la Péguy. Prendre du recul, fut-il forcé, par rapport au champ de bataille, l’a transformé, lui a ouvert la voie de la réflexion sur le commandement, et sur l’articulation politico-militaire. J’ajouterai que lors de la mission militaire en Pologne (1919-1921), il est amené à proposer des conférences théoriques sur l’art militaire, qui l’amènent aussi, sans doute, à remodeler ses réflexions sur le sujet.
À lire également
Quand Washington voulait « détruire » de Gaulle
On ressent chez Charles de Gaulle un profond respect de l’adversaire. Comment a évolué son regard vis-à-vis de l’Allemagne et du peuple allemand tout au long de sa carrière depuis sa longue captivité jusqu’à la réconciliation franco – allemande ?
Il y aurait à cet égard un ouvrage à écrire. C’est une question très vaste, à laquelle je ne peux qu’apporter des éléments de réponse épars. Le respect de certains militaires français pour la discipline de l’Armée allemande et le sens tactique de ses chefs n’est pas si rare. Le Lieutenant-Colonel Mayer, maître à penser du Général, fut lui-même mis à pied pour avoir trop loué les qualités de l’Armée allemande de la Première Guerre mondiale au goût de la censure militaire. Concernant de Gaulle, ses vues sont somme toute classiques. Si l’on reprend sa correspondance et ses analyses sur la guerre de 1914, il souligne la préparation de l’armée allemande (« L’ennemi sait faire la guerre »), son armement (particulièrement l’artillerie, un domaine dans lequel le jeune de Gaulle excelle), et son organisation, mais aussi ce qui en est le revers, sa difficulté à s’adapter à l’imprévu (« L’Allemand, incomparable devant les efforts préparés, perd ses moyens devant l’imprévu »), ce qui explique « Valmy, Iéna ou la Marne ».
Une analyse classique, mais là aussi assez largement partagée à l’époque, concerne le commandement allemand, jugé « lointain, incertain », et pas assez interventionniste. Von Moltke, « esprit distingué, âme nuancée », se borne à dresser les grandes lignes de l’offensive, qu’il observe depuis son QG, une école maternelle à Luxembourg. Ses généraux bénéficient d’une large part d’initiative, peut-être trop grande : c’est ce qui conduit Von Kluck à détacher l’aile gauche allemande trop en avant, erreur qui n’échappera pas à Gallieni. Au contraire, de Gaulle considère, ce qui est commun dans sa génération, que c’est la méthode de commandement français qui triomphe à la Marne.
Bien évidemment, sa perception de l’armée allemande change notablement dans les années 1930. Alors au secrétariat du conseil supérieur de la Défense nationale, il a la charge de préparer la loi sur l’organisation de la nation en temps de guerre, et à ce titre a accès aux données du renseignement militaire. Dès 1935, dans ses notes à Paul Reynaud, il décrit avec lucidité une autre armée allemande, transfigurée par la mécanisation accélérée et l’effort industriel. En 1940, ses interventions recoupent toutes un point essentiel : les Allemands ne « foudroient » pas la France du fait de leur supériorité morale ou personnelle, mais plutôt en raison de leur force mécanique. Dans l’appel du 18 juin, il insiste doublement sur « les chars, les avions, la tactique des Allemands » qui rompt les lignes françaises et démobilise les chefs. Il y a dans ce texte, si universellement connu, une volonté de démystifier la puissance allemande, de la ramener aux éléments techniques déjà dépeints dans le Mémorandum du 26 janvier 1940. De Gaulle est l’homme de la situation en juin 1940 précisément, car il n’est pas enfermé dans ce complexe intellectuel, dans cette fascination presque morbide pour la puissance allemande qui domine alors chez les chefs politiques et militaires.
J’ajouterai enfin que de Gaulle croit une réconciliation possible entre Français et Allemands, à condition que cette réconciliation se fasse « sans intermédiaire », ce qu’il exprime dès 1949 dans un discours prononcé à Bordeaux. Je pense que cette formule résume bien sa vision du tropisme otanien de la RFA dans les années 1960.
Entre les deux guerres, de Gaulle a publié de nombreux articles de portée tactique et stratégique, ainsi que deux livres importants ; Le fil de l’épée (1932) et Vers l’armée de métier (1934). Dans quelle mesure a-il reprit à sa manière les principes de Foch ?
Je suis un peu réservé quand on évoque l’apport « tactique et stratégique » de De Gaulle, car c’est peut-être mal cerner l’essentiel de sa contribution théorique. De Gaulle a enseigné l’histoire militaire, jamais la tactique. Et contrairement à Foch, son expérience opérationnelle est restée limitée. Mais surtout, je pense que, dans les années 1930, il cherche surtout à dépasser le débat Foch/Pétain, l’offensive/le feu tue, qui lui semble théorique. Sa contribution essentielle, alors qu’il réfléchit à la préparation de nos forces, tient en deux points.
Le premier est que l’infériorité technologique conduit inévitablement à une infériorité stratégique et intellectuelle. Je ne suis pas certain que de Gaulle prône vraiment une stratégie offensive, mais il plaide pour que l’armée française s’en ménage la possibilité, en disposant de cette force mécanique blindée performante, qui ne saurait être animée que par un corps de professionnels, pointus sur le plan technique et bien entraîné. Mais de Gaulle défend cette nécessité moins par conviction absolue que par pragmatisme, pour une raison simple : il perçoit de manière aiguë la contradiction entre notre système d’alliances de revers contre l’Allemagne, la « petite entente », et notre stratégie attentiste, dominées par le douloureux symbole de la ligne Maginot. L’interpellation de Reynaud à la commission de défense de mars 1935, préparée par de Gaulle et nourrie de ses idées, repose sur ces deux points. Et de Gaulle est cohérent : attentif à la politique de Louis Barthou, il approuve le projet de pacte franco-soviétique (auquel est attaché son ancien compagnon de captivité à Ingoldstadt, Toukhatchevski), par réalisme stratégique. Il verra douloureusement Laval transformer l’élan créé par Barthou en « chef-d’œuvre de galimatias », selon la formule de Duroselle.
À lire également
Charles de Gaulle et la guerre économique : le choix de l’indépendance nationale
Bref, Foch est mort en 1929, de Gaulle élabore ses conceptions stratégiques face à l’armée allemande qui vient, qui se prépare dans les années 1930. Foch a tiré ses enseignements de ses campagnes victorieuses de 1917-1918, que de Gaulle n’a connues que de manière livresque, puisqu’il était en captivité. Foch a réfléchi à la lumière de son expérience opérationnelle, de Gaulle en songeant à préparer l’armée française à la guerre qui s’annonce. Je ne sais pas si la comparaison est si juste sur le plan historique.
Le lieutenant-colonel de Gaulle insistait sur la notion de « surprise stratégique », et il déplorait la propension des Français à la subir régulièrement : « surpris par le péril nous l’acceptons par enthousiasme, mais sans l’avoir préparé » (de Gaulle, 1934, p. 41). Comment définir cette notion ?
Une part substantielle de Vers l’armée de métier est consacrée à la formation des chefs, et de Gaulle souligne douloureusement cette idée qu’en France, l’on a souvent tendance à préparer la guerre d’avant, à plus récompenser de responsabilités les services passés que les potentialités d’avenir. Il faut ici rendre justice au seul homme qu’il n’ait jamais considéré comme un maître à penser, le lieutenant-colonel Émile Mayer, penseur militaire visionnaire et surtout iconoclaste.
En 1934, alors que de Gaulle se passionne pour les chars, Mayer le juge déjà dépassé, presque obsolète : pour lui, la guerre qui vient, ce seront les avions et les bombardements chimiques, qui le passionnent alors. Dans une lettre inouïe du 3 juin 1940 à Paul Reynaud, de Gaulle pose ses conditions pour entrer au gouvernement. Les termes en sont fous : « Une fois devenu le maître, vous nous abandonnez aux hommes d’autrefois. Je ne méconnais ni leur gloire passée ni leurs mérites de jadis. Mais je dis que ces hommes d’autrefois, si on les laisse faire, perdent cette guerre nouvelle. Les hommes d’autrefois me redoutent parce qu’ils savent que j’ai raison et que je possède le dynamisme nécessaire pour leur forcer la main ». De Mayer, de Gaulle a tiré des leçons d’irrespect et d’intempestivité.
Je pense également que Mayer influence de Gaulle en lui donnant des grands chefs militaires français une image assez terne. En 1919, alors que les grands chefs sont portés aux nues, Mayer publie un opuscule, Trois maréchaux, Joffre, Foch, Galliéni, dans lequel, avec une ironie féroce et une certaine perfidie, il présente les trois infortunés (qu’il a personnellement connus) comme quasiment analphabètes sur le plan stratégique, dupé lamentablement par l’état-major allemand et sauvé par un miracle d’improvisation à l’été 1914. Cette idée traverse des écrits comme le Fil de l’Épée ou La France et son armée : la France sait se battre, mais elle ne sait pas se préparer, elle souffre d’une forme d’atonie intellectuelle sur le plan stratégique qu’elle compense sur le fil du rasoir par une forme de furia francese au combat, où l’enthousiasme, le courage compensent des plans mal engagés. Mais la faiblesse peut devenir force : le soldat français sait se battre sans disposer d’un plan établi, c’est d’ailleurs ce qui le distingue de l’Allemand, incapable de se repositionner. Tout l’objet du Mémorandum du 26 juin 1940 consiste précisément à mettre en garde contre cette atonie, et à annoncer la guerre qui s’annonce. Mais en 1940, la surprise principale, c’est la vitesse des opérations allemandes, de celles qui ne laissent précisément pas le temps de se ressaisir.
À lire également
Quand Charles de Gaulle franchit le Rubicon
N’oublions pas que, président de la République, de Gaulle a sans cesse accordé une importance fondamentale à l’enseignement militaire, dont, comme le rappelle Philippe Vial, il inspectait les écoles chaque année, veillant notamment à ce que la dissuasion soit bien comprise et intégrée dans une vision stratégique renouvelée. Cet enjeu de formation et de « mise à jour » des futures élites militaires aux enjeux à venir est à mon avis une ligne de force de sa manière de penser l’Armée.
Quelle place occupait le facteur moral dans la pensée du général de Gaulle imprégné de valeurs de chevalerie ?
J’ai cité plus haut la lettre à Nachin. On connaît la célèbre trilogie gaullienne de fabrication de la décision, influencée par Bergson. L’appréhension première d’une situation est de l’ordre de l’instinct, du « flair ». C’est ensuite que l’intelligence intervient pour classer les informations, définir les chemins possibles. Mais en dernier ressort, « la décision est d’ordre moral », et savoir la prendre sans faiblesse est ce qui définit le chef entre toutes qualités. Cette décision, d’ordre moral, chaque Français libre a eu à la prendre au moment de tout quitter. De Gaulle l’exprime pudiquement dans un discours de 1941 : « Chacun ici sait ce qu’il lui en a coûté ». Il y a dans la France libre, de manière très précoce, l’idée que les hommes et les femmes qui ont fait ce choix sont une élite morale, destinée à reconstruire la République et l’État, qui a failli en 1940. C’est pour cette chevalerie que l’Ordre de la Libération est créé en octobre 1940, à Brazzaville. Dès lors, à ces hommes destinés, comme les combattants de Bir-Hakeim, à jouer « un grand rôle dans une grande occasion », de Gaulle demandera tout, et sans doute plus encore.
J’étais récemment à Alger, et dans les Mémoires d’Espoir, de Gaulle évoque le « souffle âpre et salubre » qui y souffle quand, à compter de l’automne 1943, Giraud est mis de côté et tout se met en place : l’Assemblée travaille à préparer la France d’après, en bâtissant un large compromis entre droite et gauche, l’Armée de Libération fait la synthèse entre la France libre et l’armée d’Afrique, sous l’égide de grands soldats retrouvés, comme de Lattre ou Juin qui, lors de la campagne d’Italie, mène ses troupes, et particulièrement les bataillons nord-africains, à des initiatives et à des percées inouïes d’audace et de courage, qui jouent sans doute beaucoup pour sécuriser notre place à la table des vainqueurs de 1945. Cette dynamique, de Gaulle l’a créée, l’a fait vivre dans les temps les plus crépusculaires grâce à quelques héros comme Leclerc et König et aux troupes d’AEF. Sa victoire finale est de la transmettre à des unités élargies, capables de libérer le territoire. Leclerc ne disait-il pas que la constitution de ces troupes destinées à libérer Paris avait été « sa plus belle victoire » ?
Dans quelle mesure la pensée du général consacrée au concept de « projection des forces à l’extérieur du territoire national » est d’actualité ?
Il faut bien distinguer deux héritages. Dans les années 1930, de Gaulle envisage une capacité de projection mécanisée destinée au terrain européen, capable de créer des brèches et de créer de l’insécurité stratégique chez l’adversaire. Pendant la Guerre, la France libre crée une culture expéditionnaire en raison de l’apport initial absolument massif des troupes de l’Empire, et de la nécessité de s’engager sur plusieurs terrains (Tchad, Syrie, et même Russie avec l’escadrille Normandie Niemen) pour peser militairement comme politiquement face aux alliés. Enfin, l’armée des années 1960, repensée avec le CEMA, le Général Ailleret, abrite plusieurs composantes : des contingents centrés sur le théâtre européen, notamment stationnés en Allemagne, les forces liées à la dissuasion (SNLE, Mirages), et des troupes de projection, destinés notamment à honorer les accords de sécurité signés avec les pays africains et la présence française dans nos outre-mer. Je pense qu’il y a là, comme souvent chez de Gaulle, une construction progressive, mais aussi une capacité à remodeler les équilibres militaires : dans les années 1960, les LPM seront les outils de la nucléarisation rapide des forces.
Il me semble que l’héritage de de Gaulle réside dans cette complétude qui implique des choix capacitaires, dans cette volonté de conserver un format d’armées qui préserve l’essentiel des capacités d’action, ce que la France tente de faire, à la mesure de ses moyens et de l’évolution de celle de ses partenaires et rivaux.
« L’épée est l’axe du monde et la grandeur ne se divise pas » (1934, p. 251) écrivait le général. Pourriez-vous commenter cette citation ?
Je pense que cette formule se réfère directement à la fin de l’esprit de Locarno, porté par Aristide Briand. En 1926, à l’occasion de l’entrée de l’Allemagne à la Société des Nations, Briand pouvait déclarer : « C’en est fini des longs voiles de deuil sur des souffrances qui ne s’apaiseront jamais ; plus de guerres, plus de solutions brutales et sanglantes à nos différends ! ». Il meurt en 1932. Deux ans plus tard, de Gaulle cherche surtout à réveiller les esprits engourdis dans des illusions cotonneuses : la réalité reprend ses droits. La crise de 1929, l’arrivée de Hitler au pouvoir (1933), l’échec de la conférence sur le désarmement (1934) dessinent un tout autre paysage européen, un paysage auquel finalement l’on revient toujours, finalement, inéluctablement.
À lire également
Rien que la terre: La géopolitique gaullienne avant de Gaulle
Car je pense que ce que de Gaulle formule ici, qui est d’une grande actualité, c’est la part d’invariants stratégiques qui existe chez toute nation historiquement ancrée. Dès le début des années 1920, il considérait que « La Russie des tsars » boirait le communisme « comme le buvard boit l’encre ». En 1934, il revoit surgir avec lucidité le militarisme allemand, sous des traits nouveaux et totalitaires, mais avec des objectifs stratégiques en Europe centrale et à la frontière française finalement immuables, car dictés par la géographie. Le Quai d’Orsay, qui juge Hitler bien moins dangereux que Von Schleicher, car moins directement lié à la Reichswehr, n’a pas cette lucidité. C’est dès lors la tâche du soldat de veiller, de prévenir les dangers, de garantir le « génie » du pays. C’est en effet par ce mot que se clôt la France et son armée (1938) : « Grand peuple, fait pour l’exemple, l’entreprise, le combat, toujours en vedette de l’histoire, qu’il soit tyran, victime ou champion, et dont le génie, tour à tour négligent ou bien terrible, se reflète fidèlement au miroir de son armée ».