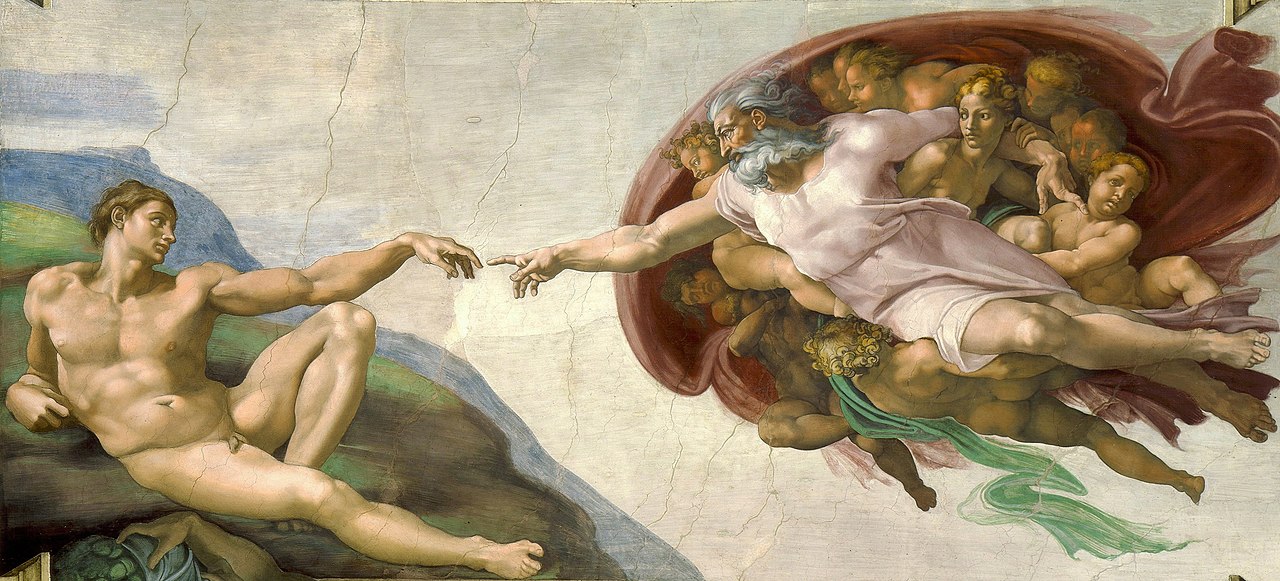La politique est devenue impuissante et déclassée, le peuple se détourne des suffrages, l’abstention massive manifeste le désintérêt des citoyens à l’égard des élus. Pourtant, la France était autrefois le pays du politique, mais cette exception semble aujourd’hui terminée. Arnaud Benedetti analyse les causes de cet effacement du politique et de ce désamour des Français.
Arnaud Benedetti est rédacteur en chef de La Revue politique et parlementaire. Il est également professeur associé à Sorbonne-Université, ainsi qu’aux Hautes études internationales et politiques. Il a publié Comment sont morts les politiques ? Le grand malaise du pouvoir, (Le Cerf, 2021). Entretien réalisé par Antoine-Baptiste Filippi.
La thèse de votre ouvrage est celle d’un effacement du politique dans la démocratie moderne, un processus enclenché voilà plusieurs décennies. Pouvez-vous nous en dire davantage ?
Nous assistons à un triple effacement : celui de la souveraineté des États-nations, celui de la démocratie dans sa dimension libérale, celui des peuples comme corps politique. Encore faut-il nuancer ou distinguer, car certains États, comme le Royaume-Uni, l’Allemagne ou les États-Unis disposent encore dans des formes différentes des moyens de leur souveraineté, laissent tout autant les processus délibératifs réguler l’espace démocratique et n’ont pas, loin de là, dissous le peuple au profit d’une classe dirigeante à dominante oligarchique. Non pas que ce processus n’existe pas au sein de ces trois pays, mais il est mieux contenu, quand bien même les phénomènes décrits plus haut tendraient à se développer : néanmoins l’Allemagne gouverne d’abord ses intérêts, les États-Unis aussi, le Royaume-Uni tout autant. Le problème est surtout français. Il y a une virulence française dans le dépérissement politique : parce que l’État y est historiquement le principe d’organisation, de cohésion de la société et que cet État ne répond plus qu’aux inputs de la globalisation sans vouloir y résister, tenter de les maîtriser ; parce que le débat y est capté, kidnappé par un marais idéologique qui considère qu’il n’existe pas d’autre légitimité que la sienne pour être habilité à gouverner ; parce que le peuple qui est l’autre figure majeure de l’histoire de France n’est plus qu’un chœur dévitalisé dont la fonction n’est plus agissant, mais décorative.
Vous posez dans vos différentes analyses la question de la souveraineté (souveraineté nationale, technologique, industrielle…) comme consubstantielle à la compréhension de cet effacement du politique en France. À l’heure d’une intégration européenne toujours plus poussée, le pouvoir d’action des politiciens français, et à travers eux le politique, est-il condamné à périr ?
Pourquoi aujourd’hui l’abstention métastase la démocratie ? Pourquoi par ailleurs toutes les scintigraphies approfondies des opinions montrent la désaffiliation croissante de la société vis-à-vis des institutions et de leurs représentants ? Le processus n’est pas nouveau ; il remonte à des décennies, aux années 1980, à l’assomption d’un contresens historique sur la nature même du libéralisme réduit à un économicisme mâtiné de technocratisme sur fond d’effondrement des molochs marxistes avec la chute de l’URSS et de ses satellites. S’est ouvert et propagé ainsi l’illusion d’une victoire irréversible d’un monde libre. Or ce monde, qui s’était débarrassé certes des monstres totalitaires a confondu la dérégulation avec la liberté, le capitalisme sans frein avec l’arc démocratique, le marché absolutiste avec le libéralisme qui est d’abord une philosophie politique qui n’a pu , historiquement, s’accomplir que dans le cadre de l’État-nation. Le libéralisme historiquement en Europe ne se réalise qu’au travers d’une nation qui légitime un État. Il suppose un État qui opère, qui protège, qui délimite, qui ne se résout pas être le sous-traitant de donneur d’ordre supra-territoriaux. À partir du moment où les États sont dépossédés de leurs prérogatives, c’est toute l’idée de la politique en Occident telle qu’elle s’est façonnée depuis le XVIIIe siècle et particulièrement en France qui s’abolit progressivement. À ce dépérissement s’ajoute l’idéologie dominante qui justifie l’affaissement étatique par l’idéologie unanimiste de la non-alternative sur le plan économique notamment, mais pas seulement et dont l’Union européenne constitue l’acmé. Les démocraties n’apparaissent plus que faussement pluralistes à partir du moment où elles débouchent sur des politiques identiques, nonobstant les alternances formelles. Le politique a perdu sa capacité à être, c’est-à-dire à agir de manière souveraine et le peuple ne dispose plus de son autonomie à opérer des choix , autres que ceux de ses dirigeants. Le traité de Lisbonne est l’aboutissement de cette déperdition. Et de facto s’impose le sentiment, pour le moins fondé par la réalité, que le pouvoir ne peut plus et que la démocratie serait un vain mot. Nous aurions perdu dans un même élan l’État-nation d’une part et la démocratie libérale d’autre part.
À lire également
Nouveau Numéro : Nucléaire l’atome, futur des armées et de l’énergie ?
Est-ce là une explication structurelle à l’abstention toujours plus importante aux élections ?
L’abstention résulte de cette impuissance, mais aussi de la démonétisation du vote que la non-prise en compte du Non au référendum de 2005 a accéléré. Ce déni démocratique continue de miner l’adhésion à la représentation, mais aussi à l’acte qui est censé la constituer, la produire : le vote. Toutes les élections sont frappées d’un reflux de la participation, notamment des classes populaires et d’une partie des classes moyennes qui de la sorte expriment une forme d’objection de conscience civique. À ce phénomène se greffe également le déclassement des activités politiques : le processus est d’ailleurs cumulatif, car plus le pouvoir renonce à son pouvoir et moins la représentation est représentative de la réalité des opinions, moins le politique est sélectif dans ses modes de recrutement, moins il est attractif, plus il appelle des profils propices au conformisme et à l’ajustement aux normes dominantes. La politique n’est plus cette école de l’excellence qu’elle fut à ses sommets dans toutes les républiques jusqu’au tournant des années 1980. Elle est gagnée par la spécialisation comptable, dont François Mitterrand avait prédit l’avènement, par la substitution de la communication à la rhétorique, par l’oubli de l’histoire et le culte de l’immédiateté , par une absence cruelle de profondeur au profit de l’emprise technicienne.
Plus conjoncturellement, la crise du Covid-19 met en évidence une importance grandissante des comités scientifiques et techniques au détriment du politique qui semble s’en remettre à ces derniers. La chose semble se constater dans l’ensemble des domaines, est-ce révélateur de cette crise du politique que vous évoquez dans votre ouvrage ?
La technique écrase tout ; elle « arraisonne la nature » pour reprendre le mot de Heidegger, à commencer par la nature politique de l’homme. Elle renverse le paradigme aristotélicien : l’homme n’est plus un « animal politique » doué d’une raison spécifique qui l’amène à délibérer, mais d’abord un animal technicien au service du « système technicien » comme l’a expliqué avec prescience voici cinquante ans Jacques Ellul. Le process a pris le pouvoir, tout est question d’adaptation à une sorte de reproduction systémique et d’irréversibilité, de recherche d’effet cliquet qui interdise toute alternative, encore moins de retour en arrière. C’est vrai pour l’économie, c’est vrai pour le sociétal aussi, c’est le cas également pour l’ordre institutionnel et juridique.
Le saint-simonisme a comme trouvé son régime de croisière avec le techno-libéralisme dont l’Union européenne constitue la morne illustration et dont le macronisme en France est le bras armé. Le vrai « grand remplacement » est celui de la politique par la technique, du politique par le technocrate, de la démocratie libérale par la seule expertise technicienne, de l’État-nation par une orbe supranational et affranchie des logiques territoriales. Évidemment cette pression générique s’exerce diversement selon les États, la nature de leurs institutions, leur taille et volume de population, leur poids stratégique et économique, leur degré d’attachement à leur culture et civilisation, etc. Les pays-continents ont de ce point de vue un avantage comparatif indéniable sur les petits États-nations européens par exemple, quoique même parmi ceux-ci des différences de conduites se font jour . La France subit de plein fouet encore une fois cette accélération, alors que les autres grandes puissances européennes que sont par exemple la Grande-Bretagne et l’Allemagne conservent des marges de manœuvre stratégiques qui garantissent leur autonomie. Le Brexit d’un côté en Angleterre, la souveraineté effective de l’Allemagne dans la production d’un certain nombre de biens actent cette réalité. La peau de chagrin française trouve ainsi dans l’eschatologie de l’Union européenne un levier pour réactiver l’idée de la puissance et de la souveraineté , la fameuse « souveraineté européenne » d’Emmanuel Macron, mais ce n’est là qu’une illusion, fort peu partagée au demeurant par nos autres partenaires.
Au passage, qu’est-ce que cette crise politico-sanitaire dit de notre conception des libertés individuelles ?
La gestion de la crise sanitaire a révélé aux Français la lumière crue du déclassement de leur pays. Les politiques de santé constituaient aux yeux de nombre de nos compatriotes un motif encore de fierté. L’épidémie a hélas opéré comme un facteur de désenchantement. Sur les moyens hospitaliers, sur les stocks stratégiques, sur la capacité à développer un vaccin, le choc a été brutal et s’y ait rajouté la prise de conscience d’une organisation additionnant la brutalité managériale à l’enchevêtrement courtelinesque de bureaucraties désarticulées, entassées et ne communiquant que peu ou pas entre elles. La France a cumulé tous les défauts du management privé et de l’administration publique. Tout cela a généré une parole publique peu crédible, cherchant plus à couvrir l’impéritie de son action qu’à tenir un langage de vérité. Mais ce n’est pas tout, car la crise a mis en lumière autre chose, une sorte d’effet balancier : à proportion que l’État n’est plus souverain, ni stratège, il devient pour assurer sa mission de protection plus intrusive, plus liberticide, plus totalisant dans l’organisation de la vie quotidienne. La logique des passes (passe-sanitaire, passe-vaccinale) outre qu’elle entaille à la base les principes fondamentaux de nos régimes de libertés publiques enclenche un engrenage où l’exception se normalise et où l’existence de chacun est domestiquée par l’attribution d’un crédit social. Le modèle chinois a parfaitement démontré que le système capitaliste pouvait sans peine se départir de la démocratie et de ses libertés ; la covidisation aura accommodé les sociétés occidentales à une société de la surveillance.
Les instances qui auraient dû servir de garde-fou (Conseil d’État et Conseil constitutionnel) en matière de libertés ont au prix d’une casuistique pharisienne validé par opportunité politique des mesures d’exception qui ne sont que très peu fondées scientifiquement, et encore moins proportionnées. Rappelons que l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, laquelle est partie intégrante du bloc de constitutionnalité, stipule que « nul ne peut être contraint à faire ce que la loi n’ordonne pas ». Le passe vaccinal outrepasse, si j’ose dire, ce principe. Cette acculturation à un techno-capitalisme autoritaire qui n’a rien de libéral a trouvé en France sans doute l’un de ses points d’application les plus accommodants. Le paradoxe c’est que l’on perd tout à la fois la protection par carence des moyens d’un État qui n’est plus de droit, mais qui est guidé par des hypothèses purement biologiques ( le biopouvoir foucaldien) et sanitaires ainsi que la liberté qui n’est plus une valeur, mais une variable d’ajustement. Ce retournement est l’enseignement principal de cette crise.
Cette gouvernance technocratique et globalisée, réputée raisonnable et seule voie possible, que vous évoquée, est-elle du fait des politiques ou s’est-elle imposée à eux ? Est-elle une fatalité ?
Il résulte de dynamiques socio-historiques latentes et puissantes qu’un sociologue comme Norbert Elias a parfaitement étudiées, c’est-à-dire un mouvement de haute atmosphère en quelque sorte avec des niveaux d’intégration toujours plus supérieurs et dont les instances supranationales et les très grands ensembles régionaux, fortement imbriqués, sont l’illustration. En d’autres termes le monde n’a jamais été aussi interdépendant et cette interdépendance réduit mécaniquement les autonomies politiques, notamment celles des États-nations, briques de la modernité politique. Pour autant la responsabilité politique ne peut être écartée . La perte de maitrise n’est pas un phénomène inéluctable ; il s’agit aussi d’une « étrange défaite » , d’une trahison des élites aussi qui abandonnent les nations et les démocraties au profit d’un capitalisme globalisé, technicien, déraciné qui devient le Moloch et la mesure de toute chose. Machiavel explique que la fortune est évidemment cardinale dans le moteur de l’histoire, elle a le visage d’une nécessité qui contraint profondément l’action des Princes, mais le vrai Prince, poursuit-il, est celui qui est capable de faire preuve de virtù, c’est-à-dire d’une énergie apte à contenir, voire à détourner le cours de l’irréversibilité des événements. Reste à savoir s’il existe sur la scène politique française un Prince au sens machiavélien. D’aucuns semblent en douter…
Cette disparition des politiques est-elle une mauvaise chose ? Compte tenu des mauvaises décisions qui ont été prises au cours des dernières décennies que vous évoquées dans votre ouvrage notamment, sur le plan économique, migratoire, institutionnel, faut-il regretter cette disparition ? Ne pourrait-on pas concevoir une société qui fonctionne sans les politiques ?
Alain Supiot parle quelque part d’un retour aux féodalités. Je crois que si l’on regarde avec un œil historique le paysage contemporain, il est celui d’une friche politique post empire romain. Des formes d’organisations diverses sont en concurrence : des États-nations qui résistent plus ou moins bien en fonction des pays, des grands ensembles interrégionaux comme l’Europe par exemple, des instances supra-nationales, des États empires comme la Chine, les États-Unis, la Russie, des structures transverses qui ne connaissent pas de frontières, ni de territoires comme les entités capitalistiques d’un genre nouveau à l’instar des GAFAM ou des grands fonds gestionnaires qui opèrent au travers d’une transhumance permanente digne des bandes de chasseurs du paléolithique. Nous assistons à une révolution au sens astronomique, c’est-à-dire à un retour à un état antérieur où la désorganisation prime, où l’archipel des formes d’organisations anciennes, nouvelles ou en gestation ouvre la voie à des concurrences et conflits inédits dont on ne peut à ce stade dire ce qui en résultera. L’avenir est une boite noire, mais ce qui apparaît certain c’est la résurgence le moment venu d’une forme politique dominante. On ne peut se passer de la politique, le système technicien est lui même politique ; le problème c’est qu’il ignore les peuples et les démocraties. Toute la question consiste à savoir si nous ne sommes pas en train de sortir, nous autres Occidentaux, de cette civilisation politique des plus sophistiquées qui articulait la puissance du politique à la liberté des sociétés. Ce fut là le miracle des noces de l’État-nation et des démocraties libérales. Ce prodige n’est hélas plus une évidence.
À lire également
Europe : le crépuscule des bureaucrates. Entretien avec Henri Malosse