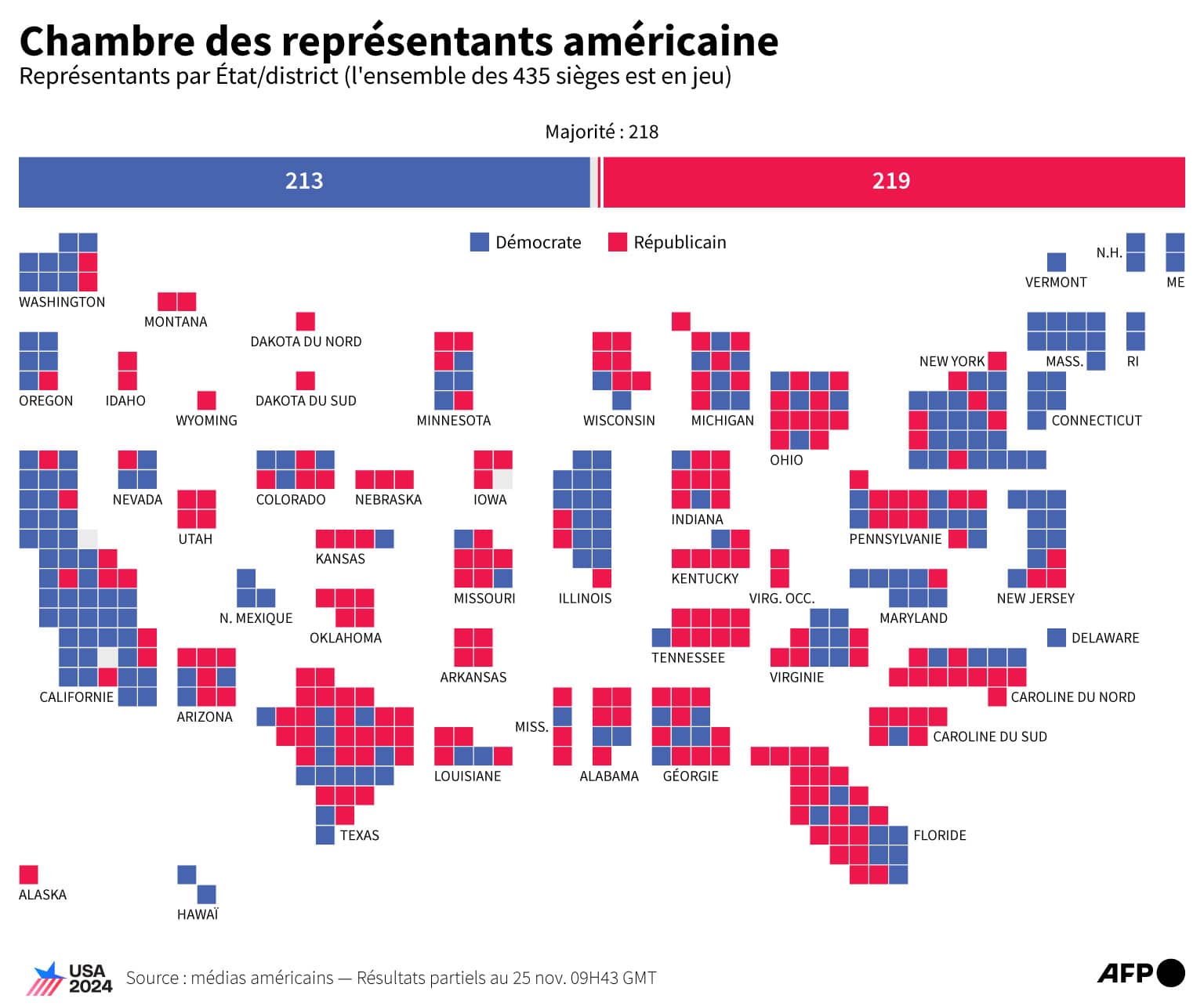Les élections américaines se déroulent dans un climat électrique. En cas de conflit entre les deux candidats, il pourrait revenir à la Cour Suprême d’être l’arbitre du choix du nouveau président.
Par François-Henri Briard et Stéphane Bonichot.
François-Henri Briard est avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation et président de l’Institut Vergennes, qu’il a fondé en 1993 avec le juge à la Cour suprême Antonin Scalia. Stéphane Bonichot est avocat au Barreau de Paris. Spécialistes des États-Unis, ils sont tous deux associés du Cabinet Briard, Bonichot & Associés.
Les élections américaines du 5 novembre vont à nouveau se dérouler dans un climat d’extrême polarisation politique, qui laisse entrevoir de possibles contestations. Les tribunaux, la Cour Suprême et même le Congrès pourraient être conduits à statuer en cas de refus par l’un ou l’autre des candidats des résultats du vote. En théorie, la Cour suprême n’a aucune compétence en matière d’élections, la Constitution du 17 septembre 1787, qui l’a instituée, est muette sur ce point. En pratique, ce sont les juges des États qui sont amenés à trancher les litiges en matière électorale. Pourtant, lors de l’élection de 2000, opposant le républicain George W. Bush au démocrate et vice-président sortant Al Gore, et alors que la plus grande confusion régnait sur le décompte des voix dans quatre comtés de Floride, la Cour suprême s’était auto-saisie le 9 décembre pour interrompre le recomptage manuel des voix dans cet État et figer le résultat en faveur du candidat républicain, qui disposait d’une avance de 327 voix. Les arguments invoqués étaient de deux ordres : garantir l’égal traitement des citoyens devant la loi au nom de «l’equal protection clause » (chose que les modalités du recomptage décidé ne permettait pas) et respecter le calendrier électoral, qui imposait une date butoir pour la présentation des listes de grands électeurs.
À lire également
Élections américaines : trois scénarios pour un pays qui restera divisé
2000 : la Cour intervient dans l’élection
Cette décision aux conséquences majeures (qui a réellement permis au président Bush d’être élu) a été prise à la majorité simple. Défendue et argumentée par le juge Antonin Scalia, elle n’avait, à l’époque, pas fait l’objet de remise en cause frontale, tant la légitimité de l’institution était importante. Al Gore, à la lecture de l’arrêt, avait immédiatement concédé sa défaite. Gardienne de la loi fondamentale américaine et institution régulatrice de la démocratie américaine, la Cour est la juridiction suprême la plus puissante sans doute jamais constituée dans l’histoire humaine. Ses membres, six à l’origine, neuf depuis 1869, sont nommés à vie, et ils ont, selon le mot d’Alpheus Thomas Mason, le pouvoir « d’envoyer en enfer le Congrès, le Président et les gouverneurs des États ». Mais depuis le début du Millénaire, un climat de défiance envers les institutions s’est développé (des deux côtés de l’Atlantique…), et il n’épargne plus la Cour suprême, qui fait maintenant l’objet de questionnements inédits.
Ces remises en cause de l’institution touchent moins à l’étendue de ses attributions qu’à son essence même, à savoir sa composition, le système de désignation de ses membres, et leur éthique. Le Juge Stephen Breyer, grand francophile, a remarquablement mis en perspective le risque de politisation que peuvent susciter les décisions de la Cour dans son ouvrage « l’Autorité de la Cour suprême au péril de la politique ». Fait extrêmement significatif, le président Joe Biden a dévoilé le 29 juillet un projet de réforme radical de la Cour, qui prévoit notamment de limiter le nombre de mandats des juges (18 ans maximum et nomination de deux nouveaux membres tous les deux ans). Ce projet, qui n’a aucune chance d’aboutir en l’état faute d’assentiment du Congrès, s’est accompagné d’une dénonciation de « l’extrémisme qui sape la confiance du public dans les décisions des juges », visant implicitement la décision du 24 juin 2022, abrogeant l’arrêt Roe/Wade (qui portait sur l’avortement) ainsi que la décision du 1er juillet 2024 sur l’immunité présidentielle de Donald Trump.
Le risque de politisation
Joe Biden, il est vrai, n’en est pas à son coup d’essai. En 2021, déjà, dans les semaines suivant son élection, il avait proposé d’augmenter le nombre de juges pour « limiter » la faculté accidentelle d’un président de façonner les équilibres politiques au sein de la Cour suprême. Trois juges – Neil Gorsush (en avril 2017), Brett Kavanaugh (en octobre 2018) et Amy Correy Barrett (en octobre 2020) – venaient d’être nommés par son prédécesseur Donald Trump, au cours de son mandat de quatre ans. La situation, tout à fait fortuite, mais sans précédent, avait nettement déplacé le centre de gravité de la Cour du côté des conservateurs et alimenté les critiques sur la politisation de l’institution. Le débat n’a en réalité rien de très nouveau ; il resurgit périodiquement, la non-coïncidence entre majorité politique et orientation supposée des membres de la haute juridiction étant assez banale aux États-Unis, où les mandats de l’exécutif sont courts et les alternances fréquentes. Cette non-coïncidence participe de l’équilibre entre les pouvoirs. Dans les années 1930, l’exécutif, alors dirigé par le Président Franklin D. Roosevelt, avait croisé le fer avec la Cour au sujet du New Deal et avait lui-même essayé, sans succès, de diluer la majorité de la Cour en augmentant le nombre de ses membres (« court packing »)…
La vigueur des attaques qu’affronte actuellement l’institution, et la polarisation des esprits qui en découlent doivent cependant amener à se poser la question de la politisation des décisions de la Cour, et à réexaminer les fondements du système de nomination de ses membres.
« L’Appointment clause » confère au Président des États-Unis le pouvoir de nommer les membres de la Cour suprême. Cette prérogative est essentielle, mais, dans ce processus, le Président n’est pas seul. Le Conseiller juridique de la Maison-Blanche, le ministère de la Justice, les parlementaires peuvent lui suggérer un nom, lui présenter des listes. La puissante American Bar Association a longtemps possédé une capacité d’influence notable. Elle a été aujourd’hui supplantée par la Federalist Society, un think tank attaché à une vision originaliste, qui se veut fidèle aux idéaux des « Pères Fondateurs de la Constitution » et aux libertés individuelles. Les membres de la Cour suprême doivent être des professionnels du droit, professeurs, ou, le plus souvent, juges fédéraux ou avocats. Leur nomination doit être impérativement validée par le Sénat, qui soumettra les candidats à des enquêtes approfondies, et à un feu roulant de questions lors des auditions. Les candidats doivent se soumettre à une enquête du FBI, rendre des comptes sur leur vie privée, leurs attaches politiques et associatives, leur compétence professionnelle, leur vision de la séparation des pouvoirs et de la politique jurisprudentielle de la Cour. Le tout sous l’œil des médias.
La question de la nomination des juges
Le processus peut s’étendre sur plusieurs mois et s’apparente à une course d’obstacles. Le système présente donc des garde-fous robustes qui empêchent qu’un président nomme à la légère une personnalité non qualifiée, ou trop engagée. Une dizaine de nominations ont d’ailleurs été repoussées, par exemple en octobre 1987, lorsque le juge libertarien Robert Bork, proposé par Ronald Reagan, fut rejeté par un vote hostile de 58 sénateurs, dont six républicains (la majorité des trois-cinquièmes était alors requise pour le vote de confirmation). A contrario, la confirmation par le Sénat confère aux juges une double légitimité, emprunte autant à l’exécutif qu’au législatif, et une autorité sans équivalent[i].
La combinaison du principe de l’intangibilité et de la règle de la nomination à vie est essentielle à l’impartialité et l’indépendance des membres de la Cour. Le caractère irrévocable de leur nomination les soustrait à l’influence de celui qui les a désignés. Le caractère perpétuel de leur charge constitue une garantie supplémentaire, le juge n’ayant pas à se soucier de l’impact de décisions qu’il pourrait prendre sur la suite de sa vie professionnelle. Ainsi, en juin 2012, le Chief Justice (président) John Roberts, ancien avocat nommé par George W. Bush, a-t-il pu trancher en faveur de la constitutionnalité de l’Obamacare, la réforme de la l’assurance santé défendue par Barack Obama. La Cour suprême, en dépit de sa majorité conservatrice, a récemment consacré des avancées sociétales, en confirmant l’interdiction de toute discrimination à l’encontre des homosexuels et des personnes transgenres en matière d’emploi (décision Bostock vs. Clayton County, juin 2020). La fameuse décision Dobbs vs. Jackson du 24 juin 2022, qui a suscité tant de commentaires, doit s’analyser au regard du Droit. Contrairement à ce qui a pu être dit et écrit de ce côté-ci de l’Atlantique, la Cour n’a pas statué sur l’avortement ni sur le droit à la vie. Elle s’est cantonnée au texte de la loi fondamentale en constatant que la Constitution de 1787 ne contenait aucun élément susceptible de fonder un droit à l’avortement. Dans son arrêt, la haute juridiction se borne à juger que la décision sur cette question appartient au peuple et à ses représentants dans les 50 États qui composent la Fédération[ii].
À lire également
L’avortement, terrain miné pour le candidat Trump
Des lignes de clivage doctrinales
Il faut se garder de lectures simplistes qui consistent à présenter les décisions de la Cour comme idéologiques et non comme fondées sur le Droit. En réalité les lignes de clivages sont essentiellement doctrinales. Les juges dits conservateurs ne veulent pas donner une interprétation constructive des textes fondateurs. Ils s’inscrivent dans le courant de l’originalisme, qui consiste à lire la Constitution telle qu’elle est, sans l’interpréter, mais au contraire en l’appliquant au sens des Pères Fondateurs. Cette approche est totalement antinomique avec la doctrine du droit vivant, qui repose sur une interprétation extensive en fonction de l’évolution du contexte et des mœurs. Cette vision, défendue par les progressistes, est aujourd’hui la vision dominante en Europe – ce qui peut expliquer, au passage, notre difficulté à comprendre sans caricaturer le débat juridique américain contemporain. L’opposition entre originalisme et droit vivant renvoie également à des divergences d’appréciation très nettes sur la répartition des rôles entre États fédérés et l’État fédéral.
En conclusion, le climat actuel de défiance, même s’il représente un enjeu, ne devrait pas être de nature à peser sur la jurisprudence de la Cour suprême, pas plus que la victoire de l’un ou l’autre des candidats. Les juges resteront impartiaux et indépendants jusqu’au bout, car ils se savent tenants de l’équilibre institutionnel américain. À ce propos, et en particulier, on notera que Kamala Harris s’est abstenue de critiques frontales à l’égard de l’institution, consciente qu’elle est de son rôle dans l’équilibre de la Fédération. De même, tout porte à croire que la Cour ne tombera pas dans une lecture partisane d’un litige électoral. Si ses membres étaient conduits à intervenir en dernière extrémité – démarche qu’ils se sont refusé de faire en 2020, malgré les appels pressants de certains partisans de Donald Trump -, il y a tout lieu de penser qu’ils se montreront extrêmement prudents et que leur décision sera exclusivement juridique. La Cour aura sans aucun doute à l’esprit les mots du Juge J.Souter dans son opinion dissidente en 2000 : « Peut-être ne connaîtrons-nous jamais avec certitude l’identité du vainqueur de l’élection présidentielle de cette année ; mais l’identité du perdant est parfaitement claire : il s’agit de la confiance de la nation dans le juge en tant que gardien impartial de l’état de droit »…
[i] François-Henri Briard, la nomination des membres de la Cour suprême des États-Unis, Nouveaux Cahiers du Conseil constitutionnel, 2018/1, n°58, pages 59 à 70
[ii] François-Henri Briard, Le Figaro, 25 juin 2022, « avortement, ce qu’a vraiment dit la Cour suprême des États-Unis »