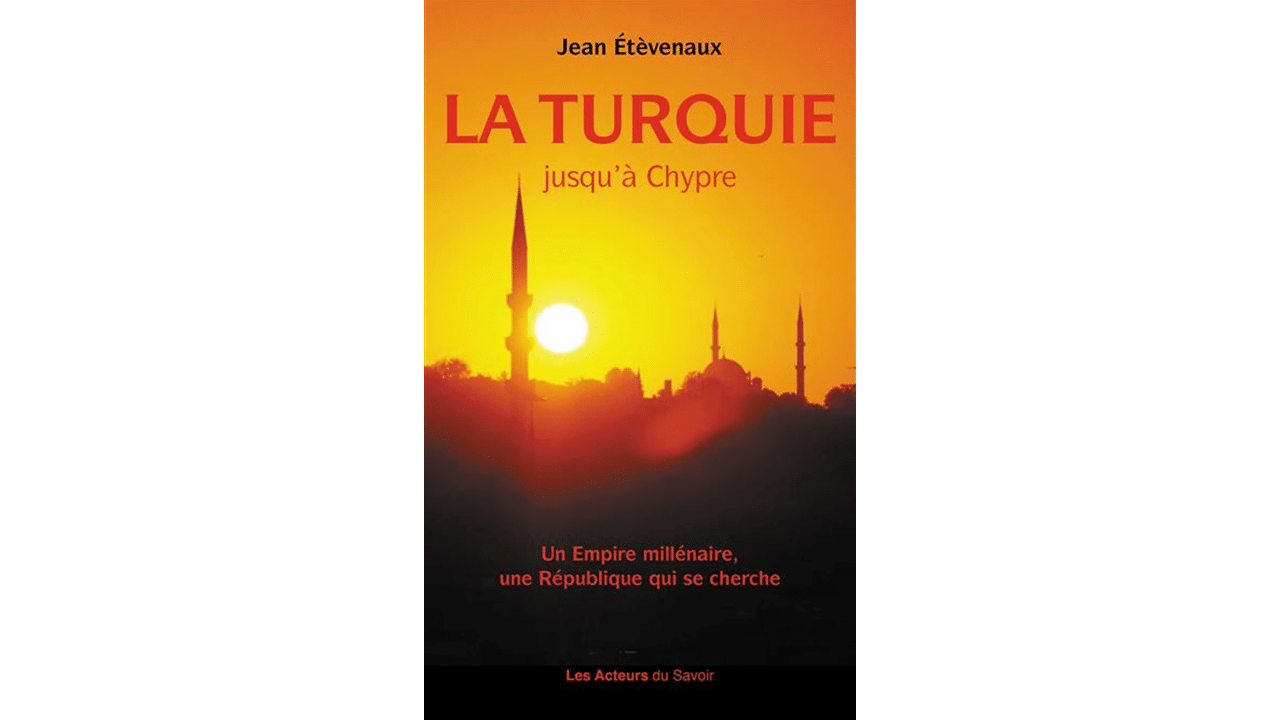Le « périple de Iamboulos » est une pépite de la littérature antique. Ramassé en cinq brefs chapitres de la Bibliothèque historique, il a donné lieu à d’innombrables gloses dès l’Antiquité et jusqu’au XIXe s. avant de tomber dans l’oubli. Pourtant cette histoire fabuleuse, au sens littéral, est une invitation au voyage en des contrées exotiques qui ne laisse pas de faire réfléchir.
Cet article est issu d’un mémoire de master réalisé sous la direction du Pr. Philippe Jockey.
Iamboulos, marchand grec de son état, lors d’un voyage d’affaires en Arabie heureuse, est capturé et réduit en esclavage par des Arabes avant d’être enlevé et vendu par des Éthiopiens, avec un autre compagnon d’infortune, qui « les destinèrent comme étrangers à l’expiation du pays ». Pour ce sacrifice rituel de purification, Iamboulos et son acolyte anonyme sont envoyés en plein Océan indien vers une île inconnue, peut-être Java, à laquelle ils accostent au bout de quatre mois de traversée. Ils passent sept années dans cette contrée mystérieuse avant d’être renvoyés sur mer comme des malpropres. Après quatre mois de traversée dans laquelle son camarade périt, Iamboulos parvient près de l’embouchure du Gange d’où les Indiens le font remonter jusqu’à Palibothra. Le roi de la cité lui offre une escorte jusqu’en Perse d’où Iamboulos rejoint enfin sa patrie. Tout est bien qui finit bien, le pauvre Iamboulos est dès lors considéré comme un mythomane par ses compatriotes, atterrés par les extravagances de son récit. « Nugator » est le surnom du marin malgré lui depuis l’Antiquité.
Iamboulos, Diodore de Sicile et les autres
Un illustre inconnu
Qui est Iamboulos ? Quand a-t-il vécu ? D’où vient-il ? Personne ne le sait plus. Il semblerait que Iamboulos apparaisse pour la première fois dans le texte de Diodore de Sicile et que les mentions postérieures qui sont faites de lui comme de son invraisemblable aventure en découlent. Il n’est pas surprenant que Iamboulos parvienne à notre connaissance par un unique auteur quand l’on considère la perte immense des ouvrages antiques et le nombre important d’auteurs majeurs qui ne nous sont connus que par des mentions brèves et éparses, des fragments prélevés de-ci de-là afin d’essayer d’en extraire une « oeuvre » vaguement cohérente. Il est possible que Iamboulos et son Histoire aient réellement existé et aient été inclus par Diodore dans sa Bibliothèque historique qui visait l’exhaustivité.
Mais il est également possible que Iamboulos soit sorti de l’imagination de Diodore dont l’existence même est également sujette à caution ! Il faut souligner ce qui le fut au long des siècles par d’éminents historiens et philologues à savoir qu’il est étrange que des œuvres majeures aient disparu corps et biens ; ainsi celles d’Ératosthène de Cyrène ou de Posidonios d’Apamée sans cesse cités ; tandis que celles de Diodore de Sicile ou encore de Strabon nous sont parvenues en grande partie alors qu’ils font figure d’illustres inconnus en leur temps. Qui sont ces hommes et qui est vraiment derrière ces œuvres tardives et suspectes est une vaste question ouverte.
À lire aussi : Livre – Dictionnaire encyclopédique des batailles : De l’antiquité à nos jours
Pour en revenir à Iamboulos, son existence est avérée du fait de l’épithète de nugator accolée à son nom dans les œuvres antiques. Quant à déterminer quand il a vécu, il n’y a aucun moyen de le savoir par le récit de la Bibliothèque historique si ce n’est un terminus post quem grâce à la mention de Palibothra, ville indienne fondée en 490 av. J.-C. Il a donc vécu entre le début du Ve et du I er s. av. J.-C. ce qui ne nous avance guère.
Il est possible que Diodore relate une Histoire qu’il a eue sous les yeux et qu’il juge digne d’intérêt, car unique en son genre. Par ailleurs, Diodore est toujours fiable quand il mentionne les auteurs auxquels il se réfère même s’il ne paraît pas avoir systématiquement eu accès à leurs œuvres originales et/ou intégrales.
L’authenticité du récit
Le récit s’est donc transmis par Diodore de Sicile (Ier s. av. J.-C. dont on ne sait à peu près rien si ce n’est qu’il est sicilien et de culture grecque comme tout [simple_tooltip content=’«Homme » pour anthropos, « homme » pour andros.’]Homme[/simple_tooltip] qui se respecte). Il a fait œuvre de compilateur reconnu pour ses qualités intellectuelles, son érudition, le respect de ses sources, mais également son travail d’historien, c’est-à-dire d’enquêteur, puisqu’il a lui-même voyagé en Europe, Asie et Libye jusqu’en Égypte.
Diodore a consulté le récit de Iamboulos dont il n’a gardé que la partie jugée inédite, celle sur l’île inconnue de l’Océan indien. En effet, il affirme que Iamboulos « donne des renseignements sur l’Inde inconnus ailleurs », notamment au sujet de Palibothra, et que c’est sur sa description de l’Inde qu’il a ajouté foi au récit de Iamboulos et non pas sur sa description de l’île mystérieuse. C’est frustrant pour l’historien, car ce sont précisément ces renseignements que nous voudrions. Palibothra en grec ou Pataliputra en sanskrit, est une cité fortifiée bâtie par Ajatasatru, roi de Maghada au nord de l’Inde, contemporain de Siddharta Gautama et dont les traditions bouddhiste et jaïniste relatent le règne mouvementé. La mention de Palibothra ne suffit pas à authentifier le récit puisque c’est Mégasthène (340-282 av. J.-C.) qui a porté à la connaissance des Grecs [simple_tooltip content=’Fragment XXV des FGH prélevé chez Strabon XV,1;35-36′]l’existence de cette cité[/simple_tooltip]. Or, les Indika si fameuses de Mégasthène ont disparu, ne reste que des fragments prélevés chez Diodore, Strabon et Arrien. Il nous faut alors faire confiance à Diodore qui a lu, lui, l’œuvre de Mégasthène et celle de Iamboulos et affirme qu’ils disaient vrai et ne se recopiaient pas.
Nous voilà soumis à l’arbitraire de Diodore de Sicile, qui ne résume que ce qui l’a intéressé dans l’Histoire de Iamboulos et à sa réputation d’auteur sérieux.
Une postérité littéraire certaine
C’est cette réputation de l’historien et la notoriété de la Bibliothèque historique qui ont valu à Iamboulos et sa mésaventure une renommée pluri-millénaire.
Lucien de Samosate se sert de ce récit pour son roman satirique Les Histoires vraies dans lequel il tourne en ridicule les relations de voyages en Inde d’auteurs grecs tels que Iamboulos ou Ctésias de Cnide, mais aussi Homère et son Odyssée ou d’autres plus sérieux ainsi Hérodote, Thucydide et Xénophon. Dès l’Antiquité, les choses extraordinaires et lointaines sont regardées comme fabulation et au mieux comme suspectes. Elles ne cessent cependant d’intriguer les plus grands érudits.
À lire aussi : Livre – Poison, l’arme secrète de l’Histoire. De l’Antiquité à aujourd’hui
À la Renaissance, Iamboulos connaît une notoriété nouvelle en servant de modèle à plusieurs utopies célèbres. Il est popularisé par Jean de Boëme dans Omnium gentium mores, leges et ritus paru en 1536 et traduit en français en 1540. Ambroise Paré s’en inspire dans Des monstres et des prodiges en 1573 ou encore Torquemada en 1570 dans Jardin.
Le siècle romantique lui donne enfin ses dernières lettres de noblesse avec un ouvrage anonyme du Baron de M. : Petits voyages pittoresques dans l’Asie, l’Afrique, l’Amérique, la Polynésie et les terres australes en 1813 et encore dans un pastiche de Balzac publié d’abord anonymement en 1832 : Voyage de Paris à Java.
Iamboulos se retrouve en bonne place dans le Dictionnaire des philosophes antiques du CNRS paru en 2000 auquel une longue notice est consacré alors même que l’existence de Iamboulos est incertaine et que son récit original, s’il a existé, est entièrement perdu.
Une île de l’Océan indien ?
La question de l’identification de l’île sur laquelle Iamboulos et son compagnon anonyme ont censément accosté demeure en suspens. Plusieurs hypothèses ont été avancées : Ceylan ; notre Sri Lanka connu des Grecs et Romains sous le nom de Taprobane depuis le IVe s. av. J.-C. ; Madagascar, Java, Sumatra, Bali.
La position géographique
Il est difficile de déterminer avec certitude la position géographique de cette île. Le récit est avare en détails : quatre mois de navigation en partant de l’Éthiopie vers le midi, « un ciel équinoxial », quatre mois pour le voyage de retour jusqu’au Gange, des fortes marées. Ceylan peut être écartée aisément, Taprobane n’est qu’à 30 km de la pointe sud de l’Inde et ne revêt plus de caractère inédit à l’époque de Diodore. Si l’île de Iamboulos lui fut un temps associée par les historiens, cela relève de la facilité, car même en admettant des vents contraires, il aurait fallu moins de quatre mois pour rejoindre l’embouchure du Gange depuis Ceylan. C’est d’ailleurs le temps qu’il aurait fallu pour remonter tout le sous-continent à pied. Diodore ne donne pas le nom de l’île et il faut supposer qu’en cela il respecte l’original de Iamboulos. S’il ne l’appelle pas Taprobane c’est sans doute qu’il ne s’agit pas d’elle. À la même époque que celle de Diodore, Strabon, Grec lui aussi, indique pour sa part clairement Taprobane, sa situation géographique et ses caractéristiques relativement connues des Occidentaux [simple_tooltip content=’Strabon XV, I, 14-15.’]depuis quelques décennies[/simple_tooltip]. Il n’y a donc aucun intérêt pour Diodore de faire passer pour inconnu ce qui ne l’est pas pour ses contemporains. De plus, son introduction dans laquelle il insiste sur le caractère mystérieux et inédit de l’île rejette l’identification avec Taprobane.
Ensuite, l’île se trouve « sous la ligne équinoxiale » tandis que Ceylan est sur le Tropique du Cancer. Il faut donc chercher plus loin et plus au Sud. Iamboulos aurait indiqué la présence de sept îles semblables dans les environs et ce nombre correspond très exactement à celui des grandes îles de l’archipel indonésien, des Philippines et de la Papouasie.
Les équateurs terrestre et céleste avaient été mis en évidence entre autres par Ératosthène. Mais il ne s’agissait alors que de théories, aucun Grec n’y étant parvenu. Les effets magnétiques de l’équateur terrestres nous sont maintenant connus même s’ils ne sont que partiellement expliqués. Ils permettent à certaines espèces pourvues d’une boussole interne de s’orienter. Or, nous en sommes dépourvus et il nous faut nous repérer grâce aux éléments extérieurs, de préférence fixes et visibles sur de longues distances, ce que sont les étoiles. La plus grande surprise pour Iamboulos en franchissant l’équateur est la différence notable du ciel nocturne. Pour un marchand-voyageur, le ciel est le seul point de repère précis grâce à Polaris contenue dans Ursa minor. Or, une fois franchit l’équateur, d’étoile polaire il n’y a plus. Iamboulos ne voit plus ni la grande ni la petite ourses. S’il était encore sur l’équateur, comme ce serait le cas si l’île est celle de Sumatra, il verrait en mars, avril et mai xi, nu, psi, oméga, mu et lambda de la Grande Ourse et ne pourrait manquer de reconnaître le sud si caractéristique de cette constellation. Il dit qu’elles ont disparu « ainsi que beaucoup d’autres astres » ce qui assure qu’il connaissait très bien le ciel de l’hémisphère nord et qu’il s’agit bien d’un ciel de l’hémisphère sud qu’il a contemplé. C’est cette mention d’un ciel nouveau, absent de tous les autres récits de voyage antérieurs à l’époque de Diodore de Sicile qui a poussé l’historien à s’appuyer sur le récit de Iamboulos.
On ne peut que déplorer l’absence de renseignements chronologiques quant à Iamboulos. En effet, si le supposé marchand grec a vécu avant le IVe s. alors son récit est de la première importance, car il livre des détails inconnus des Hellènes jusqu’à l’épopée d’Alexandre. Même la circumnavigation de la Libye par les marins de Néchao II rapportée par Hérodote et le Périple de Scylax ou encore le Périple d’Hannon ne fournissent pas la base des informations, véridiques, délivrées par Iamboulos.
Le climat équatorial
En ce qui regarde le climat et la biodiversité de l’île, l’hypothèse de Madagascar est possible, car elle diffère peu des îles orientales : en direction du midi depuis la côte éthiopienne, sous l’équateur, à distance de navigation admettant les quatre mois annoncés. Seule une étude des courants marins et aériens peut expliquer comment en partant vers le Sud les pauvres marins se seraient retrouvés au Sud-Est. Ce qui ne plaide pas en faveur de Madagascar est l’absence des six grandes îles alentour mentionnées par Iamboulos.
À lire aussi : Livre – Histoire de l’Afrique, des origines à nos jours
Nous en sommes réduits à étudier les maigres indications sur le climat qui a tout du climat de l’Océan indien. En premier lieu les typhons. Iamboulos fait part des « tempêtes » qu’il a dû affronter pendant quatre mois. Il n’y a rien de plus commun qu’un coup de tabac en mer. C’est la durée des tempêtes qui intrigue, car elle correspond à la saison cyclonique. De même la mise en garde des Éthiopiens envers ces phénomènes qu’ils paraissent bien connaître. Il semble qu’il s’agisse là d’un rituel cruel visant à envoyer vers une mort quasi-certaine des étrangers innocents en plein océan pendant la saison des cyclones. Il est possible d’y voir aussi une manière d’éprouver la valeur de ces hommes qui n’arriveront à bon port que s’ils ont, en toute logique antique, la faveur des dieux.
Le voyage du retour ne permet pas davantage de situer la fameuse île. Malgré une durée de navigation identique à celle de l’aller, les Grecs ne parviennent pas à rejoindre leur point de départ éthiopien, mais se retrouvent au contraire en Inde près de l’embouchure du Gange que Iamboulos remonte jusqu’à Palibothra. Il n’y a pas de mention de tempêtes lors de ce voyage retour. Est-ce qu’il se déroule en dehors de la période des moussons ? Ou est-ce que ce sont les puissants courants marins qui a poussé l’embarcation jusqu’en Inde ? La différence de ciel nocturne empêcherait même un marin aguerri, ce que n’était pas Iamboulos, de s’orienter et plus encore de se diriger. Le climat étant équatorial, il est impossible à Iamboulos de se situer dans l’année, l’espace et d’indiquer à quelle époque il fut chassé de l’île.
Iamboulos indique que hors la mer déchaînée, les abords immédiats de l’île ont de « l’eau douce », ce qui fait penser aux atolls, havres de paix pour les piètres marins antiques a fortiori envoyés en terra incognita. La mer orageuse intervient afin de faire ressortir le caractère inaccessible de l’île, archipel perdu et protégé par les éléments, donc par les dieux. Mais ce n’est pas que procédé littéraire, l’Océan pacifique ne méritant pas son nom trompeur, il est particulièrement déchaîné et rend hardie la navigation. La saison cyclonique, qui dure la moitié de l’année, renforce encore son caractère impétueux et le fait que les îles apparaissent comme des havres de tranquillité, tant que les typhons ne touchent pas le sol.
Enfin, Iamboulos insiste sur la monotonie du climat équatorial caractérisé par une saison unique, « les fruits, chez eux, mûrissent tout au long de l’année et chaque année » ainsi que la durée égale du jour et de la nuit tout au long de l’année. Les indigènes vivent sous un climat doux et constant, pourvoyeur de denrées abondantes, semblable à l’île des Bienheureux d’Homère avec laquelle Diodore ne manque pas de dresser un parallèle. Que Diodore cite l’Odyssée afin de justifier la véracité de ce climat oriental répond aussi à une volonté de mettre en avant la monotonie du climat équatorial tout le long de cette ligne équatoriale, invisible sans être imaginaire. Retrouver à l’autre extrémité du périple d’Ulysse les mêmes conditions climatiques devait renforcer la véracité des informations homériques pour un Grec. Il faut rappeler que, dans l’Antiquité, chaque Grec était capable de réciter l’Iliade et l’Odyssée par cœur dès l’âge de sept ans ! Ces œuvres servent de socle commun à la culture hellénistique et elles contiennent tout le monde connu des Grecs. Ce rapprochement ressort peut-être d’une volonté de rapprocher l’inconnu du connu en passant par Homère qui sert de référence ultime. Quoi qu’il en soit, nous voyons apparaître dès ce récit l’importance des latitudes qui sont appliquées avec brio par Claude Ptolémée deux siècles après Diodore.
Une flore et une faune indonésiennes ?
La faune et la flore sont semblables sur l’archipel indonésien, philippin ainsi que sur Madagascar également pour certaines espèces tandis que d’autres sont endémiques à une seule île. Le récit laisse à penser que la flore est bien celle du Sud-Est asiatique.
La plupart des plantes et animaux décrits par Iamboulos le sont de manière vague, voire franchement incongrue. Or, ce qui parait fabulation n’est peut-être que moyen de retranscrire, en la simplifiant, la réalité afin de la faire comprendre à ceux qui en sont si éloignés. Diodore nous dit qu’il y pousse de la vigne et des oliviers d’où les habitants tirent vin et huile. Il est certain que la vigne est très loin d’avoir été introduite dans un climat équatorial incompatible avec sa croissance et encore plus fantasque qu’elle y fut endémique. De même pour l’olivier qui résisterait mal à un climat aussi humide et pluvieux ainsi qu’à une absence de saisons marquées. Nous retrouvons ici les mêmes mentions improbables et incroyables que celles présentes dans le Périple de Scylax. Chez Scylax aussi, le pays des Éthiopiens aimés des dieux sur l’île de Cernè et qui jouissent de tous les bienfaits, comparables aux insulaires de Iamboulos, produit en abondance du vin et de l’huile[10]. Ces deux produits sont indissociables de ce qui fait l’Homme dans la pensée grecque, ils composent la trilogie méditerranéenne : pain, huile et vin. Il paraît difficile pour les voyageurs hellènes de faire passer pour civilisés des Hommes qui ne se nourriraient pas de ces trois produits incontournables. Cela est clair dans ce texte avec la description de l’arbre qui donne du pain. En l’absence de blé qui ne pourrait que pourrir sur pied sous ces latitudes, il faut faire intervenir un substitut de pain reconnu comme équivalent.
L’arbre à pain décrit au chapitre 57 existe vraiment et nous l’appelons, modernes, « l’arbre à pain », car aucun autre nom que celui livré par Diodore ne décrit mieux cette plante. Artocarpus altilis, originaire des îles du Pacifique, pousse sous les tropiques et l’équateur. La description qu’en fait l’auteur tant dans sa conformation que dans la manière dont il est consommé est d’un réalisme et d’une justesse incontestables. Digne d’un naturaliste du XVIIIe s.
De même, la plante utilisée pour le suicide des vieillards existe bel et bien. Popularisée sous le nom d’Upas tree par Erasmus Darwin, Antiaris toxicaria n’a été redécouvert qu’au XVIIIe s. par les Occidentaux à Java qui ont d’ailleurs donné une description de ses effets toxiques encore plus exagérée que Iamboulos ne le fit.
En ce qui concerne la vigne et l’olivier, peut-être sont-ce des allusions à d’autres plantes qui produisent de l’huile et des spiritueux. L’alcool peut être obtenu à partir de n’importe quel fruit, légume ou tubercule fermenté et/ou macéré. Le vin a ceci de particulier que pour atteindre un degré élevé en demeurant agréable au palais, il doit être issu d’un long processus de sélection et de transformation. C’est le symbole du travail de l’Homme sur la nature que l’auteur grec cherche à mettre en relief ici en employant le mot « vin ». De nouveau, cela peut être un moyen de faire comprendre l’importance du travail et de la technique, propres de l’Homme, en usage chez les insulaires, mais cela n’exclut pas l’hypothèse qu’il s’agisse d’une indication volontairement mensongère de Iamboulos ou Diodore afin de continuer à broder sur la fable.
Idem pour l’huile qui peut être tirée de quantité d’oléagineux autres que l’olivier. En Asie, les huiles sont nombreuses dès l’Antiquité : sésame, palme, riz, soja, etc. Ne penser huile qu’en termes d’olive est propre à un esprit grec et plus largement méditerranéen.
La description de la faune, outre certains animaux impossibles à identifier et sans doute imaginaires que Iamboulos ne prend pas la peine de détailler, reste assez plausible : poissons en grande quantité, grands oiseaux, immenses serpents goûteux et inoffensifs… Rien qui ne ressemble fort à la faune équatoriale abondante si ce n’est que les animaux sont tous paisibles et qu’ils paraissent peupler un paradis terrestre. Le récit de voyage fantastique s’avère finalement très sage, loin du bestiaire antique empli de griffons, de licornes ou de phénix que certains Hellènes se plaisent à imaginer en aux confins de l’Inde, de la Libye ou de l’Éthiopie.
De ces différents éléments rapportés, il est possible de supposer qu’il s’agisse d’une île de l’Océan indien, mais rien n’associe la véracité du récit de Iamboulos. Ces divers éléments ont pu être collectés depuis diverses sources mieux informées, notamment des marins peu avares en histoires, notés et retravaillés par Iamboulos ou un autre. À vrai dire, cela importe peu, il n’est besoin que d’un habile écrivain capable de forger un récit sur la base du réel.
Utopie ?
Une utopie sociale ou une société de l’Océan indien ?
C’est tout le sens de l’utopie si chère aux Grecs : narrer des histoires dans un lieu autre, lointain et étrange, qui a tout du possible et du vraisemblable, réaliste sans pour autant devenir réel.
Il faut à nouveau souligner l’étrangeté que constitue cette société anonyme sur une île elle aussi dépourvue de nom. Si Iamboulos et son compagnon ; également anonyme ce qui n’est pas sans rappeler le maître de Jacques le fataliste ; ont passé sept ans sur place, ils ont au moins appris le nom de leurs hôtes ainsi que leur langue. Cela ne plaide pas en faveur du vraisemblable, mais puisqu’il s’agit d’un récit de seconde main, faire la part entre la volonté de Iamboulos et l’ambition de Diodore est impossible. Cette absence de nom n’est-elle pas le premier silence du récit qui devrait inciter à le rejeter en tant que relation de voyage et le classer au rang des tribulations littéraires ?
Dans ce texte bref, tous les traits descriptifs des fondements de la société inconnue sont portés à notre connaissance. L’ensemble concourt à produire de l’exotisme par une débauche de bizarreries et d’étrangetés. Il est annoncé à trois reprises qu’il s’agit d’un monde de merveilles, de paradoxes qui porte une notion de transgression, de franchissement de la norme et du réel pour atteindre un monde autre, celui des Hommes d’une race différente ainsi que le laisse déjà supposer leur physique des plus stupéfiant. Le reste est à l’avenant.
Le caractère de ces Hommes est doux et pacifique, leur vie rythmée par le travail et les liturgies civiques. Les Éthiopiens vantaient déjà auprès des victimes grecques la gentillesse et la bienveillance de ceux qui les recueilleraient, ce qui s’avère exact. Nulle mention d’arme ou de guerre. La raison de cette gentillesse commune est le règlement de leurs mœurs par une organisation sociale stricte et dure qui oblige à se conformer à la Loi, la norme, en niant l’individualité et la personnalité de ses membres. La violence individuelle ou collective est remplacée par celle de l’État à l’encontre de ses citoyens. « Il ne peut y avoir ni jalousie ni ambition, les habitants vivent entre eux dans la plus parfaite harmonie ». Atteindre cette harmonie ne peut passer par l’accomplissement du bonheur de chacun, au contraire, c’est le groupe qui prime, et l’égale place de chacun au sein de celui-ci garantit son bon fonctionnement. L’isonomie vantée par les philosophes est ici réalisée. Or il ne s’agit pas d’une isonomie pour le bonheur des individus, mais d’une isonomie pour le bien de l’État. L’intérêt est celui de la société et c’est pour cela qu’elle est parfaite, celui de ses membres n’est que la variable d’ajustement en vue de l’équilibre d’un tout supérieur. Pour que l’État perdure sans aléas, il anéantit tout d’abord la famille. Plus de filiation, plus de liens de parenté. La famille est élargie au peuple et la parenté biologique est supprimée volontairement, remplacée par une parenté nourricière qui revient à toutes les femmes sans distinction. Il n’y a pas non plus de mariage, autre cause de jalousie repérée par Diodore, mais surtout noyau de la famille nucléaire à détruire.
La tribu prend en charge collectivement les enfants et les éduque. Iamboulos indique vaguement une division de ce peuple en tribus sans en donner le nombre ni la constitution. Chaque tribu est dirigée par le plus ancien de ces membres jusqu’à ce qu’il atteigne cent-cinquante ans, âge auquel il doit légalement se donner la mort. La notion de longévité est importante. La durée de vie exceptionnelle de ses hommes ne peut manquer d’être perçue comme un signe d’élection divine dans la pensée grecque. Les gérontes sont représentants de cette sagesse donnée par l’âge qui confère le droit de gouverner ainsi qu’il se retrouve à Sparte. Nous retrouvons sur l’île un unique géronte par tribu, bénéficiant des pleins pouvoirs pour faire appliquer la loi divine sur aucun autre mode d’élection que celui du temps. Son âge est le seul critère de désignation, sans aucun doute divin et, en même temps qu’il lui confère tous les droits, il le désigne comme le prochain à mourir. Tout comme le rituel expiatoire immuable et hors du temps auquel participent malgré eux Iamboulos et son compatriote, la fonction royale se présente comme une fonction immuable et d’autant plus ancienne qu’elle est exercée par un ancien. La permanence de ce système repose sur une application stricte et sans accroc de la loi. Dura lex sed lex sommes-nous tentés de dire, une loi qui s’applique à tous.
Enfin, l’utilisation de l’écriture et d’un alphabet assure que cette société est civilisée quand bien même elle est des plus étrange.
L’île est comme souvent dans la littérature grecque le lieu de l’utopie, la possibilité d’appliquer des doctrines philosophiques et sociales. Un lieu de prédilection que l’on retrouve encore sous la plume de Thomas More, forgé par les Humanités, en 1516. Le récit de Diodore insiste sur le « paradoxos » qui est en fait un monde autre rêvé par les philosophes, Platon en tête, une société idéale aux mœurs réglées par la Loi et l’éthique. On se rapportera avec profit aux filiations philosophiques détaillées par Tuero et Gonzales.
Il faut remarquer au passage dans cette utopie la mention de l’esclavage ; comme dans la cité idéale de Platon ; et du trafic d’êtres humains pratiqué par les Arabes et les Noirs dans cette partie du monde à l’époque et toujours d’actualité sur le pourtour de l’Océan indien.
La violence et le sacré
L’harmonie de cette société idéale repose sur la violence : euthanasie des enfants faibles, condamnation à mort des handicapés et des malades, sacrifice d’étrangers en l’honneur des dieux, suicides rituels du roi. Cette harmonie répond à l’harmonie de la société éthiopienne unanimement reconnue par les Anciens qui, elle, n’a pas ces pratiques d’élimination systématique des indésirables.
Comment des Éthiopiens peuvent-ils être en contact avec des habitants du Sri Lanka, de Java ou de Sumatra ? Ce lien n’est pas direct. Il n’est pas question pour les uns et les autres de se rencontrer, mais uniquement d’échanger à distance des présents pour les dieux. Le lien est donc divin et cela n’a alors plus rien d’étonnant si ces mêmes endroits lointains et les routes pour y parvenir leur ont été indiqués par les dieux qui, eux, ont les moyens de voyager de manière non-conventionnelle et d’atteindre les extrémités du globe.
Le rituel apotropaïque dont se retrouvent victimes les étrangers est intrigant. Dans ce cas précis, xenos prend tout son double-sens, à la fois l’hôte et l’étranger en grec. L’étranger est rejeté hors de la communauté en vue du renforcement de celle-ci par la faveur divine. Mais l’étranger n’est pas directement mis à mort, il est envoyé vers un autre monde très accueillant où il est traité comme un hôte, un invité de marque. Nous pourrions y voir la volonté de transposer à l’Extrême-Orient l’île des Phéaciens en extrême-Occident. Il n’empêche que cette entreprise sacrificielle est bien risquée. Quelle est la probabilité de survivre à un voyage en mer conduit à l’aveugle ? L’un des deux xenoï y perd d’ailleurs la vie, quand bien même son décès intervient lors de son second exil.
Le temps est un facteur aussi important que l’espace pour signaler la sacralité du récit. Ce rituel « sanctionné par des oracles » existe depuis « un temps immémorial » nous dit Diodore et se déroule « tous les six cents ans ». Apparaissent avec force ces temps démesurés à l’échelle humaine correspondant à celle des dieux. Trois cérémonies depuis nous pour voir s’ériger le mur d’Hadrien, trois autres pour côtoyer Hammourabi, trois autres pour assister à la naissance de l’écriture. Seulement neuf cérémonies pour sortir de l’Histoire et entrer dans l’inconnu préhistorique qui ne semble en aucun cas l’être pour les Éthiopiens. Les dix-huit mille ans qu’ils attribuent à leur civilisation sont renforcés par le gigantisme des cérémonies rituelles impossible à concevoir à notre échelle. Comment s’assurer le respect d’une périodicité aussi longue dans les cérémonies religieuses ? Le temps n’aura-t-il pas fait son œuvre sur les croyances et les mœurs humaines ? Voire sur l’identité même de ces hommes ? Diodore comme sa source Iamboulos sont conscient de l’exagération qui ne manquera pas d’apparaître à des gens dont l’histoire est quantifiable en quelques siècles. Cette exagération du temps, nous la retrouvons à chaque fois sous la plume d’auteurs grecs en Éthiopie et dans sa colonie égyptienne. Et, à chaque fois, cette chronologie inaccessible se double de l’omniprésence de la divinité.
Ce sont pour les dieux que s’effectuent ces cérémonies « expiatoires ». Ce qui est impie ici c’est l’étranger en terre éthiopienne. Afin de se préserver, les Éthiopiens vivent fermés sur eux-mêmes. Cet enfermement volontaire vise à conserver ce qui leur a été donné par les dieux afin de garder leurs faveurs. Ils demeurent à l’état de civilisation identique à celui dans lequel ils ont été tirés de la sauvagerie par leurs divinités. Ce respect à tout prix des commandements divins est la condition sine qua non à leur pérennité et à la liberté qui règne chez eux[13]. La défiance vis-à-vis de l’étranger est mise en exergue sans aucune ambiguïté. Les Éthiopiens présentent la menace comme venant de l’extérieur et la potentielle déstabilisation de leur société comme provenant du non-respect des lois divines. Si Diodore peut présenter comme probables ces faits incroyables pour un esprit cartésien, c’est que la preuve en existe toujours à son époque : l’Éthiopie garde la faveur des dieux malgré tout et n’a jamais été inquiétée par les envahisseurs, car elle pratique assidûment les rituels imposés par les divinités, au premier rang desquels le sacrifice.
L’importance du fait religieux est d’autant plus visible si l’on s’attache au symbolisme des nombres, chers aux amateurs de numérologie, présents dans le texte : trois « 6 » chez les Éthiopiens, trois « 7 » chez les insulaires. Au déséquilibre rencontré par les étrangers en Éthiopie répond la perfection divine issue du sacrifice dans l’île. Il est dommage que l’original ne nous soit pas parvenu, mais peut-être le compilateur a-t-il pris soin de reproduire tous les chiffres à leur place initiale.
La violence de la société utopique ne s’exerce pas uniquement à l’encontre des étrangers. Elle prend une forme différente en ce qui regarde les enfants jetés au rebut, à la lacédémonienne, ou les vieux autochtones sacrés puis poussés au suicide. Dans l’île comme en Éthiopie, la royauté est sacrée, consacrée par les dieux et au premier chef le Soleil. Mais pour la survie de la société utopique, la personne royale concentre en elle, selon la loi divine, la violence et le sacrifice. C’est un étrange jeu de massacre que narre Diodore. Chacun des membres de la société est sacrifié à tour de rôle pour assurer la tranquillité de tous, chacun est roi puis victime expiatoire innocente pour le bien de la communauté. [simple_tooltip content=’Girard, La violence et le sacré p.16 éditions Grasset 1972′]« On ne peut tromper la violence que dans la mesure où on ne la prive pas de tout exutoire, où on lui fournit quelque chose à se mettre sous la dent »[/simple_tooltip]. Ce mythe répond exactement à la théorie de Girard sur la fonction sacrée que revêt la violence dans les sociétés anciennes. L’utopie non plus ne parvient pas à s’en affranchir, elle érige même la violence en garante de la stabilité sociale.
Le Blanc bouc-émissaire du Noir ?
Le récit livré par Diodore appartient de toute évidence à celui du mythe et à l’intérieur du mythe au genre de la persécution. René Girard pose que la violence collective est constitutive de la société. D’après son analyse des mythes grecs, le « mécanisme sacrificiel » est présent et régule la violence des sociétés humaines. Le mécanisme s’articule selon un « cycle mimétique » qui transparaît en filigrane dans les mythes. On retrouve dans les mythes les mêmes éléments de déstabilisation, sacrifice puis retour à l’harmonie de la société qui justifient la violence rituelle de la communauté. Or, dans le périple de Iamboulos, il n’est nul besoin de chercher ce cycle mimétique qui est explicité par les Éthiopiens dès la capture de l’étranger : tous les six cents ans en l’honneur des dieux pour la paix du pays.
Dans ce mécanisme sacrificiel, le bouc-émissaire tient une place centrale puisque c’est autour de lui que se déroulent les événements sacrés, quand bien même il est parfois absent de l’action. Cela est flagrant dans ce récit, le seul tort de Iamboulos et son comparse est d’être présents au mauvais endroit au mauvais moment. La persécution est caractéristique de la mythologie grecque d’après Girard, tous les types victimaires se retrouvent dans la geste des héros. Il propose une grille de lecture des mythes qui s’applique à notre récit. Qu’on le considère d’un point de vue historique, mythologique ou ethnographique, l’aventure de Iamboulos répond à tous les stéréotypes de la persécution définis par Girard. « La gamme entière des signes victimaires figure dans les mythes. Si nous ne les remarquons pas, c’est parce nous retenons surtout l’appartenance à une minorité ethnique ou religieuse connue. Ce signe-là ne peut reparaître tel quel dans la mythologie. Nous ne retrouvons ni juifs ni Noirs persécutés. Mais nous avons leur équivalent, je pense, dans un thème qui joue un rôle central dans toutes les parties du monde, celui de l’étranger collectivement chassé ou assassiné ».
En plus de la place de l’étranger occupée par Iamboulos, ne devrait-on pas y voir surtout celle de la minorité ethnique ? Et si, comme le pense le philosophe, on ne retrouve pas de Noirs persécutés dans les mythes grecs, pourquoi ce récit ne serait-il pas justement celui de Blancs persécutés par des Noirs ?
Est-ce l’étranger qui est désigné par les Éthiopiens comme bouc-émissaire ou le Blanc ? Iamboulos et son compagnon sont-ils choisis comme victimes en tant que Grecs ou en tant que Blancs ? Quels sont les signes victimaires des deux hommes ? Comment se définit l’étranger pour les Éthiopiens ? Est-il l’équivalent du barbare ? Quelle importance a la couleur de peau de l’étranger dans la définition éthiopienne de l’altérité ? Pourquoi les Éthiopiens ne choisissent-ils pas les Arabes de leur voisinage pour leur rituel expiatoire ? Ce serait tout de même plus facile. Cherchent-ils des étrangers plus étrangers, plus loin de leur apparence ? Il apparaît que, dans ce récit, pour les Éthiopiens certains sont plus étrangers que d’autres sans que les critères retenus ne soient explicites. Ou peut-être le sont-ils, mais nous ne les voyons pas ainsi que l’affirme Girard.
Le mythe de Busiris raconte la même histoire que celle de Iamboulos selon le même schème. Le thème est celui de l’étranger tué par les Égyptiens en l’honneur des dieux. Or, le seul étranger nommé dans ce mythe est le devin grec Phrasios qui a prophétisé au pharaon Busiris qu’immoler un étranger chaque année sauverait l’Égypte de la famine, selon Apollodore. D’après Diodore, Busiris n’a d’autre motivation que sa monstruosité sanguinaire. Il précise qu’il tue tous les étrangers qui se présentent en Égypte, mais les deux seuls connus sont Phrasios et Hercule, donc deux Grecs. Deux Blancs. C’est cohérent, le récit étant grec il est centré sur eux. Mais Busiris ne tue pas les Libyens ou les Éthiopiens. Il faut alors se demander qui est étranger pour les Égyptiens.
Si, dans le cas contraire, nous avions affaire à des mythes où systématiquement la victime est noire ou juive, ne poserions-nous pas la question de savoir s’ils sont révélateurs d’une persécution réelle ? C’est bien le cas de figure inexistant en mythologie grecque souligné par Girard. Face à des récits qui indiquent pourtant clairement uniquement des Blancs victimes de Noirs, la question n’est pas posée de la signification concrète de ces mythes. Je la pose : ne faut-il pas voir dans le mythe de Busiris comme dans celui de Iamboulos la transcription de persécutions avérées à l’encontre d’étrangers désignés comme tels du fait de leur peau blanche ? Dans les deux cas, les Grecs ne sont pas désignés par les signes victimaires de l’étranger, mais par ceux de la minorité ethnique tels que définis par Girard. Ils n’ont rien fait de mal et n’appartiennent même pas à ce monde éthiopien. Ils sont capturés, achetés, exploités et sacrifiés. Tuer quelqu’un parce qu’il est étranger n’est pas la même chose que le tuer parce qu’il est noir. Dans le premier cas le motif est xénophobe, dans le second raciste. Tuer quelqu’un parce qu’il est étranger est un acte xénophobe, le tuer parce qu’il est blanc est un acte raciste.
La xénophobie rituelle est assumée, mais il faut se demander si elle ne masque pas une forme de racisme envers les Blancs. Iamboulos et son compagnon sont victimes d’un double rejet, par les Éthiopiens d’abord puis par les étrangers dans l’île qui sont de toute évidence dravidiens, Éthiopiens d’Asie pour les Grecs, des Visages brûlés par l’ardente divinité solaire, des Noirs donc, qui les envoient vers une mort certaine. Ce n’est qu’arrivé au nord de l’Inde, peuplée d’Aryens, que le malheureux Iamboulos trouve enfin de l’aide. Peut-être les Éthiopiens ne faisaient-ils pas cette distinction et que c’est par hasard qu’ils sacrifiaient uniquement des Blancs en tant qu’étrangers. Peut-être pas.