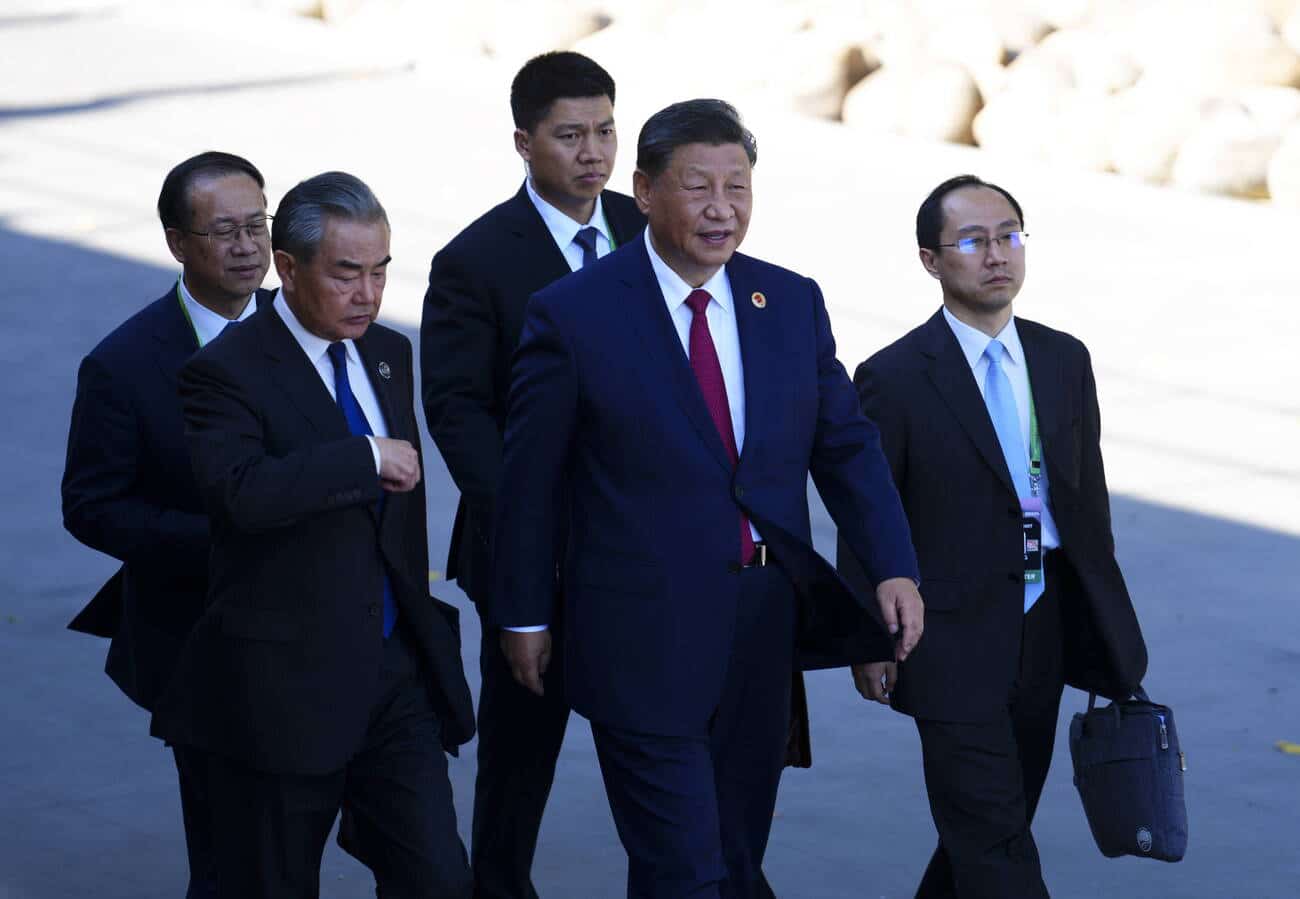Comme ses camarades, l’officier s’engagea totalement au service des populations sous sa protection. Cette mission lui donna des raisons intenses de servir, de vivre et de mourir. L’« Indo » nourrit son formidable humanisme. Elle fut surtout la matrice de sa rébellion en Algérie. Retour sur le terrain, en relisant ses plus beaux textes.
« Certains soirs, si l’on m’avait proposé de rester au Vietnam jusqu’à la fin de mes jours, j’aurais répondu oui », écrit le commandant Hélie de Saint-Marc au soir de sa vie. Il le dira dans tous ses livres, dans ses conférences et ses interviews. Lui aussi, comme tant d’autres, fut victime du « mal jaune », cette magnifique et agaçante expression inventée par Jean Lartéguy, comme si la passion indochinoise de nos militaires, de nos missionnaires et de nos colons avait été une maladie, une fièvre malsaine.
Cette passion indochinoise fut d’abord un engagement total, au service de la France et des populations vietnamiennes. Elle fut aussi un déchirement. Quelques années plus tard, elle conduisit des soldats parmi les meilleurs à se dresser contre la légalité, contre leurs chefs. À tout remettre en question au nom de l’honneur, de la fidélité, du respect de la parole donnée. Hélie de Saint-Marc en fut l’un des symboles les plus forts.
Une passion ardente pour l’Indochine
Septembre 1948 : premier séjour pour le jeune officier. Débarqué du Pasteur, trois ans tout juste après sa sortie de Buchenwald, quand il ne pesait plus qu’une quarantaine de kilos, Saint-Marc ressent une très forte émotion. « Le choc que j’ai ressenti en découvrant, en quelques jours, le delta du Mékong fut à la hauteur de ce mal-être. Nous avons jeté l’ancre dans les eaux vertes de la baie d’Along. J’étais accroché à la rambarde, sur le pont, ébloui par tant de beauté. Des écailles quittèrent mes yeux. Deux ans après avoir attendu la mort dans une baraque de planches envahie par la vermine, j’étais projeté dans un monde féerique. » Le jeune Hélie découvre l’Indochine rêvée dans ses lectures de l’épopée des explorateurs, des militaires, des missionnaires.
« Des années éblouissantes et cruelles » commencent. Lorsqu’il reviendra pour un deuxième séjour, en juillet 1951, le charme sera aussi fort. Cette « passion violente pour le Vietnam » ne le quittera plus, de sa première affectation au Tonkin à… son mémoire de réinsertion dans la vie civile qu’il rédigea, entre 1961 et 1963, derrière les barreaux de la prison de Tulle. Son sujet le fera « s’évader » vers les rizières : « La formation des jeunes volontaires vietnamiens pour en faire des combattants d’élite ».

Poster advertising Messageries Maritimes, French mail service steamships to Australia, Indochina, the Indian Ocean, the Mediterranean, Brazil and Argentina.
En Indochine, Hélie de Saint-Marc débarque d’une France rationnée, frigorifiée, privée de tout, corsetée par la CGT et le Parti communiste, verrouillée par une administration tatillonne, engluée dans les procès et les règlements de compte : « J’ai quitté la France comme on s’éloigne d’une maison où l’on se sent confusément mal, sans savoir pourquoi. » Il déborde d’énergie après les sombres années de l’occupation et de la déportation : « Et puis il y avait une part de notre jeunesse que nous avions laissée dans ce pays, au milieu de cette puissance cosmique qui noie tout dans l’Asie des moussons : on aime ou on rejette. Moi, j’aimais. J’aimais la lumière, les odeurs, le grouillement des villes et des rizières, le mystère des montagnes, le bruissement oppressant de la jungle, le chaos de la Haute-Région, la chaleur moite, le fracas de la mousson. »
A lire aussi: Livre : Françafrique, opérations secrètes et affaires d’Etat
Que trouve-t-il, à 13 000 kilomètres de sa patrie ? C’est un paradis, malgré la guerre, un pays à la fois jeune et ancien, fort d’une culture immémoriale et d’aspirations à un renouveau qu’Hélie comprend très bien : « Cette vie me rentrait dans la peau comme un alcool fort… » Le cocktail est enivrant quand il découvre les pitons de calcaire nimbés de brume bleutée, leur manteau de végétation, inextricable, couleur de jade ou d’émeraude, les temples rouges et or qui surgissent de la jungle, les parfums d’encens et de fruits pourris, le trottinement des paysans en chapeaux coniques, la nonchalance des buffles avachis dans la boue. Fasciné, il écoute la houle des champs de cannes à sucre sous le vent, le chant rauque des crapauds-buffles, le cri des singes, les craquements de la forêt, le crépitement de la mousson.
Son regard se perd sur l’argent des rizières plombées sous le soleil, fouettées par la mousson, sur les étangs piquetés de lotus roses, de nénuphars jaunes. Il suit les jonques à la proue dorée décorée de grands yeux noirs sur fond blanc, pour éloigner le mauvais esprit. Il goûte le parfum entêtant du frangipanier, la suavité de la mangue et de la goyave. « Les paysages nous attirent dans la mesure où ils sont le miroir de notre perception intérieure, écrit-il. Je me retrouvais au Vietnam dans un élément à la hauteur de mes émotions. Cette nature extrême empêche l’homme de se croire le maître des choses. Que peut un homme seul face au déchaînement de la mousson ou à la force des lianes, capables de briser un rocher ? Vivre dans ce décor oblige à composer avec l’ordre du monde. La nature prévient les hommes de ce pays des illusions qui sont les nôtres. Ils sont provisoires et ils le savent, quand nous nous croyons puissants et éternels. »
Les plus beaux monuments, ce sont les hommes
Les gens qu’il rencontre l’émerveillent par leur endurance, leurs mystères. Il est enthousiaste : « Les plus beaux monuments qui se visitent au Vietnam, ce sont les hommes. » Le jeune lieutenant de 26 ans tombe bien sûr sous le charme des filles graciles et rieuses, souples comme des lianes. Leurs tuniques blanches – áo dài – soulevées par le vent sont des ailes de papillons : « J’aimais les femmes de ce pays, énigmatiques et belles, douces et fières. Elles pouvaient être fidèles, parfois héroïques. Certaines savaient ce qu’un homme porte en lui de passion quand la veille il a joué sa peau et qu’il risque de crever le lendemain. »
Il s’attache aux minorités, les Thaïs noirs, les Thaïs rouges, et les rudes Thô bleus de Talung, auxquels il va tant s’attacher. À jamais. Ces peuples à la gaieté éphémère et précieuse le fascinent : « Je ne me suis jamais senti aussi proche d’une communauté humaine. Je savais déjà que, quel que soit l’avenir qui nous attendait, le Vietnam m’habiterait toute ma vie. » Il apprend à mieux les connaître, dans la paix comme dans la guerre : « J’aimais les combattants asiatiques, fidèles, indomptables ; le petit peuple, dur à la peine, railleur, malin ; cette civilisation ancienne et raffinée qui, malgré tout, nous accueillait. Je m’étais battu dans ce pays, pour ce pays, de longues années, et je savais que j’en porterais la marque pour toujours. »
A lire aussi: Rien que la terre: La géopolitique gaullienne avant de Gaulle
Au soir de sa vie, Hélie de Saint-Marc aimait parler de ces jours de joie et de tristesse, d’enthousiasme et de colères. La plaie était encore à vif, sentimentale, politique : « J’ai pris, durant ces mois d’aventures où tout semblait possible, un plaisir personnel qui dépassait les limites de mon métier de soldat. Toutes les facettes de mon caractère étaient comblées… Il existe dans une vie d’homme des jours comme ceux-là, où les forces qui l’habitent concordent et se rejoignent. Il s’agit d’une sorte de pic de l’existence, un bonheur unique dont on sent immédiatement qu’il faut en extraire le suc, car il ne reviendra pas. »
Du bonheur, certes, mais aussi l’âpreté et la tragédie de la guerre, surtout quand on la perd. La guerre où tombent les attaches obligées, où l’on choisit ses frères et ses pères, dans la fièvre et la fraternité du combat, où l’on construit sa bande. La grandeur des engagements, au milieu de combattants exceptionnels, quand on gagne des batailles et qu’on perd des hommes, des amis, des subordonnés, des chefs. Leur souvenir ne s’effacera jamais, comme son cher adjudant Bonnin, le commandant Rafalli et tant d’autres.
A lire aussi: Coronavirus : la sécurité alimentaire, la prochaine bataille de l’Asie dans un monde post-Covid
C’est lors de son deuxième séjour que Saint-Marc endure ses plus féroces accrochages : « Les combats que j’ai connus de 1950 à 1953 au Vietnam furent d’une âpreté et d’une violence que je n’ai plus jamais retrouvées durant ma carrière militaire. » Il garde pourtant encore plus fort le souvenir de son premier séjour, commencé dans l’un des pires secteurs de l’époque : la fameuse RC4, le long de la frontière de Chine. Les 120 km qui séparent Langson de Cao Bang sont baptisés « la route du sang ». Entre That Khé et Dong Khé, les calcaires et les ravins grouillent d’unités viêt-minh. Près de 5 000 soldats français y seront anéantis entre septembre et octobre 1950.

Annamite people of Indochina (Vietnam).
circa 1890
Talung, au bout de la piste
Il est affecté à Talung. « Au bout d’une piste, une vallée s’offrait, éblouissante de lumière, comme la porte d’un monde d’esprits malins et d’oiseaux maléfiques, écrit Saint-Marc. Nous étions éblouis et inquiets par ce prodige. La plaine s’étalait avec sensualité, féconde, étroite et douce… J’ai accepté le poste de Talung sans savoir que ce “oui” allait bouleverser ma vie. » La RC 4 n’existe plus. Pour aller à Talung, on emprunte d’abord la 4A puis, vers l’est, la route 208. À 33 km de Dong Khé – une heure de route aujourd’hui, six à huit heures en 1950 – on découvre ce qui était naguère une petite vallée traversée par la Song Bang Giang, cette rivière à l’écume rouge à la saison des pluies.
L’ancien poste de l’époque de Galliéni surveillait la pénétration des Chinois, à 600 mètres de la frontière chinoise. Il était entouré de quelques paillotes. C’est aujourd’hui une ville-frontière, encombrée par des camions. Au loin, des montagnes, la jungle. Les sentiers et les grottes servaient de refuge au Viêt-minh. Ces calcaires magnifiques et tragiques portent encore l’empreinte des espoirs et des sacrifices de nos troupes, de l’engagement et des désillusions du lieutenant Hélie de Saint-Marc et de ses camarades.
Talung fut son royaume pendant dix-huit mois. Un roi âgé de 27 ans. « À Talung, nous étions libres de nos actes. Je me suis lancé dans l’aventure avec l’énergie et la fièvre que j’avais accumulées depuis 1940. Je me suis lancé dans leurs pas sans même le savoir, éprouvant les mêmes illusions et la même plénitude, rencontrant les mêmes obstacles. »
L’officier y fait l’apprentissage de la pauvreté, une sorte d’ascèse faite d’humilité absolue et de liberté totale. Le jeune chef est livré à lui-même (une liaison seulement par mois). Malgré la solitude, il vit une fraternité intense au milieu de ses légionnaires et de ses partisans Thôs qui vivent encore comme leurs ancêtres, mille ans plus tôt. « Talung apportait la réponse qui m’obsédait depuis Buchenwald : comment être heureux malgré tout ? Après avoir connu l’humiliation de chaque jour en déportation, je m’étais fondu avec bonheur dans la politesse du Vietnam, qui n’est pas un attendrissement, mais une manière de préserver l’humanité en soi. Ma vie à Talung fut une sorte de métaphore de mon destin, où le pire et le meilleur se sont imbriqués. Il arrive que certains instants contiennent en réduction toute une vie. »
C’est en Indochine qu’Hélie de Saint-Marc forge cette cuirasse d’honneur et cette détermination qui le conduiront, dix ans plus tard, à choisir la rébellion, à supporter ses 2 120 jours de prison, acceptant le prix de de sa désobéissance, au nom de ses partisans Thôs et de leurs familles auxquels il avait tant promis. Il les avait trahis parce qu’on lui avait ordonné de les trahir. L’abandon à la mort et au goulag communiste de ces Vietnamiens fidèles ne cessera jamais de le hanter.
Le tournant de sa vie est à Talung, un jour de février 1950. Le repli est décidé par le haut commandement pour rapatrier des forces trop éparpillées, menacées par la victoire des communistes en Chine. Les ordres ne sont pas discutables. Il faut obéir. Saint-Marc se souvient des villageois qui accourent, prévenus par la rumeur : « Ils savaient que, sans nous, la mort était promise. » L’extrait suivant est capital : « Les images de cet instant-là sont restées gravées dans ma mémoire, comme si elles avaient été découpées au fer, comme un remords qui ne s’atténuera jamais. Des hommes et des femmes qui m’avaient fait confiance, que j’avais entraînés à notre suite et que les légionnaires repoussaient sur le sol. Les mains qui s’accrochaient aux ridelles recevaient des coups de crosse jusqu’à tomber dans la poussière. Certains criaient, suppliaient. D’autres nous regardaient simplement, et leur incompréhension rendait notre trahison plus effroyable encore. »
« Exilé d’un pays où je ne suis pas né »
Quand les camions s’éloignent, le silence retombe. L’arrachement est consommé. Les légionnaires regardent le plancher : « Cette évacuation me brûlait. Secoué par les cahots de la piste, je fermais les yeux de douleur et de honte. Cette scène de cauchemar, où tous les liens humains basculèrent dans l’innommable, me happe encore, certains soirs, pour me jeter dans les gouffres de mon passé. Le remords me hante alors que j’ai atteint, vaille que vaille, les hauts plateaux de la vie, cette période de paix où l’on adhère à soi-même. » Saint-Marc évoque ses cauchemars : Talung a rejoint Buchenwald. « J’avais le sentiment d’avoir été parjure. […] Nous avons pris la fuite comme des malfrats. Ils ont été assassinés à cause de nous. Sachez-le, c’était un crime. » Saint-Marc retourna au Vietnam, quatre décennies plus tard. Il refusa d’aller à Talung : « Je n’ai pas pu… Il est des sanctuaires à préserver, même en soi. »
Ses premières épreuves, endurées entre 19 et 23 ans, lui avaient appris le tragique de la vie. En Indochine, son engagement total lui a fait découvrir un monde inconnu et la rage de vivre, le goût du défi, du plaisir, la fraternité d’armes, l’égalité devant la mort. Après Buchenwald, « l’Indo » fut la matrice de ce formidable humanisme que le grand public découvrira, quarante ans plus tard : « À nous qui devions donner la mort, cette guerre a enseigné l’éblouissement de la vie. Elle nous a appris la fragilité de l’instant, l’ordre parallèle des choses. Elle a uni notre sang à celui des Vietnamiens. […] J’allais devoir vivre la suite de mon existence avec cette blessure. […] Dans ce combat étrange qu’est la vie, quelques feux nous éclairent. Ces brèves et éblouissantes flambées jalonnent notre route. Talung a été pour moi l’un de ces incendies. »
Cette incandescence, heureuse et douloureuse, restera vive, jusqu’à la fin. Avant de s’éteindre, le 26 août 2013, Hélie de Saint-Marc remontait parfois la piste de ses « années de braise ». Il s’attardait toujours, un peu plus, sur l’Indochine : « Depuis 1954, il me semble parfois vivre en exil d’un pays où je ne suis pas né. »