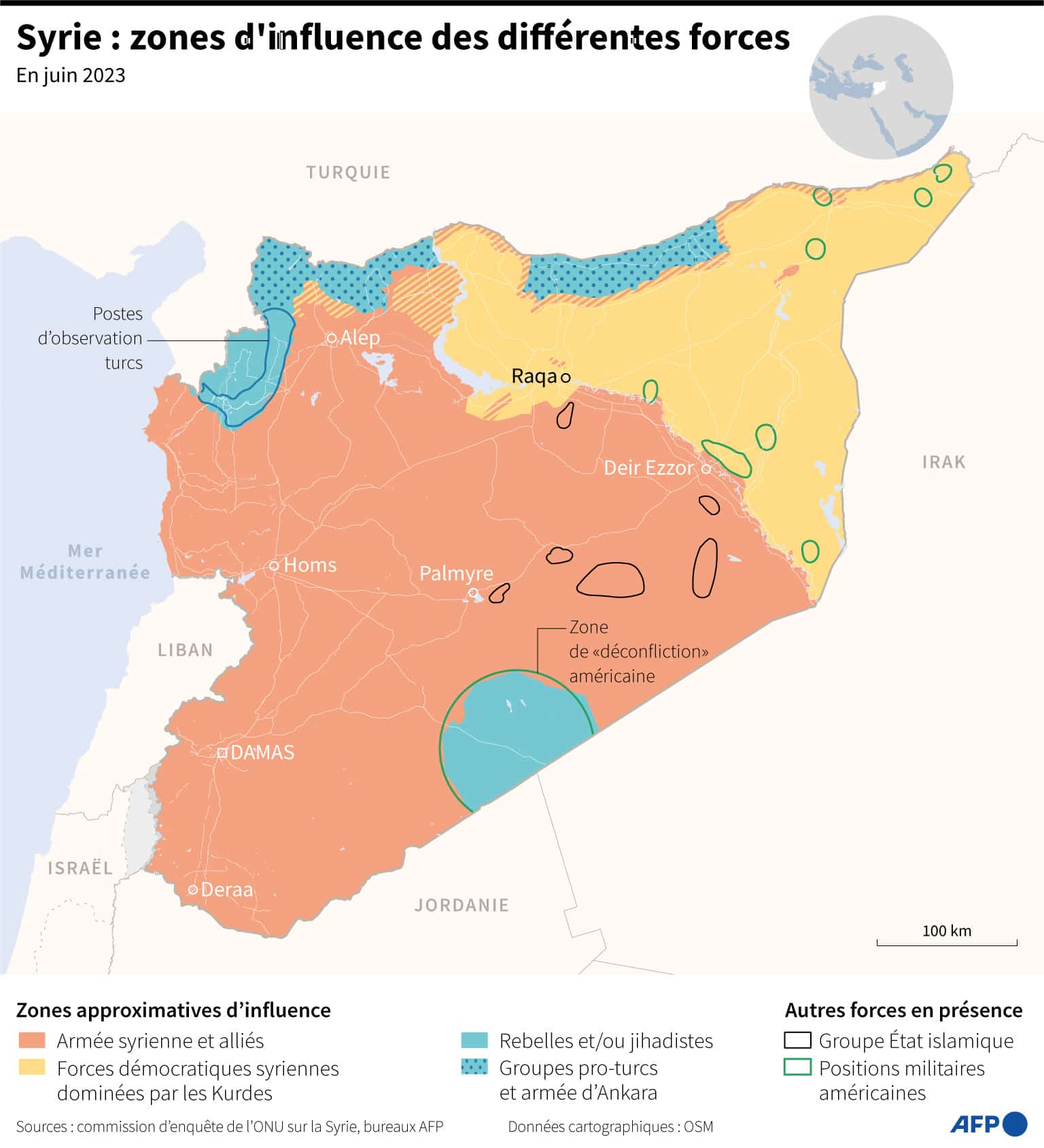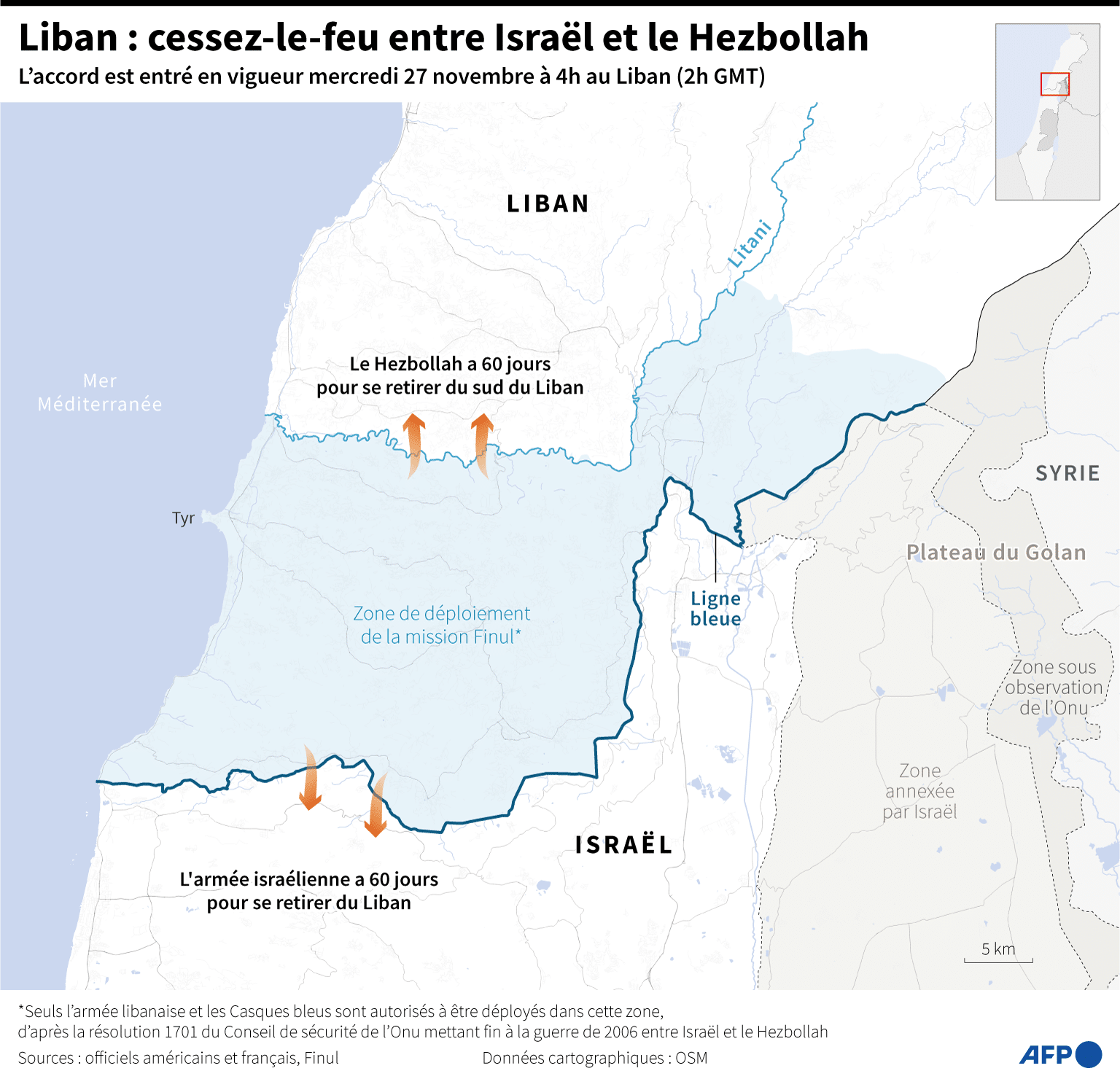Le 4 juin 1940, le monde est sous le choc de la déroute de l’armée française. Aux Communes, Winston Churchill transforme l’évacuation de la poche de Dunkerque en première victoire de la guerre et affiche sa détermination : « […] nous nous battrons sur les mers et les océans, nous nous battrons […] dans les airs, […] nous nous battrons sur les plages, […] nous nous battrons dans les champs et dans les rues, nous nous battrons dans les collines ; nous ne nous rendrons jamais […]. »
Mais sera-t-il suivi ? Devant l’effondrement imprévu de la France, l’opinion britannique, et notamment celle des dirigeants, est rien moins qu’unanime. Le Royaume-Uni a été, depuis 1936 au moins, l’inspirateur de la politique d’appeasement, reposant sur la conviction que la guerre pouvait, donc devait, être évitée. Telle fut la certitude du prédécesseur de Churchill, Neville Chamberlain, jusqu’à l’invasion de la Tchécoslovaquie en mars 1939 ; Chamberlain est toujours au gouvernement et après son raidissement en 1939, la défaite française l’incite à nouveau au compromis. Comme lord Halifax, incarnation de l’appeasement et inamovible ministre des Affaires étrangères depuis février 1938, qui cherche à nouer des contacts avec l’Allemagne via la Suède dès le 17 juin.
« Their finest hour »
La position de Churchill, devenu Premier ministre le 10 mai, au lendemain de l’échec de l’expédition de Norvège, est donc fragile, car son cabinet n’a d’union nationale que le nom et l’apparence. Son autorité est discutée : fin mai, le général Gort ignore son ordre de participer à une offensive pour tenter de dégager Dunkerque, privilégiant l’évacuation de son corps expéditionnaire, et Dowding refuse d’engager les 450 chasseurs restant à la Royal Air Force (RAF) pour couvrir une armée française déjà en perdition. Une partie de son cabinet est aussi circonspecte sur le soutien qu’il accorde à de Gaulle, à qui il cache cependant jusqu’au bout l’opération Catapult qui aboutit au drame de Mers-el-Kébir, le 3 juillet. A posteriori, cette opération semble d’une maladresse insigne – « plus qu’un crime, c’est une faute », aurait dit Fouché. Elle alimente en France une anglophobie déjà bien représentée autour de Pétain, avec notamment Darlan ou Laval ; elle prépare donc le terrain au vote des pleins pouvoirs à Vichy, le 10 juillet ; enfin, elle torpille le recrutement de la France libre naissante, voire de la Résistance. Au regard de tels inconvénients, et sachant que l’Axe manquait de toute façon de marins et de mazout pour utiliser les navires français, la décision a surtout un sens politique : prouver que les discours du 4 et du 18 juin, qui annonce la « bataille d’Angleterre » comme l’heure de gloire de l’empire, n’étaient pas un effet de manche, et ainsi couper court à une paix de compromis.
Hitler comprit le message. Le ton de ses discours se durcit durant l’été et il résolut de faire céder les Britanniques par deux voies : à court terme, préparer ostensiblement une invasion de la Grande-Bretagne, en espérant pousser les « apaiseurs » à évincer Churchill ; à moyen terme, basculer secrètement ses forces vers l’est pour foudroyer l’URSS et priver ainsi Churchill du dernier soutien qu’il pouvait espérer – Hitler ne croyait pas en effet à un engagement américain.
À lire aussi : Livre ; Les Mémoires de Winston Churchill
Pour que la perspective d’invasion apparaisse crédible, en dépit des faibles moyens alloués (11 divisions dont 2 aéroportées, quand l’attaque du 10 mai en avait mobilisé 160), il fallait dominer le ciel au-dessus de la Manche, donc achever de balayer une RAF éprouvée par la campagne de France. La bataille d’Angleterre est donc bien conçue, côté allemand, comme une bataille décisive, dans une logique napoléonienne : concentration des forces, anéantissement de l’adversaire ou de sa capacité et volonté de combattre. Le chef de la Luftwaffe, Hermann Göring, est d’ailleurs confiant, comme à son habitude : pour peu que règne le beau temps, il se fait fort d’éliminer la RAF en cinq jours. Il n’y parviendra pas en seize… semaines !
Un aigle vite déplumé
Le rapport de force semblait pourtant favorable : malgré de lourdes pertes au printemps, les trois Luftflotten (flottes aériennes) qu’engage l’Allemagne alignent environ deux fois plus de chasseurs que le Royaume-Uni. Conscient de cette faiblesse, l’Air Marshal Dowding, commandant le Figther Command, mena sa bataille dans une logique inverse de Göring, n’engageant ses forces qu’avec parcimonie et livrant une bataille d’attrition qui tourna à son avantage pour trois raisons principales : les pertes allemandes furent presque toujours supérieures aux anglaises[6] ; l’industrie britannique produisait 100 à 120 nouveaux chasseurs chaque semaine, trois fois plus que de Bf 109 ; last but not least, les objectifs allemands furent régulièrement modifiés. En juillet, la Luftwaffe vise les convois de navires marchands, que les chasseurs sont contraints de protéger ; début août, les navires britanniques, même de guerre, ne se hasardent plus guère dans la Manche ou subissent de lourdes pertes, mais Hitler, qui a désormais résolu d’attaquer l’URSS au printemps 1941, s’impatiente et prévoit le débarquement en Angleterre au 15 septembre. Göring doit porter le coup de grâce en attaquant les installations au sol et l’industrie aéronautique depuis la côte jusqu’à la région londonienne ou aux Midlands : cette deuxième phase est baptisée « Attaque de l’aigle ».
L’attaque commence le 13 août, logiquement désigné « jour de l’Aigle ». Dès le début, l’efficacité de la défense anglaise est patente, appuyée sur un dense réseau de stations radars le long des côtes de Grande-Bretagne – la Chain Home – qui juxtaposait des radars de longue portée à hautes fréquences et des radars repérant des objets plus proches à basse altitude. Le Fighter Command disposait donc d’un préavis suffisant pour intercepter les raids. Ce jour-là, au prix de 20 avions perdus, la RAF abattit 44 appareils allemands et en endommagea une vingtaine d’autres. A contrario, la planification allemande souffrait d’une carence du renseignement de terrain. Sous-estimation du nombre de bases ou des usines aéronautiques, confusion entre les bases de la chasse et celles des autres branches, imprécision du nombre et des localisations des stations radars… Autant d’approximations qui entraînèrent une dilution d’efficacité. Pire : Göring interdira rapidement les attaques contre les stations radars, les jugeant inefficaces au vu de leur rapide remise en service, et contre les bases déjà atteintes la veille, facilitant ainsi la restauration des infrastructures.
À lire aussi : Grande bataille ; Hastings (14 octobre 1066), quand l’Angleterre s’arrimait au continent
Le 15 août la Luftwaffe produit un effort exceptionnel, avec 1 784 sorties, mais subit aussi des pertes très lourdes : 75 avions détruits pour les Luftflotte 2 et 3, opérant depuis la France et la Belgique, et 57 pour la seule Luftflotte 5, venue pour la première fois depuis la Norvège ou le Danemark – et qu’on ne reverra plus dans le ciel britannique. Ce « jeudi noir » illustre les difficultés tactiques de la Luftwaffe : son chasseur le plus performant, le Messerschmitt Bf 109 (cf. note 6), avait un rayon d’action trop limité pour soutenir longtemps le combat si le vol d’approche se prolongeait ou quand il fallait escorter les bombardiers jusqu’à la région de Londres ; quant au bimoteur Bf 110, sur lequel Göring comptait beaucoup pour son autonomie et sa puissance de feu, surclassé en manœuvre par les Hurricane et Spitfire, il subit une véritable hécatombe et finit par être retiré, comme le bombardier en piqué Stuka, si efficace en attaque au sol et dans la Manche, mais trop lent face aux chasseurs britanniques. Quant aux bombardiers, ils n’étaient pas assez protégés pour agir sans escorte et manquaient aussi d’autonomie.
Un changement inespéré
Après trois semaines de combats intenses, la RAF arrive néanmoins en limite de capacité, car l’industrie ne peut compenser les pertes en avions qu’en puisant dans ses stocks et les pilotes sont épuisés ou… de plus en plus rares et inexpérimentés (l’espérance de vie moyenne est de 87 heures de vol, à peine deux semaines en escadrille active). Dowding ne se voit pas tenir plus de trois semaines, quand un enchaînement fortuit lui procure un répit salvateur : le 24 août, un bombardier allemand égaré, croyant attaquer une raffinerie, lâche ses bombes sur Londres, qu’Hitler avait interdit d’attaquer sans son ordre exprès. En représailles, la RAF monte les jours suivants plusieurs raids sur Berlin, faisant peu de dégâts, mais mettant Hitler en fureur. Comme il hésite toutefois à déclencher l’invasion, qui lui est déconseillée par Jodl, le chef de l’OKW, Göring affirme pouvoir contraindre les Anglais à capituler en bombardant massivement les villes, à commencer par Londres. Dès le 7 septembre, un premier raid de 300 bombardiers, couverts par 700 chasseurs, frappe la capitale d’autant plus facilement que la défense, comme à l’habitude, s’est déployée au-dessus des cibles militaires. Les Anglais baptisèrent la période le Blitz, qui se prolongea jusqu’au printemps 1941.
Paradoxalement, car les pertes civiles augmentèrent (elles atteindront le niveau encore inédit de 40 000 morts et 46 000 blessés), ce changement sauva la Grande-Bretagne : la RAF reconstitua ses forces et fin septembre, elle alignait autant de chasseurs que son adversaire ; son nombre de pilotes en ligne est passé de 1 200 en juillet à 1 800 en novembre, malgré les 544 tués représentant 45 % de l’effectif initial. Fin septembre, les Allemands renoncèrent aux raids de jour, trop coûteux, pour se limiter aux attaques nocturnes, comme dans la nuit du 14 au 15 novembre sur Coventry, dont la cathédrale du xive siècle brûla totalement. La RAF restait impuissante face à ces attaques, ne disposant d’aucun chasseur de nuit avec radar avant le printemps 1941, et ne pouvant intercepter les Bf 109 et Bf 110 reconvertis en bombardiers légers, qui volaient à 9 000 m d’altitude, hors d’atteinte de ses chasseurs.
La bataille d’Angleterre fut donc bien une bataille décisive, à plus d’un titre : elle poussa Hitler à changer de stratégie et légitima définitivement la position radicale de Churchill – Halifax est écarté en décembre 1940 –, constituant un pas décisif vers la mondialisation du conflit ; elle affaiblit durablement la Luftwaffe par la saignée humaine qu’elle subit (2 700 navigants, dont beaucoup expérimentés par trois campagnes) ; enfin, elle encouragea les Alliés à développer, avec des moyens bien plus conséquents et adaptés que ceux de la Luftwaffe de 1940, une tactique de bombardements stratégiques visant l’économie et les civils ennemis selon la prophétie du général italien Douhet : « Désormais, il n’y aura plus de distinction entre les soldats et les civils. » Signe que la population britannique ne fut sans doute pas aussi stoïque que le montra la propagande de guerre.