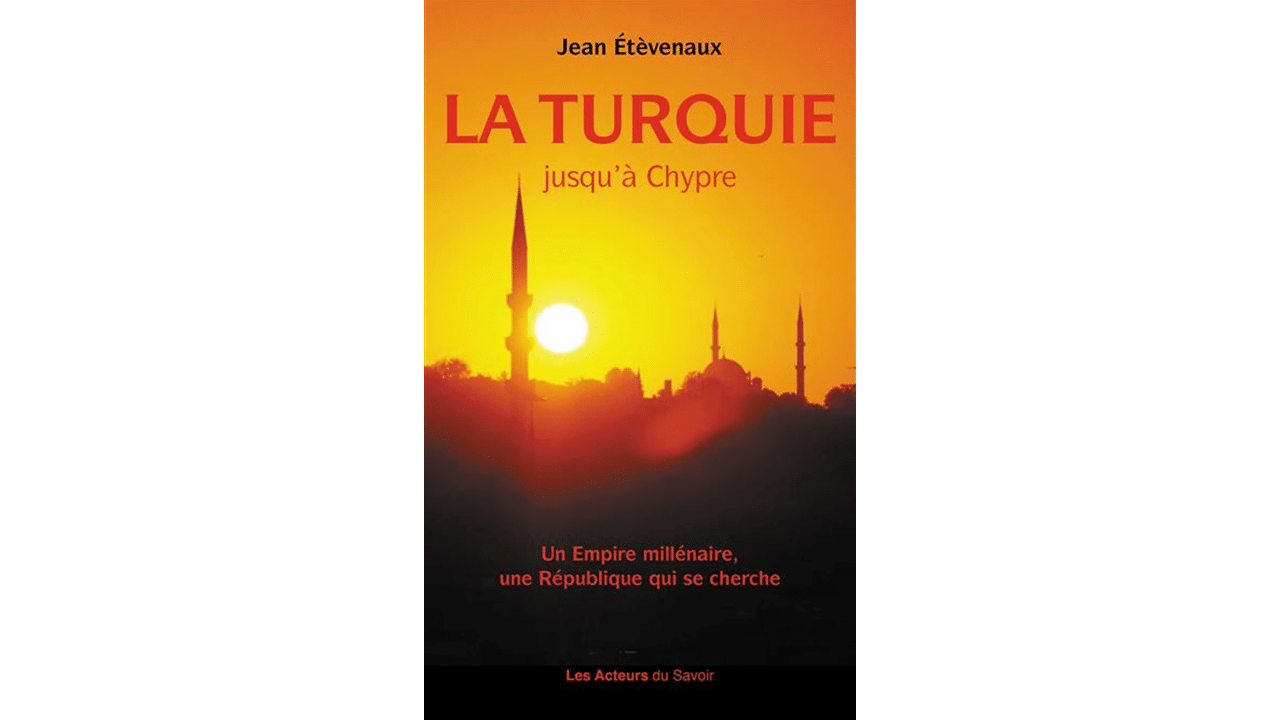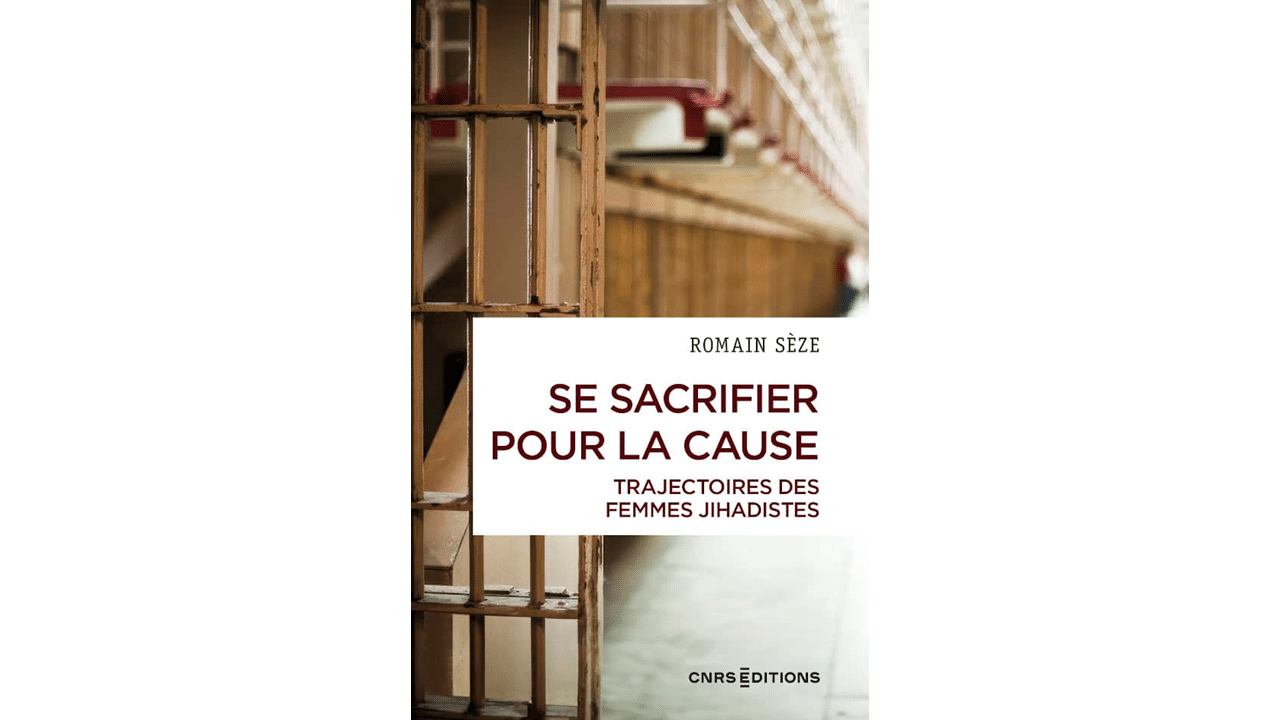Israël a été confronté au terrorisme dès le début de son histoire. Conscient de l’impossibilité de supprimer la menace, l’État hébreux a développé plusieurs techniques pour la réduire au maximum, la fameuse stratégie de « la tonte de gazon ».
Le projet national juif eut, dès ses origines à la fin du XIXe siècle, une dimension violente. Très tôt, face aux intentions des nouveaux arrivants, la population indigène non juive[1] s’est mise à résister, y compris par la violence, à leur projet politique et culturel. Cette population, comme les juifs européens sionistes, était travaillée par les mêmes courants de fond économiques, culturels et politiques qui bouleversèrent l’Europe et l’Orient.
Ainsi, les premières décennies du conflit ont vu ses différents acteurs se doter de techniques et d’institutions qui les ont profondément transformés. Les juifs, ainsi que les communautés arabes dans les territoires arrachés après 1918 à l’Empire ottoman – à l’exception notable des Palestiniens – ont chacun construit des États et en ont épousé les logiques et les pratiques.
En 1948, le conflit au Moyen-Orient est devenu étatique dans le sens où l’État – avec son statut juridique et ses monopoles (notamment sur la violence et les domaines régaliens) – en constituait son principal moyen d’organisation et de mobilisation. De ce fait, les Palestiniens, seuls acteurs non dotés d’État, ont été réduits au rôle d’outil entre les mains des États arabes. Mais une vingtaine d’années plus tard, à la suite de la guerre de 1967, cette matrice commença à se fissurer. À partir de 1968, Israël fait face à une nouvelle forme d’une vieille menace : la violence palestinienne utilisée à des fins politiques par une myriade d’organisations subétatiques. Nouvelles structures, nouvelles idéologies (les différentes chapelles du socialisme anticolonial tiers-mondiste), mais surtout nouveaux modes opératoires : détournements d’avions, attentats à l’étranger, tirs de roquettes[2] – sans abandonner la guérilla – font leur apparition aux côtés des menaces traditionnelles venues des États arabes, leurs armées et leurs alliances. Cette évolution commence un an après la guerre des Six Jours de juin 1967. Même si le Fatah, la structure qui inaugure la lutte armée palestinienne contre Israël, lance le premier attentat le 1er janvier 1965, c’est à la suite de la guerre de 1967 que les dirigeants des États arabes comprirent qu’Israël ne serait pas éliminé par l’action des armées conventionnelles et que les Palestiniens réalisèrent que les armées arabes n’allaient pas reconquérir pour eux les terres perdues en 1948-1949.
À lire aussi : Livre – Les douze piliers d’Israël
De la lutte à la normalisation de l’État
Entre 1968 et 1982, un conflit de haute intensité entre États où les Palestiniens sont utilisés à des fins étrangères à leurs propres intérêts se transforme en un conflit de basse intensité entre Israël et une multitude d’acteurs subétatiques palestiniens. Le dernier grand affrontement militaire conventionnel auquel Israël a participé a eu lieu en 1982 au Liban, contre l’armée syrienne. Entre l’accord de paix avec l’Égypte en 1979 et la rafale de normalisations de jure en 2020 (Émirats arabes unis, Bahreïn, Maroc) et de facto (l’Oman, l’Arabie saoudite et le Soudan), l’ère de l’hostilité des États arabes à Israël est terminé, au moins temporairement. Dans la plupart des pays arabes, la logique de l’État et ses intérêts propres ont fini par s’imposer et imposer cette normalisation. Or, en même temps que les différents États arabes sortaient, chacun à son rythme, du cycle de la violence, l’État comme institution continuait son affaiblissement dans le monde arabe. Le séisme connu sous le nom de « printemps arabes » mettant à terre un certain nombre de ces États, comme la Syrie et le Yémen. Si l’on ajoute l’écroulement des États iraquien et libanais et la crise profonde des États algérien et tunisien, le constat est sans appel : il n’y a pas vraiment de dimension étatique du conflit israélo-arabe. Les deux premières décennies du xxie siècle ont achevé de façonner la nouvelle donne géopolitique : le Hamas, le Hezbollah, Daech et Al-Qaïda prospèrent sur les cadavres des États arabes et le chaos d’un monde postidéologique et multipolaire. Désormais, c’est la faiblesse ou l’absence des structures étatiques qui posent un problème à l’État le mieux organisé de la région.
S’organiser contre le terrorisme
Par tâtonnements, Israël a peu à peu élaboré ses réponses à cette nouvelle situation. Comme de coutume, les idées tactiques et technologiques ont précédé une réflexion politique et stratégique faible et tardive. Dans un premier temps, la réponse fut composée de cinq éléments : protection de cibles à l’étranger (El Al, ambassades, communautés juives), moyens tactiques antiterroristes (les forces spéciales d’intervention, ancêtres du GIGN, font leur première en prenant d’assaut l’avion de Sabena le 9 mai 1972), surveillance accrue des frontières, énorme effort de renseignement (la population palestinienne est étroitement quadrillée et surveillée par le Shin Bet) et enfin une pression sur les États qui servaient de bases arrières (Jordanie, Liban et Syrie). Cette étape culmine en 1976 avec l’opération de libération d’un avion d’Air France détourné, dont les otages étaient détenus à Entebbe (Ouganda), et prend fin en 1987 avec le déclenchement de la première intifada, l’insurrection de la population palestinienne de Gaza et de la Cisjordanie. Contrairement aux États arabes des années 1950-1980, des organisations telles que le Hamas, le Jihad islamique, le Hezbollah ou le Jihad mondial (Al-Qaïda et Daech) adoptent une doctrine de résistance – Mukawama, en arabe : la croyance qu’en dépit des obstacles temporaires, le conflit historique avec Israël, aussi long soit-il, se terminera par la destruction de celui-ci comme le fut jadis l’État des croisés. Leur stratégie vise à maintenir une violence continue dans le de saper la volonté israélienne. Ils croient que le temps et la démographie jouent en leur faveur et voient en Israël une société occidentale molle et apeurée, fatiguée des sacrifices et accro à la consommation.
À lire aussi : Israël : le renseignement, une question de survie
Depuis 1982, Israël utilise la force militaire principalement contre ces organisations armées subétatiques dans un effort de longue haleine appelé en hébreu « la guerre entre les guerres ». Cette logique est résumée par l’expression « tonte de gazon », une métaphore reflétant la conviction que le conflit est insoluble, car en face se trouvent des entités non étatiques pour lesquelles la guerre n’est pas une continuité de la politique, mais leur raison d’être et la base de leur légitimité. Comment le Hezbollah justifierait-il ses armes et son statut d’État dans l’État au lendemain d’une paix avec Israël ? Comment le Hamas se distinguerait-il de l’Autorité palestinienne sinon par le choix stratégique – et non pas tactique – de la lutte armée contre Israël dont la destruction est l’unique issue possible ? Ainsi, le recours à la force n’a pas pour objectif une solution politique, considérée d’emblée comme impossible, mais de minimiser autant que possible la capacité de l’ennemi à infliger des dommages à Israël. Autrement dit, rendre la vie avec la menace non pas tolérable, mais carrément bonne pour les Israéliens, les juifs qui souhaiteraient s’y installer ainsi que les touristes et autres visiteurs. Conceptuellement, Israël a fini par faire sienne la stratégie de la guérilla : puisqu’on ne peut pas battre l’ennemi sur le champ de bataille, on va l’épuiser et le pousser à la faute.
Les cycles de violence suivent donc une logique d’attrition. L’ennemi attaque et Israël réplique en adaptant sa réponse aux dommages subis et au contexte politique et géopolitique. À la fin du cycle, un événement goutte d’eau fait déborder le vase : une opération d’envergure est déclenchée avec comme but de rendre l’inévitable prochain cycle le plus éloigné possible dans le temps. On coupe le gazon au ras du sol, tout en sachant parfaitement qu’il repoussera. Dans ce contexte géopolitique, la notion de guerre comme une irruption de violence dans une durée limitée flanquée de deux périodes de paix n’a pas de sens. Une guerre de basse intensité, souvent clandestine, appuyée sur un renseignement de qualité, vise sans relâche des personnes, des structures, des circuits de financement et d’approvisionnement, ou des régions géographiques.
Penser le contre-terrorisme
Quant à la conquête des cœurs et des esprits, elle n’est pas négligée, mais ne vise pas l’opinion publique ennemie – impossible à retourner – mais plutôt le renforcement de la résilience de l’opinion publique israélienne. Les idées de David Galula – jamais vraiment appliquée avec succès par ailleurs – ne sont pas opérantes dans le contexte arabo-israélien. La clé est donc dans l’équation de la résilience : l’aptitude de la société israélienne à encaisser sans craquer les capacités des ennemis subétatiques à nuire et à perturber leur vie. La stratégie israélienne repose donc sur trois éléments : renforcer la résistance de sa propre société, affaiblir la capacité de nuire de ses ennemis et enfin inscrire cet ensemble dans la durée, persévérer, continuer à encaisser et à frapper sans relâche décennie après décennie.
Face à la puissante mobilisation du fanatisme islamique et à la haine des « juifs et des croisés », Israël déploie sa richesse, son avantage technologique, une infrastructure étatique développée et un système d’alliances efficace. Tant que le prix du conflit sera perçu par la société israélienne comme tolérable, il n’y aura ni pression pour une solution politique ni découragement.
Quant à la friction directe avec les populations hostiles, à la suite de l’amère expérience acquise au Liban, en Cisjordanie et à Gaza, Israël poursuit depuis les années 1990 une politique de désengagement des zones habitées. En mai 2000, Israël s’est retiré unilatéralement du sud du Liban et en 2002, en pleine deuxième intifada, il a construit une clôture de sécurité en bordure ouest de la Cisjordanie. Enfin, en août 2005, Israël s’est complètement retiré de Gaza. Cependant, dans les zones que l’État hébreu considère comme essentielles à sa sécurité – comme la Cisjordanie –, il maintient une présence militaire, toujours en dehors des zones densément peuplées. Cette guerre de basse intensité est donc menée de plus en plus de part et d’autre par le feu à distance, des roquettes (et non des missiles) d’un côté, des unités spéciales et des plateformes aériennes de l’autre.
Au fil des années, l’armée de l’air israélienne s’est adaptée aux nouveaux usages de la force. En étroite coopération avec le Shin Bet, elle a perfectionné des méthodes permettant de faire une chasse efficace aux lanceurs de roquettes et aux leaders militaires et politiques adversaires. Dans les deux cas, il s’agit de cycles opérationnels (détection, identification, priorisation, allocation d’armement, décision, frappe, évaluation des dégâts) extrêmement courts (quelques minutes), résultat d’une révolution technologique et organisationnelle dominée par la mise en réseaux de moyens et de plateformes aériennes pilotées de loin.
À lire aussi : Livre – Le terrorisme comme personnage de roman
Établir un système de défense
Les actions préventives, telles que celles visant à empêcher la fourniture en armes avancées au Hezbollah et au Hamas (notamment des moyens améliorant la portée et la précision des roquettes) – rarement revendiquées par Israël – font partie de la guerre entre les guerres. Cette catégorie comprend également les opérations secrètes contre les réseaux de renseignement et de financement à l’étranger, ainsi que les arrestations préventives d’agents terroristes, destinées à perturber les attaques planifiées ou à recueillir des renseignements.
Enfin, l’utilisation intensive d’armes à trajectoire haute (roquettes et mortiers) par l’ennemi a obligé les stratèges israéliens à réfléchir et à allouer de vrais moyens à la défense. Longtemps obsédé par la logique offensive, Israël a fini par développer un système de défense dont le premier niveau est le dôme de fer pour l’interception des obus de mortier et de roquettes à courte et moyenne portée. Le gain est double. Sur le plan politique, minimiser les dégâts matériels et les pertes humaines laisse au gouvernement israélien le choix du moment propice et de l’ampleur de la réponse. De même, le développement et la production en un temps record d’un système aussi performant a permis à l’industrie israélienne de la défense de proposer à ses clients une solution unique. Comme jadis avec les drones, un problème opérationnel devient un avantage technologique et opérationnel en même temps qu’un secteur d’activité économique. Cependant, cette stratégie a ses limites. L’opération Bouclier défensif en Cisjordanie en avril 2002, la seconde guerre du Liban en 2006, les opérations à Gaza en 2008-2009, 2012 et 2014 : autant de « petites guerres » qui durent des jours, voire des semaines, paralysent l’État d’Israël, lui coûtent cher et exposent sa vulnérabilité. Le bilan est donc positif, mais fragile : l’opération Bouclier défensif a brisé la seconde intifada et la guerre au Liban en 2006 a contribué à calmer le secteur depuis. Grâce aux opérations israéliennes plus au moins secrètes, ainsi qu’en raison de l’implication du Hezbollah en Syrie, la frontière israélo-libanaise bénéficie ces quinze dernières années d’un répit sans précédent depuis 1968.
Soixante-douze ans après sa fondation et cent quarante ans après les premières réalisations du projet national juif, Israël et le sionisme n’ont toujours pas trouvé une réponse adéquate à la question qui leur est posée depuis les origines : quelle place pour les Arabes (devenus Palestiniens) sur cette terre ? Mais faute de réponse, doté d’un génie tactique et technologique, Israël comble les brèches, gagne du temps et impose des faits accomplis, tout en soignant sa population, son économie et ses infrastructures.
À lire aussi : Le terrorisme maritime : menace ou fantasme ?
[1] Il existait des juifs autochtones dans quasiment toutes les villes arabes avant le début du sionisme.
[2] Les premières Katiouchas sont lancées de la Jordanie vers la ville de Beth Shéan le 16 septembre 1968.