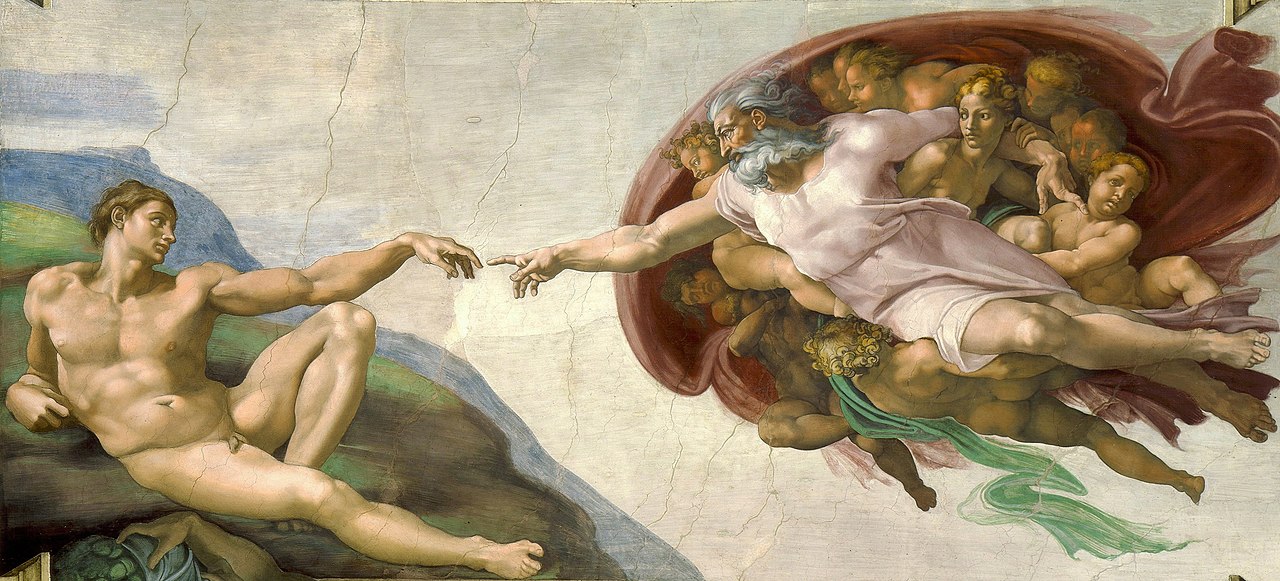Entretien avec Justo Mellado, attaché culturel de l’ambassade du Chili en France pour évoquer ce pays d’Amérique latine du cône sud de l’Atlantique. Histoire du Chili, rapports à la mémoire, constitution et élaboration de la nation, Justo Mellado explique les particularités de cette région.
Cet entretien est la retranscription d’une partie de l’émission podcast réalisée avec Justo Mellado. L’émission est à écouter ici.
Jean-Baptiste Noé : Le Chili est indépendant depuis deux siècles, comme la plupart des pays d’Amérique latine. Ces différents pays, s’ils ont un fond culturel identique, ont de grandes différences, des tonalités propres. D’où vient cette diversité des pays d’Amérique latine ?
Justo Mellado : C’est difficile de répondre comme ça. Ça dépend de la façon dont ils étaient liés à la couronne espagnole et des rapports entretenus avec les populations indigènes. Le Chili était une capitaine générale d’un vice-royaume. A Lima, il y avait une cour royale et la cuisine qui allait avec, ce qui n’est pas le cas du Chili qui était une capitainerie générale. L’histoire des élites locales est différente aussi, moins liée à des difficultés internes de guerre civile pendant la colonisation. On n’allait pas chercher d’or ou de pierres précieuses au Chili. Des bourgeoisies nationales se sont développées de manière autonome.
JBN : C’est le pays le plus stable de l’Amérique latine, le plus développé et riche, il a une tradition démocratique et de stabilité que n’ont pas les autres pays…
JM : Ce n’est pas si vrai, les militaires ont toujours eu quelque chose à dire. Alain Joxe a publié dans les années 1960 un essai sur l’action politique des militaires au Chili, c’est un signe d’instabilité. Mais il y avait bien une stabilité formelle au moins jusqu’en 1973.
À lire aussi : Fenêtre sur le monde. Chili, populisme et unité nationale
JBN : Pinochet part à la suite d’un référendum perdu, donc d’un processus démocratique. Comment le Chili est parvenu à la transition démocratique sans violence après son départ ?
JM : Notre classe politique a réussi un compromis qu’une partie de la population considère comme illégitime aujourd’hui. Ceux qui sont dans la rue aujourd’hui soutiennent que notre démocratie est fondée sur un pacte illégitime. Mais y avait-il une autre possibilité ? Certes, ces hommes de 1987-88 avaient peut-être une marge de manœuvre plus grande, mais c’est de l’histoire-fiction, on ne peut pas réécrire l’histoire. Le départ de Pinochet a été une affaire complexe, avec les Américains etc. Il y a eu une conciliation, qu’elle nous plaise ou non.
JBN : Qu’est-ce qu’on reproche à ce pacte ? On a parlé d’écrire une nouvelle constitution…
JM : De ne pas avoir satisfait les demandes légitimes de la société chilienne dans son ensemble. Nos problèmes sont l’inégalité, la participation politique, la protection des écosystèmes, la culture comme industrie… On n’a pas rempli ces demandes d’équité et de justice sociale, associées aux droits de l’homme. Mais c’est lié à l’histoire de notre souveraineté, de la légitimité de notre classe politique. Une gauche fondamentaliste pense l’histoire du Chili comme celle de la séquestration de la volonté populaire par les constitutions libérales, c’est un anachronisme total, une réécriture de l’histoire à travers celle des rapports de force.
JBN : Le Chili a une forte concentration urbaine à Santiago, quelles sont les autres grandes villes ? N’y a-t-il pas une disparité territoriale dans ce pays si étendu, en termes d’activité, d’aménagement du territoire ?
JM : Concepcion est une autre grande ville. Oui c’est un pays très centralisé mais avec une certaine homogénéité, qui va décroissant. Tout au long du XXe siècle, on a pris conscience d’une diversité territoriale et culturelle qui est devenue un sujet politique. La diversité reste inférieure à l’homogénéité. Le grand nord, le sud austral font une grande diversité territoriale, climatique et culturelle mais pas politique, le Chili est assez jacobin.
JBN : Le Chili est dans le Pacifique sud, comment voir une coopération franco-chilienne (Nouvelle-Calédonie, Polynésie…) dans le Pacifique ?
JM : Il y a une complicité dans cette complexité. C’est un triangle très vaste. En face du Chili, il y a la Polynésie par Rapa-Nui. Le port de Valparaiso était le plus important de la mondialisation du XIXe siècle, en lien avec celui de Brest notamment. Il s’agit d’établir des rapports stratégiques, une géopolitique de l’océan. Il y a là des enjeux scientifiques avec l’Antarctique.
À lire aussi : Chili : l’impulsion destructrice
JBN : Au-delà du cadre littéraire des œuvres de Jean Raspail, il y a eu un projet politique de la Patagonie qui a échoué…
JM : Oui, le projet d’Antoine Ier, ce n’était pas fou du tout, il avait un projet politique. Il a voulu que le gouvernement français l’appuie, il s’est installé comme roi et a été accepté par des communautés indigènes qui ne se méfient pas de la monarchie comme ils se méfient de la république, vorace. Alberto Blest Gana chef de la légation du Chili a été à la tête de cette légation entre 1869 et 1887. Il était en France au moment du printemps des peuples.
JBN : Il y avait un vrai projet politique de contrôle de la mer du Sud et de contrôle des populations indigènes, qui auraient un territoire où elles seraient libres et fédérées…
JM : Oui, des communautés qui pour certaines ont été décimées.
JBN : Napoléon III a eu un projet proche au Mexique, voulant fédérer un gouvernement latin avec un monarque contre les Etats-Unis naissants. Il y avait une pensée globale du continent…
JM : Certes, mais cela a été mineur. C’est un cas particulier, il n’y a pas vraiment eu de diplomatie, de politique française pour l’Amérique du Sud au XIXe siècle.
JBN : Le Chili a eu des tensions avec l’Argentine et la Bolivie, ces relations sont-elles pacifiées aujourd’hui ?
JM : Oui. On n’arrête jamais de discuter, on est allés devant la Cour pénale internationale sur le droit à la mer notamment, c’est le produit d’une guerre mais elle s’est terminée par des traités qu’on respecte.
JBN : On parle parfois d’une volonté destructrice de certains. Par sa réussite économique, le Chili ne suscite-t-il pas des jalousies ?
JM : Sans devenir conspirationniste, on peut penser ça mais ça n’explique pas tout. La politique économique du Chili ne fait pas consensus, il y a une contestation. Il faut changer l’état de ses bases, donc il y a une campagne pour obtenir un accord national pour changer de constitution. S’il y a l’hypothèse d’un changement de constitution, on en discutera, ça ne fait que commencer. Le Chili est un laboratoire de l’analyse du fait constitutionnel en 2020 : faire une constitution aujourd’hui et il y a 30 ans ce n’est pas la même chose.
JBN : En Espagne, la politique est très décentralisée, ce n’est pas le cas au Chili…
JM : Une boutade dit de toujours comparer ce qui se passe au Chili et ce qui se passe en Espagne. L’extrême gauche des années 70 lisait des auteurs espagnols pour anticiper le coup d’Etat contre Allende. La référence à une pensée mythique antérieure vise à voir l’avenir, c’est une folie. Du coup l’idée de « faire comme la constitution espagnole » ce n’est pas si simple. Avec la réforme agraire il y a une remise en question non seulement du principe de propriété mais du rapport, du lien social à la terre et à la société. On fait une constitution pour trancher la question du partage de la non-voracité sociale, pas pour avantager l’un ou l’autre. Que sommes-nous disposés à perdre ? Telle est la question.
JBN : On a vu les contestations contre l’augmentation du prix du ticket de métro, des églises incendiées, des statues déboulonnées… La question n’est donc pas qu’économique ou sociale, elle est culturelle, symbolique, il s’agit de bâtir un Etat sur d’autres bases…
JM : C’est tout à fait symbolique, c’est un scandale. On ne peut pas effacer le passé à cause de la rue, la rue c’est l’absence de discours, de dialogue, c’est la dernière manifestation d’une chute de la parole. L’élaboration d’un passé ne dépend pas de la rue. « Jusqu’où puis-je supporter ce mal-être qu’a installé l’Etat dans mon corps ? », disent-ils. Peut-on avoir cet accord ? Certains ne veulent pas arriver à un accord. C’est l’idée que je ferai du mal à un autre même si je me fais mal par la même occasion : c’est une voie sans issue. On ne peut dépasser ça qu’avec la parole. Je ne peux plus parler avec tout un tas de gens, parce qu’ils le refusent, du coup moi-même je ne veux pas parler.
JBN : Quand un conflit social porte sur ce genre de questions symboliques, comment recréer une société de fraternité où une nation accepte de nouveau de vivre en commun ?
JM : Il faut que l’un s’abstienne d’exercer quelque chose et que l’autre accepte de perdre quelque chose. Vouloir « tout maintenant », c’est impossible. Il faut d’abord se mettre d’accord sur la nature du « maintenant », sur les entre-deux entre les paroles irréductibles, et sur le « tout », qui est la dimension d’un mal-être qui passe par les inégalités sociales, l’éducation, la répression policière, la santé… Oui mais c’est tout.
JBN : Par quoi sont inspirés les révolutionnaires ? Le modèle cubain, vénézuélien ?
JM : Non, ce n’est pas une question de modèle, c’est la nostalgie de l’unité populaire. C’est « vous nous avez séquestré la possibilité d’une utopie, on veut l’utopie, maintenant ». C’est Allende qui est le grand fantasme derrière tout ça, mais on l’invente comme ça. Allende représentait l’utopie qui a été détruite. C’est une tournure symbolique qui est collée à la peau.
JBN : Le perronisme, le populisme est-il présent dans l’histoire politique chilienne ?
JM : Il y a du populisme dans tous les mouvements de la transition démocratique : sans un certain taux de populisme, ils n’auraient pas pu arriver au pouvoir. C’était du populisme raisonnable, il fallait attendre et maintenant on n’attend plus, c’est la grande différence… En termes de sciences politiques, le populisme, au sens non péjoratif, est substantiel à notre vie politique, mais il doit rester dans le raisonnable. Au Chili, c’est surtout le rapport à l’utopie, au verbe, quasi-religieux, qui compte. Il y a quelque part une parole qui a été trahie. C’est notre rapport à la loi, à la lettre. La société chilienne est une société orale. Le rapport au verbe est sacré, religieux, c’est la poésie qui a inventé le Chili.
JBN : Quels sont les poètes importants qui y ont contribué ?
JM : Il y en a dix ou vingt ! Pablo Neruda, Pablo de Rokha, Gabriela Mistral, Vicente Huidobro… Il y a une poésie qui nomme le territoire, le pays. On n’a pas tellement de peinture, de romans ou autre, surtout de la poésie.
JBN : Comment est pensé le territoire au Chili, dans son unité alors qu’il est très étendu et divers ?
JM : Par le mythe, par la poésie, qui est unificatrice. C’est par la parole, on se met d’accord dans la poésie. On a une construction collective de l’utopie, symbolique, qui prend au corps de la société et du rapport de celle-ci avec son territoire. Chaque revendication actuelle mapuche remet en cause 100 ans de rapport, c’est une situation violente.
JBN : C’est aussi la question de la nation : quand on a plusieurs peuples sur un territoire, comment faire une seule nation, une seule culture ?
JM : Par une volonté étatique, un jacobinisme. Mais en se modernisant, face à la diversité, elle doit se modifier et suivre la dynamique de la société, sinon il se passe ce qui est en train de se passer. C’est comme si le contenu était devenu si dense et riche qu’il ne retenait plus dans la forme. Il faut donc changer la forme. Redéfinir la nation est une tâche énorme, et c’est le défi que nous avons devant nous, quand on sait que la science politique européenne considère qu’il n’y a pas eu d’Etat-nation en Amérique latine.
À lire aussi : Entretien avec Andrès Allamand, ministre des Affaires étrangères du Chili