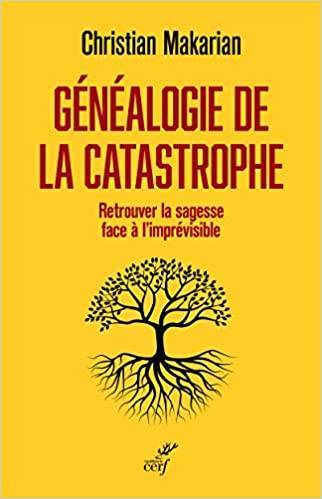Nul besoin de croire en Dieu pour avoir des croyances. Face au virus, nous nous sommes comportés avec des réflexes religieux encore enfouis affirme d’emblée, dans son puissant essai, Christian Makarian, éditorialiste chez L’Express.
Bien entendu, nous avons perdu la connaissance des textes, chassé la transcendance ; mais nous avons conservé l’essentiel du mécanisme des religions : la peur inconsciente de la catastrophe finale. La peur de ce que l’on ne comprend pas, de ce que l’on ne maîtrise pas. La sensation de l’absence de limites était si rassurante, l’exploitation de la terre, le trafic maritime et aérien si réconfortants. Or Descartes supposait la compréhension des lois physiques du macro-univers et du monde microscopique, mais aussi la capacité de restreinte de l’Homme. Dominer et se dominer, c’est que disait aussi le père d’Albert Camus, l’illettré. Être modestement cartésien est l’inverse de se vouloir démesurément hyper-productiviste, ce qui est en soi un projet apocalyptique, au sens de fatal, dans le sens où cette frénésie accélère la chaîne des causalités destructrices. L’épidémie de Covid-19 a révélé une tendance très profonde, pourtant déliée de toute inclination religieuse, qui s’apparente à une idéologie de la fin des temps. Les théories de l’effondrement abondent et elles se sont abondamment exprimées sous leurs différentes tonalités, graves ou aiguës.
La peur de l’effondrement
La pandémie les a alimentées, car elle est intervenue sur un substrat préalable très fertile. La collapsologie a envahi l’arène médiatique. Comme si l’Apocalypse, ensevelie avec l’enterrement de la religion, ne pouvait disparaître des mémoires sans engendrer des récidives abâtardies, une formule de substitution laïcisée, sécularisée. En 2020, le collapse a remplacé l’apocalypse. Par un paradoxe extraordinaire, les collapsologues font entrer en scène une morale de la nature, comme si cette dernière, de la sorte déifiée, disposait d’une force spirituelle intrinsèque, voire d’une conscience transcendante. Une eschatologie laïque s’installe peu à peu à travers la rhétorique de l’effondrement. Ses défenseurs trouvent de multiples raisons de voir leurs thèses confirmées par l’enchaînement des évènements de 2020. Ils oublient la sagesse athée d’Albert Camus : « N’attendez pas le Jugement dernier, il arrive tous les jours. » Or le virus n’a pas d’âme ni de plan, une fois pour toutes. Lui attribuer une intention ou une finalité, quelle qu’elle soit, revient à accroître le malheur des hommes. L’idée de vengeance de la nature est profondément fausse. Comme celle d’expiation, de contrition, d’attrition, de flagellation l’étaient naguère. Le bonheur, estimait Pierre Teilhard de Chardin, est dans « la croissance ». Pour sûr, pas dans celle des déchets et des émissions de gaz à effet de serre. Dans l’augmentation de la connaissance, la valorisation des connaissances. La nature est intelligible ; il n’est pas irresponsable de la domestiquer. En abusant de nos pouvoirs sur elle, nous n’avons pas commis de crime à l’égard d’une puissance intergalactique et vengeresse, nous nous sommes perdus nous-mêmes, nous avons foulé aux pieds notre capacité de pensée. Car nous avons pris peur, si grandement peur. C’est ici que Christian Makarian se livre à une superbe promenade philosophique que nous ne pouvons que résumer par bribes. « J’ai découvert que tout le malheur des hommes vient d’une seule chose, qui est de ne savoir pas demeurer au repos, dans une chambre. » Par ces mots, tirés de ses riches Pensées, publiées en 1670, Pascal le janséniste, adepte d’une doctrine ascétique de la foi catholique qui rivalisait d’exigence et d’austérité avec le protestantisme de l’Allemand Martin Luther, entendait surtout souligner à quel point l’idée de divertissement était à la fois propre à l’Homme et néfaste à l’Homme. Par le divertissement, qui vient du latin divertere (détourner), Pascal ne désignait pas banalement les loisirs ou l’agrément de vivre, mais tout ce qui nous fait fondamentalement dévier de ce qui devrait pourtant constituer l’essentiel. Pascal, en quelque sorte plus radical, choisit une autre démarche. Prédicateur exceptionnel d’une morale par trop sévère pour ses contemporains, il tente d’isoler ce qui rend l’Homme irrémédiablement tributaire de la fragilité de sa condition. Ce ne sont pas les souffrances, les multiples adversités, les moments les plus durs qui rendent nos vies parfois si amères ; c’est la nature même de ce que nous sommes. Notre faiblesse, notre dépendance, notre inconstance, notre inconsistance.
Apprivoiser l’incertitude
Voilà pourquoi en un sens, tout ce qui constituait la base et le triomphe de notre mode de vie « antiviral » est devenu le vecteur privilégié de la Covid-19. L’inquiétude s’est donc incrustée, au stade de l’invisible, dans la fibre, dans le nerf de notre progrès global : nous ne pouvons pas chasser le Mal en le désignant comme s’il était une saleté venue du dehors. Il s’est immiscé dans nos autonomies individuelles. Il est consubstantiel à tout notre être social, à notre conception de la mondialisation irréversible, à notre extension spatiale continue, à notre inclination irrémédiable vers l’avenir expansif. Le coronavirus a emprunté les canaux mêmes de notre « réussite » : échanges facilités, rapidité des trafics, fluidité des déplacements humains. Cette mobilité sans entrave ressemble de près à un mouvement brownien : 1,4 milliard de touristes en 2019, 4 milliards de passagers aériens en 2017, 8 milliards espérés en 2035. Cette agitation de type aléatoire fait à son tour des individus des particules – ou des transmetteurs – lors même que le voyage se définit comme un loisir des plus agréables. C’est donc le plaisir qui se voit frappé au cœur. Au stade de l’inconscient, la Covid-19, qu’il est pourtant impossible de personnifier, s’attaque à notre conception même du bonheur collectif et individuel. En tout cas à notre définition de la liberté, indissociable d’un certain niveau de consumérisme. C’est ce couplage serré qu’il faut sans doute repenser en attribuant à notre liberté d’autres acceptions, plus profondes. L’imprévu microscopique nous invite à être humainement « plus » plutôt qu’à prolonger l’insouciance spirituelle et l’attente d’un nouveau bond du progrès jusqu’au suivant et ainsi de suite. Cette imprévisibilité ne trouve pas d’accalmie dans la pensée nietzschéenne : le « ce qui ne me tue pas me rend plus fort » est en la circonstance inapproprié. Il ne s’agit pas d’une épreuve de résistance des matériaux ni d’un crash-test susceptible de nous endurcir afin d’être plus solide et résistant lors de la prochaine attaque. Bien plus fertile est la fragilité que confesse Flaubert : « Je suis doué d’une sensibilité absurde, ce qui érafle les autres me déchire. » Il s’agit d’apprivoiser l’incertitude, d’en retrouver la vertu philosophique pour se libérer de la peur qu’elle cause.
A lire aussi : Livre – L’Europe décadente ? de Julien Freund
Accepter l’existence
Nous avons été éduqués dans la croyance en l’exactitude ; scientifique, au stade le plus infime, ou économique, à la nanoseconde près. Or l’exactitude induit la certitude, laquelle n’est pas toujours une vertu, loin de là. Nous sommes arrivés au moment où cette masse d’exactitudes pèse comme un joug, le coronavirus n’en est qu’un des catalyseurs. Le philosophe Jean Baudrillard, fin analyste de la postmodernité, a perçu cette échéance avec clairvoyance : « Le principe du Mal est tout simplement synonyme du principe de réversion. Dans des systèmes en voie de possibilisation totale, et donc de désymbolisassions, le mal équivaut simplement sous toutes ses formes, à la règle fondamentale de la réversibilité. » En positivant toute la marche du monde par la croyance en un progrès continu, conçu sans anicroche, l’abondance s’est transformée en évidence existentielle. En vénérant l’avenir perpétuel sans goûter le présent et ses éventuels silences, nous nous sommes crus plus libres que jamais. Ce qui nous avait conduits à nous affranchir du divin nous a, dans le même élan, poussé à croire que la rationalisation était partout, qu’il suffisait que « ça marche » pour que ce soit « bon ». Ainsi s’est enclenchée une dynamique sans finalité. Pour le dire avec le grand critique musical André Tubeuf : « C’est la transmission d’une habitude qui ne contient plus rien et qui ne tient que par la force des choses. Cette force à son tour ne reposant plus sur rien. » Mais, pour peu qu’un évènement intempestif se produise ou qu’un retournement imprévu se manifeste, cette interruption prend aussitôt une forme maléfique. Et il n’y a plus de Ciel pour l’en blâmer. D’où la désymbolisation finale qui est de doter la Nature d’une force morale venue infliger sa punition. La réversion s’opère par la crise des puissants vecteurs du capitalisme que sont l’innovation permanente, la création continue, l’investissement tous azimuts, tous ces éléments qui font notre confort matériel, ces biens s’étant confondus avec le Bien. Leur rapide diffusion et adoption au sein de sociétés qui ne partagent ni notre perception du Mal, ni même nos valeurs secondaires, comme c’est le cas du bonheur malgré l’incertitude de la Chine, démontrent de façon aveuglante que ces critères n’en sont pas, que la détermination qu’ils exercent sur nos existences est au mieux neutre. Qu’au sens propre, ils sont secs. Cette dichotomie est meurtrière. Pour nous, pas pour les régimes totalitaires ou autocratiques. Le malheur épidémiologique atteint moins les dictatures puisqu’elles sont déjà en elles-mêmes un malheur. Dans un entretien au journal Le Monde, le philosophe des sciences sociales Jürgen Habermas a cerné la clarté glaçante de cette incertitude qui dénude le politique et oblige à repenser le processus même de délégation du pouvoir. « La pandémie impose aujourd’hui, dans le même temps et à tous, une poussée réflexive qui, jusqu’à présent, était l’affaire des experts : il nous faut agir dans le savoir explicite de notre non-savoir. » Vrai. Malgré les certitudes que l’on exige d’elle, la science est par essence fondée sur l’incertitude. Notre civilisation technicienne et consumériste l’a détournée de son principe en exigeant d’elle l’euphorie d’un optimisme sans interruption. L’astrologue Johannes Kepler, qui découvrit que les planètes ne tournaient pas autour du soleil en suivant des trajectoires circulaires, mais elliptiques, avait posé comme principe de ses recherches que « celui qui ne doute pas ne peut être certain de rien. » Pourquoi a-t‑il fallu un malheur épidémique pour nous rappeler que le doute fait partie de nous, que le fait de ne pas savoir est le propre de notre condition ?