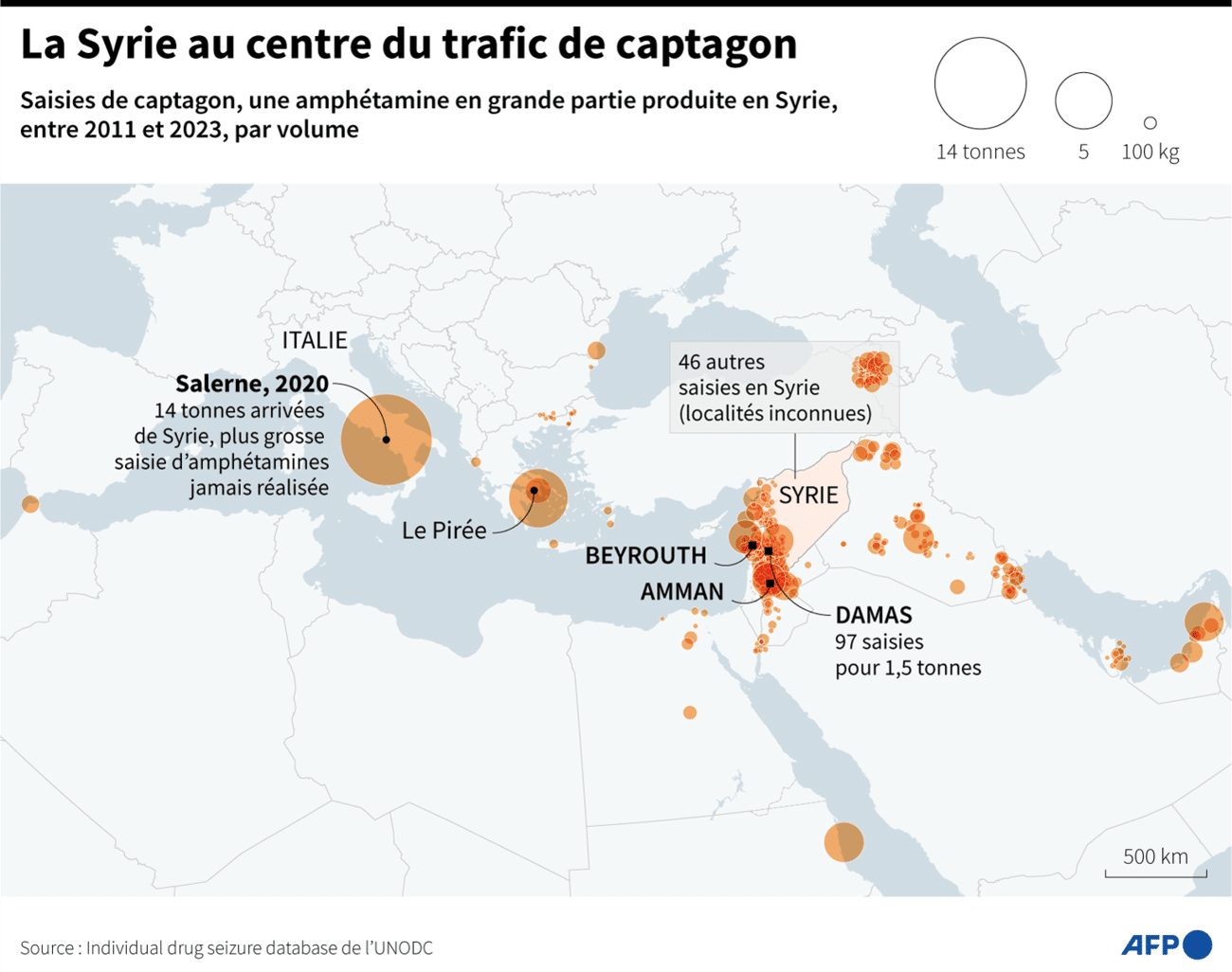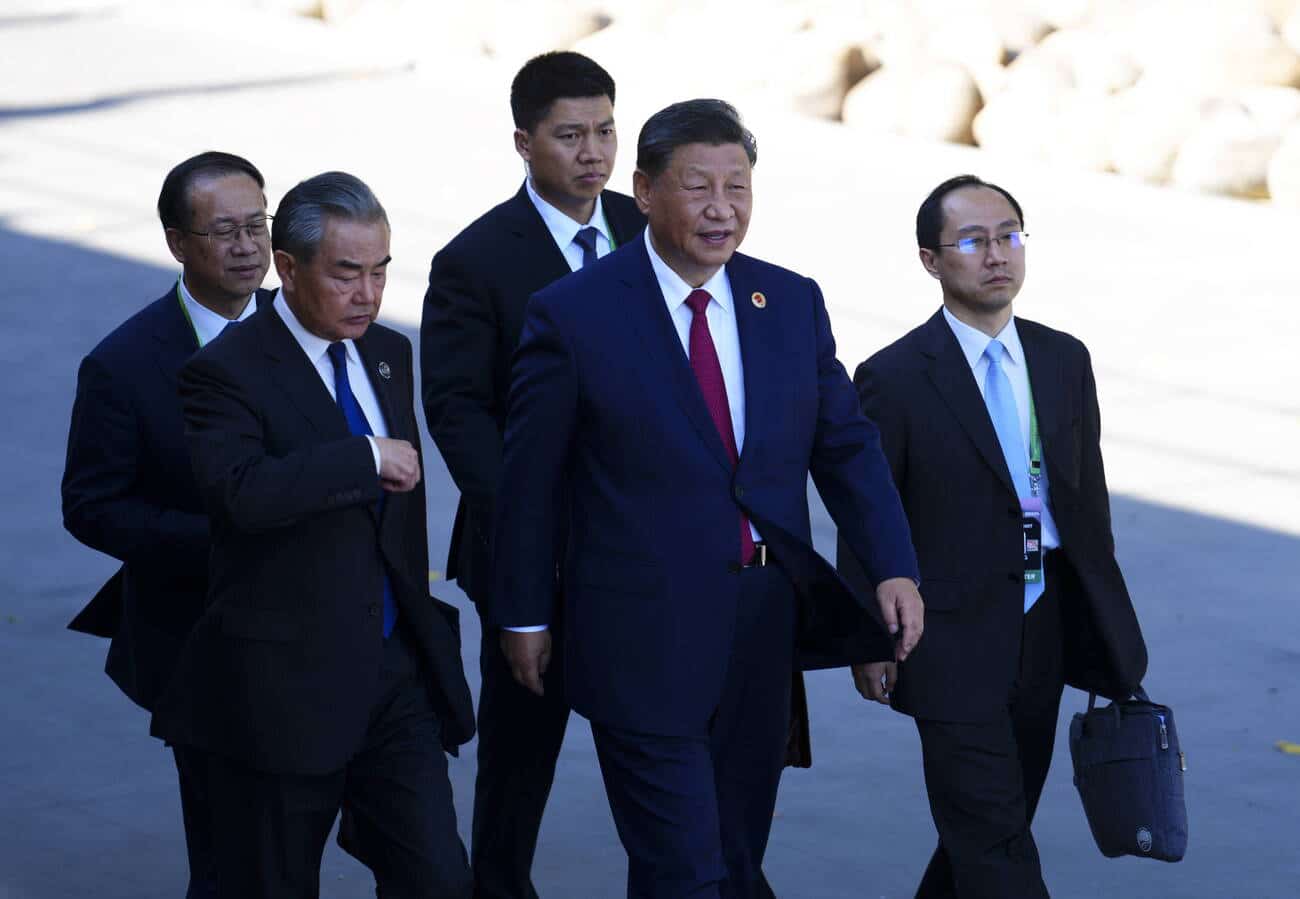Les relations entre les États-Unis et le Maghreb sont longtemps restées modestes. Le Maroc fut l’un des premiers états à reconnaître dès 1777 les insurgés américains. Les nombreux différends entraînèrent dès 1805, l’expédition de Tripoli. Fait plus important et plus récent, Washington soutint les mouvements d’indépendance, en particulier en Algérie, sans s’engager trop nettement afin de ne pas se brouiller avec la France. Les Américains laissèrent ensuite s’exercer l’influence de cette dernière, tandis qu’ils contrôlaient solidement la Méditerranée pour empêcher l’URSS de s’y déployer. Ils privilégièrent les relations bilatérales avec chacun des États pour contenir la poussée du communisme et pour faciliter l’acheminement du pétrole vers l’Occident. La crainte du terrorisme est ensuite apparue comme une préoccupation majeure justifiant le raid aérien contre la Libye en 1986.
1991-2001-2011 : UN TRIPLE TOURNANT
Tout change avec les années 1990 : l’ensemble de la région méditerranéenne passe pour l’administration américaine du statut d’espace de confrontation Est-Ouest à celui d’une zone potentiellement menaçante lors de la guerre civile algérienne à partir de 1991. Néanmoins, les intérêts restent surtout économiques avec pour indicateur l’initiative Eizens-tat, alliance économique lancée en 1999 qui devait favoriser les liens en matière d’investissements et de réduction des barrières internes entre les trois pays principaux du Maghreb et les États-Unis.
L’après 11 septembre 2001 est marqué par une intense activité diplomatique américaine dans la région : volonté de créer une coalition contre le terrorisme, de faire émerger un ensemble régional maghrébin intégré à l’économie de marché (à l’intérieur du projet Grand Moyen-Orient de George Bush) et d’organiser un forum de l’avenir (qui aura lieu au Maroc en 2004).
Les printemps arabes de 2011 changent la donne. Barack Obama saisit l’occasion d’appliquer le message qu’il avait délivré au Caire en juin 2009, en rupture avec le discours et les pratiques de George Bush : « Je suis venu au Caire pour rechercher un nouveau départ pour les relations entre États-Unis et musulmans à travers le monde qui soit fondé sur l’intérêt et le respect mutuels ». En Libye, il soutient l’intervention française et anglaise de 2011 – c’est aussi l’occasion de se débarrasser d’un vieil adversaire, Mouammar Kadhafi, dont Washington s’était pourtant rapproché après le 11 septembre car il disposait d’informations précieuses sur les islamistes. En Tunisie, la révolution de Jasmin affaiblit surtout les relations entre Tunis et Paris, offrant des opportunités à Washington. Ici Barack Obama donne l’impression de ménager le parti islamiste Ennahdha dont il pensait sans doute qu’il serait influencé par l’AKP turc (voir p. 55) et dont le secrétaire général Hamadi Jebali s’était rendu à Washington en 2011 pour rencontrer plusieurs responsables politiques. Mais cette attitude a choqué les forces laïques et les États-Unis sont revenus de leur bienveillance envers les islamistes « soft », d’autant plus qu’Ennahdha a régressé lors des élections de 2014 et qu’un terrorisme sanglant est apparu. Les faits sont encore plus brutaux en Libye où l’ambassadeur américain est assassiné à Benghazi en septembre 2012 tandis que l’ambassade est attaquée à Tripoli. Le refroidissement des relations avec la Turquie confirme cette conclusion : Washington a bien du mal à bâtir des relations apaisées avec les islamistes modérés et à les détacher des terroristes.
Le problème ne se pose pas, ou pas encore, avec le Maroc dont le roi est le Commandeur des croyants. Les intérêts communs demeurent importants : Washington fournit une aide substantielle contre des positions modérées de Rabat, en particulier dans le conflit israélo-palestinien. Les États-Unis disposent de facilités stratégiques dans le pays (aéroports militaires) pour pouvoir se projeter vers le Moyen-Orient. Le développement de réformes politiques et économiques plus libérales facilite ces relations : un accord de libre-échange a été signé entre les deux pays et est entré en vigueur en 2006.
Avec l’Algérie, les relations restent ambiguës. Elles butent sur deux questions : le Sahara occidental et la lutte contre le terrorisme. Sur la première question, Washington tente un équilibre quasi impossible entre les deux voisins au projet opposé : autonomie (pour l’Algérie) contre référendum (pour le Maroc). Sur le terrorisme, les divergences se font sur des définitions : Alger fait une distinction entre la lutte armée en Palestine, qu’elle estime légitime, et le terrorisme contre des populations civiles ou les institutions légales d’un État. Cependant, la politique de réconciliation nationale entamée depuis 2005 par Abdelaziz Bouteflika permet la mise en place de coopérations en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme : le TSCTP (Trans-Sahara Counterterrorism Partnership) comprend 11 membres dont l’Algérie. Alger reste pourtant un allié difficile par son souci de préserver son indépendance.
Durant sa campagne électorale, Donald Trump n’a jamais parlé du Maghreb. Depuis deux ans, Washington semble revenu à une consolidation de sa politique traditionnelle.