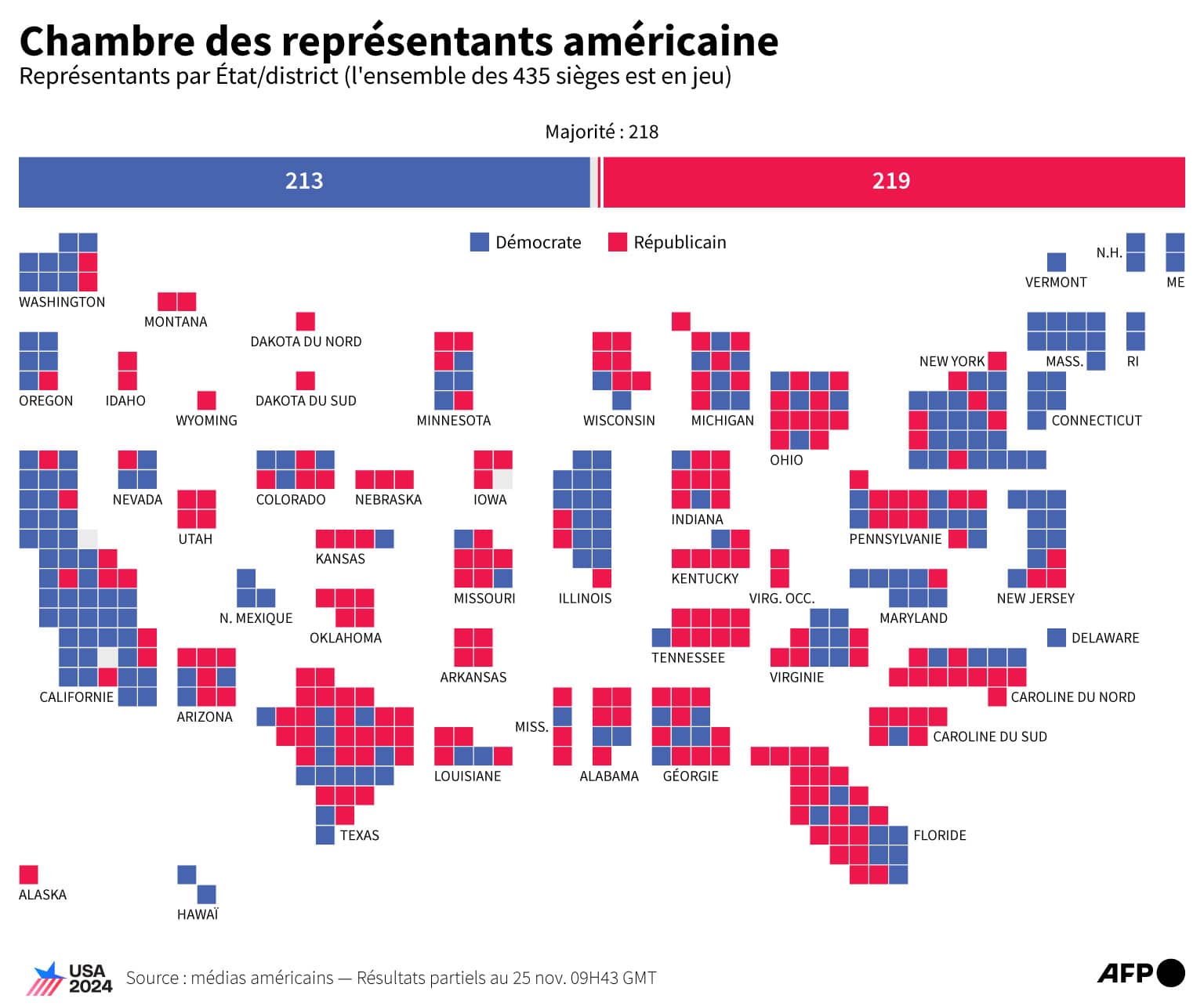La « quête du bonheur » constitue le cœur du rêve américain. Elle apparaît dès les premiers pas des treize colonies et se trouve au centre de la déclaration d’Indépendance des États-Unis. Elle a pourtant connu bien des vicissitudes au cours des XVIIIe et XIXe siècles, de la conquête de l’Ouest à la prospérité et des crises économiques à la crainte que l’immigration menace la « promesse » américaine. Récit d’un rêve, de ses transformations et de ses limites.
Sous la plume de Thomas Jefferson, la Déclaration d’indépendance des États-Unis (4 juillet 1776) proclame solennellement que l’homme a reçu de son Créateur « certains droits inaliénables » notamment la vie, la liberté et la « quête du bonheur ».
Le droit à la recherche du bonheur
Comme le note l’historien Bernard Cottret dans son histoire de la révolution américaine, « Qu’y a-t-il de plus révolutionnaire que de proclamer le droit au bonheur ? Ou de voir en lui l’objectif le plus élevé de la vie sociale ? » Cette quête du bonheur n’est pas un simple droit à l’hédonisme, individualiste, mais une notion collective, la fin même de tout gouvernement.
Or, cette quête du bonheur comme fin du gouvernement civil n’est pas une idée révolutionnaire en 1776. L’aspect révolutionnaire est l’application de ces principes à une situation concrète, et non énoncés de façon abstraite. Les mots de Jefferson sont également révolutionnaires par leur universalisme qui dépasse de loin la cause spécifique des colonies britanniques en révolte contre leur métropole, mais sans pour autant être nouveaux. Le fait que ces valeurs soient proclamées sans explication ou référence montre en effet qu’elles font partie du paysage mental des hommes éduqués de l’époque.
Le triptyque des droits inaliénables de Jefferson fait écho à celui de l’Anglais John Locke – vie, liberté et propriété – qui justifiait la Glorieuse révolution anglaise de 1688-1689 dans ses deux Traités du gouvernement civil (1690). Le droit à la propriété est un sujet central du texte de Locke, mais il n’apparaît pas en tant que tel chez Jefferson. Il est implicitement inclus dans un droit à la quête du bonheur qui englobe d’autres droits plus précis comme le droit à la sécurité.
L’expression de « quête du bonheur » (pursuit of happiness) apparaît à plusieurs reprises dans l’Essai sur l’entendement humain de Locke, paru également en 1690, et elle traverse ensuite la philosophie des Lumières écossaises du milieu du XVIIIe siècle, qui sont lues et enseignées dans les colonies américaines du troisième quart du siècle, période de formation intellectuelle des futurs « Pères fondateurs ».
En 1776, l’idée d’un droit à la quête du bonheur est tellement dans l’air du temps qu’on le trouve dans d’autres documents contemporains mais moins connus. Ainsi, dans la Déclaration des droits de la Constitution de Virginie, signée par George Mason en juin 1776, les droits inaliénables sont la jouissance de la vie et de la liberté, l’accession à la propriété, la quête du bonheur et de la sécurité. Quelques mois plus tard, la Déclaration des droits des habitants de la République ou État de Pennsylvanie proclame : « Tous les hommes sont nés également libres et indépendants, et ils ont des droits certains, naturels, essentiels et inaliénables, parmi lesquels le droit de jouir de la vie et de la liberté, et de les défendre, celui d’acquérir une propriété, de la posséder et de la protéger, enfin, celui de chercher et d’obtenir le bonheur et la sécurité. »
A lire aussi : Face à la Chine, Taïwan aura du mal à conserver son indépendance
Rêve virginien, rêve novanglais : deux quêtes du bonheur
Le rêve américain comme quête du bonheur est souvent associé à des notions matérielles : prospérité, voire fortune, ou simplement accès à la consommation de la classe moyenne. En réalité, c’est la synthèse de valeurs matérielles et immatérielles, ou plutôt une valeur immatérielle (l’accomplissement de soi) qui peut inclure une dimension matérielle sans s’y limiter. Travailler à son compte, être son propre patron, faire de sa passion son métier : une certaine liberté, un accomplissement de soi qui dépasse la quête du profit à tout prix. Bien entendu, ces deux acceptions, matérielle et immatérielle, ne sont pas mutuellement exclusives mais il faut considérer que l’une prend le pas sur l’autre.
« J’ai construit ma cabane. Lentement, à l’écart, en restant fidèle à mes principes. J’avance à mon rythme. Personne ne me gouverne. » (Clint Eastwood)
Le peuplement très différent de la Virginie d’une part et de la Nouvelle-Angleterre de l’autre permet d’observer comment ils sont chacun la manifestation d’un des aspects du rêve américain, matériel d’un côté, immatériel de l’autre. En Virginie, où s’installent aussi quelques communautés de puritains, le modèle dominant reste celui d’une immigration de jeunes hommes célibataires qui viennent pour travailler. Beaucoup sont des engagés, sous contrat de plusieurs années. À l’issue de leur engagement (s’ils ont survécu à l’environnement épidémiologique et sanitaire, ce qui n’est pas une mince affaire), ils peuvent s’installer sur place ou rentrer en Angleterre, mais leur motivation n’est pas religieuse ou politique.
C’est en cela que le modèle virginien diffère radicalement du modèle novanglais (de Nouvelle-Angleterre). Les colons y sont majoritairement des familles (qui emportent aussi des serviteurs sous contrat), qui accompagnent souvent un pasteur. Ainsi, des villages entiers sont transplantés d’une rive à l’autre de l’Atlantique. Leur motivation n’est pas matérielle : ils ne traversent pas l’Atlantique –une entreprise dangereuse et très incertaine – pour faire fortune. Dans certains cas, ce sont des artisans établis qui quittent des situations stables pour sauter dans l’inconnu et un monde où tout est à construire.
Le versant novanglais de ce que l’on n’appelle pas encore le rêve américain, c’est de trouver un refuge où l’on pourra vivre sa foi comme on l’entend, ne pas avoir à craindre des persécutions (politiques et/ou religieuses), quitte ensuite à imposer sa propre vision quand on passe du statut de minorité à celui de majorité au pouvoir. Cette ambiguïté en apparence vient du fait que les puritains du Massachusetts ne concevaient la survie de leur expérience américaine par et pour la foi que sous la forme d’une société homogène. Ce que nous appellerions le pluralisme n’était pour eux que le levain qui allait corrompre la pâte : l’Amérique était après tout suffisamment vaste pour que les dissidents aillent s’implanter un peu plus loin. Fuir les persécutions (réelles ou simplement perçues comme telles) ne rendait donc pas automatiquement tolérant.
Le rêve novanglais peut être étendu à d’autres colonies ayant accueilli des réfugiés pour la foi, comme la Pennsylvanie avec les quakers, ou la Caroline du Sud avec ses huguenots français fuyant les dragonnades de Louis XIV, mais le modèle commence avec les Pères pèlerins en 1620, qui s’étaient déjà réfugiés aux Pays-Bas après avoir fui l’Angleterre en 1608.
Le bonheur par la consommation
Si les premières décennies des colonies sont le plus souvent marquées par une certaine précarité et une quête du bonheur qui ne peut être qu’immatérielle (limitée à la survie), la stabilisation de la vie coloniale est ensuite spectaculaire et le XVIIIe siècle voit une nette amélioration des conditions de vie, de l’espérance de vie, une hausse du pouvoir d’achat dans un contexte de diversification de l’offre dans ce qui s’apparente à une révolution de la consommation. Les colons sont en effet en mesure d’acheter davantage et d’effectuer des achats plus discriminants : on n’est plus dans la première nécessité, le choix s’est étendu notamment à différents niveaux de qualité. On précise même l’origine des produits importés pour mettre en avant leur qualité supérieure. Quand cette libre consommation se trouve grevée de droits de douane, dans les années 1760, et que la grande autonomie vis-à-vis de la métropole semble remise en cause, la colère gronde et c’est le point de départ de ce qui deviendra, de crise en crise et de malentendu en malentendu, la Révolution américaine. Paradoxalement, la tension entre la métropole et les colonies se situe à un moment où le goût des colons s’anglicise fortement : on consomme dans un esprit d’émulation de la British Way of Life, on veut faire comme en métropole, boire du thé dans de la porcelaine Wedgwood, par exemple.
Par ailleurs, la liberté que revendiquent les Pères fondateurs, c’est d’abord la liberté des citoyens britanniques ! La quête du bonheur est évidemment liée à la peur de perdre des libertés politiques plus britanniques que strictement américaines. Mais la quête du bonheur est également liée au contexte matériel, que l’on peut rapprocher de la propriété de Locke : le colon veut pouvoir consommer comme il l’entend.
A lire aussi : Le rugby peut-il échapper à la trajectoire du sport mondialisé?
La rupture spatiale : l’exceptionnalisme et l’Amérique comme laboratoire
La rupture politique se fait sur fond de continuité philosophique : si nous ne pouvons pas jouir de nos droits de citoyens britanniques, pouvons-nous encore nous considérer comme britanniques ?
Pour justifier la rupture politique, inédite à l’époque, Thomas Paine convoque la rupture spatiale. L’auteur du fameux Sens commun, « best-seller » de l’année 1776, y estime que « la distance même que le Tout-puissant a mise entre l’Angleterre et l’Amérique est une preuve convaincante et naturelle que l’autorité de l’une sur l’autre n’a jamais fait partie des desseins de la Providence ». Quelques décennies avant Paine, le pasteur Jonathan Edwards avait cru déceler un signe providentiel dans la découverte de l’Amérique par les Européens au moment même de la Réforme. Pour lui, cela ne pouvait relever du hasard. Il voyait l’Amérique comme un lieu particulièrement important dans l’histoire du monde puisque c’est là que devait se réaliser le Millennium, le paradis sur terre.
Dès la période des découvertes, au XVIe siècle, la littérature promotionnelle « vendait » l’Amérique comme un Éden et comme le paradis perdu. John Winthrop, le gouverneur emblématique du Massachusetts qui a mené la « grande migration » anglaise vers Boston en 1630 voyait la Nouvelle-Angleterre comme un « refuge » pour quelques élus, pendant que Dieu infligerait un châtiment apocalyptique à une Angleterre incapable de se réformer.
L’Amérique coloniale puis les États-Unis sont donc vus depuis toujours comme un lieu à part, où l’on peut à la fois renouer avec la pureté originelle (l’Éden) et s’affranchir des pesanteurs et des chaînes de l’Ancien Monde pour accéder à un niveau inédit de dignité humaine (le Millennium), notamment par le travail et non par la naissance. C’est ce que l’on appelle généralement l’éthique protestante, mais que l’on peut qualifier plus précisément d’éthique franklinienne tant elle doit aux formulations de Benjamin Franklin. C’est donc cette rupture qui confère à l’Amérique son caractère exceptionnel et qui y rend possible la réussite.
Dans son Avis à ceux qui voudraient s’en aller en Amérique, publié alors qu’il était en mission à Paris (1784), Franklin explique notamment que la corruption et la vénalité des offices omniprésentes dans l’Europe de l’époque n’existaient pas dans le nouveau système américain : « Il n’y a qu’un petit nombre d’offices civils ou d’emplois ; il n’y en a point de superflus, comme en Europe ; la règle établie dans quelques États est qu’aucun office ne doit être assez lucratif pour être désirable. » La société américaine compte bien moins de pauvres et de riches que l’Europe ; il y règne plutôt « une heureuse et générale médiocrité », ce que l’on n’appelle pas encore la classe moyenne. Et le mérite prend le pas sur la naissance : « On ne demande point à l’égard d’un étranger, qui est-il ? mais, que sait-il faire ? » Franklin vend à ses lecteurs français un rêve américain fondé sur le travail, dans un système social, politique et économique qui n’est pas faussé comme c’est le cas alors en Europe. Non seulement il est possible d’y réussir pour qui s’en donne la peine mais, pour Franklin, il s’agit même d’une « certitude ». Pour le Normand Hector St-John de Crèvecœur, qui écrit au même moment, l’Amérique est « un continent neuf ; une société moderne », les Américains, issus de toute l’Europe, sont « tous animés d’un esprit d’entreprise sans limites, sans entraves, parce que chacun travaille pour soi ». Là où Franklin voyait une « heureuse et générale médiocrité », Crèvecœur parle d’une « agréable uniformité ». Pour lui, la société américaine est « la plus parfaite qui existe au monde » où « le chemin de la fortune » est ouvert à tous, moyennant travail et effort. Comme Franklin, Crèvecœur oppose l’Europe, au passé funeste, à une Amérique tournée uniquement vers l’avenir. Pourtant, l’Amérique est selon lui le lieu où l’Homme a « retrouvé l’ancienne dignité du genre humain ». C’est donc un lieu de recommencement, mais également de régénération, de restauration.
L’immigration : rêve des uns, cauchemar des autres
Les États-Unis sont une terre de paradoxe, avec une population issue de l’immigration à un moment ou à un autre, mais qui peut montrer une forte hostilité contre l’immigration récente ou à venir.
Au XVIIe siècle, déjà, les puritains estimaient que la cohésion sociale dépendait de l’homogénéité religieuse. En d’autres termes, la quête du bonheur social, collectif, passait par le maintien d’une communauté homogène, dont les éléments dissidents n’étaient pas les bienvenus. Le mécanisme qui sous-tend l’anticatholicisme est similaire : le catholicisme – ou « papisme » – est aux yeux de l’opinion protestante, majoritaire alors, le versant religieux de l’autoritarisme et de l’absolutisme, à l’inverse d’un protestantisme synonyme de liberté et de démocratie. À cela se greffe notamment l’hostilité d’ordre plus ethnique aux Irlandais. Ainsi, au milieu du XIXe siècle, les petites annonces pour des emplois de gouvernante, par exemple, stipulent explicitement « No Irish need apply » (Irlandais s’abstenir). Les Irlandais sont pauvres, catholiques et probablement dépourvus de sens moral. Sur la côte ouest, les Chinois ont certes constitué une main-d’œuvre bon marché corvéable à merci, mais quand on considère qu’ils sont trop nombreux, on édicte les premiers quotas ethniques contre leur immigration (1882). Enfin, les mormons, pourtant un des rares groupes religieux nés aux États-Unis et non importés d’Europe, sont considérés comme une « Église étrangère ». La raison tient à leur dogme (ils ajoutent un livre à la Bible, ce qui est anathème pour de nombreux protestants) et à leurs pratiques sociales (la polygamie jusqu’en 1890). Ils sont donc persécutés et fuient toujours plus à l’ouest. Ils trouvent refuge à Salt Lake City, aux confins septentrionaux du Mexique, avant d’être rattrapés par l’irrépressible expansion des États-Unis vers l’ouest, à grands renforts d’idéologie de la « destinée manifeste. » Entre 1845 et 1848, la frontière occidentale des États-Unis est repoussée jusqu’au Pacifique, et le Texas, la Californie, et tout l’Ouest passent sous le contrôle des États-Unis.
Cette expansion n’a pas lieu que sur la carte : elle est souvent précédée et toujours suivie par les pionniers, parmi lesquels on trouve le Suisse Théodore Bost, qui a laissé une riche correspondance transatlantique. Ses lettres, qui couvrent plus d’un demi-siècle, montrent bien à la fois les espoirs et les frustrations, une quête du bonheur qui lui fait d’abord traverser l’Atlantique et qui le pousse toujours un peu plus à l’ouest, malgré les épreuves et la rudesse extrême de ses conditions de vie. Malgré tout cela, il ne perd jamais espoir. La quête reste sans cesse inachevée. Le rêve américain est au moins autant la destination (que l’on n’atteint pas forcément) que le voyage qui est censé y mener.
Bost s’éteint quand le Ku Klux Klan renaît de ses cendres et dépasse largement le Vieux Sud confédéré de sa première existence éphémère (1866-1871). Outre les Noirs émancipés, ses nouveaux boucs émissaires sont les catholiques, les juifs et les bolchéviques, qui ont en commun de ne pouvoir être de vrais Américains car leur loyauté va d’abord à une autre source (le Vatican, Moscou, la communauté). Cette version très défensive de l’américanité est le reflet des angoisses d’une Amérique qui se sent de plus en plus menacée par les profondes mutations structurelles à l’œuvre à l’époque : urbanisation galopante, industrialisation, immigration en provenance d’Europe du Sud et de l’Est d’une ampleur inédite qui accélérait une diversification elle aussi inédite de la population de « souche » (d’ascendance britannique et protestante). Ce à quoi il faut ajouter la menace sur la religion révélée que constituent les progrès de la science, à la fois la philologie et l’évolutionnisme, qui remettent en cause la véracité du texte biblique. La prohibition, les lois anti-évolution et les quotas migratoires drastiques (1921, 1924) sont autant de croisades symboliques destinées à enrayer ce qui est perçu comme cette dénaturation profonde de ce que doit être l’Amérique éternelle. La quête du bonheur des uns, particulièrement les immigrés (italiens, grecs, juifs, russes), qui fuient la misère et les persécutions (religieuses, politiques) est le cauchemar des autres – les « vrais » Américains.
Les banlieues et l’American Way of Life
Les décennies de postérité d’après-guerre sont la quintessence du rêve américain, et parmi ses symboles les plus puissants figurent le pavillon de banlieue et la voiture. Lors de la grande exposition de New York en 1939-1940, le pavillon Futurama a un succès retentissant. Il y anticipe une vision de la société américaine du futur – en 1960. Le fait qu’il soit sponsorisé par General Motors n’est probablement pas étranger au fait que la voiture et l’infrastructure routière y sont centrales. L’automobile s’était démocratisée très tôt aux États-Unis, notamment sous l’impulsion d’Henry Ford, qui voulait que ses ouvriers puissent se payer ce qu’ils fabriquaient. Les salaires généreux des usines du Nord (Chicago, Détroit) attirent de nombreux Noirs du Sud, qui fuient la misère et le travail des champs. Sur le modèle du fordisme, la construction résidentielle se rationnalise, ce qui permet d’en diminuer les coûts et d’en faciliter l’accessibilité.
Dans les années 1950, l’expansion du modèle pavillonnaire dans les banlieues poursuit cette tendance à la massification mais à une échelle inédite. Certes, la moyennisation par la consommation est indéniable, mais la suburbanisation et la prospérité ne doivent pas occulter la pérennité des discriminations raciales, par exemple. Le processus de suburbanisation par lequel on s’extrait de villes associées à Babylone correspond à la vision jeffersonienne de l’Amérique, néo-rurale, qui associe la vertu à la terre et à la nature, par opposition à la vision hamiltonienne, d’après Alexander Hamilton, ministre de George Washington, pour qui la prospérité viendrait du développement des villes et du commerce transatlantique. Cependant, la suburbanisation est indissociable d’une consommation de masse associée à la prospérité, synthèse de ces deux visions. Le symbole de cette consommation nouvelle est le centre commercial, ou « mall », où la consommation est centralisée, rationnalisée, en rupture avec le type de consommation classique des centres villes. À la consommation de masse succède rapidement une consommation très segmentée, associée à un ciblage marketing de plus en plus pointu. C’est ainsi que naît la figure du « teenager », entre l’enfant et l’adulte, doté d’un pouvoir d’achat inédit, à qui l’on destine des produits culturels et matériels spécifiques, comme le rock‘n’roll et tout ce qui devient la « culture jeune ».
Ce modèle de l’« American Way of Life » s’exporte bien – c’est la puissance du soft power, sous l’impulsion des représentations culturelles (séries, films, musique) mais aussi sous les formes matérielles : produits technologiques, enseignes alimentaires (McDonald’s, Coca Cola) et lotissements pavillonnaires aux périphéries des villes. Bien entendu, ce soft power est parfois assimilé à une forme d’impérialisme culturel (la « coca-colonisation » dénoncée par le Parti communiste français dès la fin des années 1940). Mais les Américains eux-mêmes dénoncent ces excès : la série Desperate Housewives est un des nombreux exemples où l’illusion d’une surface lisse des banlieues américaines cache une réalité chaotique peu reluisante. La place de la femme dans les banlieues des années de prospérité est assez peu épanouissante, et une partie de la révolte des années 1960 se fait contre le modèle conformiste des années 1950.
En portant un coup d’arrêt net à l’expansion continue, toujours un peu plus loin des grandes villes, la crise des subprimes semblait mettre un terme à un long processus d’ascension sociale par l’accession à la propriété dans les utopies édéniques des banlieues résidentielles. Aujourd’hui, les délocalisations et la précarisation du salariat combinées à l’endettement (frais de scolarité et différents crédits) rognent toujours plus sur les conditions de vie, au point que si, en 1970, 90 % des trentenaires avaient mieux réussi que leurs parents au même âge, on était à peine à 50 % pour les trentenaires de 2015.
Pour la première fois dans l’histoire des États-Unis, une génération n’est plus assurée du tout de vivre mieux que la génération de ses parents, les baby-boomers, ce qui remet en cause le rêve américain.