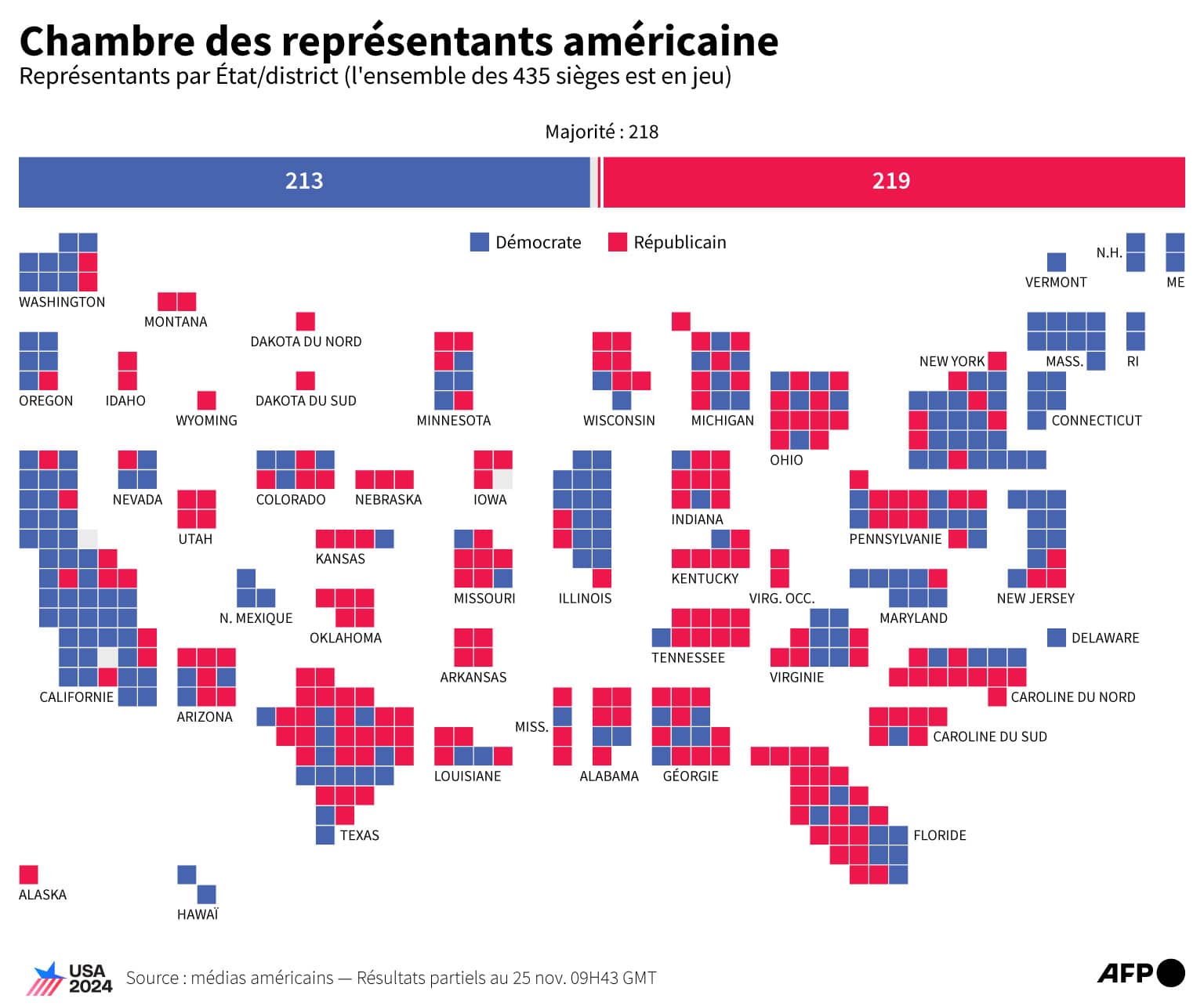Pas de relation spéciale entre l’Espagne et les États-Unis, alors que ces derniers sont aussi le produit de la colonisation hispanique. Une culture hispanique qui n’est pas toujours assumée et une histoire commune qui est souvent une suite de rendez-vous manqués. Les relations entre les États-Unis et l’Espagne sont plus proches du divorce que de l’union.
En avril 2004, ainsi qu’il l’a promis, le président du gouvernement José Luis Rodríguez Zapatero met en œuvre le retrait des troupes espagnoles stationnées en Irak.
Leur engagement dans la guerre menée par les États-Unis, qui avait pour but de renverser le régime de Saddam Hussein, n’a jamais fait l’objet d’un consensus au sein de la société. Les manifestations qui parcourent les principales villes espagnoles en mars 2003 en sont un excellent marqueur. Plus encore que cette invasion par les armées coalisées autour de Washington, c’est la vision du monde défendue par le chef de l’exécutif de l’époque, le conservateur José María Aznar, qui est la cible des critiques. Fondée sur l’imposition des valeurs occidentales et sur le soutien aux néoconservateurs américains, sa conception des relations internationales est rejetée par les citoyens espagnols, notamment à gauche.
Les photographies prises en 2001 (à l’occasion du séjour de George W. Bush dans la résidence officielle de Quintos de Mora, non loin de Tolède) puis en 2003 (lors du sommet des Açores, sous les auspices de José Manuel Barroso), deviennent le symbole de tout ce que honnissent ceux qui s’opposent de façon globale à l’hégémonie américaine sur le monde. Dans ce contexte, la complicité affichée entre Bush, Aznar et Blair est un point de fixation tout particulier.
Le départ de l’armée espagnole d’Irak semble marquer un tournant dans le lien qui unit Washington et Madrid depuis plusieurs décennies. De fait, les rapports entre les deux capitales paraissent ne s’être jamais améliorés depuis lors.
L’Espagne et l’OTAN, une histoire pleine d’ambiguïtés
Pourtant, il ne faudrait pas en surestimer les répercussions. L’Espagne reste en effet membre de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord (OTAN), qu’elle rejoint en mai 1982. Elle devient alors le dernier grand pays d’Europe occidentale à y entrer.
Notre voisin pyrénéen est en effet exclu de la fondation de l’organisme, en 1949, au prétexte qu’il ne répond pas aux standards des démocraties issues de la Seconde Guerre mondiale. La présence du Portugal de Salazar dès cette époque contredit toutefois cette thèse. C’est surtout l’opposition de Paris et Londres, qui craignent le poids géopolitique que pourrait acquérir l’Espagne au sein de l’OTAN, qui expliquent un tel rejet. Dans le cadre de la guerre froide, le bloc capitaliste gagnerait beaucoup à intégrer un pays proche de l’Afrique du Nord et qui contrôle le passage entre Méditerranée et Atlantique.
Pour contourner ces réticences, en 1953, les États-Unis signent avec Francisco Franco les accords de Madrid. En échange d’une aide agricole et financière, Washington obtient d’installer quatre bases militaires outre-Pyrénées : une à Saragosse (Aragon), une à proximité de Madrid (Torrejón de Ardoz) et deux en Andalousie (Morón de la Frontera et Rota).
À lire aussi : 70 ans d’OTAN, mais pas beaucoup plus ?
Historiquement opposée à la mainmise américaine, la gauche espagnole défend, lors du retour à la démocratie, la sortie de l’Espagne de l’Organisation du traité de l’Atlantique nord. C’est notamment la position du Parti socialiste ouvrier espagnol, qui critique vertement le président du gouvernement centriste Leopoldo Calvo-Sotelo lorsqu’il opte pour l’adhésion du pays à l’institution. Le candidat social-démocrate à la présidence de l’exécutif, Felipe González, promet la tenue d’un référendum sur la question s’il est élu.
Il s’exécute en mars 1986, non sans avoir changé d’avis entre-temps. Pour lui, désormais, l’Espagne doit rester dans l’OTAN… mais à plusieurs conditions : pas d’armes nucléaires américaines sur le territoire national ; réduction du nombre de soldats présents dans les bases américaines ; refus de participer au commandement militaire de l’organisme. Le pari est gagné pour González, qui obtient un soutien électoral de plus de 56 % à son projet. Pourtant, l’abstention est marquée (plus de 40 % des citoyens espagnols ne glissent aucun bulletin dans l’urne) et la gauche se fracture sur cette question.
Une partie des socialistes et des communistes, regroupés autour de l’écrivain Antonio Gala et du responsable politique Gerardo Iglesias, passe dans l’opposition au gouvernement social-démocrate. Ce secteur fonde la Gauche unie (IU) afin de défendre des positions contraires à l’atlantisme.
D’Obama à Trump : les choses ne s’améliorent pas
Les États-Unis, qui ne disposent plus que de deux bases militaires outre-Pyrénées à l’heure actuelle (Morón et Rota), font pression sur Madrid afin d’obtenir des gages matériels et financiers de sa part.
Donald Trump exige par exemple de l’Espagne qu’elle augmente drastiquement son budget de la défense, qui stagne depuis plusieurs années autour de 0,92 % de son PIB. Il s’agit, en termes relatifs, de l’une des plus faibles contributions à « l’effort de défense » de l’Europe. Pourtant, notre voisin ibérique semble incapable de faire mieux, surtout dans un contexte de crise économique. Il faut dire qu’il déploie déjà des hommes aux quatre coins du monde, notamment en mer Méditerranée, dans l’océan Indien ou encore dans les pays baltes.
Bien que finalement ralliée à l’OTAN, la gauche « radicale » d’Unidas Podemos (entrée au sein du gouvernement de Pedro Sánchez en janvier 2020) ne défend pas avec beaucoup d’ardeur la présence du pays sur des terrains qui ne la concernent pas. Et elle a raison : l’Espagne est-elle menacée par la Russie au point de devoir envoyer ses avions de chasse patrouiller dans le ciel de Lituanie ?
À lire aussi : Le sport, facteur de rayonnement international pour l’Espagne
De leur côté, les socialistes tentent de négocier des avantages pour leur pays en échange du renforcement des bases de Morón et Rota. Ils doivent également faire face aux menaces de sanctions de la part de Trump, qui peste contre la collaboration étroite entre Espagne et Chine dans le cadre de la 5G ou encore contre les liens entre Unidas Podemos et le Venezuela de Nicolás Maduro.
Ces dissensions marquent également les deux mandats de Barack Obama (2009-2017). Le président démocrate n’effectue qu’une seule visite officielle outre-Pyrénées, peu de temps avant de quitter la Maison-Blanche et au pas de charge. Quelque chose semble « brisé » entre Madrid et Washington.
L’Espagne face au renouveau du « nationalisme économique »
L’Espagne est mal à l’aise face à Donald Trump et à ses décisions diplomatiques et militaires. Plus encore, les dirigeants espagnols sont incapables de comprendre le renouveau du « nationalisme économique » qui caractérise les États-Unis.
Cette incompréhension est patente lorsque Donald Trump tente de mettre des bâtons dans les roues au projet de TGV californien, mené par trois entreprises espagnoles qui y ont déjà investi plusieurs milliards de dollars. De même, le président du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro Sánchez, ne sait comment réagir lorsque Washington fulmine face à l’annonce d’une « taxe Google » sur les profits des géants du numérique américain.
Mais le pire concerne les relations commerciales hispano-américaines. Pris de court, notre voisin ibérique semble tétanisé par l’augmentation subite des tarifs douaniers décidée par Trump concernant de nombreux produits industriels et agricoles, dont les olives, les huiles et le vin.
À lire aussi : Podcast ; Espagne, politique et organisation. Nicolas Klein
Aux menaces de représailles succède outre-Pyrénées la panique du secteur de l’olive, capital dans le dynamisme économique du centre et du sud de l’Espagne. De fait, les produits espagnols concernés disparaissent quasiment des rayons des supermarchés américains, avec des pertes estimées à près d’un milliard de dollars rien que pour l’année 2019. Il en va de même pour le vin – notre voisin pyrénéen en est le troisième exportateur mondial.
Les entreprises de production d’huile d’olive tentent bien quelques subterfuges – transporter par exemple le liquide brut vers le Maghreb pour l’y embouteiller. Pourtant, la pilule passe mal en Andalousie ou en Castille-La Manche, deux régions touchées.
C’est que l’Espagne doit en réalité faire face à un phénomène de « démondialisation » des échanges qui s’accélère avec la pandémie de coronavirus de 2020. Les rapports qu’elle entretient avec la première puissance mondiale n’en sont qu’une illustration supplémentaire et mettent à l’épreuve la capacité de ses dirigeants à saisir le monde tel qu’il se profile en ce début de décennie 2020. Et pour le moment, le résultat n’est pas brillant…