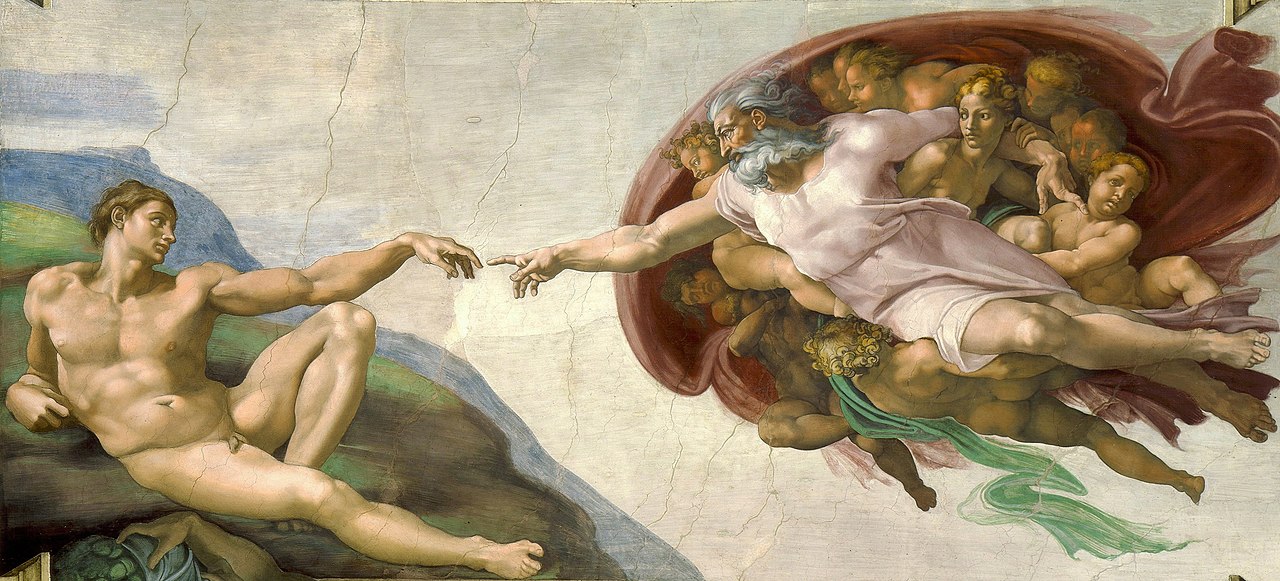Chasseur alpin, ancien chef d’état-major de la Minusma au Mali, le général Pierre-Joseph Givre dirige le Centre de doctrine et d’enseignement du commandement (CDEC). C’est l’organisme référent pour la pensée doctrinale et la formation supérieure des officiers de l’armée de terre. Ses experts analysent la guerre russe en Ukraine.
Propos recueillis par Mériadec Raffray
L’invasion de l’Ukraine est un choc pour les opinions occidentales. Et pour vous ?
La nature de l’opération militaire russe en Ukraine ne surprend pas tous ceux qui étudient la guerre. Cette tendance au retour des conflits de haute intensité était inscrite dans le paysage.
À quels conflits pensez-vous ?
La haute intensité, c’est déjà Israël contre le Hezbollah en 2006. En un mois, Tsahal tire 150 000 obus de 155 mm et roquettes, 50 chars lourds Merkava sont mis hors de combat. C’est la guerre en Syrie de 2012 à 2019, qui s’est soldée par près de 500 000 morts selon certaines sources. L’armée de Bachar el-Assad et son allié russe, comme celle de la Turquie dans le camp opposé, ont utilisé tout l’arsenal de la puissance de feu, y compris les bombes thermobariques que les Russes ont lâchées également sur l’Ukraine. C’est aussi leur opération d’annexion de la Crimée en 2014. Dans ce cas précis, la guerre éclair a fonctionné immédiatement et sans résistance, mais tant la démarche stratégique que le niveau d’engagement des forces militaires relevaient clairement du registre de la guerre de haute intensité. Il y a d’autres exemples très récents. La guerre au Haut-Karabakh de septembre à novembre 2020. Le conflit qui a embrasé le nord de l’Éthiopie au mois de décembre suivant et qui dure encore ; par l’ampleur et la dureté des combats, le nombre de morts civils et militaires, le volume de munitions tirées, cette guerre civile appartient à cette catégorie. On peut aussi pour les mêmes raisons y ajouter la guerre au Yémen.
Pourtant, chacun sent qu’avec la guerre d’Ukraine, nous avons changé d’échelle…
Vous avez raison. Et le directeur du CDEC que je suis confesse volontiers avoir été surpris par l’ampleur de l’engagement russe, l’ambition stratégique en particulier : faire tomber les instances dirigeantes du pays en s’attaquant à Kiev. Je pensais, comme d’autres d’experts militaires, que si les Russes attaquaient, ils se borneraient – si je puis dire – à élargir les limites du Donbass sécessionniste et, peut-être, à créer une continuité territoriale avec la Crimée, voire jusqu’à la Transnistrie. En visant Kiev, le Kremlin inscrit sa guerre dans une dimension stratégique qui s’apparente à une guerre quasi totale. J’en veux pour preuve le volume et l’intégralité de moyens engagés. Pour moi, ce qui constitue la surprise, c’est vraiment le caractère généralisé de l’attaque.
À lire également
Conférence Conflits – Guerre en Ukraine : où va l’Europe ?
Vous n’imaginiez pas Poutine et ses généraux opter pour cette stratégie radicale ?
Je n’écartais pas cette éventualité en soi. J’imaginais simplement que cela impliquait trop d’efforts et de sacrifices pour la nation russe. Je crois toujours que ses dirigeants politiques et militaires vont vite buter sur de nombreuses limites, sauf à basculer définitivement dans le mode de la guerre totale – celui qui implique la mobilisation générale du pays. Cette perspective ne me semble pas envisageable pour son économie et sa société. Surtout que l’ennemi n’est « que » l’Ukraine, de surcroît terre slave dont l’histoire est liée de gré ou de force à la Russie, et non l’Occident tout entier, comme du temps de la guerre froide. D’autant également que l’OTAN a fermement rejeté l’hypothèse d’entrer en guerre contre elle. Dès lors, comment justifier la mobilisation générale ? La société russe est plus résiliente que la nôtre, mais son taux d’acceptabilité des pertes en particulier n’est sans doute pas celui des Syriens. Je crois qu’il s’approche plutôt de celui des Iraniens, des Israéliens ou du Hezbollah. En Russie, il existe aussi des limites économiques, psychologiques et sociales à l’acceptation du prix du sang à payer.
Dès les premiers coups de canon, les experts débattaient déjà des leçons militaires de l’opération russe. Quels éléments ont d’abord retenu votre attention ?
Visiblement, le plan initial des Russes n’a pas fonctionné. Ils ont la réputation d’être extrêmement forts dans la planification des moyens militaires et paramilitaires combinés. On savait aussi que leur point faible était l’exécution et la conduite des opérations. C’est lié à leur culture. Si les choses ne se déroulent pas conformément aux prévisions, ils ne peuvent pas compter sur la subsidiarité pour réagir et relancer l’action. C’est une qualité absente de leur bagage militaire et politique. Tout ce qui grippe leur plan les oblige donc à rendre compte à l’échelon central. Cela ralentit les processus de réarticulation au niveau tactique et ralentit de facto la manœuvre. Ils doivent marquer des pauses et, in fine, bien souvent, sont contraints de se rabattre sur l’option plus traditionnelle et plus radicale : l’emploi massif, voir indiscriminé, des feux. C’est sans doute l’explication des hésitations que chacun a bien perçues dans l’offensive russe vers Kiev, illustrée par l’entrée en scène retardée et brutale des chars et de l’artillerie.
Pensez-vous que beaucoup s’est joué à ce moment-là ?
Cette stratégie de la terre brulée, mise en œuvre pour se dégager le passage, comme en Syrie ou lors de la deuxième guerre de Tchétchénie, risque probablement de briser tout le travail presque réussi de la Russie pour, en amont de cette campagne militaire, créer la discorde dans les opinions occidentales et chez leurs dirigeants. Sincèrement, je suis surpris par la discontinuité entre l’action stratégique russe de déstabilisation de l’Occident qui était sur le point de réussir, et une action militaire type « rouleau compresseur » qui délégitime leurs soutiens et fédère les opinions, hier divisées, contre eux.
À lire également
Guerre en Ukraine : le délicat positionnement de la Bulgarie
Cette guerre est aussi une guerre des volontés, des perceptions…
Vladimir Poutine nous connaît très bien. Il sait combien l’Occident a oublié ce qu’étaient les ressorts de la dialectique ou du dialogue stratégique. Nos sociétés libérales, la nôtre étant une exception sous certains aspects, ont nié la force du collectif en érigeant l’individu sur un piédestal, en privilégiant l’esprit à la force physique. Elles ont eu tendance non seulement à ne plus considérer la force comme nécessaire, mais aussi, plus grave encore, à la désigner comme étant la cause des crises, ainsi que je l’ai entendu au Mali de la part de responsables de l’ONU. Penser que l’armement moral, les valeurs philosophiques d’une société suffisent à dissuader tout agresseur, c’est se méprendre sur la réalité de la nature humaine et de la guerre. Celle-ci comporte une part de force dont, malheureusement, la guerre est l’expression paroxystique. Clausewitz disait : « Tant que je n’ai pas abattu mon ennemi, je peux craindre qu’il ne m’abatte. » Nous nous étions habitués à ce que les Américains montent sur le ring à notre place. Tout en soufflant sur les braises en Ukraine depuis 2013, ils ont envoyé aux Russes le signal qu’ils n’interviendraient pas contre eux dans cette zone. Cela s’est traduit par l’annexion de la Crimée en 2014, et l’invasion de l’Ukraine aujourd’hui, avec quelques avertissements intermédiaires, comme l’arrivée de Wagner au Mali et en République centrafricaine, dont vous pourrez noter qu’il s’agit à chaque fois de pays où la France est engagée en première ligne, comme si en Europe, la France puissante était un obstacle aux ambitions russes. Stopper ces mercenaires avec lesquels l’État russe affirme ne pas avoir de liens aurait peut-être permis de faire réfléchir le Kremlin. La condition du rétablissement du dialogue stratégique avec Poutine, c’est le rétablissement du rapport de force « physique ».
Dès le début de la guerre, la Russie semble s’être désintéressée de la bataille de la communication…
Peut-être que pour Moscou, dans cette campagne militaire de haute intensité en Ukraine, l’effet majeur est la conquête d’un territoire et de sa population. Point. Dans ces conditions, la fin justifie tous les moyens et relègue de facto les autres enjeux au second plan, dont la conquête et l’influence durable sur les opinions publiques. Cela pourrait traduire la difficulté des Russes à conduire simultanément plusieurs campagnes multi-champs et multi-domaines, tactiques, opératives et stratégiques.
Quelles leçons pour le réarmement français ?
Permettez-moi de rappeler que nous, nous n’avons jamais désarmé. Quel autre pays européen que la France peut se prévaloir d’avoir des institutions aussi organisées et articulées autour de la prise de décision stratégique ? C’est l’héritage gaullien bâti autour de la dissuasion nucléaire, selon l’idée que la souveraineté nationale est inaliénable. Auprès du président de la République, deux chefs militaires sont chargés de coconcevoir la stratégie militaire de la France : son chef d’état-major particulier et le chef d’état-major des armées. Du fait du nucléaire, nous sommes le seul pays européen à revendiquer et assumer une stratégie militaire mondiale. Les Français, toutes générations confondues, le savent et en sont fiers. J’en veux pour preuve que l’armée française est la seule en Europe qui recrute sans difficultés. Ainsi, près de 15 000 homme et femmes, issus de toutes les couches de la population, rejoignent chaque année l’armée de terre. Cette alchimie fonctionnera tant qu’on ne mentira pas aux Français. Tant qu’ils auront le sentiment que leur armée est employée au service de la défense de leurs valeurs et que son comportement au combat est éthique. Le contrat de confiance entre les citoyens français et leur armée conditionne la liberté d’action militaire.
Dans un monde idéal, et à l’aune de la guerre d’Ukraine, que manque-t-il aujourd’hui à l’armée de terre ?
Nous avons d’ores et déjà identifié des axes capacitaires qu’il est nécessaire de renforcer pour être en mesure, le cas échéant, de contrebalancer une puissance de type russe. L’enjeu premier me semble être la maîtrise de la basse et moyenne couche dans la troisième dimension (3D), c’est-à-dire d’être capable de se défendre contre les aéronefs, drones, missiles balistiques, obus ennemis, de battre des objectifs dans la grande profondeur tactique et de contrebattre les frappes ennemies. Le tout en disposant des moyens de commandement, dont les radars, permettant de détecter et de transmettre les ordres de tir entre zéro et moins de dix secondes. Ces systèmes doivent permettre à tous nos vecteurs d’agir simultanément et non plus séquentiellement.
À lire également
Que nous apprend la guerre en Ukraine ? Que la déconstruction de « l’ordre du monde » s’accélère !
Par exemple ?
Dans le détail, il s’agit de disposer d’une artillerie capable d’appliquer des feux dans la grande profondeur tactique, c’est-à-dire au-delà de la portée actuelle de nos excellents canons Caesar qui seront modernisés, ainsi que des moyens de lutte antiaérienne et antidrone. Des capacités supplémentaires en renseignement, qu’il s’agisse des drones, des vecteurs humains, de la guerre électronique, et dans le champ cybernétique, jusqu’au niveau tactique. Nous en aurons besoin pour intoxiquer, leurrer, brouiller, neutraliser l’ennemi ; pour capter et localiser l’information disponible sur les réseaux numériques et télécoms. Le renforcement de notre épaisseur logistique, via l’acquisition de vecteurs supplémentaires et l’augmentation de nos stocks de munitions et de pièces de rechange sont nécessaires dans l’hypothèse d’un engagement majeur.
Quid des chars, dont l’Ukraine consacre le retour sur le champ de bataille ?
Oui, ils sont incontournables par leur puissance de feu au contact et leur mobilité tout terrain, malgré la raspoutitsa [ndlr : la boue causée par le dégel]. Nous allons aussi lancer les premiers travaux Titan de modernisation du segment lourd dont le projet emblématique sera le « MGCS », le successeur du char Leclerc. Mais j’observe que les Russes combinent des moyens lourds et légers. Ils ont aussi conduit de nombreuses opérations aéroportées par exemple. Et qu’en mode défensif, les Ukrainiens démontrent si besoin en était l’importance de disposer de forces d’infanterie légère et armées de systèmes antichars performants pour évoluer notamment dans les villes. Cette guerre plaide aussi pour moderniser les capacités de nos brigades d’intervention légères et amphibies, aujourd’hui dotées de véhicules à haute mobilité chenillés qu’il s’agira de renouveler, car la chenille reste un facteur clé de mobilité tactique, en zone urbaine et sur tous les terrains difficiles. On y perçoit évidemment l’importance de la logistique de guerre que j’ai déjà rapidement évoquée. C’est pour nous un autre axe d’effort prioritaire. Notre défi est d’avoir les moyens de tenir initialement au moins un mois dans un engagement de très haute intensité, notamment en consommation de munitions. Pour cela, nous devons restaurer de la fluidité entre les forces et les chaînes organiques de soutien et favoriser la remontée en puissance de notre industrie de défense. Il ne faut pas revenir à l’organisation de la guerre froide, mais il sera nécessaire de réinternaliser tout ou partie des soutiens des forces, à l’exemple allemand, et d’augmenter le niveau des stocks.
À lire également
Guerre en Ukraine : que va-t-il rester du soft power russe en France ?