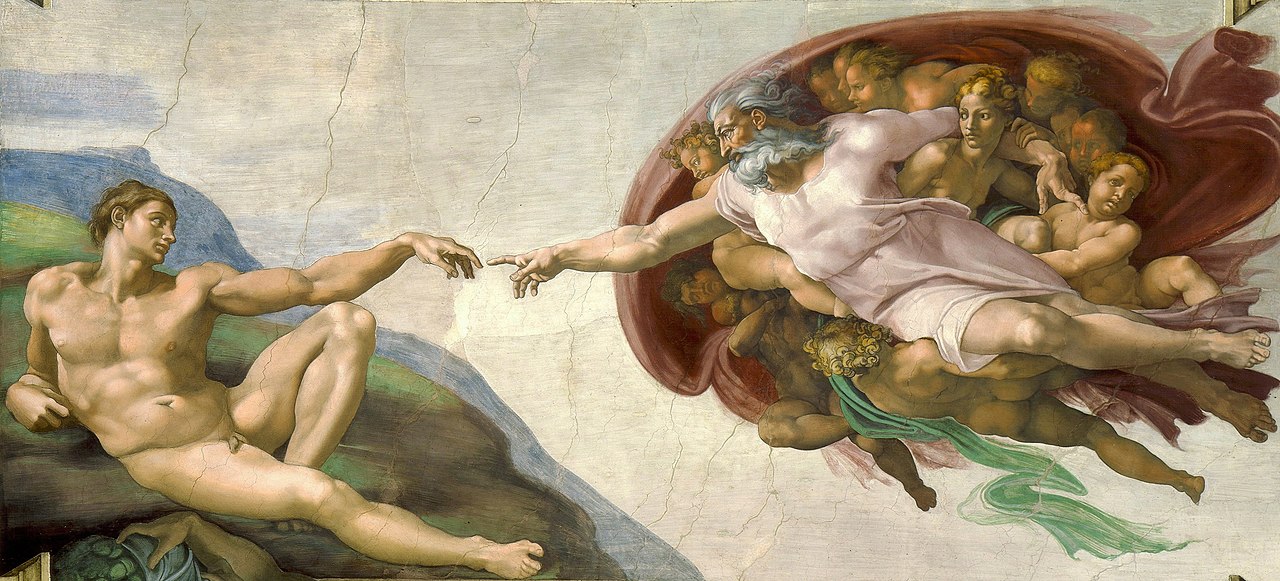Professeur de science politique à Sciences-Po Paris, chercheur au Centre de recherches internationales (CERI, FNSP) et professeur invité dans de nombreuses universités latino-américaines, Olivier Dabène préside l’Observatoire politique de l’Amérique latine et des Caraïbes (Opalc) du CERI. Auteur de plusieurs ouvrages de référence, parmi lesquels La gauche en Amérique latine, 1998-2012 (Presses de Sciences, 2012), Atlas de l’Amérique latine (3e édition, 2019), L’Amérique latine à l’époque contemporaine (9e édition, 2020), et Los efectos de los procesos participativos en la acción pública (Teseo 2019), ses travaux portent sur l’état de la démocratie et l’intégration régionale en Amérique latine. Son dernier ouvrage est intitulé Street art and democracy in Latin America (Palgrave Macmillan, 2020).
Propos recueillis par Tigrane Yegavian
Conflits : À l’évidence, l’enchevêtrement de crises politiques graves que connaît l’Amérique latine évoque une vague de « dégagisme ». Il s’y produit des événements majeurs pas toujours aisés à prévoir comme dans le cas du Chili. Sommes-nous entrés dans une décennie de transition dans laquelle ces crises remettent profondément en cause des choix politiques qui remontent aux transitions démocratiques des années 1980 ?
Olivier Dabène : Le déclenchement des crises, leur déroulement et leur dénouement sont emprunts d’incertitude et d’imprévisibilité. Si l’on en revient à cette année 2019, elle a indiscutablement été marquée par une vague de fond, mais dont il ne faut pas exagérer l’homogénéité et la cohérence. Les crises au Chili et en Équateur se ressemblent à première vue, car elles ont été déclenchées par des augmentations de tarifs (métro, essence notamment). La crise colombienne est plus complexe parce qu’elle a mêlé des préoccupations concernant des mesures d’austérité aux difficultés que connaît la mise en œuvre de l’accord de paix et la violence qui l’accompagne. La crise bolivienne, enfin, est différente, car il s’agit d’une crise électorale.
A lire aussi: L’Amérique latine face au coronavirus
Sur un plan plus général, le malaise qui parcourt l’Amérique latine a deux origines. Il y a d’un côté une profonde déception concernant la démocratie représentative, que révèlent les enquêtes du type « Latino-baromètre ». Une part importante de la population considère que les partis politiques ne représentent pas leurs intérêts. Face à la surdité des gouvernements, la prise de parole en public, dans la rue, à l’occasion de manifestations de masse, se banalise. De l’autre côté, il y a une grande frustration face à l’interruption des progrès sociaux qu’avait orchestrée la gauche lorsqu’elle gouvernait dans les années 2000. Les millions de Latino-Américains sortis de la pauvreté craignent d’y retourner.
Conflits : Les conflits sociaux et crises se multiplient sur le continent latino-américain qui n’a jamais vraiment réussi à exploiter ses richesses, aussi bien naturelles qu’humaines. Avec une croissance de 0,2 % en 2019, l’Amérique latine se classe bonne dernière. Quelles en sont les causes principales ? L’économie de rente et une mauvaise gouvernance ?
Olivier Dabène : Là encore, il convient de revenir quelques années en arrière. Après cinquante ans de politiques de « substitution d’importations », dans les années 1980, le néolibéralisme a remis au goût du jour l’économie de rente en misant sur les avantages comparatifs et la globalisation. Le « virage à gauche », qui a débuté avec l’élection de Chavez au Venezuela en 1998, a ensuite coïncidé avec un boom des exportations de matière première dont l’Amérique latine a largement bénéficié. Un tel effet d’aubaine a permis aux gouvernements progressistes de financer de généreux programmes de lutte contre la pauvreté, mais il a repoussé le changement du modèle de développement que la gauche appelait de ses vœux lorsqu’elle était dans l’opposition. L’Amérique latine continue aujourd’hui d’être tragiquement dépendante des marchés mondiaux. Et sur le plan interne, la distribution des rentes de matières premières est redevenue très inégalitaire. L’absence de croissance en 2019 ne fait qu’exacerber ces tensions potentielles.
Conflits : Après le libéralisme triomphant des années 1990 succédait une période favorable aux gouvernements de gauche et aux intégrations régionales. Il semblerait que le temps du retour de l’État, du nationalisme économique soit de retour… Qu’en est-il ?
Olivier Dabène : La gauche a été très active dans le domaine du régionalisme. Mais il s’agissait d’un régionalisme « postcommercial ». L’idée était de mettre à l’agenda un grand nombre de thématiques nouvelles pour lesquelles la coopération régionale pouvait apporter un surcroît d’efficacité : infrastructure, santé publique, défense, environnement, narcotrafic, éducation, culture, etc. L’Union des nations sud-américaines (Unasur) a permis d’avancer dans certains de ces domaines, grâce au leadership du Brésil sous la présidence de Lula. Parallèlement, les pays qui continuaient à privilégier l’option du libre-échange se sont regroupés au sein de l’Alliance du Pacifique et ont signé des accords avec les États-Unis et l’Europe. Avec le retour de gouvernements conservateurs, l’Unasur a été démantelée, au motif qu’elle était devenue trop politique.
Sur le plan économique, dans les années 2000, le protectionnisme avait déjà paralysé le Marché commun du sud (Mercosur, associant l’Argentine, le Brésil, l’Uruguay et le Paraguay). L’étape actuelle devrait voir une relance d’un régionalisme centré sur le libre-échange. On peut douter qu’il permette de relancer durablement la croissance, car les pays d’Amérique latine commercent beaucoup plus avec le reste du monde (notamment la Chine) qu’avec leurs voisins.
A lire aussi: Amérique latine : La reprise en mains
Conflits : Dans votre dossier intitulé l’Amérique latine en fusion (Ramses 2020), vous parlez d’une région qui brûle au sens propre (Amazonie) comme au figuré, en énumérant une liste à la Prévert des maux dont souffre le continent. À la lumière de ces crises, pensez-vous que l’Amérique latine connaît une sorte d’accélération de l’histoire dans laquelle les sociétés civiles sont appelées à jouer un rôle déterminant ?
Olivier Dabène : Il y a eu en 2019 une indiscutable accélération de l’histoire. Les crises comme les incendies en forêt amazonienne et les mouvements sociaux (défense de l’environnement, féminisme, étudiants…) ont ouvert les yeux de nombreux gouvernements. Certains ont commencé à satisfaire les demandes des acteurs sociaux. Mais qu’en restera-t-il fin 2020 ? La crise sanitaire a imposé son propre agenda, balayant tous les autres projets. Il n’est pas certain que la même dynamique favorable aux réformes réapparaisse une fois le Covid-19 vaincu. Il faut en revanche s’attendre à de nouveaux soubresauts, lorsque sera venu le moment d’évaluer la réaction des gouvernements face au virus.
Conflits : La crise vénézuélienne semble être bloquée et connaît un effet de lassitude. A-t-elle perdu de sa centralité au regard des autres foyers de crises qui ébranlent l’Amérique latine ? Autrement dit, le temps joue-t-il en faveur du chavisme ?
Olivier Dabène : Il y a effectivement tant au Venezuela qu’à l’extérieur une grande lassitude, voire de la résignation. Depuis 2013, Maduro fait l’objet d’une répudiation générale sur la scène internationale, mais il parvient à contrôler l’agenda en proposant par exemple des négociations sans aucune intention de les voir aboutir, ou en présentant ses opposants comme manipulés par les États-Unis. Au besoin, son gouvernement réprime dans le sang les tentatives de rébellion.
Début 2019, lorsque le président de l’Assemblée nationale Juan Guaidó s’est autoproclamé président de la République, l’espoir est réapparu d’une transition démocratique rapide. Rien ni personne n’a pourtant sérieusement déstabilisé le régime. Maduro parade en chef de guerre et met sur le compte des sanctions américaines le terrible drame humanitaire que subit le pays.
Conflits : La crise migratoire vénézuélienne aurait dû appeler à une concertation entre les pays de la région pour établir des mécanismes de coopération. Malgré la réunion de Quito des pays andins, il n’existe pas de politique migratoire commune vis-à-vis des réfugiés vénézuéliens. Peut-on dire que le régionalisme a fait son temps ou s’agit-il d’un phénomène cyclique ?
Olivier Dabène : Le régionalisme en Amérique latine a toujours connu des cycles, alternant les périodes de lancement de projets nouveaux et les crises qui les paralysent. La période actuelle est plutôt défavorable, mais en 2019, plusieurs initiatives ont été lancées qui ont permis aux pays de se remettre à travailler ensemble. Le thème migratoire a fait l’objet d’une réunion et peu de décisions concrètes. Cela peut paraître décevant, mais une approche multilatérale est dans l’air. La difficulté vient du fait que les pays d’Amérique latine sont très inégalement impactés par la crise migratoire. La Colombie est de très loin le principal pays d’accueil. Pour les autres pays, des mesures restrictives comme l’exigence d’un passeport (qui contrevient à une norme andine) peut suffire.
Le régionalisme ne pourra être relancé que s’il associe le Venezuela. L’enjeu en 2020 est la relance de la Communauté des États latino-américains et caribéens (Celac), sous présidence mexicaine. Un sommet réunissant tous ses membres, y compris le Venezuela, serait un progrès considérable.
A lire aussi: Entretien: Brésil, le pays sans ennemi
Conflits : Si on note l’existence de thématiques transversales communes aux pays de la région (crise migratoire, environnement, narcotrafic…), celles-ci ne figurent pas dans les agendas des diplomaties latino-américaines, alors que le dynamisme des diplomaties brésilienne et mexicaine dans les forums multilatéraux est reconnu de tous. Est-ce là encore le signe de la mise en arrêt des intégrations ?
Olivier Dabène : Il y a un problème avec le Brésil et le Mexique. Ce sont les leaders « naturels » de l’Amérique latine mais aucun n’assume aujourd’hui cette responsabilité. Le Brésil a été un acteur important du multilatéralisme (dans le cadre de l’OMC par exemple) et du régionalisme latino-américain (Unasur) à l’époque de Lula (2002-2010). Dilma Rousseff (2010-2016) s’intéressait beaucoup moins aux relations internationales. Sa destitution a mis le Brésil au ban des nations, et l’élection de Bolsonaro en 2018 a accentué l’isolement du Brésil. Sans leadership brésilien, le régionalisme en Amérique du Sud est handicapé.
Le Mexique, de son côté, est absent de la scène internationale depuis des décennies. Le président López Obrador ne déroge pas à la règle. En fonction depuis plus d’un an, il n’est pas sorti une seule fois de son pays. Or ce pays peut jouer un rôle important de tampon entre l’Amérique latine et les États-Unis.
Un axe progressiste Argentine/Mexique semble pourtant se dessiner. Il pourrait être à l’origine de la relance de la Celac. Mais sans le Brésil, le projet manquera d’ambition.
Conflits : L’autre point commun qui réunit tous ces États est la place prépondérante de la Chine dans leurs économies. Premier investisseur en Amérique latine et second partenaire commercial de la région, la Chine a-t-elle une responsabilité dans la reprimarisation du secteur économique facteur d’une dépendance accrue ?
Olivier Dabène : Oui, absolument. Le boom des exportations des années 2000 a aussi été un boom des importations de produits chinois qui ont ruiné le tissu industriel en Amérique latine. La tendance à la reprimarisation des économies sera difficile à inverser. La Chine a en quelque sorte renvoyé l’Amérique latine au xixe siècle, lorsque sa croissance dépendait de l’exportation de peu de produits à destination de peu de clients. Même le Brésil est touché par ce processus.
On ne peut toutefois pas accuser la Chine d’avoir sciemment détruit des pans entiers de l’industrie en Amérique latine. Un tel résultat est le produit de choix politiques. Les pays d’Amérique latine ont cédé à la facilité et n’ont pas (ou peu) cherché à faire évoluer leur modèle de développement.
Conflits : Dans quelle mesure les présidentielles américaines vont influer sur les relations des pays latino-américains vis-à-vis des États-Unis ?
Le sens commun considère qu’une défaite de Donald Trump serait profitable à l’Amérique latine (et au monde !). C’est sans doute vrai, mais il convient cependant de nuancer.
A lire aussi: De la multi-polarisation politique émotionnelle en Amérique
Barack Obama avait suscité beaucoup d’espoir, avant de décevoir. Une exception toutefois : sa politique de rapprochement avec Cuba qui a conduit au rétablissement des relations diplomatiques. Une telle évolution était attendue depuis des décennies par l’Amérique latine.
Trump de son côté est obnubilé par trois dossiers : le démantèlement de la politique d’ouverture vis-à-vis de Cuba, le changement de régime au Venezuela et la question migratoire centraméricaine. Le premier point a fait l’objet de décisions rapides. Les deux autres se sont enlisés.
Mais pour le reste, et à quelques exceptions près (Brésil), Trump fait preuve de désintérêt à l’égard de l’Amérique latine, et ce n’est pas nécessairement une mauvaise nouvelle.
L’histoire nous apprend que les périodes de désintérêt sont plus favorables à l’Amérique latine que les périodes de politique erronée ou agressive. Un salutaire oubli vaut mieux qu’un interventionnisme brutal.
Il est toujours permis de rêver d’une nouvelle « alliance pour le progrès », comme à l’époque de Kennedy. Mais la situation est bien différente. L’Amérique latine est désormais tournée vers l’Asie et peut se contenter d’un nouveau président américain qui se limite à collaborer avec elle pour éradiquer les activités transfrontalières illicites comme les trafics de drogue, d’armes et de personnes.