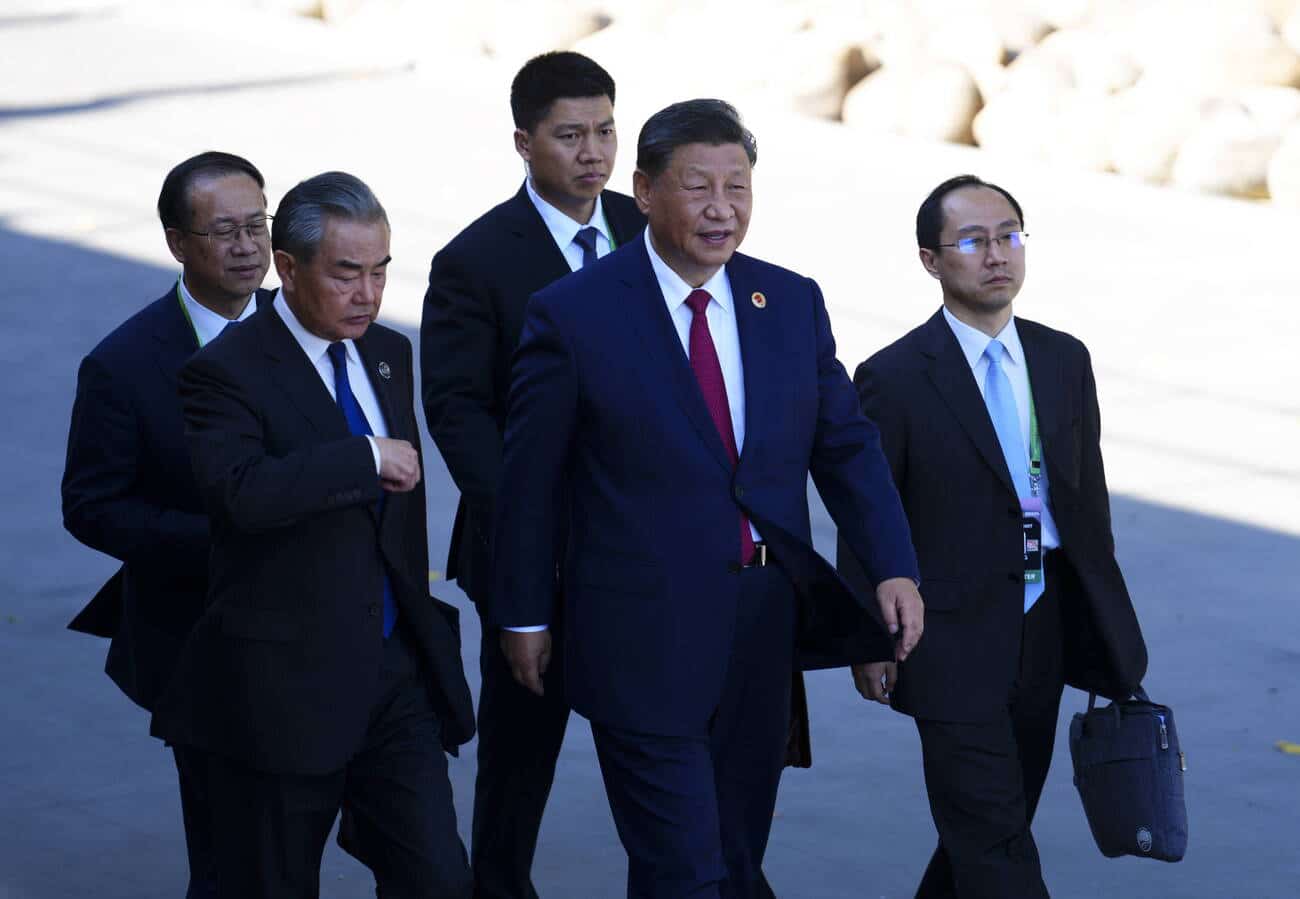Il existe dans le monde un engouement assez général pour les énergies renouvelables. À cet égard, un chiffre est très significatif : à partir de 2013, les investissements dans ces énergies renouvelables ont dépassé ceux dans les énergies fossiles.
Les énergies renouvelables (ENR) permettent de réduire massivement les émissions de gaz à effet de serre et les grandes conférences internationales cherchent à les promouvoir (accord de Paris en 2015). Ainsi, les États s’engagent beaucoup dans les ENR, à coups de subventions massives, et leur croissance est très rapide : en incluant l’hydroélectricité, elles représentent 10 % du bilan énergétique mondial et 25 % de la production d’électricité proprement dite (et sans doute 30 % à l’horizon 2025).
Les coûts de production sont en baisse rapide : le prix de la tonne équivalent pétrole de l’énergie solaire a plongé de 20 % depuis 2010, celle de l’éolien de 25 %. Selon l’Agence internationale de l’énergie, il sera moins coûteux en 2020 de produire une tonne d’énergie avec des ENR qu’avec des énergies fossiles, surtout si une forte hausse du pétrole dans les années à venir se produit. Les investissements dans les ENR sont ainsi en forte hausse, les deux tiers étant orientés vers les nouvelles centrales électriques. De nombreux projets-modèles ont été lancés dans le monde ces dernières années. Pour n’en garder qu’un, assez emblématique de la transition écologique en France : la Biovallée dans la Drôme (102 communes) ambitionne de n’utiliser que des énergies propres (biomasse, éolien et hydraulique à égalité).
Éolien, hydrolien et solaire
L’éolien, énergie la moins polluante avec 9 grammes de CO2 par kWh, est l’énergie verte la plus importante avec le solaire. Chaque année, au Danemark, la production d’électricité par éoliennes fait économiser au pays 3,5 millions de tonnes de dioxyde de carbone, 6 450 tonnes de dioxyde de soufre, 6 000 tonnes d’oxydes azotiques et 223 000 tonnes de cendres volantes. Aujourd’hui, le pays le plus équipé est la Chine (environ un tiers de la puissance installée mondiale), devant les États-Unis (15 %), l’Allemagne (10 %), l’Inde, l’Espagne… Le plus grand parc éolien du monde est au large du Danemark (Horns Rev) : 80 turbines hautes de 110 mètres, produisant chacune 2 MW, sur une surface de 20 km². Les turbines sont construites par Vestas, commandées à distance et en temps réel par le biais d’un réseau internet, exploitées par Elsam. Ce parc fournit en un an environ 2 % de la consommation danoise d’électricité, de quoi alimenter 150 000 foyers. Les grands projets de fermes éoliennes en mer se multiplient : Royaume-Uni, Danemark, Norvège. La France, quant à elle, prévoit un vaste programme de 600 éoliennes en mer.
L’hydrolien se développe dans son sillage, utilisant non la force des vents mais celle des courants marins.
Le solaire progresse encore plus rapidement, à un rythme de 35 % par an environ, car il est très subventionné (plus encore que l’éolien), en particulier en Europe. En France, EDF l’achète à des prix garantis pour 20 ans. La subvention ne va pas directement à l’industrie (production de panneaux), mais à la demande (équipements individuels et collectifs). Toutefois, les gouvernements tendent depuis quelques années à réduire les prix de rachat de cette électricité (France, Italie, Allemagne) et les producteurs de panneaux, surtout chinois, se trouvent en situation de surcapacité (la Chine réalise 65 % de la production mondiale) ; ainsi les prix ont baissé des trois quarts au niveau mondial en quelques années et beaucoup de firmes chinoises sont en difficulté (Suntech). Le marché est donc tendu, comme le prouve le rachat de l’américain SunPower par Total ou l’abandon du projet Desertec dans le Sahara.
Certains pays sont très avancés dans la production de ces ENR et de leurs équipements spécialisés. L’Europe est de loin le leader du développement des ENR. Quatre pays sont très en pointe et leur bilan énergétique laisse une place majoritaire aux ENR : Islande, Norvège, Suède, Danemark. Ces pays sont parvenus à réduire de 2 à 6 % par an leurs émissions de GES ces dernières années, alors que celles de l’Union européenne dans son ensemble augmentaient à nouveau avec le retour de la croissance (rapport Enerdata 2018). Les fabricants d’aérogénérateurs sont danois (Vestas, premier) et allemands (Enercon, Siemens, E.ON qui investit dans le secteur…), devant les Américains qui commencent juste à s’y mettre (General Electric).
De son côté, la Chine investit des sommes faramineuses dans des projets d’énergie propre sur son territoire : 40 % de son plan de relance de 600 milliards de dollars en 2009 était consacré à ces énergies, mais aussi au transport ferroviaire, aux économies d’énergie… Elle est leader pour la fabrication de turbines éoliennes et pour celle de panneaux solaires.
A lire aussi : Des énergies renouvelables de plus en plus diversifiées, de moins en moins brésiliennes
Des limites considérables
Ces limites expliquent que ces énergies ne sont pour l’heure que des ressources complémentaires des autres avec tout au plus 3 à 4 % de la production électrique mondiale. Elles sont de quatre types.
Ces énergies sont intermittentes et peu compétitives. Les investissements sont très élevés par rapport aux autres énergies : dans l’éolien 1 500 à 3 000 euros par kW, dans le photovoltaïque 5 000 à 9 000 euros par kW, à comparer aux 500 euros par kW pour le gaz naturel, par exemple. Et les coûts d’exploitation sont élevés, même s’ils sont en forte réduction : le coût d’un kWh dans l’éolien est de l’ordre de 4,5 centimes d’euros contre 3 à 4 pour le nucléaire. La ferme d’éoliennes Horns Rev, la plus grande du monde, a ainsi coûté 270 millions d’euros pour une production de 600 GWh par an. L’éolien est pourtant la plus compétitive de toutes ces énergies.
La faible taille des infrastructures et des équipements rend difficiles les économies d’échelle, ainsi la moitié de l’électricité bas-carbone produite dans le monde l’est encore par des centrales hydroélectriques. L’hydroélectricité réalise ainsi 18 % de la production électrique mondiale, quatre fois plus que l’éolien (4 %), huit fois plus que le solaire et la biomasse (environ 3 %).
Une des faiblesses les plus graves des énergies renouvelables est leur intermittence. Lorsque les vents sont faibles, quand le soleil est couché ou caché, elles ne produisent pas. Cela rend les investissements moins rentables. Par ailleurs, faute de moyens pour stocker l’électricité, il faut des centrales classiques pour maintenir la production nationale quand les énergies renouvelables ne produisent pas, soit nucléaires (mais les écologistes ne veulent pas en entendre parler), soit au charbon ou au gaz (mais elles émettent du CO2).
Leur essor dépend d’une percée technologique majeure, le stockage massif de l’électricité qui, actuellement, n’est pas possible. Le sera-t-il demain (voir infra) ?
Ces énergies ne doivent leur développement actuel qu’au soutien massif des États. Les subventions publiques sont massives. Les États membres de l’Union européenne ont dépensé environ 600 milliards d’euros sur des projets d’énergies renouvelables depuis 2005, selon Bloomberg New Energy Finance. Lorsque ces sommes diminuent, le secteur des ENR est en danger. Ainsi, en Allemagne, avec des faillites en chaîne après la baisse de l’aide au solaire (Conergy, Q-cells repris par le coréen Hanwha, Solarhybrid, Solon, Solar Millenium, Sovello…) et le retrait du secteur de Siemens et Bosch, suite à de lourdes pertes.
Ces énergies sont menacées par la pénurie sur le marché des métaux rares et précieux : ces métaux sont très utilisés pour les éoliennes et hydroliennes, cellules photovoltaïques, batteries électriques… Ainsi, Daniel Yergin, spécialiste américain de l’histoire des énergies, annonçait il y a quelques années que le xxie siècle serait celui des métaux alors que le xxe siècle avait été celui des hydrocarbures. Ceux-ci sont produits par un petit nombre de pays en position d’oligopole ou de monopole, comme la Chine pour les terres rares.
Enfin, il existe des disparités énormes entre les territoires pour leur utilisation, et ce pour des raisons géographiques et politiques. Les contraintes de localisation sont considérables, elles rappellent la prégnance de la « vieille géographie » ; elles dépendent de l’ensoleillement, de l’exposition aux vents, de la géothermie ou des courants marins… La production ne peut être pour l’essentiel que délocalisée, dispersée. De plus, la volonté politique de développer les ENR est très inégale dans le monde : en Asie, si c’est une priorité absolue pour l’Inde pour des raisons de développement économique et de softpower (elle a lancé l’Alliance solaire internationale), ce n’est pas le cas pour le Japon encore très dépendant des hydrocarbures et tenté de redévelopper le nucléaire malgré les séquelles de Fukushima. La Chine y voit une aubaine économique, ses entreprises produisent la moitié des nouveaux panneaux solaires fabriqués dans le monde. Les pays du Golfe ne s’y mettent que progressivement : les Émirats arabes unis davantage que le Qatar riche de ses ressources gigantesques en gaz.
Des enjeux considérables
L’un des enjeux essentiels est le stockage de l’électricité bas-carbone. Il intéresse ainsi des sociétés américaines high-tech comme Tesla Motors, championne des véhicules électriques haut de gamme, qui a ouvert fin 2017 le plus grand système de stockage d’électricité par batteries au lithium (à partir de panneaux solaires et d’éoliennes) en Australie du Sud, ce qui constitue une rupture technologique.
Associées à Internet et aux NTIC, les ENR sont le moteur d’une nouvelle révolution technologique. Ainsi, en Californie, la Silicon Valley connaît sa troisième révolution industrielle et technologique dans les Green IT tech, après celles de l’électronique, puis de l’informatique et de l’Internet (Tesla, Solazyme, Nanosolar, GreatPoint, Solis Energy, Leosphere, Biobasic…). Parlant de troisième révolution industrielle, l’économiste prophète des nouvelles technologies Jérémy Rifkin anticipe le développement de smart grids, réseaux intelligents associant Internet et ENR pour faire correspondre production, consommation et stockage, dans le cadre d’une nouvelle économie verte déployée localement, les consommateurs étant également des producteurs d’énergie (prosumers) grâce aux nouveaux équipements solaires et éoliens décentralisés au niveau de l’habitation, du quartier, de l’immeuble de bureaux et grâce à des technologies réputées disruptives (piles ou batteries à hydrogène, par exemple). Bref, des perspectives de croissance sans limites !
Mais cette « Troisième révolution industrielle » est-elle une bonne nouvelle pour l’environnement ? Hormis les métaux rares et l’énergie pour fabriquer les équipements aussi bien lourds que légers, les data centers fonctionnant 24 heures sur 24 (serveurs et systèmes de refroidissement) consommeraient de 2 % à 7 % de l’électricité mondiale (selon les sources). Gaspillage de métaux rares, gaspillage d’électricité… La planète sera-t-elle plus verte ?
A lire aussi : Les grands marchés de l’énergie aujourd’hui et demain
L’hydroélectricité, la moins écologique des énergies renouvelables
L’utilisation de la force vive de l’eau pour produire de l’électricité a commencé à la fin du xixe siècle. Le principe est simple : profiter du débit d’un cours d’eau pour faire tourner une turbine, laquelle est reliée à un générateur d’électricité. Le potentiel de cette source d’énergie, renouvelable, dépend donc de la pluviométrie et de l’étendue du bassin-versant. L’usine hydroélectrique comprend le même couple turbine-alternateur que la centrale thermique, mais le mouvement rotatif de la turbine y est animé par l’énergie cinétique. Des conduites amènent l’eau au-dessus de turbines et la précipitent contre leurs pales : la productivité d’une centrale dépend donc de la hauteur de la chute et du débit. Le principe de l’hydroélectricité est également applicable aux mers et océans : on peut tirer parti des marées, là où l’amplitude est importante (estuaire de la Rance en France, baie de Fundy au Canada, baie de San José en Argentine, baie de la Severn en Grande-Bretagne), mais le développement est limité : la centrale de la Rance demeure à ce jour la plus grande du monde, pourtant elle n’alimente que 250 000 foyers en électricité.
Peu coûteuse, l’hydroélectricité est souvent disponible dans des régions montagneuses dépourvues de charbon, elle est un facteur de progrès socio-économique là où elle s’implante (vallées alpines en France, par exemple). Mais les contraintes des sites sont fortes, de même que la masse de capitaux à investir, d’où une énergie sous-utilisée à l’échelle mondiale. La question est de savoir si les capacités hydroélectriques mondiales peuvent être encore développées dans les décennies à venir, notamment dans les pays du Sud, pour répondre à la demande grandissante en électricité, alors que leur coût environnemental est lourd.
Depuis les années 1950, le nombre de barrages hydroélectriques a été multiplié par sept. Le plus grand nombre a été réalisé dans les pays en développement : 360 ouvrages par an ont été construits entre 1951 et 1977 puis 180 par an depuis 1980 dans le monde. Par exemple, le Great Anatolian Project en Turquie compte treize barrages construits sur le Tigre et l’Euphrate entre 1972 et 1984, aujourd’hui plus d’une vingtaine. Plus de 20 000 barrages équipent aujourd’hui les grands fleuves du monde. C’est plus du double qui équipe au total la moitié des cours d’eau existant sur la planète (45 000 environ). C’est la première des ENR : 7 % du bilan énergétique mondial, 16 % de l’électricité mondiale.
Cependant, le potentiel hydraulique est loin d’être pleinement exploité au niveau mondial : on estime que seul le quart du potentiel le serait. Certains pays l’utilisent beaucoup, tant au Nord qu’au Sud : la Norvège pour 99 % de son électricité, le Brésil pour 84 %, le Venezuela pour 66 %, le Canada pour 56 %. Asie et Amérique du Sud n’ont mis en valeur que 20 % de leur potentiel hydroélectrique, l’Afrique seulement 5 %. Seuls deux grands pays recourent majoritairement à l’hydroélectricité pour se fournir : le Brésil avec le complexe d’Iguaçu-Itaipu (14 000 MW) et le Canada avec celui de La Grande dans la Baie-James (15 000 MW). En Chine, le barrage des Trois-Gorges fournit désormais 18 000 MW, soit 10 % de la consommation nationale annuelle et celui de Guri au Venezuela plus de 10 000 MW. Mais on peut ajouter à cela des pays plus petits comme Norvège, Autriche, Suisse, mais aussi Colombie, Nouvelle-Zélande… L’Europe, qui comptait 1/5e des barrages mondiaux dans les années 1950, n’en compte plus aujourd’hui qu’1/10e. On retrouve cette diminution relative en Amérique. À l’inverse, si l’Afrique reste plutôt à la traîne, toujours autour de 2 % des barrages, l’Asie connaît la plus impressionnante augmentation relative qui révèle un rattrapage mais aussi un effort sans précédent, notamment en vue d’augmenter les surfaces irriguées. Disposant de 30 % des barrages du monde en 1950, l’Asie atteint aujourd’hui près des 2/3. On semble avoir atteint un seuil dans l’équipement des grands fleuves du monde avec la mise en eau des barrages chinois des Trois-Gorges et de Sanxia, mais aussi du barrage argentin de Pati.
Une technologie coûteuse, peu écologique, géopolitiquement sensible
Les grands barrages ont un coût gigantesque : 75 à 100 milliards de dollars pour le barrage des Trois-Gorges contre les 25 milliards initialement prévus, par exemple. Ces coûts sont de plus en plus lourds à supporter dans des pays en situation financière difficile et dans un contexte où la Banque mondiale rechigne à accorder de nouveaux prêts pour ce type de chantier (15 % de ses fonds vont chaque année aux aménagements hydrauliques). Les aménageurs s’orientent aujourd’hui davantage vers de petits projets.
Les impacts environnementaux sont considérables : la construction des grands barrages s’accompagne d’une perturbation majeure des écosystèmes par ennoiement de régions entières, elle renforce le risque d’assèchement des régions en aval (mer d’Aral, lac Tchad, lac d’Ichkeul en Tunisie), ainsi que du déplacement de nombreuses personnes (1,5 million de déplacés dans le cas du barrage des Trois-Gorges en Chine), de la transformation en profondeur des paysages. Mais les difficultés sont également sanitaires. Les micro-organismes (virus, bactéries, parasites) pullulent dans les lacs-réservoirs, à l’origine d’épidémies graves comme le choléra ou la fièvre typhoïde, mais aussi d’infections mortelles comme la dysenterie, la poliomyélite et les hépatites. L’eau stagnante est responsable des épidémies de paludisme, transmis à l’homme par la femelle d’un moustique dont les larves se développent dans l’eau.
Dans les bassins fluviaux internationaux, les grands barrages créent des situations de conflits plus ou moins graves, à l’image du GAP en Turquie qui, lors de la mise en eau du lac Ataturk au début des années 1990, a failli provoquer une guerre avec la Syrie qui a renforcé son soutien à la rébellion du Parti indépendantiste kurde (PKK).
La croissance verte, une utopie ?
La transition énergétique et écologique est ainsi loin d’être achevée, on peut même affirmer qu’elle est trop lente vu les dispositifs prévus par l’accord de Paris (2015). Dans son dernier rapport Bilan énergétique mondial (2018), la société de conseil Enerdata évoque un « pas en arrière dans la transition énergétique » et met en avant le fait qu’après une baisse sensible des émissions de CO2 dans les années 2010 à 2016, sans aucun doute liée en grande partie à la crise économique, celles-ci remontent nettement, à un rythme de 2 % par an dans les pays du G20.
Il ne s’agit pas d’abandonner du jour au lendemain les énergies fossiles mais d’atteindre de nouveaux équilibres en privilégiant toutes les énergies bas-carbone, à commencer par le gaz face au pétrole et au charbon, mais aussi bien évidemment les énergies vertes qui deviennent un nouveau marché en expansion rapide favorisé par la baisse des coûts (mais aussi les subventions publiques !) et enfin le nucléaire dont la plupart des grandes puissances n’ont pas l’intention de se passer, bien au contraire. On le voit donc clairement, la croissance dans le monde n’est pas beaucoup plus « verte » aujourd’hui qu’hier. Selon l’AIE, les subventions aux énergies fossiles (surtout le charbon) représentent toujours cinq à six fois les subventions destinées aux énergies renouvelables.