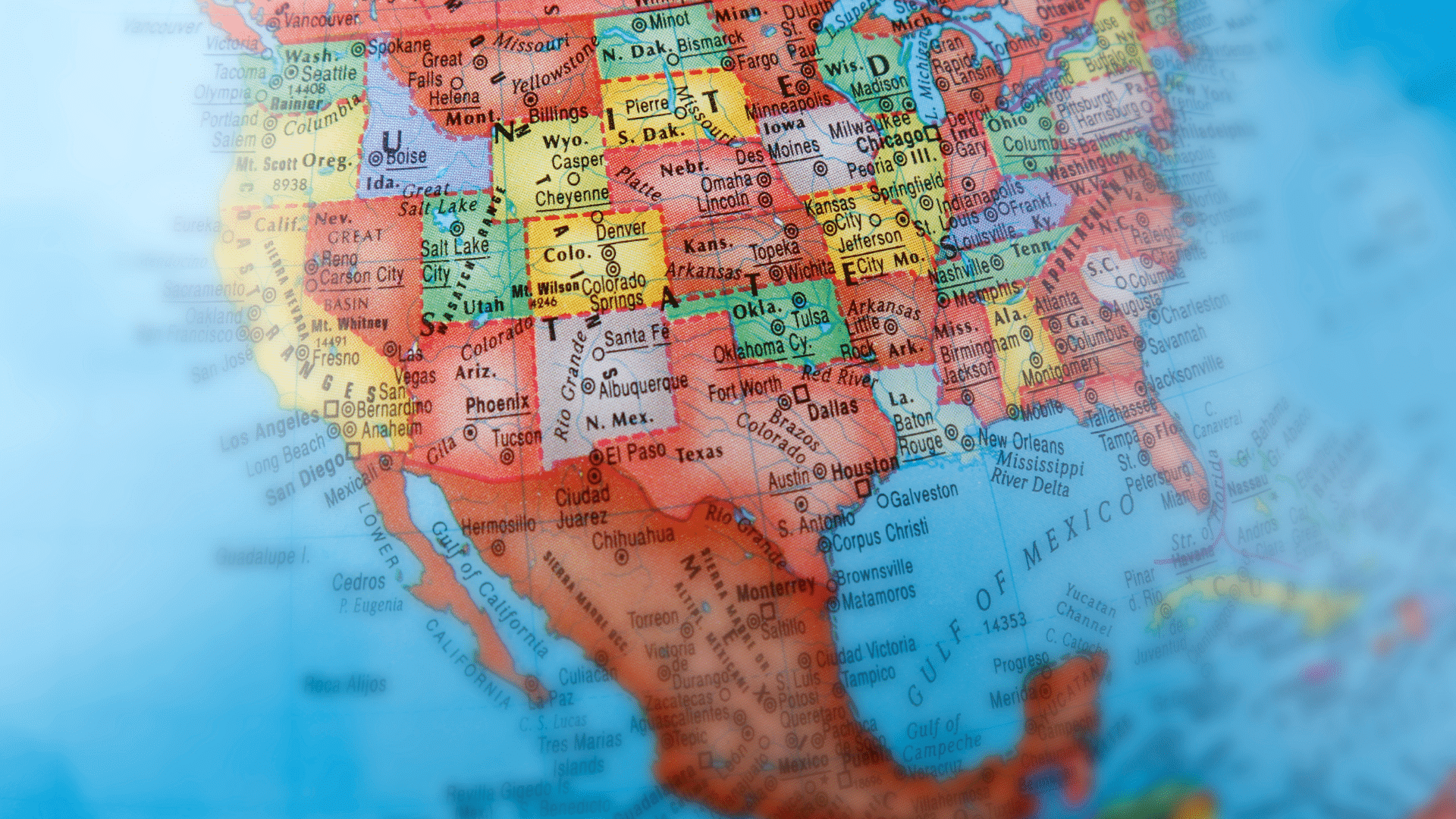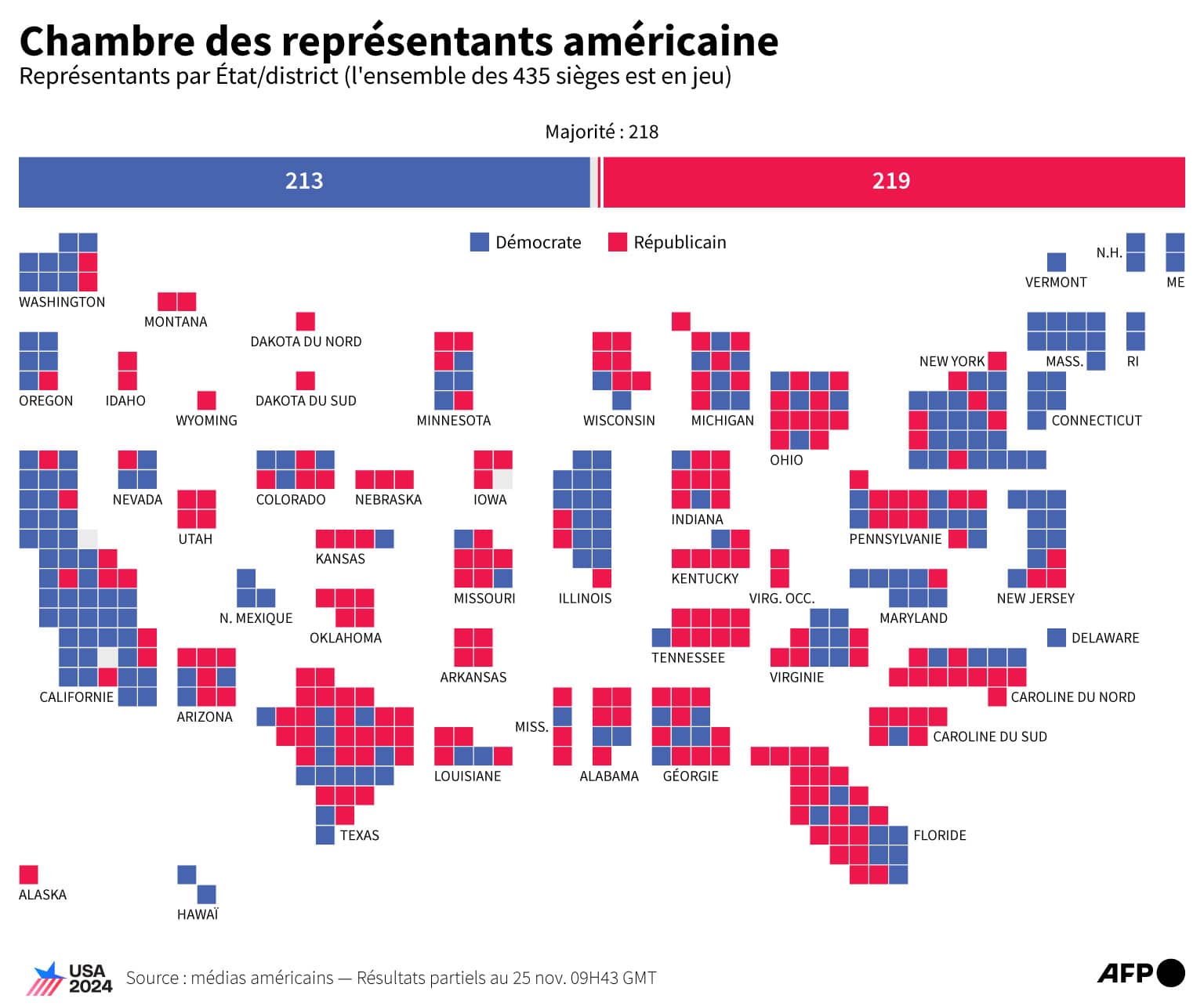Le monde latino aux États-Unis exprime ses rêves et ses craintes, ses lubies et ses obsessions, dans des textes désormais écrits dans les deux langues, espagnol et anglais, ou entre les deux langues. Revues, maisons d’édition, ouvrages populaires fleurissent et témoignent du dynamisme d’une culture qui parvient à se renouveler et à se développer.
Le visiteur des grands centres urbains aux États-Unis s’en rend facilement compte : les hispanophones sont désormais la première minorité dans le grand pays anglo-saxon. Difficile de s’appuyer sur des statistiques fermes tant ces hispanophones présentent de variétés : ils peuvent être migrants récents voire clandestins, descendants de latinos depuis des générations, ou même fruits d’un mariage mixte. On estime que 42 % des habitants de Los Angeles s’expriment tous les jours en espagnol. Et que dire de Miami la cubaine ? Ou de Chicago qui compte plus de 500 000 Mexicains dans sa population ? La situation n’est pas nouvelle, mais n’a fait que croître depuis des décennies. L’histoire en donne une première raison. À la suite de la perte du Texas et au traité de paix entre le Mexique et les États-Unis en 1848, le pays hispanique est amputé de près de la moitié de son territoire et cède de vastes régions dont la Californie. Cependant, bon nombre d’habitants vont rester, et la société qui s’installe dans ces zones prend en compte cet héritage, visible aussi bien dans les noms de ces habitants que dans la toponymie.
Une Amérique hispanique
Le xxe siècle accélère ce processus avec une constante : les États-Unis et leur réussite économique, qui semblent narguer le monde latino-américain, attirent des migrants en tous genres. Depuis les Mexicains qui vont travailler comme saisonniers dans les entreprises agricoles du sud jusqu’aux étudiants qui réussissent à entrer dans les prestigieuses universités nord-américaines, en passant par les réfugiés politiques qui fuient la Cuba castriste : les profils de ceux qui cherchent une nouvelle vie de l’autre côté du Rio Grande sont divers et variés. Certains, comme l’écrivain mexicain Carlos Fuentes, n’hésitent pas à utiliser le terme de « reconquête des territoires », comme si ce processus émanait d’une volonté plus ou moins consciente d’un peuple toujours vexé d’avoir perdu une partie de sa superficie. Sans en arriver là, force est de constater que ce mouvement s’accompagne aussi d’une certaine fierté et que l’on sent parfois de la revanche dans l’air.
La réalité rend l’analyse encore plus complexe, car plusieurs phénomènes d’ordres différents se mêlent et compliquent les données. Mais un fait ressort, presque un symptôme : depuis une vingtaine d’années, l’écriture littéraire en espagnol aux États-Unis n’a fait que s’étendre et touche un public de plus en plus étendu. Tous les genres littéraires sont concernés et l’aspect militant que cette production présentait dans les années 1960 ou 1970 a tendance à s’atténuer. La figure de César Chávez est révélatrice de ces moments de revendications. Né en 1927 en Arizona, il doit travailler dès son plus jeune âge avec sa famille dans diverses plantations. Il abandonne très tôt l’école, mais devient vite un leader de sa communauté et transforme ses positions personnelles en cause et en luttes sociales qui donnent des résultats concrets. Cela impose entre autres une visibilité à cette minorité quand les combats de toutes sortes occupent l’espace public aux États-Unis. Chávez obtient par des moyens pacifiques des avantages pour les travailleurs agricoles. Et comme si l’histoire avait le sens de l’humour, il lance d’autres combats liés à l’écologie, est végan avant l’heure, et défend aussi le droit des animaux, devenant ainsi une icône aujourd’hui. Disparu en 1993, sa mémoire est célébrée de multiples façons et le mythe du grand syndicaliste fonctionne plus que jamais.
À lire également
Mexique : les désillusions de Manuel Obrador
Expression privilégiée de cette identité, la production littéraire au sein de la communauté chicana se développe à partir des années 1960 même si une production en langue espagnole existait auparavant de façon très marginale. Le théâtre en particulier connaît un engouement peu commun, accompagnant souvent des mouvements de grévistes. Parmi les livres publiés alors, deux caractéristiques l’emportent. D’un côté la recherche d’identité motive bon nombre de textes et ancre des fictions dans cette dynamique et, d’un autre côté, la langue devient plus qu’un instrument, elle est le centre de cette façon singulière de se regarder que constitue la production de textes. Les grands romans de ce temps proposent, dans un langage coincé entre un espagnol oral et un anglais populaire, la recherche que font les héros de ce qu’ils sont et surtout de ce qu’ils veulent devenir. Avec Peregrinos de Aztlán (Pèlerins de Aztlan), Miguel Mendez donne en 1974 une série de personnages qui sont toujours en quête d’identité, marginaux évoluant dans la zone frontalière. De même Tomás Rivera avec Y no se lo tragó la tierra (1971) a donné un texte d’une grande maturité linguistique, et a ainsi été comparé à Faulkner. Lui aussi écrit dans une langue éloignée des canons de sa langue natale, cet espagnol tordu par les chicanos. Rivera représente aussi par sa trajectoire une forme de réussite à l’américaine : il récolte enfant des fruits dans les champs de Californie, puis réussit à entrer à l’université, où il fait carrière jusqu’à devenir Chancellor de l’université de Californie-Riverside, comme une espèce de rêve américain adapté à l’écriture littéraire et au monde académique.
Le rêve américain s’écrit en espagnol
D’autres livres illustrent ces temps de combat et d’affirmation et montrent combien la langue était alors l’outil privilégié pour faire valoir une différence. On peut citer encore Klail City y sus alrededores (Klail City et ses environs) dans lequel l’auteur, Rolando Hinojosa, crée une ville imaginaire qui ressemble à tant de villes frontalières. Il réussit à remporter le prix Casa de las Américas, remis à Cuba en 1976, et qui constitue à cette époque l’un des grands prix littéraires de langue espagnole. Proche de l’univers du roman policier, mais animé par une langue très travaillée, ce livre connaît un succès international et fut l’objet de nombreuses thèses. Ces quelques exemples sont révélateurs d’une production riche et inventive, authentique et ambitieuse, mais dont le rayonnement est loin d’être à la hauteur de ses aspirations. Elle se heurte à ses propres limitations : en s’adressant presque exclusivement à sa propre communauté, peu lectrice en général, et en proposant comme centre de son expression un désir de reconnaissance, ces textes n’arrivent que rarement à rencontrer un lectorat, aussi bien aux États-Unis qu’au Mexique, où la littérature ne regarde alors que très peu au-delà de la frontière. Les chicanos – ces personnes d’origine mexicaine qui vivent dans des zones sud des États-Unis – sentent bien qu’ils ne sont ni Mexicains ni Nord-Américains. Ils sont à la marge des deux grands pays et assument cette position avec fierté. Même si cela les handicape pour jouir d’un statut plus visible ou plus enviable.
Ces chicanos sont les plus anciens dans ce panorama de l’écriture en langue espagnole aux États-Unis et ils sont d’ailleurs les seuls à manier une langue particulière, pas toujours compréhensible pour les non-chicanos. Pour mieux marquer leur singularité, ils ont creusé dans leur propre langue, trouver les mots pour mettre en valeur leur singularité quitte à se couper de possibles lecteurs. Ces auteurs ont fièrement écouté le langage de la rue pour le transformer en matière littéraire. Cependant, depuis une vingtaine d’années, le développement des littératures de langue espagnole passe par d’autres stratégies. Il est vrai aussi que les membres des communautés hispanophones se posent souvent la question de la langue et bon nombre d’entre eux pensent que leur assimilation aux États-Unis passe par l’abandon de leur langue natale et la pratique de l’anglais. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui désirent grimper les échelons de la société, qu’ils soient écrivains ou non. Le succès commercial des livres de la Mexicaine Valeria Luiselli, par exemple, est lié à son changement de langue. Privilégier l’anglais à l’espagnol, en choisissant soigneusement ses thèmes liés à l’immigration et l’identité, a été un choix payant. Encore faut-il pouvoir passer ainsi d’une langue à l’autre, ce qui n’est pas donné à tout le monde.
À lire également
La lusophonie : un destin de langue
Écrire aujourd’hui en espagnol aux États-Unis n’est pas incongru : on observe un mouvement d’expansion plutôt qu’une dynamique d’enfermement qui a parfois marqué auparavant cette pratique. Il existe un univers qui permet de publier, lire, faire circuler textes et idées en espagnol. Un système de reconnaissance et de formation avec ses prix et ses centres d’apprentissage, ses espaces de promotion et ses lieux de diffusion. La tradition littéraire y est marquée par un apprentissage obtenu dans des ateliers ou des universités dans lesquelles « l’écriture créative » occupe une place de choix. Aujourd’hui, plus de 800 centres académiques offrent cette formation en anglais. La langue espagnole n’est pas en reste ; un célèbre master en écriture créative existe depuis longtemps à Iowa City et bénéficie de l’apport du grand auteur salvadorien Horacio Castellanos Moya. D’autres jeunes étudient et obtiennent leur diplôme dans cette discipline à l’université de New York (la NYU) ou à celle d’El Paso au Texas. Des écrivains en herbe venus d’Amérique latine ou déjà résidents aux États-Unis suivent un cursus académique qui semble aujourd’hui nécessaire pour être pris au sérieux dans le monde littéraire de ce pays. Difficile de publier sans être passé par ces centres. En ce sens, l’écriture en langue espagnole s’inspire directement et sans complexe des processus mis en place pour la langue anglaise.
Géographie de la littérature chicanos
Les grands points géographiques où se développe ce « tissu littéraire » sont attendus et les lieux dominants sont : New York, Miami, Chicago et Los Angeles. Cependant, d’autres régions participent aussi à ce mouvement comme le Texas ou l’Arizona. Dans les grandes villes ont pu se monter et survivre des revues et des maisons d’édition qui représentent l’essentiel de la production littéraire écrite en espagnol aux États-Unis. L’augmentation de l’offre est frappante alors que la diffusion reste un point faible : les grandes chaînes de distribution ne laissent pas d’espace pour les textes écrits dans cette langue, mais cela va sans doute évoluer avec le temps. Les millions de possibles lecteurs constituent un argument de poids. Malgré les difficultés liées à ce type d’activité, on sent un grand optimisme dans les discours des animateurs de revue et de maison d’édition. Ils sont tous convaincus qu’ils sont les témoins privilégiés et les acteurs d’un nouveau boom littéraire hispano-américain qui ne fait que commencer.
Mariza Bafile dirige la revue ViceVersa à New York. Elle parle sans complexe de son activité qu’elle mène à bien malgré la crise du Covid qui a gravement affecté son économie. Mais sa revue sait traiter les sujets de société qui constituent les grandes préoccupations d’un Latino-Américain aux États-Unis. Elle ne s’enferme pas dans la création littéraire, mais donne un espace d’échanges entre des univers linguistiques qui se côtoient parfois sans se connaître. Les revues de Miami comme Nagari ou Suburbano sont plus impliquées dans l’écriture et même dans la vie culturelle en général. Franky Piña dirige le projet El BeiSMan à Chicago. Elle anime ainsi sa revue et la maison d’édition du même nom, lance des projets d’anthologie, intervient dans l’espace public, coordonne des ateliers d’écriture et des lectures. C’est de ce projet qu’est issu le terme de New Latino Boom pour décrire l’effervescence vécue dans cette littérature, la comparant au vaste mouvement qui a imposé les Lettres latino-américaines dans le monde dans les années 1960. Curieusement, la Californie, qui était autrefois le centre de cette littérature, a perdu de sa vitalité dans le domaine éditorial. En revanche, les auteurs qui y vivent ont un rôle capital comme la poète Vickie Vértiz ou Gris Muñoz, qui n’hésitent pas à passer de l’espagnol à l’anglais voire en ayant recours à des langues indiennes. La définition du champ littéraire par le choix du langage est moins ferme qu’autrefois : les plus jeunes auteurs jouent avec leur bilinguisme et leur double appartenance culturelle, sans contradictions.
Appartenance culturelle
Le rôle des femmes s’est grandement développé. Le nom de Sandra Cisneros est connu par les lecteurs de langue anglaise depuis longtemps : elle a commencé à publier des romans très marqués par sa propre vie dans les années 1980 et a touché un vaste public. Ces auteurs choisissent leur langue avec une plus grande liberté et si une Elizabeth Acevedo opte pour un anglais inspiré par son univers latino pour nous proposer des romans et des poèmes, une Melanie Márquez-Adams défend la langue espagnole avec force dans ses chroniques très drôles. La première vient de New York et du monde dominicain et est comme ancrée depuis son enfance dans la langue anglaise ; la seconde a émigré de l’Équateur déjà adulte, a étudié l’écriture créative à l’université de l’Iowa, et peut s’exprimer dans les deux langues. Le monde latino aux États-Unis, si dur à figer dans un concept précis, parfois appelé Latinex, exprime ses rêves et ses craintes, ses lubies et ses obsessions, dans des textes désormais écrits dans les deux langues, espagnol et anglais, ou entre les deux langues. Néanmoins, ceux qui sont rédigés en espagnol connaissent une circulation accrue et montrent à quel point une langue minoritaire arrive à s’imposer sans crainte ni complexe. Le défi est désormais dans sa diffusion. Les années à venir vont être passionnantes pour ceux qui s’intéressent à cette production.
À lire également
Les langues : enjeux indirects de la puissance. Jean-Yves Bouffet