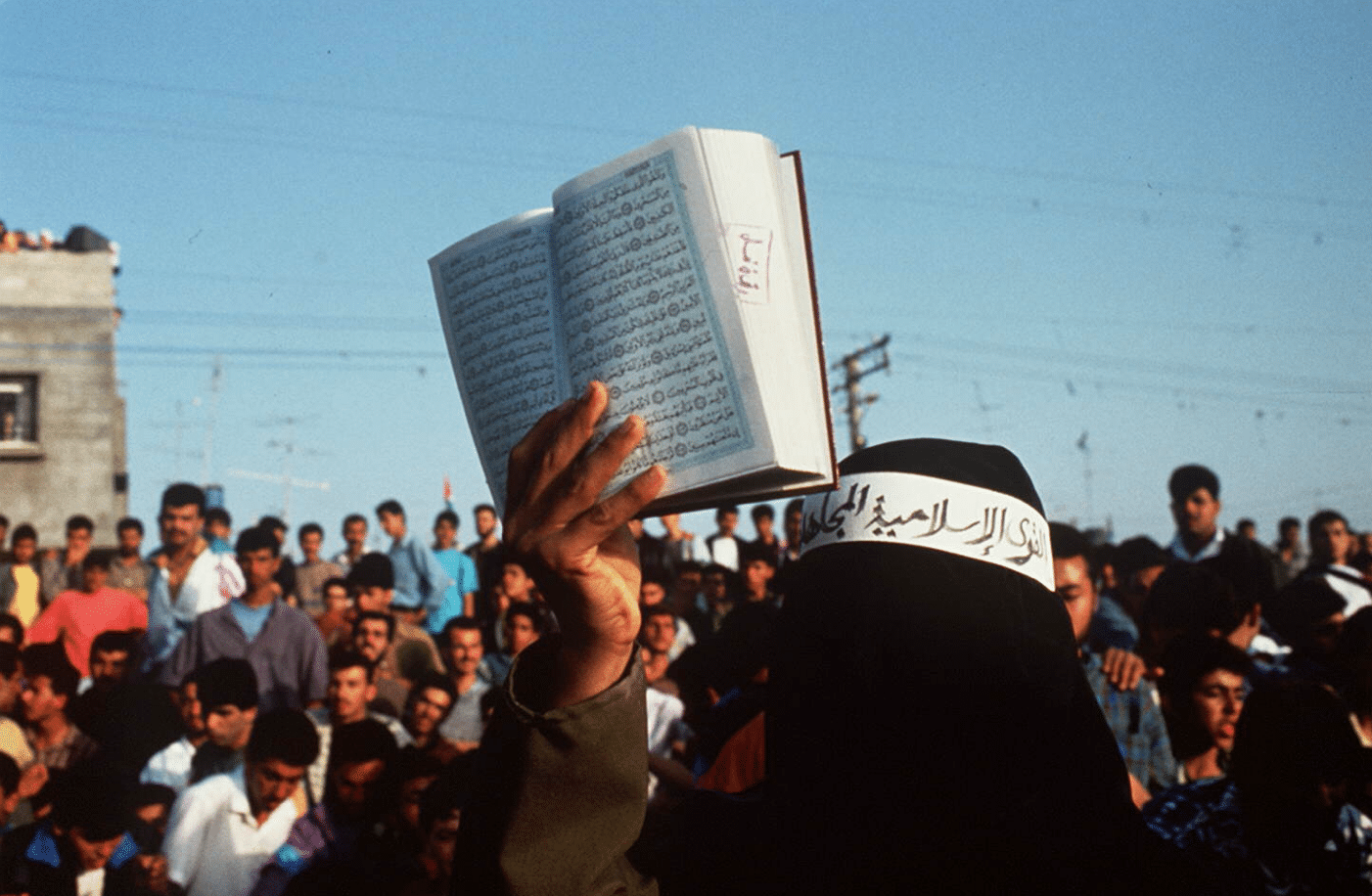À la faveur des attentats de 2001 puis de 2015, le djihadisme est apparu comme une menace que beaucoup d’analystes ont expliquée par le Coran et la religion musulmane. Souvent interprété comme un fait de guerre, il devient urgent de briser l’apparente cohérence du djihad et de comprendre l’origine d’un terme utilisé par quelques individus dont le fondamentalisme l’emporte souvent sur la raison.
Olivier Hanne est agrégé et docteur (HDR) en histoire. Chercheur à l’université de Poitiers, professeur à l’Académie militaire de Saint-Cyr Coëtquidan, il publie Djihad, un état des savoirs religieux, historiques et sociaux aux éditions Influences, fruit d’un colloque réalisé à l’École militaire en mai 2022.
Propos recueillis par Côme de Bisschop.
Au carrefour du droit, de l’histoire et de la théologie, l’interprétation du djihad oscille entre doctrine politique de la guerre et théologie de l’action vertueuse. Communément associé à « une guerre sainte », que dit vraiment le Coran et pourquoi l’interprétation du djihad n’est-elle pas unanime ?
Si l’on s’appuie uniquement sur le texte coranique et sans en faire d’interprétations, ce dernier ne permet pas de définir une doctrine militaire. Le Coran évoque bien sûr la guerre, et ce sous la forme de deux mots différents. D’abord harb qui signifie la guerre dans le but d’obtenir quelque chose, que ce soit un butin ou un pillage. La guerre est donc définie ici selon ses objectifs. Le mot harb n’implique pas la destruction d’un ennemi. Le second terme est qitâl qui consiste à tuer et combattre l’adversaire. La guerre est ici une modalité. Ainsi, comme dans n’importe quel texte religieux, le Coran évoque bien le phénomène de la guerre, mais dans des contextes différents d’un mot à l’autre, que ce soit pour défendre la religion, défendre les musulmans eux-mêmes ou attaquer les ennemis ; en bref, cela peut être autant offensif que défensif. Enfin, le mot djihâd apparaît sous 35 occurrences dans le texte coranique. La plupart du temps, malgré les difficultés sémantiques, djihâd signifie l’effort. Cet effort peut être douloureux, exiger un dépassement et entraîner une souffrance vécue pour soi-même ou envers les autres. Seules dix occurrences apparaissent explicitement dans un contexte militaire. Le terme s’inscrit ponctuellement dans une formule complète qui indique l’engagement militaire pour Dieu : « l’effort dans le sentier de Dieu » (djihâd fî sabîl Allah). Mais même dans ces contextes, une interprétation d’ordre spirituel ou moral ne peut être exclue : « Ceux qui ont cru, qui ont émigré et ont fait l’effort dans le sentier de Dieu avec leurs biens et leur personne auront les plus hauts degrés chez Dieu » (sourate 9, verset 20). Le Coran ne permet donc pas de définir ce qu’est le djihâd, quelles sont ses obligations et ses modalités. Il n’en existe pas de théorie claire dans le texte sacré, quand bien même celui-ci autorise des formes de violence armée. Ce sont en réalité les traditions ultérieures, notamment les textes juridiques qui, à partir du VIIIe siècle, ont élaboré des théories bien plus précises en réinterprétant des passages du Coran et en puisant dans les hadiths (les paroles du prophète), notamment le Livre des conduites militaires d’al-Shaybanî (mort en 805), qui est le premier écrit sur ce sujet. Ainsi, c’est surtout avec les années 800-850 que l’on a conçu une véritable doctrine, illustrée par un chapitre très connu des recueils de hadiths appelé : « Livre du djihâd et du comportement militaire ». Tout y est explicité : comment traiter l’ennemi, les prisonniers, les conditions de la guerre, les accords de paix, etc. Ce sont les juristes au service des califes qui ont théorisé le djihâd, lequel n’existe pas sous cette forme auparavant.
Comment le contexte historique participe-t-il à l’élaboration de la théorie du « djihad » comme une guerre contre l’ennemi, alors que celle-ci n’existait pas à l’origine au sein des textes coraniques ?
Cela s’explique principalement en raison de la formation d’un empire islamique. À l’époque de la théorisation du djihâd, les califes, successeurs de Mohammed, sont en lutte contre Byzance. Avec le XIIe siècle s’ajoutent les guerres contre les croisés puis au siècle suivant contre les Mongols. L’empire doit se défendre et trouve dans ses juristes des relais qui mettent en place une théorie au bout de laquelle on donne la promesse du martyr et donc du Paradis. Cela accompagne le recrutement des troupes envoyées sur les frontières de l’empire islamique et autorise les souverains à lever des taxes sur ceux qui n’iront pas combattre. Le djihâd est ainsi parfois devenu une forme de fiscalité. D’ailleurs, les juristes sont unanimes à poser comme première condition au djihâd l’obéissance au calife, car c’est lui qui déclare l’empire en état de « guerre sainte ». On voit même à la fin du XIe siècle des textes faisant du djihâd un sixième pilier de l’islam, ce qui est une innovation évidente. Ce concept finit par servir dans tous les contextes opportunistes, même dans l’islam : le chef sunnite Saladin s’en sert contre les califes fâtimides, chiites.
Une étude des grands lexicographes de langue arabe au Moyen Âge montre que le terme djihâd est utilisé avant le Xe siècle principalement pour parler d’un « effort » afin de se surpasser et d’accepter les souffrances. Ce n’est donc que progressivement que ce mot devient explicitement belliciste et agressif, suite à une interprétation des textes, sous l’influence des guerres contre Byzance puis les croisés. Le mot s’efface d’ailleurs au cours de l’époque moderne pour renaître au XIXe siècle dans le contexte de la colonisation, avant d’envahir le champ politique et médiatique après les années 1970.
À lire également
Le terrorisme djihadiste, l’ennemi absolu ?
Cette notion de « guerre sainte » souvent utilisée pour traduire le concept de « djihad » vient-elle ainsi d’une réinterprétation des califes à propos du Coran ?
On trouve certaines formes de violences légitimes au sein du Coran, mais la guerre n’est pas un concept en soi. La sourate 3 promet une « récompense » à ceux qui sont morts « dans le sentier de Dieu », mais le mythe des 72 vierges est absent du livre et ne se trouve que dans un hadith rapporté au IXe siècle et considéré comme faible. En outre, qui est l’ennemi ? Le Coran évoque les kufâr, c’est-à-dire les infidèles qui luttaient contre Mohammed. Mais les juifs et les chrétiens n’étaient pas inscrits dans cette catégorie à son époque. La difficulté réside dans le fait que certains passages du livre semblent contradictoires. Par exemple, les sourates 5, 9 et 47 sont très agressives : « Combattez ceux qui ne croient pas en Dieu ni au dernier jour » (9, 29). Mais d’autres passages inversent la proposition : « Pas de contrainte en religion » (2, 256). La sourate 5 déploie l’ensemble des règles strictes de la communauté musulmane contre les juifs et les chrétiens, puis soudain annonce le rejet de toute violence envers eux (verset 69) et l’exigence d’une excellence éthique entre tous les monothéistes (v. 48).
Les versets de paix et de guerre apparaissent bien au sein du texte coranique, mais sans guide d’utilisation. L’enjeu des califes a été de créer une hiérarchie entre eux. Leurs savants ont estimé par exemple que les versets de guerre l’emportaient sur les versets de paix, afin évidemment de justifier les mobilisations contre Byzance, mais le fameux « verset du sabre » que les juristes mettent en exergue n’est jamais défini précisément et sa référence suscite un désaccord. Ces interprétations mènent à des ambiguïtés. La tradition musulmane du Moyen Âge à nos jours propose des distinctions entre versets, des hiérarchisations et même des abrogations ; de même, un passage du Coran a en principe plus d’autorité qu’un hadith aux origines douteuses. Néanmoins, cette hiérarchie peut varier d’une école à l’autre, d’une université islamique à l’autre, selon le contexte géopolitique aussi. Les débats autour des réinterprétations du texte sont aujourd’hui très forts.
Les djihadistes endoctrinés se réfèrent aussi bien à un corpus religieux qu’à des périodes historiques comme les conquêtes du prophète. En quoi ces arguments sont en décalage par rapport au texte originel du Coran ?
Les djihadistes ne sont pas en décalage vis-à-vis de la tradition juridique médiévale des IXe– XIIe siècles. Ils l’observent en partie, même s’ils s’affranchissent régulièrement des éléments qui les gênent. Daech a utilisé des enfants, ce qui est explicitement interdit dans les recueils de hadiths. En outre, pour appuyer leur doctrine, ils piochent des morceaux de phrase coranique coupés de leur contexte. Par exemple, le doctrinaire Sayyid Qutb (exécuté en Égypte en 1966), avait justifié l’établissement d’un Etat islamique contre les infidèles par le passage : « La souveraineté (hukm) n’appartient qu’à Dieu » (12, 40). Or, cette formule s’inscrit dans un passage qui dénonce le manque de puissance des idoles ; il ne sert à rien de les prier, car elles n’ont pas de pouvoir (hukm), ce dernier n’appartenant qu’à Dieu. Ainsi, la sourate ne parle pas de politique. Il est donc essentiel d’appréhender les versets dans leur globalité, au sein des différentes sourates. Mais les djihadistes parviennent à convaincre à force de recomposition des références. Ils lisent le Coran comme si chaque mot, même détaché du reste, avait une valeur absolue ; ceux qui se refusent de les suivre se retrouvent ainsi en opposition au texte sacré. Le djihadisme n’est donc pas un retour au passé, mais un modernisme, une relecture radicale de l’islam, parfaitement intégrée aux problématiques contemporaines. Al-Zawahiri, le doctrinaire d’Al-Qaida, a plusieurs fois appelé les minorités des Etats-Unis (noirs, latinos, indiens) à se soulever pour la justice avec l’organisation terroriste. Et Daech de faire de même lors du mouvement Black Lives Matter. C’est pourquoi le djihadisme parvient à récupérer des individus qui sont en rupture ou ont des pulsions à caractère révolutionnaire. Le djihad serait la manière moderne et violente de « renverser la table » sociale et politique. Il y a cinquante ans, ils auraient été dans des groupes terroristes anarchistes ou trotskistes.
Souvent décriés en France comme des relais de la radicalisation, dans l’ensemble, les imams sont-ils lucides sur la réalité du texte ?
Globalement, aucun des 2000 imams de France ne peut défendre un discours radical sans être interpellé ou repéré. Même si certains ont une maîtrise incertaine de la langue française, la majorité d’entre eux se sont adaptés à la réalité du pays. Les prêches se font désormais en français. On évite de froisser à la fois les autorités publiques et les fidèles, qui vivent dans le monde réel et ne se privent pas de critiquer leurs imams. Même l’univers salafiste est complexe. Ce sont des individus qui exigent une pratique rigoriste et une rupture avec le monde environnant, chargé de toutes les fautes. Pourtant, il n’y a pas eu de « djihadisation » des salafistes. Alors qu’on en compte 40 000 en France, les salafistes représenteraient à peine 500 individus sur les 2 500 Français (approximativement) qui sont partis chez Daech (2013-2016). La radicalité de leur discours est évidemment gênante pour la République française, mais ils ont été à l’origine de nombreux signalements de candidats au djihâd qu’ils appelaient les « chiens de l’enfer ». En outre, les gouvernements du président Macron ont multiplié les fermetures de lieux de culte soupçonnés de radicalité, ce qui contraint les imams intégristes à modérer leur discours.
Le problème est sans doute plus global et concerne les lieux d’apprentissage de l’islam. Par exemple, l’Arabie saoudite est un pays qui effectue un immense travail de lutte contre le djihadisme, mais paradoxalement la grande université islamique de Médine propose des cours de droit médiéval, détaillant les règles sur l’esclavage, le djihâd ou encore la guerre contre le mécréant. Or, ces thématiques sont étudiées, non comme des faits historiques, mais comme des bases de toute législation musulmane. On enseigne aux étudiants la façon de traiter les esclaves et de les affranchir, alors qu’il n’y a plus d’esclaves dans les pays musulmans. À titre de comparaison, la Somme théologique de saint Thomas d’Aquin demande de mettre à mort l’hérétique (II II, Q 11, a 3). Bien sûr, n’importe quelle institution catholique enseigne l’œuvre en la replaçant dans son contexte. Ce sont ces nuances sur le texte et la formulation d’un apparat critique – les fameuses notes de bas de page – qui doivent encore beaucoup progresser dans le monde musulman.
À lire également
Penser l’ennemi à l’heure de la djihad academy
Le Coran est-il plus violent que les autres textes religieux ?
Les textes coraniques évoquent la violence, mais pas davantage que d’autres textes religieux. L’une des études que nous publions démontre que les passages à caractère violent représentent 2,1 % du texte du Coran, contre 5,3 % pour l’Ancien Testament. En outre, des études de sociologie quantitative soulignent que l’utilisation de références scripturaires violentes augmente selon deux critères : 1-le sentiment d’injustice sociale ou politique, et donc selon un facteur non religieux ; 2-la cohésion du groupe, c’est-à-dire qu’un collectif humain soudé a tendance à diminuer son empathie envers ceux qui n’y appartiennent pas ; c’est donc un comportement universel.
Si l’on prend le cas du christianisme, avant même son officialisation dans l’Empire romain, il fallut donner un sens à la violence de l’Ancien Testament. C’est l’exégète Origène (IIIe siècle) qui précisa que les guerres menées par le peuple juif n’avaient pour les chrétiens qu’une valeur allégorique. A la même époque, Tertullien refuse l’usage de la violence armée, sous prétexte que le Christ a désarmé Pierre au Jardin des oliviers (Jean 18, 11), mais certains groupes hérétiques justifient leurs violences par la phrase du Christ affirmant qu’il est venu apporter le glaive dans le monde (Matthieu 10, 34). L’affrontement intellectuel entre le littéralisme et le spirituel a été vivace dans le monde chrétien, et il l’est actuellement dans l’univers musulman où un lent travail de relecture est en cours. Cela concerne aussi la place à accorder au droit classique musulman – c’est-à-dire médiéval – qui n’est plus applicable en l’état. Cette volonté de changement est fréquemment évoquée sous des formes libérales, notamment la « charia du cœur », qui serait une manière éthique et non plus juridique d’être musulman. Même la Ligue islamique mondiale – longtemps support du salafisme saoudien – défend désormais une approche de la convivialité interreligieuse, et cela sous la pression du prince saoudien Mohammed Ben Salman. Mais après des siècles d’enseignement médiéval, les choses prendront du temps. Le mot djihâd pourrait ainsi retrouver son sens premier d’effort spirituel et moral, comme d’ailleurs l’interprètent depuis le Xe siècle les maîtres du soufisme, c’est-à-dire du courant mystique de l’islam.
Depuis le 11 septembre, les exemples d’actes terroristes au nom de l’islam se multiplient. Cependant, une approche scientifique et théologique de la question montre que la religiosité est souvent loin des intentions des terroristes. Comment établir une différenciation entre ce qu’on appelle le djihadisme et le terrorisme ?
Les spécialistes insistent sur le fait que le terrorisme n’est qu’un moyen d’action. Le but des djihadistes est généralement la mise en place d’un État islamique. En ce sens, le terrorisme est un moyen pour arriver à cette fin. Mais les projets ne sont pas toujours identiques. Le projet d’Al-Qaida visait cet État et la ruine des impérialismes occidentaux. Le projet de Daech reprend l’idée d’Etat, mais aussi de califat et de tension eschatologique, c’est-à-dire que le groupe accompagne la fin des temps. Le but n’étant pas identique, le terrorisme n’a pas la même fonction. Chez Daech, le terrorisme est à la fois une méthode et une voie, l’ultra-violence permet ainsi de séparer les bons des mauvais avant la fin des temps. Chez Al-Qaida, le terrorisme peut être abandonné s’il n’est plus efficace ou si le but a été atteint. Par exemple, les Talibans – longtemps liés à Al-Qaida – ont pris le pouvoir, installé l’émirat islamique, entendent devenir des gestionnaires et font désormais du contre-terrorisme contre Daech. Pour les uns le terrorisme est presque un but, pour les autres c’est un moyen.
Quelle place pour Daech dans le djihadisme contemporain ? Comment cette organisation islamiste a-t-elle réussi à légitimer une ultra-violence contre les ennemis de Dieu ?
Daech a développé une quasi-science de la justification de la violence. Le Coran se prêtant mal à ce jeu, les djihadistes sont allés chercher dans la jurisprudence médiévale ce dont ils avaient besoin. Ils ont surtout cité les textes du XIIe siècle, lorsque les juristes ont voulu redéfinir les textes de guerre en fonction des croisades. Ibn Taymiyya, le grand savant rigoriste mort en 1328, a été particulièrement cité par Daech. Par exemple, pour justifier les meurtres d’autres musulmans, il a fallu expliquer qu’ils n’étaient plus musulmans mais kufâr et que leur mort n’était pas une faute. Daech exploitant la tension eschatologique pouvait légitimer l’ultra-violence car, le monde allant vers sa fin, il n’était plus question d’être tiède, mais de choisir son camp.
Malgré l’opération Barkhane, le djihadisme continue de se développer dans le Sahel. Comment expliquer que cette zone géographique de l’Afrique soit un terreau fertile pour le déploiement du djihadisme contemporain ?
Il n’existe pas de djihadisme sans contexte. À aucun moment un groupe ne parvient à s’implanter dans la population sans raison. Il existe toujours en amont des fractures qui permettent aux djihadistes de s’implanter. C’est le cas du Mali : la région des Trois Frontières était particulièrement touchée par la pauvreté rurale, par les problèmes d’accès à la terre et questions climatiques qui décimaient les troupeaux. Ce sont exactement dans ces zones fragiles que les groupes djihadistes les plus violents ont réussi à s’implanter. Ainsi, la réponse sécuritaire est inévitable, mais sans une approche plus globale des problèmes sociétaux et économiques en Afrique, le problème ne pourra être réglé. Avant l’arrivée des djihadistes au Mali, il existait une multitude de groupes ethniques qui vivaient sans difficulté, même si les revendications des Touaregs au Nord étaient fortes. Les tensions ethniques ont commencé à grandir lorsque les djihadistes ont exploité les identités pour monter les communautés les unes contre les autres. Or, les rapports d’interrogatoires des djihadistes capturés au Nigeria ou au Mali montrent toujours que la première cause de leur engagement est la défense du village et de la famille, l’attraction pour un salaire, voire pour la force que représente le fusil d’assaut, mais la justification par la défense de l’islam ou du prophète vient toujours dans un second temps.
À lire également
Évolution du djihadisme et du terrorisme au Sahel depuis vingt ans
Qui doit se charger de lutter contre le djihadisme ? Ces derniers étant soutenus par des pans entiers de la population, leur démantèlement est-il impossible ?
Le problème sécuritaire ne peut être résolu sans les questions sociales et économiques, or cela prend au minimum une vingtaine d’années, à force d’investissements, d’infrastructures, de micro-projets ruraux, d’éducation aux droits, de mise en valeur des plus faibles, etc. Cette question bien sûr ne peut être réglée sans les locaux, car les étrangers peuvent aider à maintenir la sécurité, mais ils ne sont pas dans leur rôle pour définir comment doit évoluer la société malienne. Le Niger a beaucoup progressé de son côté sur les questions de stabilité rurale grâce à des lois sur la terre, sur le pastoralisme, sur les communautés touarègues, mais le pays profite pour cela des ressources en uranium sur lesquelles ne peut compter le Mali. L’opération Barkhane a fait son travail concernant sa mission sécuritaire, mais il apparaît difficile de dire aux opinions publiques européennes que nous allons investir des milliards d’euros au Sahel, surtout dans le contexte national actuel. Notons tout de même que le président Macron a doublé les fonds d’aide au développement – surtout en Afrique – en passant à 12 milliards d’euros.
Le djihad est-il en somme un moyen pour les musulmans de développer leur spiritualité ou bien une lutte pour la propagation de l’islam au sein des infidèles ?
Je suis plutôt optimiste. Dans leur écrasante majorité, les musulmans sont dans une optique morale et spirituelle. Certains États, conscient que les réalités de l’islam classique sont désormais inadaptées, ont choisi de nouvelles voies, mais leurs propres universités continuent d’enseigner paradoxalement le droit médiéval. Il y a là un hiatus qui est appelé à se résorber avec le temps, à moins qu’une crise géopolitique ne crispe à nouveau les relations avec les pays d’islam et ne paralyse ce mouvement de modernisation.