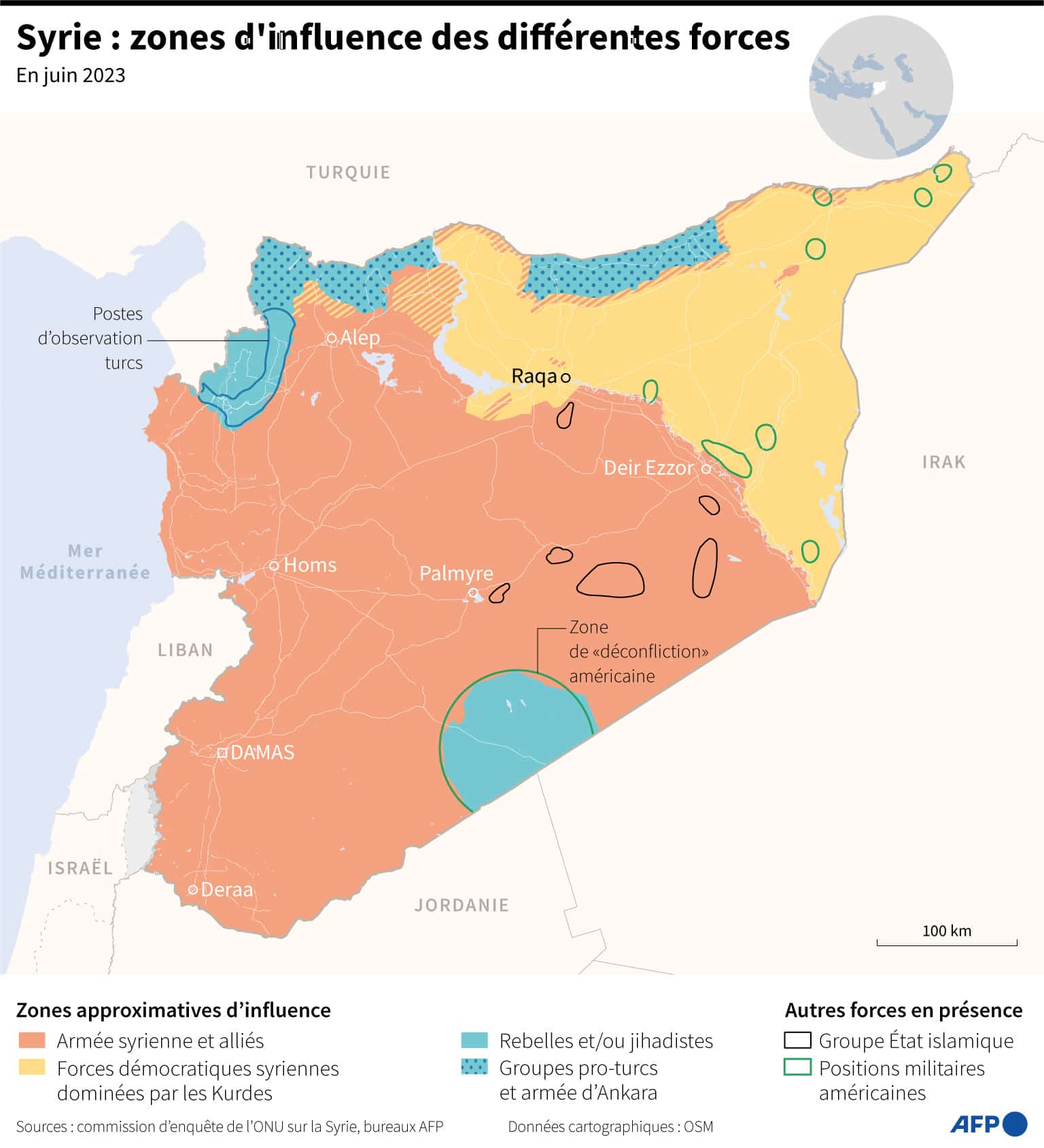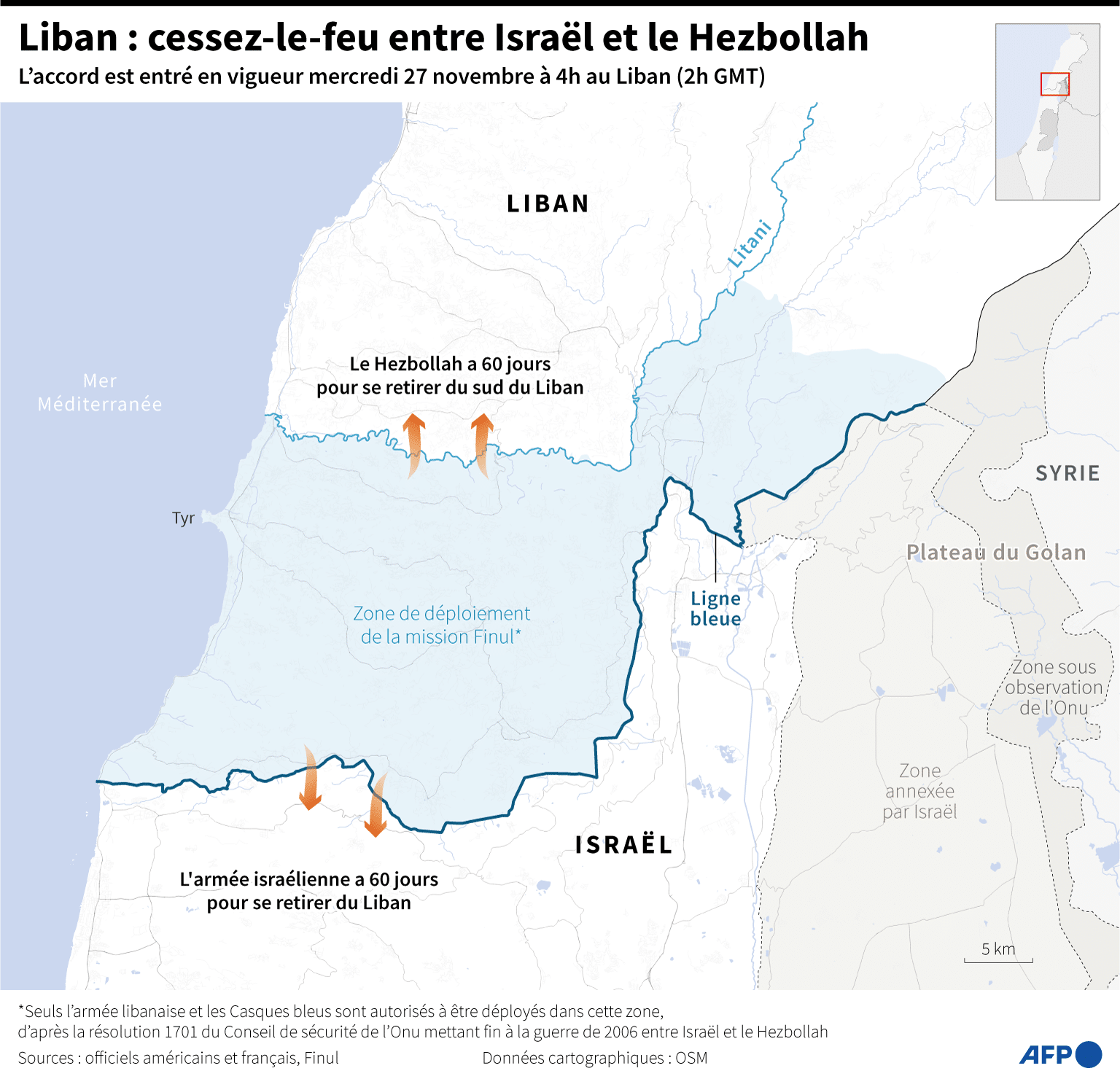La pensée stratégique moderne nous a habitués à raisonner en termes de défense et d’armées nationales reflétant l’adéquation, voire l’homologie entre le marché, la nation et l’État. Aujourd’hui toutefois, , est-il encore possible de parler de « défense nationale » ? Ne vaudrait-il pas mieux se tourner vers le concept d’ « autodéfense » ? Pour comprendre le sens de cette question et tenter d’y répondre, il faut s’intéresser à ce paramètre central du monde actuel qu’est le capitalisme. Donnons la parole à Fernand Braudel.
À lire également
Nouveau Numéro spécial : Regards sur la guerre
Dans ses travaux sur le sujet, le grand historien établit une distinction fondamentale entre capitalisme d’une part, et économie de marché d’autre part. Il relève que cette dernière est basée sur les échanges, qu’elle est relativement transparente et ouverte à tous : la valeur approximative des produits étant connue tant du vendeur que de l’acheteur, les prix ne peuvent pas faire l’objet de trop de spéculation. Ceci conduit à un certain équilibre dans les transactions et entre les acteurs. Il en va tout autrement du capitalisme. Si celui-ci se construit sur l’économie de marché, s’il en a besoin pour se constituer, il ne tarde pas à s’en détacher, voire à s’y opposer. Il n’entre pas dans le jeu des échanges, il crée sa propre dynamique d’accumulation et de spéculation fondée essentiellement sur la finance. Braudel expose ainsi que le capitalisme fonctionne en quelque sorte « à l’inverse » de l’économie de marché : il n’est pas fondé sur l’équilibre des prestations, il n’est ni transparent, ni ouvert à tous, mais opaque et réservé à une petite oligarchie d’initiés ayant un accès privilégié aux informations stratégiques permettant de maximiser les dividendes « au bon moment ». C’est le domaine des taux de change, de la bourse et des combinaisons financières. C’est en ce sens qu’il s’inscrit en opposition avec l’économie de marché : s’il se bâtit à partir de celle-ci, sa dynamique d’appropriation et de financiarisation prive ensuite celle-ci du capital nécessaire à son développement.
À lire également
La stratégie du terrorisme : le cas du FLN, selon Martha Crenshaw
Histoire d’une dissociation
En suivant l’analyse de Braudel, on comprend que cette dynamique a un caractère inexorable : lorsqu’elle parvient à se débarrasser des nations et de leur idéal égalitaire, plus rien ne l’arrête tel un gigantesque feu de forêt consumant tout sur son passage. Ceci explique la place centrale de l’explication braudelienne pour saisir la spécificité de notre époque et la dynamique à laquelle elle se trouve soumise.
Une des principales victimes de cette dynamique est l’État-nation. Avec la mondialisation, ce dernier est vidé de sa substance selon une dialectique de fusion des États et de fission des sociétés[1] . Il est absorbé par le Capital et les classes politiques nationales fusionnent avec l’élite financière globale dans une unique logique de profit. Braudel le rappelle en ces termes , « le capitalisme ne triomphe que lorsqu’il s’identifie avec l’État, qu’il est l’État ». Et il ajoute concernant les sociétés, « le capitalisme n’invente pas les hiérarchies, il les utilise » [2]. C’est le stade où nous sommes parvenus aujourd’hui.
Cette absorption-fusion de l’État et des classes politiques nationales marque une véritable rupture et signifie la disparition d’un cadre politique cohérent où pouvait s’exercer la représentation démocratique et les libertés citoyennes, d’un corps social structuré prêt à défendre son pays contre l’ennemi extérieur commun. Il y a ainsi remise en cause des piliers essentiels de la défense nationale. Le philosophe Paul Virilio le pressentait déjà dans les années 1970 lorsqu’il disait : « Les lois ne pérennisant pas l’ordre existant qui les fait adopter, il est certain que les démocraties ne survivront pas au flottement de la légalité dans le monde. La tangibilité d’un pouvoir encore partagé est sauvegardée par ses institutions, non par leur fonctionnement précaire, mais par leur simple existence. Que cet ultime barrage cède, alors le corps social tombera comme une masse informe de matière vivante … »[3]. De moins en moins d’instance et de plus en plus de substance déstructurée ; car dépourvue dorénavant d’un ennemi extérieur commun, cette masse informe de matière vivante ne représente plus une communauté politiquement organisée au sens schmittien (distinction ami/ennemi, intérieur/extérieur). L’absence de ce repère premier et la fin des grands récits fédérateurs (nation, révolution, modernité) enclenchent une lente, mais inéluctable dérive, une désintégration progressive où la menace est remplacée par le risque (du tabagisme au COVID-19 en passant par le réchauffement climatique), l’émotionnel prenant le pas sur le rationnel.
Revenons au capitalisme. D’une période industrielle (jusqu’en 1979), puis financière (jusqu’en 2008), on passe dorénavant à un capitalisme du désastre[4] se nourrissant de toutes les formes de crises – de la gestion de l’ouragan Katrina aux guerres protéiformes du Sud et, maintenant, du Nord (la métaphore du feu de forêt). En cela, on retrouve les thèses de Carl Schmitt et de Hannah Arendt, « l’économie de la dette transforme la „guerre civile mondiale“ en une imbrication de guerres civiles »[5]. En lieu et place d’une régulation structurée par l’État-nation (État-providence et suffrage universel), c’est donc la guerre qui se diffuse dans toutes les couches des sociétés sans plus aucun obstacle (émeutes, terrorisme, violence extrême, guerres des gangs). L’adéquation entre le marché, la nation et l’État vole en éclat.
La guerre au service du capital
L’analyse marxiste est celle qui insiste le plus sur la relation entre guerre et capitalisme, considérant que la première est le principal facteur de « régulation » du second. S’agissant de la fusion de l’État avec le Capital, elle avance ainsi queles guerres industrielles de masse de la première moitié du XXe siècle ont permis au capitalisme de prendre peu à peu le contrôle du secteur de l’armement d’abord via les différents complexes militaro-industriels nationaux puis de manière globale à partir des années 1980, avec l’apparition des armes de haute technologie et la Révolution dans les Affaires Militaires. Parallèlement, la fin des armées nationales de masse et l’avènement de forces professionnelles et privées ont permis au capitalisme de s’emparer définitivement de l’outil militaire étatique lui-même. La grille de lecture marxiste inclut la puissante armée américaine dans ce schéma : « L’expansion militaire correspond aux intérêts de la classe capitaliste transnationale. Le seul appareil militaire au monde capable d’exercer une autorité coercitive globale est l’armée américaine. Les bénéficiaires de l’action militaire américaine autour du monde ne sont pas les États-Unis, mais des groupes capitalistes transnationaux[6] »
Cette approche distingue ainsi trois phases[7] :
- la prise de contrôle de l’appareil de coercition étatique (armée, police) par le Capital
- le passage des guerres industrielles aux guerres « au sein des populations »
- l’utilisation des techniques coloniales de contre-insurrection contre les citoyens eux-mêmes (dérive pénale-carcérale).
En conséquence, si les instruments étatiques de la guerre et du monopole de la violence (armée, police) passent en main du Capital, la notion de défense nationale est elle aussi vidée de sa substance. La rupture entre l’État et la nation est consommée. Le Capital se sert en effet de ces instruments pour ses besoins de « régulation répressive » : plutôt qu’à un rééquilibrage des inégalités, on assiste à la coercition des populations tant du Sud (guerres néocoloniales) que du Nord (guerres antiterroristes, appareil sécuritaire, état d’urgence, étouffement de la démocratie). À l’heure actuelle, cette dynamique s’est élargie à l’ensemble de la planète, des bidonvilles du Sud aux banlieues hors contrôle du Nord. Le capitalisme étant devenu global, la régulation doit l’être forcément aussi. Mais, les mécanismes régulateurs-stabilisateurs mis en place en Europe avec l’État-providence (welfare) et le suffrage universel à la fin du XIXe siècle, puis au Sud avec les mouvements de libération nationale à l’époque de la décolonisation, sans oublier les brefs intermèdes de l’Aide au développement Nord-Sud et du crédit facile pour tous ont, complètement épuisé leurs effets comme l’indiquent pêle-mêle la crise financière de 2008, le Printemps arabe de 2011, le Brexit, l’élection de Donald Trump en 2016, le mouvement des Gilets Jaunes et le terrorisme islamiste, lui aussi en passe de devenir global. Les multiples guerres contemporaines, à la fois civiles et fractales, traduisent cette absence de régulation.
À lire également
Penser la stratégie. Entretien avec Martin Motte
Warfare States
Ce n’est donc plus au moyen de l’État-providence (welfare), mais au moyen de la guerre (warfare) que les élites globales tentent de maintenir un semblant d’ordre[8]. D’ailleurs, le maintien de ce dernier est traité comme une lutte contre-insurrectionnelle avec l’emploi de polices de plus en plus militarisées, la déclaration de l’état d’urgence, la promulgation de lois d’exception et la généralisation de la vidéo-surveillance. On parle à ce propos de la nord-irlandisation des sociétés européennes[9]. C’est dans ce sens que la pensée marxiste parle de la transition du welfare au warfare : les élites transnationales globales ayant captées les instruments du pouvoir étatique national, cherchent ainsi à gérer les inégalités par la coercition. La crise du COVID-19 va d’ailleurs accélérer l’avènement d’une nouvelle étape, celle du capitalisme de surveillance[10].
Il n’y a plus d’ennemi extérieur commun (donc plus de communautés politiquement constituées) et la violence n’est plus canalisée par la guerre inter-étatique. Elle se répand au niveau infra-étatique prenant la forme d’un continuum de guerres civiles. Dès lors, il y a, d’un côté, des « braves citoyens désarmés » qui paient docilement leurs impôts et que l’on prétend protéger et, de l’autre côté, un monde gris, criminel et féroce se finançant par différentes formes de trafic illicites – Banlieue 13 – et qui, pour sa part, met en œuvre les méthodes de guérilla développées en Irak et en Afghanistan.
Hier l’État, demain l’autodéfense
C’est dans cette optique de déstructuration, qu’il apparaît nécessaire d’abandonner la notion de « défense nationale » pour se tourner vers le concept d’ « autodéfense ». Laissons la parole aux philosophes Éric Werner et Elsa Dorlin.
Pour le premier, dans le contexte esquissé ci-dessus il n’y a plus de citoyens, mais des individus « nus », sans cité (polis). S’étant globalisée, celle-ci a perdu sa fonction politique. Werner rappelle en effet que la citoyenneté nécessite impérativement une polis au sens d’une communauté politique où les décisions peuvent être prises en commun. Cet homme nu n’a donc plus de statut et bien qu’il ne soit pas formellement un proscrit, le pouvoir autocratique (d’essence capitaliste, idéologique ou religieuse) le considère rapidement comme un criminel. C’est donc par rapport à cette absence de statut qu’il faut envisager non seulement la guerre mais aussi la défense, en particulier l’autodéfense. Or, en l’absence de citoyenneté, cette dernière ne peut être assimilée à la « légitime défense ». Werner s’interroge : ce citoyen sans citoyenneté peut donc être mis à mort tant pas la police, les mercenaires ou les gangs ? Mais il précise immédiatement : cet homme nu demeure néanmoins un animal politique capable d’action et, comme tel, capable de se défendre. Il rappelle à cet égard les propos d’Antigone (la dissidente idéaliste) à l’adresse de Créon (le tyran) : « Vous êtes vraiment mal placés pour parler de la loi. Car, les véritables hors-la-loi, c’est vous : vous qui ne nous protégez plus aujourd’hui de rien, alors même que vous étiez engagés à le faire. Vous qui avez tout trahi en faisant passer vos intérêts propres de caste avant l’intérêt commun. Vous avez peut-être encore la force pour vous, mais c’est vraiment tout ce qui vous reste. Vous êtes privés de toute légitimité. La légitimité est de notre côté, non du vôtre[11] ».
C’est précisément à ce stade qu’intervient la réflexion d’Elsa Dorlin. Dans son ouvrage, Se défendre, une philosophie de la violence, elle effectue une radiographie du concept d’autodéfense. Elle montre ainsi que c’est généralement une démarche du faible au fort et, plus encore, de celui ou celle qui est asservi et qui légalement n’a le droit ni de se défendre, ni de résister au pouvoir : « À ces corps vulnérables et violentables n’échoient plus que des subjectivités à mains nues. Tenues en respect dans et par la violence, celles-ci ne vivent et ne survivent qu’en tant qu’elles parviennent à se doter de tactiques défensives. Ces pratiques subalternes forment ce que j’appelle l’autodéfense proprement dite, par contraste avec le concept juridique de légitime défense[12] ». À partir de là, l’autodéfense apparaît à la fois comme une réaction de survie et de reconstruction de la personnalité : se défendre c’est exister ou, comme le dit Ortega y Gasset, « exister c’est résister ». Dès lors, avant de parler de son efficacité pratique, l’autodéfense est d’abord envisagée comme une voie pour retrouver le statut d’être humain, voire d’animal politique. Dorlin parle à ce propos d’une « éthique martiale de soi », c’est-à-dire des pratiques que l’individu désarmé et sans citoyenneté (femme, esclave) utilise pour se protéger physiquement des agressions. Elle en parle comme de « l’envers agonistique » de la légitime défense.
En l’occurrence, c’est l’exemple de la révolte du Ghetto de Varsovie qui illustre le mieux la démarche de la philosophe. Car, bien que sans espoir, cette action devient un véritable fait de culture : « Les gendarmes polonais, les SS et leurs alliés devaient désormais entrer dans l’enceinte du ghetto la peur au ventre et prendre conscience qu’ils y risquaient également leur vie, que chaque mort-vivant qu’ils croisaient, homme, femme, enfant, était un potentiel résistant en arme. Les appels à l’autodéfense et le lexique du champ de bataille, de la guerre, de la résistance armée qui les soutient, participent d’un processus de réhumanisation, comme un hommage aux vies du ghetto »[13]. En effet, quelque 750 combattants juifs équipés principalement de pistolets et de cocktails Molotov tiennent tête pendant trois semaines à plus de 2000 soldats allemands et supplétifs polonais appuyés par des chars et de l’artillerie. L’autodéfense permet semble-t-il de faire la différence !
À lire également
La guerre en ville. Stratégies obsidionales
[1] Formule empruntée à Ignacio Ramonet.
[2] Fernand Braudel, La dynamique du capitalisme, Paris, Arthaud, 1985, p. 68, 78.
[3] Paul Virilio, L’insécurité du territoire, Paris Galilée, 1976, p. 55.
[4] Cf. Naomi Klein, La stratégie du choc : la montée d’un capitalisme du désastre, trad., Montréal, Babel, 2008.
[5] Éric Alliez/Maurizio Lazzarato, Guerres et Capital, Paris, éditions Amsterdam, 2016, p. 28.
[6] Cité chez Benjamin Bürbaumer, Le souverain et le marché : théories contemporaines de l’impérialisme, Paris, éditions Amsterdam, 2020, p. 112.
[7] Cf. Guerres et Capital.
[8] Cf. Guerres et Capital.
[9] Cf. « Militaires et sécurité intérieure : l’Irlande du Nord comme métaphore », Cultures & Conflits, no 56, 2004.
[10] Cf. Shoshana Zuboff, L’âge du capitalisme de surveillance : le combat pour un avenir humain face aux nouvelles frontières du pouvoir, trad., Paris, Zulma, 2020.
[11] Cité chez Éric Werner, La légitimité de l’autodéfense : quand a-t-on le droit de prendre les armes, Sion, Xenia, 2019, p. 64.
[12] Elsa Dorlin, Se défendre : une philosophie de la violence, Paris, La Découverte, 2017, p. 15.
[13] Ibid., p. 66.