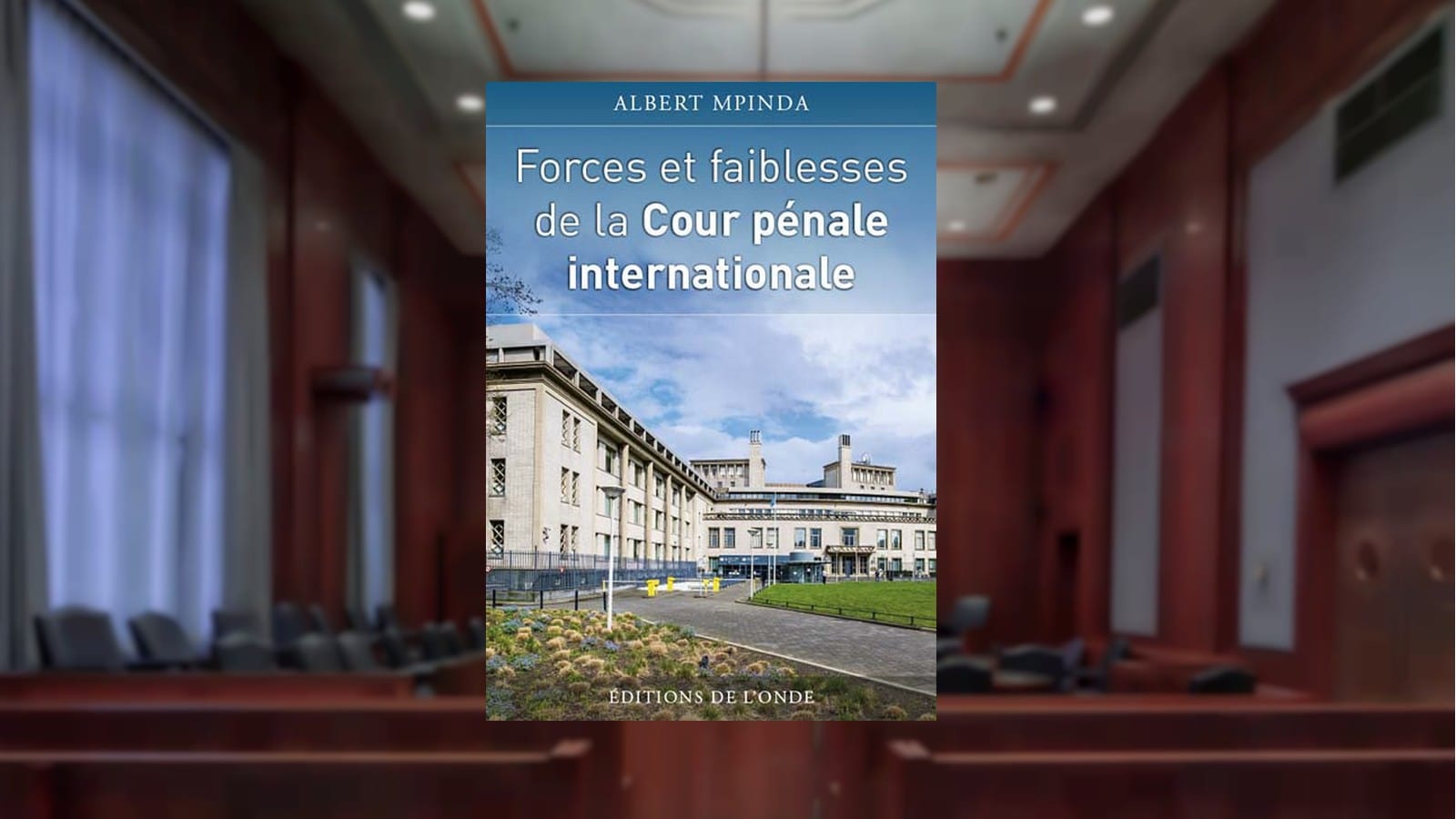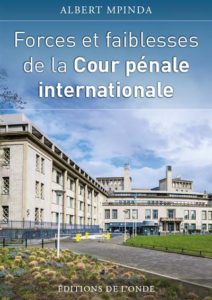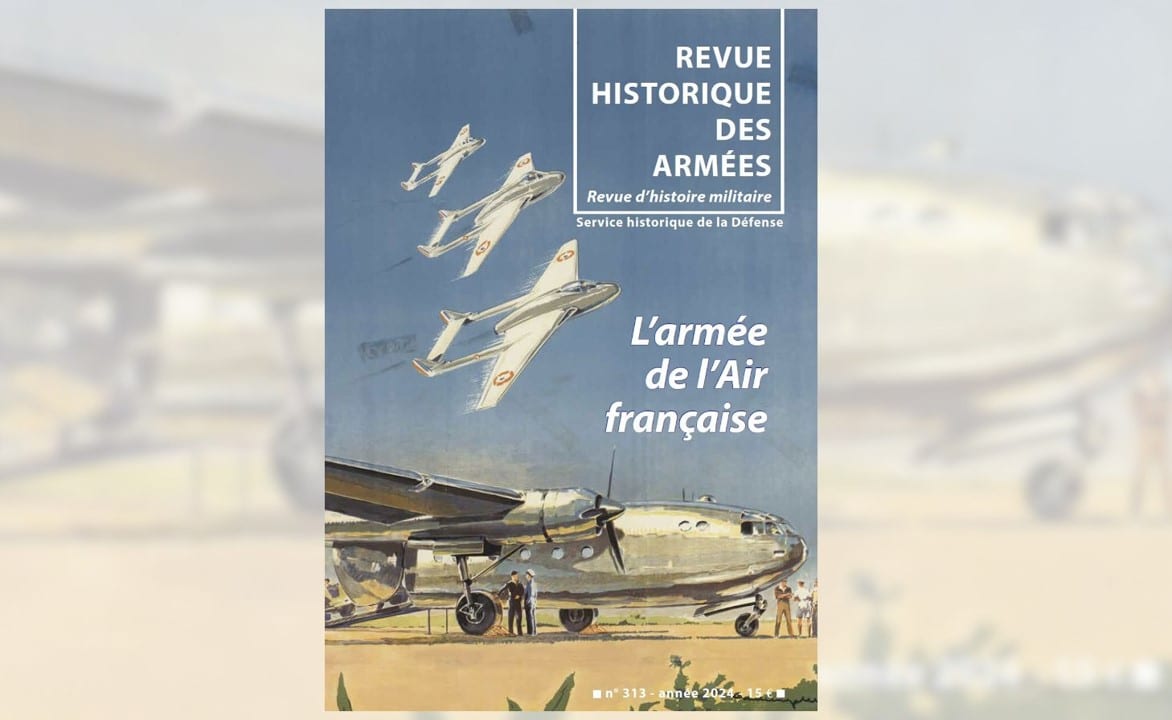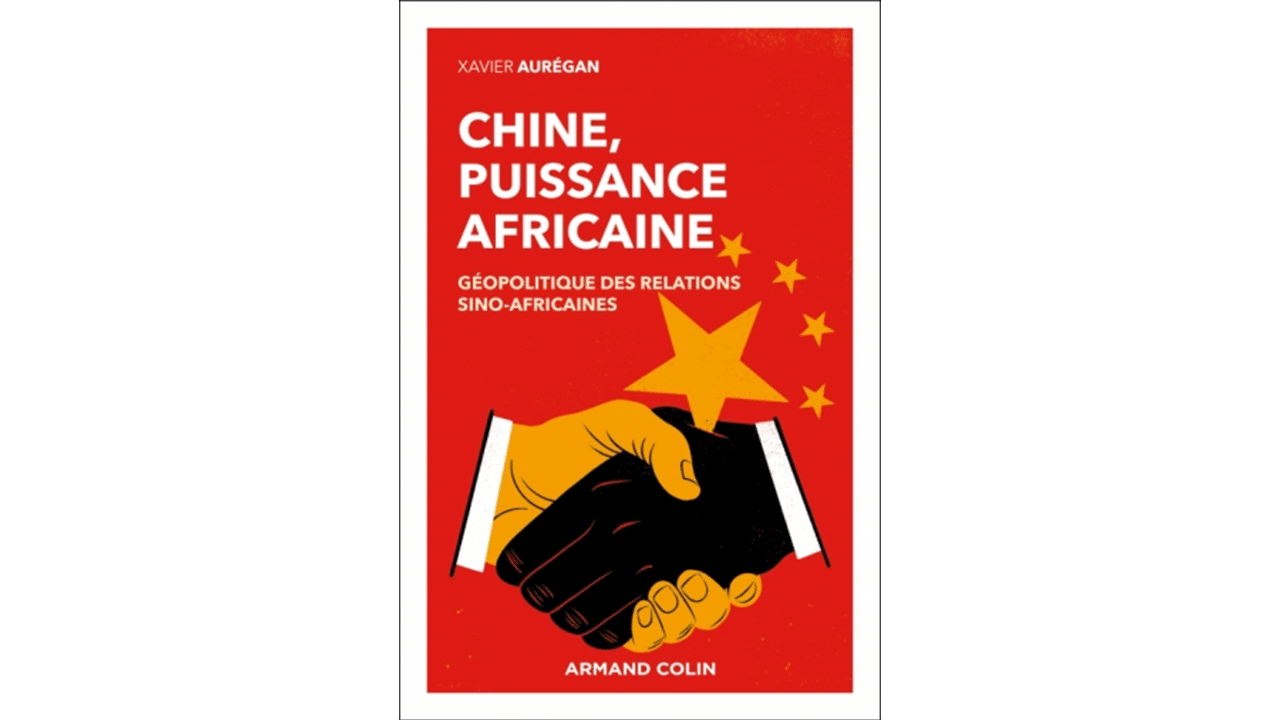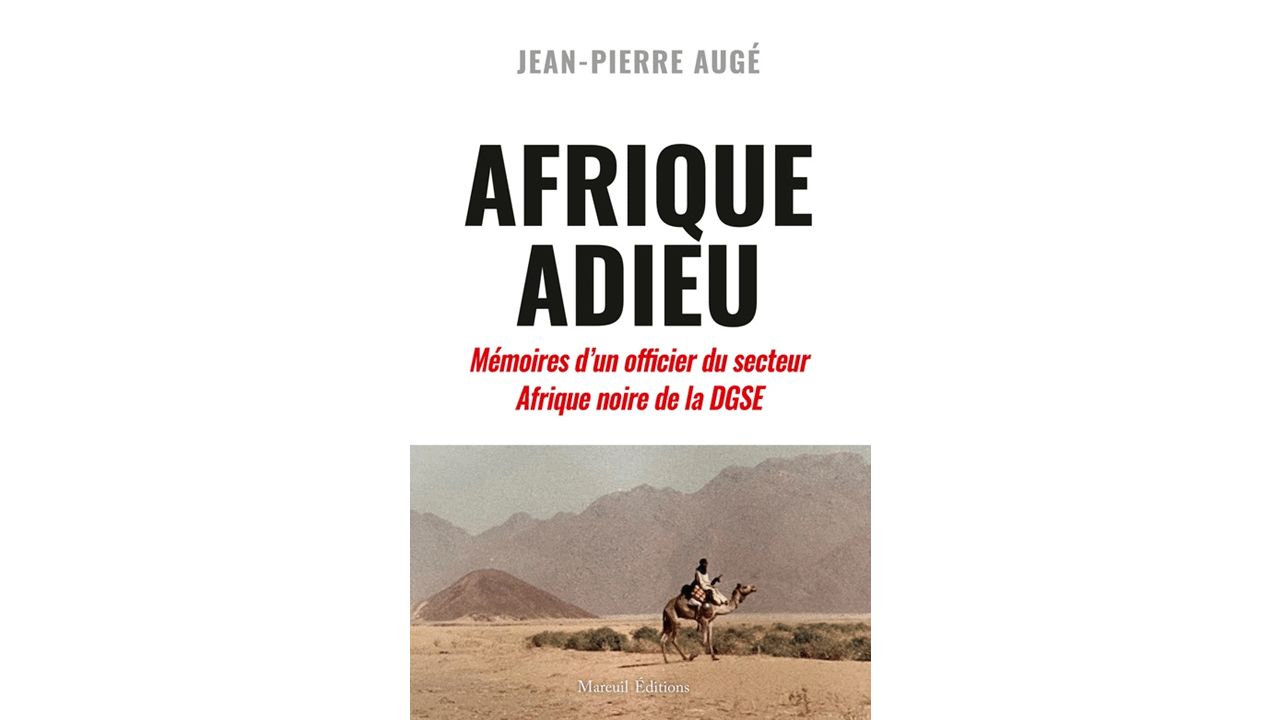La ratification le 11 avril 2002 par dix États du statut de Rome de la Cour Pénale Internationale, a porté à plus de 60 le nombre total des ratifications et permis par la même occasion l’entrée en vigueur de ce traité international le 1er juillet 2002. Ainsi après plusieurs attentes et laborieuses négociations, la CPI qui est le premier tribunal international permanent et de dernier recours est effectivement créée et peut commencer ses activités.
La création de cette juridiction unique en son genre constitue un essor incroyable pour la justice pénale internationale qui, après avoir connu plusieurs décennies de tergiversation, s’affirme aujourd’hui comme un élément important tant dans les relations internationales que dans le droit international.
Établir un droit humanitaire
La création de la Cour pénale internationale lors de la conférence diplomatique de Rome, le 17 juillet 1998, avait suscité beaucoup d’espoir. Aux lendemains des guerres civiles yougoslaves et du génocide au Rwanda qui avaient entrainé la création de deux tribunaux internationaux spéciaux, la communauté internationale décide de sauter le pas et de créer à la suite de ces tribunaux limités dans le temps et dans l’espace, une cour permanente et universelle. Ses promoteurs espéraient que grâce à l’effet de dissuasion de la Cour, le nombre de crimes à caractère international serait sensiblement réduit, car les forces et groupes armés engagés dans les conflits seraient plus sensibles à appliquer les règles et princes du droit international humanitaire. Force est de constater au vu des guerres civiles en Irak, en Syrie, au Yémen, et dans bien d’autres conflits que cela n’a pas été, loin de là, le cas. Aussi quinze ans après l’entrée en fonction de la Cour pénale internationale (CPI) une crise s’est installée. Les critiques les plus virulentes émanent des pays africains. En effet, la CPI a examiné 25 affaires depuis sa création et toutes ne concernent que des Africains, seuls les Africains ont été jugés par cette cour et sur les 11 enquêtes menées, une seule est ouverte en dehors de l’Afrique. Ainsi bon nombre des dirigeants africains accusent la CPI de partialité et d’appliquer les règles de la lutte contre l’impunité qu’en Afrique. Au fait, c’est depuis l’inculpation du président soudanais puis celle du président kenyan que l’UA s’oppose à la Cour, lui reprochant d’être l’instrument d’un « néocolonialisme » judiciaire. Cette opposition de l’UA à la CPI s’est traduite par le vote d’une première résolution par l’organisation africaine le 4 juillet 2009 qui porte sur le refus d’exécuter les mandats d’arrêt contre les dirigeants africains.
Une Cour contre l’Afrique ?
La crise étant devenue ouverte entre les deux institutions, l’UA rejettera lors de son quinzième sommet à Kampala en Ouganda en juillet 2010, la demande de la CPI d’ouvrir un bureau de liaison à son siège. Poursuivant sur la même lancée, les dirigeants africains vont adopter une deuxième résolution qui est non contraignante en octobre 2013 et qui appelle les États membres à ne pas coopérer avec la CPI « à cause de sa politisation et l’utilisation abusive des inculpations et les poursuites sans précédent engagées contre le Président et le Vice-Président en exercice au Kenya en rapport avec les événements récents au Kenya ». L’UA demandera à cet effet la suspension des procès du Président Uhuru Kenyatta et de son Vice-Président William Samoei Ruto, qui sont les dirigeants en service du Kenya jusqu’à la fin de leur mandat. Le continent africain est le plus impliqué, car sur les 123 États partis au statut de Rome, 33 sont africains. Finalement l’UA adoptera une stratégie de retrait collectif lors de son 28e sommet qui s’est tenu à Addis Abeba du 30 au 31 janvier 2017.
À lire aussi : Fixer les règles du monde…
Celle-ci n’a pourtant pas abouti, car seul le Burundi s’est effectivement retiré, l’Afrique du Sud et la Gambie s’étant ravisées. Par ailleurs, certains pays, comme le Nigéria, la Côte d’Ivoire, impliquée dans le procès Gbagbo, et le Sénégal se sont prononcés en faveur du maintien à la CPI. De fait, puisque les États-Unis, la Russie et la Chine n’ont pas adhéré à la CPI et peuvent par leur veto protéger pays amis ou clients c’est bien à une justice de « deux poids deux mesures que l’on a affaire. Reste à voir si les réformes proposées par l’auteur à savoir la saisine de la Cour pénale par l’Assemblée générale des Nations-Unies ou la Cour de Justice internationale seront de nature à remédier aux lacunes de la justice pénale internationale, surtout avec la montée des dirigeants autocratiques, des démocraties illibérales et la marée populiste. Chaque pays est tenté d’utiliser la justice pénale contre ses adversaires ou ses opposants, mais entend s’y dérober lorsqu’il est lui-même mis en cause. Malgré ces lacunes Albert M, reconnaît d’inconstatables vertus à cette justice pénale internationale encore jeune et peu ancrée dans les esprits. Elle a pu produire un effet dissuasif sur les États et sur bon nombre des seigneurs de guerres. Suite à son action, la lutte contre l’impunité est devenue une réalité et une norme en l’espace d’une vingtaine d’années même si elle reste souvent mal appliquée. Il faut reconnaître que ce soit en Afrique ou ailleurs, l’existence et l’effectivité de la CPI ont poussé certains États à ouvrir des procédures par crainte que la Cour intervienne sur leur territoire. Sa création a permis à de nombreux États de modifier leur Code pénal en pénalisant les graves crimes des masses.
Forces et faiblesses de la Cour de Justice internationale, par Albert Mpinda, Editions de l’Onde, 2019.