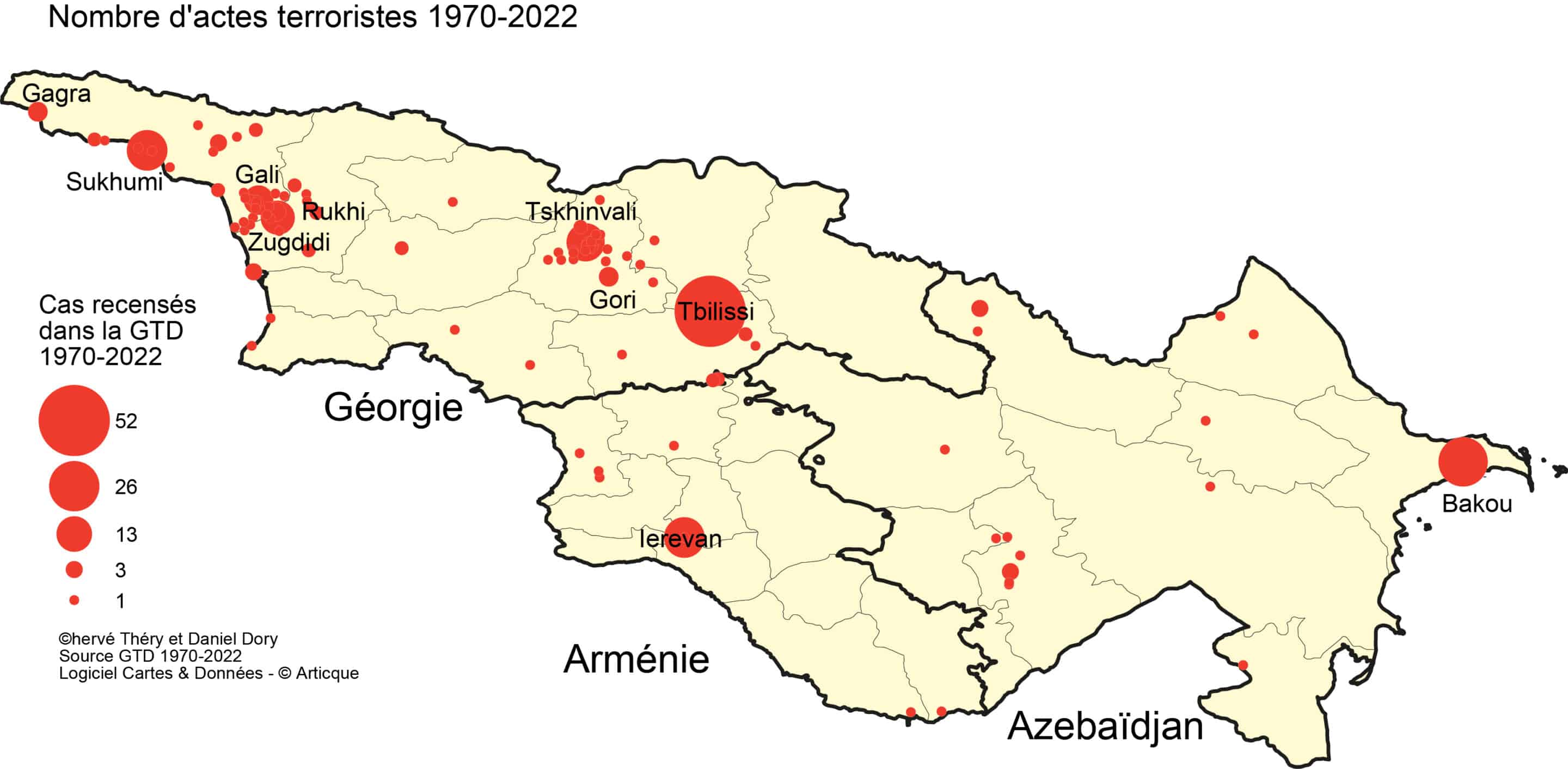En passe de s’implanter durablement sur le marché mondial du film, le cinéma sud-coréen s’apprête à devenir un véritable concurrent d’Hollywood. Soutenu par les pouvoirs publics, le septième art du Pays du matin calme rêve d’un avenir flamboyant. Entre soft power et potentiel économique de choix, le cinéma sera, sans aucun doute, un moyen de la puissance coréenne.
Comme pour célébrer dignement le centenaire de la naissance du cinéma sud-coréen (The Righteous Revenge, un kino-drama au titre fort explicite passe pour être le premier film du pays réalisé en 1919), 2019 restera à jamais dans les annales du cinéma mondial comme l’année Parasite.
Le succès viral interplanétaire et inattendu du film-gigogne de Bong Joon-ho (qui vient de ressortir en salles en version noir et blanc) semble consacrer une certaine « exception culturelle » sud-coréenne incarnée sans complexe par une « Nouvelle vague » talentueuse et désinvolte, bras armé d’un véritable « soft power » national qui tiendrait la dragée haute aux blockbusters américains à prétention hégémonique ainsi qu’aux productions envahissantes de l’encombrant voisin chinois. Après Hollywood et Bollywood pour l’Inde, on parle désormais d’ « Hallyuwood » (Hallyu signifiant vague coréenne) pour désigner le phénomène culturel (musique pop, séries TV) et cinématographique sud-coréen.
Quels sont les ressorts de ce petit miracle artistique et créatif mêlant à plaisir les différents genres cinématographiques et que nous révèle-t-il sur l’état réel de la société sud-coréenne et par ricochet ses connexions avec les mondes occidentaux ?
Ils se nomment Bong Joon-ho (Memories of Murder ; The Host ; Mother ; Snowpiercer ; Okja ; Parasite), Lee Chang-dong (Poetry ; Burning), Na Hong-jin (The Chaser ; The Murder ; The Starngers), Park Chan-wook (Old boy ; Lady Vengeance ; Stoker ; Mademoiselle), Kim Jee-woon (Deux sœurs ; Le Bon, la Brute et le Cinglé ; J’ai rencontré le Diable ; Le Dernier Rempart) , Yeon Sang-ho (Dernier train pour Busan) ou encore Kim Seong-hun (Hard Day, Tunnel) et sont devenus ces dernières années les coqueluches des différents festivals internationaux, récompensés pour leur audace graphique et scénaristique ainsi que leur faculté à inventer de nouveaux langages cinématographiques en digérant les grands classiques du cinéma mondial et en mixant intelligemment les genres : thriller, policier, film noir, drame social, comédie, fantastique, épouvante, érotisme… au point de se voir confier les rênes de plus importantes productions internationales (Snowpiercer ; Le Dernier Rempart) ou voir leur film d’origine connaître des remakes américains plus ou moins ratés au contenu forcément édulcoré (Old Boy de Spike Lee, Deux sœurs/ Les intrus de Charles et Thomas Guard… en attendant l’inévitable remake de Parasite ?).
A lire aussi: Coronavirus : la Corée a endigué l’épidémie sans confiner les villes
Le cinéma comme « soft power »
C’est peu dire que le pays du Matin calme (littéralement « Matin frais »), expression impropre que l’on prête aux missionnaires européens du XIXe siècle en référence à la longue période de prospérité de la dynastie Joseon (1392-1910), a connu un XXe siècle tragique et mouvementé : occupation japonaise de 1903 à 1945 et son cortège d’exactions et de violences, effets collatéraux de la Deuxième Guerre Mondiale immédiatement suivie par la fratricide guerre de Corée (1950-1953) et une traumatisante partition du pays, dictature militaire et répressive des années 1960 et 1970, modernisation du pays (futur « Dragon ») à marche forcée avec ses cohortes de laissés-pour-compte du miracle économique, crise financière asiatique de 1997, corruption et scandales politiques des années 2000… autant de marqueurs forts dans l’inconscient culturel et artistique d’une nation parfois vacillante, contrainte de se livrer à un lourd travail introspectif depuis plusieurs années.
Parce que la culture a très tôt été perçue comme un efficace instrument de « soft power » par les différents régimes successifs de Séoul, que ce soit durant la longue période autoritaire et nationaliste ou depuis le rétablissement de la démocratie à la fin des années 80, la production cinématographique domestique a bénéficié de puissantes lois protectionnistes destinées notamment à la protéger contre l’ogre américain.
Ajoutons à cela que depuis la décennie 1990, les artistes jouissent d’une certaine liberté d’expression créatrice, fort appréciable dans un pays asiatique aux rapports complexes avec le respect des libertés individuelles, tel que l’on peut l’entendre en Occident.
On se plait souvent à rappeler la fameuse phrase de l’ancien Président Kim Dae-jung (1998-2003) : « Offrez un soutien financier aux artistes, mais surtout n’intervenez jamais dans leur travail. Dès que le gouvernement interfère, les industries créatives se brisent. »
Et de soutien, il en est largement question dans un pays à la fibre nationale (nationaliste ?) prononcée. L’industrie cinématographique est ainsi fortement aidée depuis les années 90 par les chaebols, ces grands conglomérats sud-coréens (Daewoo, Hyundai, Samsung, CJ Group, Orion, Lotte) ainsi que par les fonds d’investissement et les sociétés de capital-risque, ce qui contribue aujourd’hui à faire du pays le cinquième producteur mondial de films.
Sans oublier le rôle proactif joué par le KOFIC (Korean Film Council), lancé en 1999 par le gouvernement et largement inspiré du système français (où l’on parle également beaucoup de la fameuse « exception culturelle ») afin de soutenir et promouvoir son cinéma sur le marché national et à l’étranger : bourses, subventions, soutien des activités de R&D, appui aux productions indépendantes et aux salles d’art et d’essai.
«Pas de culture, pas de pays », tel était le slogan marketing promu en 1995 par le géant de l’agroalimentaire CJ Group, lié à Samsung. L’ensemble du système d’acteurs locaux a bien intégré et retenu la leçon…
Une « Nouvelle vague » douée et inventive
Dans le sillage des illustres précurseurs qui ont ouvert la voie (et porté la voix) (Kim Ki-Young, Im Kwon-taek), la Corée du Sud peut se targuer d’avoir enfanté ces deux dernières décennies de nombreux talents dont les films, perspicaces, frais, originaux, authentiques et -plutôt- radicaux sont généralement mondialement salués par la critique et le public.
Ces cinéastes francs-tireurs, éclectiques et brillants, portent un regard à la fois poétique et sans concession sur l’état de leur société et au-delà du monde, tout en ayant assimilé les grands classiques du 7e art.
Leur terrain de jeu de prédilection consiste à dynamiter les genres et accoucher de nouveaux langages cinématographiques tantôt syncrétiques, tantôt disruptifs, toujours surprenants, a fortiori pour le spectateur ouest-européen qui n’est pas forcément habitué à ce maelström d’images et d’arcs narratifs.
Ce mélange des styles et des ambiances rendant compte à merveille du brouillage et de la porosité des frontières entre les notions de Bien et Mal, réalité/illusion, lumières/ ténèbres, civilisation/barbarie, « mainstream »/marges n’est pas sans rappeler le moment-charnière d’ébullition représenté par le Nouvel Hollywood outre-Atlantique du début des années 70.
Deux exemples évocateurs parmi tant d’autres avant de s’attarder plus longuement sur le magnum opus de Bong Joon-ho.
The Strangers est le chef d’œuvre inclassable et d’une durée hallucinante pour un film de genre (2h36 !) de Na Hong-jin (2016), déjà remarqué par ses déconcertants The Chaser et The Murderer. Son film, qui présente une certaine filiation avec le Memories of Murder de Bong-Joon-ho, propose des changements de ton délicieux mais déroutants, baladant sournoisement le spectateur hagard, entre thriller psychologique, conte macabre, film « ruraliste », drame familial, film de possession et de zombies et bien entendu féroce satire sociale.
Il réussit à digérer sans jamais plagier ni moquer quantité de films-étalons du genre (La Nuit des Morts-vivants de George Romero, L’Enfer des zombies de Lucio Fulci, L’Exorciste et Killer Joe de William Friedkin, Jeeper Creepers de Victor Salva, Cabin Fever de Elie Roth, Ring de Hideo Nakata et bien d’autres), tout en créant une œuvre personnelle, singulière et unique.
Mais qui sont alors ces « étrangers » contenus dans le titre du film ? Un mystérieux ermite japonais cristallisant la haine de tout un village, un chaman au look seventies dont les transes semblent engendrer la fabrication d’un remède pire que le mal qu’il est censé combattre ? Un jeune diacre catholique hésitant et faible ? Une jeune femme spectrale drapée de blanc insaisissable ? Féroce critique de l’effritement des institutions et valeurs de la société sud-coréenne (positionnement et rôle du père, du flic, propagation des superstitions villageoises et animistes, succès mercantile de breuvages miraculeux…), le film se veut une extraordinaire invitation à un voyage pluvieux, poisseux, boueux, purulent et méphistophélique qui finit par mettre le spectateur K.O. dont l’unique salut consistera à des visionnages répétés afin d’en saisir toutes les complexités.
Na Hong-jin réussit le tour de force dans son dernier acte de faire basculer son film dans une dimension métaphysique en abordant frontalement et sans complexe les grands thèmes nord-américains chers à Friedkin et Carpenter sur la propagation inexorable du Mal et sa radicalité absolue, en dehors de toute explication scientifique et rationnelle.
Autre film magistral, en apparence plus apaisé et éthéré qui aurait sans doute mérité la Palme d’Or à Cannes en 2018 (à la place d’Une affaire de famille du japonais Kore-eda au traitement plus classique et convenu…) l’incendiaire Burning de Lee Chang-dong.
Un temps ministre de la culture et farouche militant anti-dictature durant ses jeunes années d’étudiant, Lee Chang-dong, déjà réalisateur du magnifique Poetry, livre un thriller psychologique troublant et hermétique, posant patiemment les pièces d’un énigmatique puzzle sur un trio amoureux de jeunes adultes, aux personnalités très différentes, condamnés à une fin (forcément ?) tragique. Haemi est cette fille un brin aguicheuse, anciennement complexée par son physique et désormais esthétiquement refaite, passionnée par le mime et les jeux d’illusion (maudit chat qui n’apparaîtra jamais…) ; Jongsu, le grand garçon timide et sensible, fils d’un agriculteur violent envers les autorités, livreur à mi-temps et aspirant écrivain ; enfin Ben, le séduisant et magnétique Gatsby local dont l’arrogance et les signes extérieurs de richesse suscitent fascination et malaise…
Quelque part entre Claude Chabrol, François Truffaut, Louis Malle, Alfred Hitchcock, David Lynch et bien-sûr William Faulkner puisque le film est indirectement inspiré de sa nouvelle Barn Burning (L’incendiaire, 1939), Lee Chang-dong évoque les mystères du désir, les affres de la sortie de l’innocence juvénile pour l’entrée dans le ténébreux monde adulte tout en se livrant à une critique sociale et politique des plus acerbes : règne des apparences et des illusions, jeunesse déboussolée et velléitaire, frénésie d’une société d’hyperconsommation engendrant frustrations et exclusions, notamment dans une Corée des marges, périphérique et rurale, violence dans les rapports de classes, extrême sévérité des juridictions locales, obsession de l’invisible voisin nord-coréen, alertes sur un environnement naturel massacré…
Autant de thèmes corrosifs politiquement forts que l’on va retrouver dans l’opus désormais culte du multi-récompensé « King » Bong Joon-ho.
A lire aussi: Le cinéma patriotique russe sous Poutine
Fractures et panne de l’ascenseur social
« Il y a dans ce pays une fracture sociale » annonçait prophétiquement feu le candidat Chirac au cours de la mémorable campagne présidentielle de 1995. Le même constat est dressé avec froideur et fatalité mais aussi ironie et touches burlesques par le réalisateur de Parasite qui rappelons-le, a réalisé un cursus en sociologie à l’Université Yonsei de Séoul avant de se lancer dans le cinéma. Qui plus est, il est également le petit-fils du célèbre écrivain Park Tae-won, promoteur dans ses œuvres d’idéaux progressistes et communistes avant de passer carrément au Nord et de devenir professeur à Pyongyang après la partition du pays de 1950. Un héritage familial qui compte dans une carrière d’artiste et d’intellectuel.
Dans son film, deux familles archétypales, les richissimes mais engoncés Park et les sous-prolétaires mais rusés Kim apparaissent ainsi comme deux camps, deux blocs irréconciliables, vivant -c’est le cas de le dire- dans deux mondes très différents, condamnés à se « parasiter » mutuellement jusqu’à l’annihilation… s’il n’y avait cette mince lueur d’espoir final qui fait définitivement basculer le long-métrage dans une dimension de conte poétique et fantastique.
L’ensemble du métrage qui se veut puissamment métaphorique (ce mot est opportunément prononcé à plusieurs reprises par les protagonistes) est avant tout basé sur une série de contrastes (en termes de couleurs, odeurs [probablement jamais un film n’aura été aussi olfactif !], espaces, postures, vocables…). De nettes oppositions caractérisées qui ont l’apparence d’une fausse simplicité confinant à la caricature sociale.
Tout n’est que masques, impostures, faux-semblants et finalement affaires de perception(s). Impossible pour les spectateurs français que nous sommes de ne pas penser au cinéma d’Henri-Georges Clouzot et surtout de Claude Chabrol, notamment aux films Que la bête meure et La Cérémonie (influences directement revendiquées par Bong Joon-ho). D’aucuns citeront également le film séminal La Servante du pionnier et mentor sud-coréen Kim Ki-Young qui a inspiré toute cette nouvelle vague sud-coréenne, Affreux, sales et méchants d’Ettore Scola, L’Argent de la vieille de Luigi Comencini ou encore The Servant de Joseph Losey.
C’est cette radicalité dans la division des classes et dans l’exacerbation des rapports dominants-dominés qui a pu choquer en Corée certains spectateurs et surtout les autorités publiques à la sortie du film et même après le sacre cannois. Il convient de se souvenir aujourd’hui que le retour du réalisateur prodige dans son pays au printemps 2019 n’a pas forcément déchaîné l’enthousiasme parmi les autorités locales et les représentants du gouvernement qui ont cru trop bien saisir le message social de son brûlot !
Ce qui peut également déconcerter et brouiller toute lisibilité du message, c’est l’absence de solidarité entre les « pauvres/ opprimés » puisqu’on les voit se battre entre eux de manière véhémente, annulant toute lecture marxisante du film dans la mesure où la progression de la dialectique maitres-esclaves ne débouche pas forcément sur l’affranchissement du peuple travailleur et désaliéné, libéré de ses chaînes de servitude. Le réalisateur choisit de renvoyer dos à dos et dans les cordes tout le monde, riches, pauvres, ambitieux, frustrés, arrogants, dupes, madrés… D’où ce sentiment de résignation et de « tristesse » (au-delà de la « colère » c’est le mot employé le plus souvent en interview par Bong Joon-ho) devant une société définitivement bloquée et verrouillée.
La puissance symbolique du film réside justement dans la portée universelle du traitement de ces thématiques, ce qui est un marqueur fort de la majorité des œuvres réalisées par cette nouvelle génération sud-coréenne : bien qu’inspirées par des histoires ou faits divers locaux, les trames narratives de ces auteurs sont susceptibles de concerner les sociétés occidentales, plus que jamais proches cousines du Pays du Matin calme. Il est insolite et révélateur de constater que la Corée du Sud est parfois située dans la catégorie « sociétés occidentales » en termes de classement pour les indicateurs économiques et industriels.
Un même film aurait très bien pu être réalisé en France si l’on avait un Bong Joon-ho aussi talentueux et audacieux. La Corée du Sud… miroir grossissant des tares du système libéral et capitaliste mondialisé ?
Familles dysfonctionnelles et jeunesse fascinée par le dieu « Dollar »
Tout le cinéma de Bong charrie ces histoires de familles déstructurées, atypiques, dysfonctionnelles, frappées au cœur par la brutalité et le caractère discriminant et exclusif des mouvements accélérés de la société sud-coréenne, plus que jamais engagée dans la bataille mondiale de la compétitivité et de l’innovation économique et technologique.
La fascination pour l’Amérique matérialiste, dorée et hyper connectée (« le Dieu Wi-Fi »), la quête de la réussite individuelle coûte que coûte, l’ahurissante spéculation immobilière (ô combien palpable dans Parasite) ainsi que le manque d’empathie entre classes et entre individus sont clairement brocardés dans le film. Ces valeurs viciées entraînant d’importantes dérives paraissent à l’opposé du socle culturel et philosophique ancestral sud-coréen assis sur les diverses « voies de la sagesse » confucéenne, shintoïste, bouddhiste et taoïste.
On ne le perçoit pas forcément en Occident à l’heure de la K-Pop mondialement triomphante, mais 75% des jeunes coréens, chiffre hallucinant, disent souhaiter quitter la Corée pour aller vivre à l’étranger. Il y a ceux qui sont totalement largués par la modernisation à outrance du pays et le rythme « compétition non-stop » imposé par les « premiers de cordée » et ceux fascinés par une Amérique du Nord mythifiée, Eldorado des temps modernes tout en présentant l’avantage d’offrir un système social global plus souple, moins sévère, respectant davantage les droits des individus, contrairement à l’Etat omnipotent sud-coréen, trop perçu comme le Big Brother avide d’un contrôle permanent des foules. Rappelons que la Corée du Sud a le taux de suicide le plus élevé parmi les membres de l’OCDE (en moyenne 26 personnes sur 100 000, soit plus de 36 suicides par jour !).
C’est un peu la face sombre de cet Hell Chosun comme disent ces jeunes en guise de mépris pour qualifier cette société honnie, en référence à la dernière dynastie coréenne féodale hyper hiérarchisée et sclérosée, dans laquelle seul le rang importait au-delà donc des compétences et aspirations des individus. Déjà l’introuvable ascenseur social…
Film foncièrement politique, Parasite, au-delà de toutes les récompenses glanées dans les plus belles compétitions mondiales, a réalisé l’exploit de faire bouger le gouvernement coréen sur le mal-logement et l’insalubrité sociale, dans la mesure où Séoul a décidé d’octroyer une aide financière conséquente à chacun des 1 500 ménages du pays qui vivent dans des logements de ce type (financement de travaux permettant d’améliorer l’éclairage et la ventilation mais aussi l’isolation des murs durant les périodes d’inondations, particulièrement fréquentes durant l’été). D’après les chiffres officiels, près de 383 000 appartements similaires à celui des Kim, mis tristement en lumière dans le film, seraient occupés par des familles « précaires » ou des étudiants. Bong… futur ministre à l’instar d’un Lee Chang-dong ? Attendons un peu.
Urgence écologie !
C’est un doux euphémisme que de prétendre que le cinéma de Bong développe une conscience écologique prononcée. De la description d’un monde absurde « glacé » post-apocalyptique acculant les rares survivants à (sur)vivre dans un train roulant continuellement (Snowpiercer) à la créature mutante issue des déchets radioactifs de l’armée américaine (The Host), au gros cochon sympathique nourri aux hormones par une multinationale américaine (encore !) avide de business en dehors de toute éthique (Okja) et jusqu’au déchainement des éléments climatiques dans Parasite (pluies, inondations, tonnerre, tempêtes), Bong se mue en grand lanceur d’alerte (imprécateur ?) des catastrophes à venir…
Il n’est d’ailleurs pas anodin de constater que le Ciel se déchaîne lorsque la famille « parasitaire » pense pouvoir sereinement profiter de la villa des riches, se soûlant dans le salon en regardant, tel un spectacle grandiose, les éclairs à travers l’immense baie vitrée transparente. C’est justement à ce moment-là, sous une pluie battante, que sonne à la porte l’ancienne gouvernante dans le but de se rendre à la cave de la propriété en invoquant de mystérieuses raisons. Ce qui fait ipso facto basculer le film dans une autre dimension, beaucoup plus ténébreuse et violente, et accélérer la dynamique narrative.
Une fois de plus, les hommes, riches ou pauvres, ne peuvent rien face aux éléments irrationnels naturels dont le rôle sera peut-être de rétablir in fine un nouvel ordre social, fût-il post-apocalyptique.
Apocalypse ou pas, la Corée du Sud, dans sa version « ciné », ferait peur à Trump himself ! « Ils nous tuent dans le commerce, vous savez, puis ils remportent l’Oscar pour un film flippant ! » aurait tonné le Président américain le soir de la fameuse cérémonie hollywoodienne. Comme il paraît loin le temps où un Kim Youg-sam, alors à la tête de l’Etat sud-coréen se pâmait devant le succès phénoménal de Jurassic Park (1993) du golden boy Spielberg en faisant remarquer que les recettes du film équivalaient à la vente de 1,5 million de voitures Hyundai. D’où la décision immédiate de transformer le cinéma du pays en véritable arme économique.
Alors 27 ans plus tard… Bong Joon-ho, serait-il le futur Spielberg d’un pays, actuellement au 12e rang mondial (PIB), qui n’a peut-être pas fini de surprendre son monde en continuant à enfanter des œuvres authentiques et fortes à l’impression de « jamais vu » ?