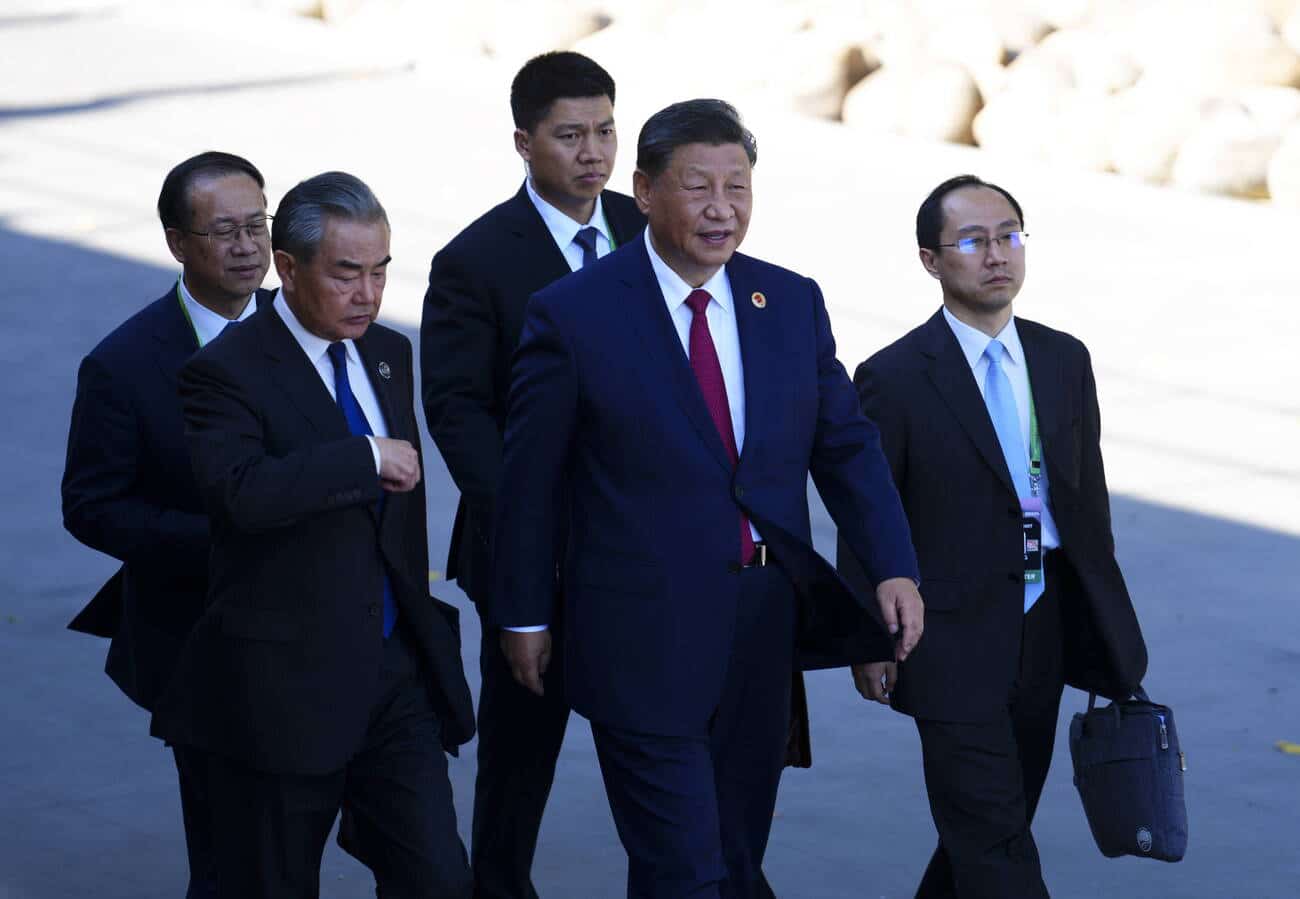En 2016, Gérard Chaliand publiait Pourquoi perd-on la guerre? Un nouvel art occidental [simple_tooltip content=’Gérard Chaliand, Pourquoi perd-on la guerre ? Un nouvel art occidental, Éditions Odile Jacob, 2016.’](1)[/simple_tooltip]. Conflits en a rendu compte. Nous lui avons demandé à quelle condition les pays occidentaux pouvaient rompre cette fatalité.
Tout d’abord, l’Occident doit-il faire la guerre ?
Si l’on analyse les guerres des dernières décennies, la réponse serait plutôt non. S’agissant de la guerre de Libye nous avons créé un chaos considérable qui s’étend jusqu’au Sahel où nous contenons l’ennemi, sans vraiment gagner. En Afghanistan, le président Trump voulait retirer ses troupes; ses généraux l’en ont dissuadé, ils l’ont même persuadé d’envoyer quelques renforts. Pour gagner? Non, pour empêcher les talibans de gagner. Quant à la guerre en Irak, on en voit tous les résultats. Avoir marginalisé les sunnites qui constituaient l’épine dorsale du pays, les avoir exclus de l’administration et de l’armée, c’était une erreur incroyable.
Le plus important en stratégie est la compréhension de l’adversaire. Mettez-vous dans la peau d’un sunnite. Des troupes arrivent, elles font de moi un étranger dans mon propre pays, elles mettent à ma place des chiites que je considère comme des hérétiques et que je méprise, des Kurdes que j’ai toujours combattus. C’est de ce ressentiment qu’est né Daech.
C’est une cause de nos défaites sur laquelle vous insistez: ne plus chercher à comprendre l’adversaire.
Oui, on l’a vu en Afghanistan. Après leur victoire de 2002, les Américains ont pensé qu’il suffisait de sécuriser Kaboul et de capturer Ben Laden. Il leur a fallu dix ans pour le trouver! Entre-temps, les talibans ont reconstitué leurs forces.
Comprendre l’ennemi est essentiel. Nous le faisions autrefois parce que, quand nous envoyions des troupes à l’étranger, elles y restaient. Aujourd’hui, elles tournent, elles ne s’enracinent pas. Un général américain expliquait ainsi l’échec de son pays au Vietnam: les États-Unis n’y ont pas mené la guerre pendant 8 ans, ils ont fait la guerre 8 fois pendant un an. À chaque fois les GI’s retournaient au pays et étaient remplacés par d’autres.
Pourtant dans quelques cas les Occidentaux ont gagné des guerres insurrectionnelles. La Malaisie par exemple.
Oui. Les Britanniques se sont montrés assez fins pour dire aux notables malais: nous vous accorderons l’indépendance dès que vous nous aurez aidés à nous débarrasser des rebelles, la minorité communiste au sein de la minorité chinoise. Elles ont eu leur soutien. Par ailleurs, les troupes britanniques étaient là depuis des années, elles savaient qui est qui, elles menaient une guerre «correcte» qui respecte la population, elles ne pillaient pas, elles ne représentaient pas une administration corrompue et inefficace.
C’est un point essentiel, regardez les hommes que les Américains ont amenés dans leurs bagages comme Hamid Karzai en Afghanistan. Nous nous sommes trop souvent appuyés sur des régimes corrompus. C’est une clé d’explication majeure de nos échecs.
Et le rôle des combattants?
Une autre erreur est de se reposer principalement sur la technologie, qui va de pair avec le refus des pertes au sol. Nous n’en sommes plus à la théorie intenable du «zéro mort», mais nous ne sommes plus capables d’encaisser des pertes comme à l’époque du Vietnam. C’est un élément totalement neuf, la dimension sociale de la stratégie. Nos pays vieillissent, leur part dans la population mondiale régresse et l’opinion en est plus ou moins consciente. Faire la guerre, c’est exposer un bien qui se raréfie, notre jeunesse. Un autre aspect de cette dimension sociale de la stratégie est le rôle croissant de l’opinion. Cette dernière ne supporte pas les guerres qui s’éternisent. Toute guerre qui dure est perdue. Elle coûte en argent, en hommes éventuellement, en prestige. Et les guerres que nous menons ne paraissent pas vitales à nos concitoyens. C’est toute la différence avec Israël: ce dernier ne peut pas se permettre de perdre, les Israéliens le comprennent. Ils savent que rien n’est pire que d’être vaincu. Si vous me demandiez ce que j’ai appris au cours de ma vie, je dirais une chose: il ne faut pas être vaincu.
À l’inverse, aucune erreur n’a été fatale aux Américains. Ils n’ont jamais senti la tragédie de la défaite. La tragédie c’est fait pour les autres, cela se regarde à la télévision, cela n’est pas pour nous. Pour gagner les guerres, il faut retrouver ce sens du tragique qui interdit l’idée même de défaite, d’anéantissement.
Gagner la guerre, c’est donc d’abord affaire de mentalités.
Oui. Aujourd’hui nous sommes dans la victimologie. Le statut de victime devient envié et âprement disputé. On nage dans un magma de sensiblerie. Et cette tendance victimaire est suicidaire, elle nous désarme. Lorsqu’une dizaine de soldats français sont morts dans une embuscade en Afghanistan, le président de l’époque leur a rendu hommage en disant qu’ils étaient des victimes. Mes amis des forces spéciales m’ont fait part de leur indignation. Ce n’était pas des victimes, mais des combattants.
Peut-on faire quelque chose contre cette tendance?
Il faut des guerriers. J’ai beaucoup d’admiration pour Léonidas. Il faut des gens pour défendre la cité. Heureusement il y a toujours des jeunes, garçons ou filles, qui ne veulent pas d’une vie de sécurité. Il faut encourager cela, vous et moi y participons. Une phrase m’a frappé, quand Lyndon Johnson avait trouvé «humiliant» d’être tenu en échec par des petits Vietnamiens en pyjama. Ils ne maîtrisaient peut-être pas les technologies les plus élaborées de l’époque. Mais en capacité de souffrance, il n’y avait pas mieux. Et ils tenaient. Voilà ce que sont les vrais guerriers.
Ne faut-il pas revenir à Clausewitz: «le militaire est soumis au politique»?
En effet, le but de la guerre est d’établir une paix plus favorable. C’est l’ABC intelligent de la stratégie. Mais cela n’est pas si pratiqué que l’on pourrait le croire.
Regardez au Vietnam. Régulièrement le général Westmoreland annonçait que la victoire était à portée de main, grâce à la supériorité technique des Américains, en particulier leurs hélicoptères. Mais il partait de prémices fausses: il voyait dans les combattants vietcong des communistes alors qu’il s’agissait ausside nationalistes; il les croyait soumis à la Chine; il pensait qu’un échec déclencherait la victoire du communisme dans toute l’Asie du SudEst. Trois prémices fausses, un record. Il aurait mieux fait d’opérer une analyse politique dépassionnée. Robert McNamara a reconnu plus tard qu’il ne connaissait rien au Vietnam et qu’il se reposait trop sur la technologie. Il a au moins ce mérite de la probité intellectuelle.
Prenons un cas concret. qu’aurions-nous dû faire contre daech?
D’abord ne pas l’alimenter par les mesures anti-sunnites dont nous avons parlé.
Ensuite ne pas le laisser faire. Daech a pu redéployer ses troupes d’Irak à Racca en Syrie, puis se déployer vers le nord de l’Irak en traversant de vastes territoires désertiques où tout mouvement est immédiatement détecté du ciel ou de l’espace. On n’a pas réagi alors que des bombardements intensifs sur ses colonnes les auraient dispersées. Daech a pu alors attirer des volontaires du monde entier, je les estime à 20000. Ce succès que nous avons laissé faire, il a fallu trois ans pour le détricoter.
Pourquoi ce laisser-faire?
Parce que nous n’avions pas de politique sérieuse. Obama voulait avant tout se désengager du bourbier irakien. Les Français auraient pu le faire avec leur aviation, mais ils ne sont pas intervenus. De peur d’aider Assad? Parce que nous n’avions pas le soutien américain? C’est une erreur, la victoire doit être déniée à l’adversaire.
Ensuite Daech mène une politique inédite à l’époque contemporaine. Il pratique la terreur la plus sauvage de la façon la plus spectaculaire. Et nous avons laissé se diffuser ces images au risque de rendre la population de plus en plus craintive. Quand on est en guerre, comme l’a proclamé François Hollande de façon d’ailleurs excessive, il faut pratiquer une censure de guerre.
La vérité est que le terrorisme ne représente rien. La probabilité que vous et moi mourrions dans un attentat est nulle. C’est quand on traverse la rue qu’il faut se méfier. Ce qui m’inquiète c’est le travail de sape qu’ont entrepris divers acteurs islamistes pour créer les conditions d’un «eux» et «nous» qui est mortifère. Mais il s’agit d’un autre type de guerre.
Et cette guerre, comment la gagne-t-on?
Je n’ai pas de recette miracle, mais elle ne peut pas être gagnée si l’on a peur des mots.
Résumons. Pour gagner les guerres, il faut changer la politique, changer la société, changer la stratégie militaire. Vaste programme…
Oui, vaste programme. À condition d’avoir une volonté.