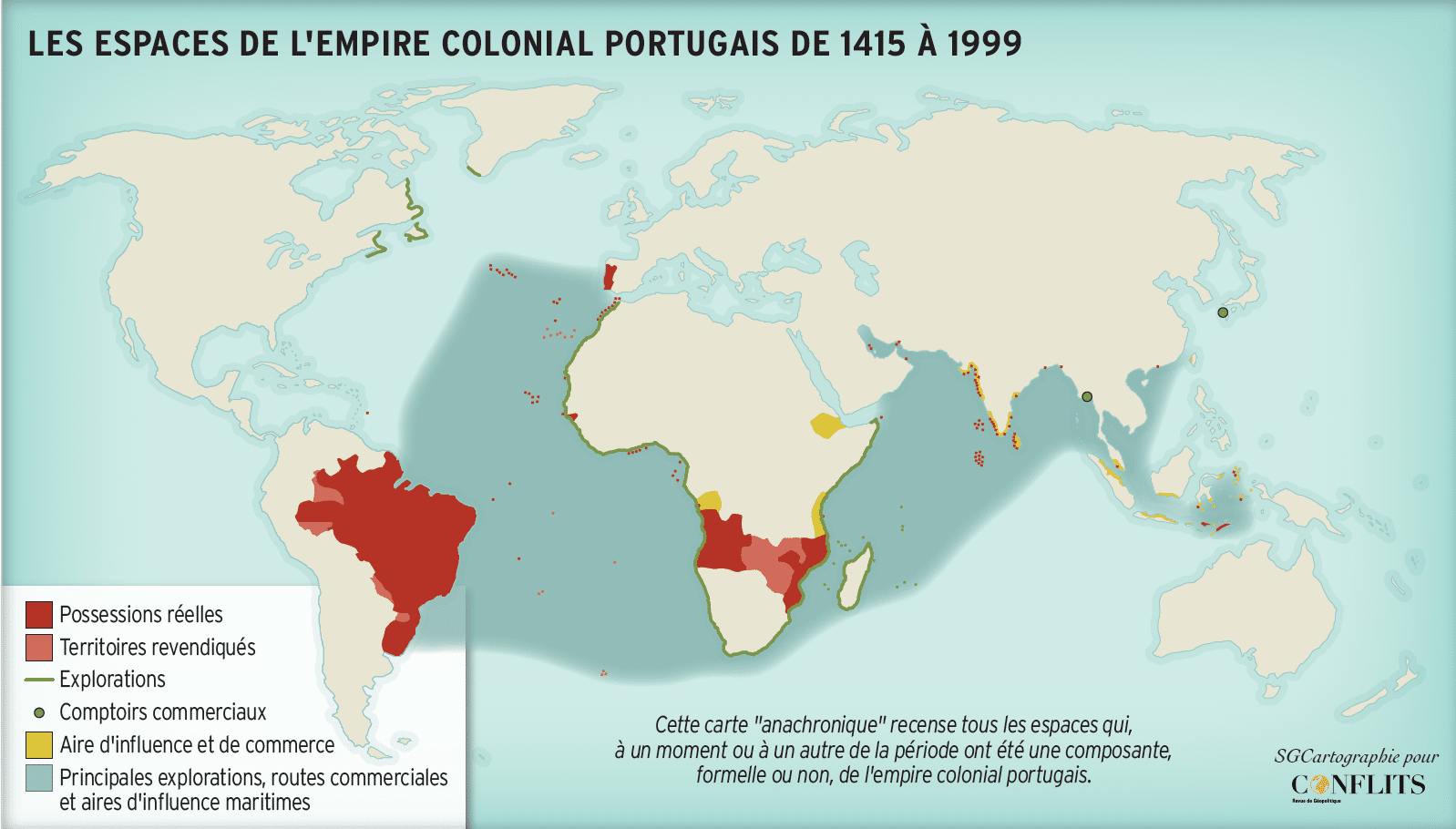La colline de Sion Vaudémont fut rendue célèbre par le roman de Maurice Barrès. Elle fut un temps la frontière avec l’Empire allemand, elle est aujourd’hui un lieu touristique où poussent les mirabelliers. S’y promener, c’est découvrir la Lorraine et cette région de marche entre la France et l’Empire.
La colline s’impose par son allure : un arc de cercle dominé au nord par la pointe tendue du clocher de Sion et à l’opposé par l’éperon couronné d’arbres de Vaudémont. Elle trône, confortablement incurvée au sein des collines boisées et plaines ondulées qui en forment le décor. Elle n’affiche pas le passé, ses quelques vestiges sont noyés dans la verdure. Ici l’Histoire ne se voit pas ; elle s’imagine. Tous les ans, le 8 septembre, une procession fait le tour de la basilique, le long du chemin de croix qui borde les pentes raides en reprenant le refrain du cantique : « Sur ta Lorraine, sur tes Lorrains ô douce Reine étend les mains ».
La colline de la mémoire lorraine « une immensité de silence et de douceur » (M. Barrès).
La butte-témoin de Sion-Vaudémont domine de ses pentes escarpées les plaines alentour. De 500 m d’altitude en moyenne et longue d’environ 4 km, elle se détache de loin. Ses deux extrémités la distinguent des autres éminences : au sud-ouest l’éperon rocheux de Vaudémont, jadis siège du château des puissants comtes du même nom ; au nord la basilique de Sion, dotée d’une tour de 45 m de haut, surplombée par une statue de la Vierge haute de 7 m, aux mains étendues vers la terre. Fondue à Vaucouleurs, elle fut mise en place le 8 septembre 1871, le regard tourné vers l’Alsace… Entre les deux, dressé en l’honneur de Maurice Barrès au point culminant (545 m.), s’élance le fanal de Vaudémont (22 m).
A lire aussi : La Billebaude
« Ici » écrit l’auteur de La colline inspirée, « l’immense horizon imprévu, la griserie de l’air, le désir de retenir tant d’images si pures et si pacifiantes obligent à faire halte. […] On passerait des heures à entendre le vent sur la friche, les appels lointains d’un laboureur à son attelage, un chant de coq, l’immense silence, puis une reprise du vent éternel. On regarde la plaine, ses mouvements puissants et paisibles, les ombres de velours que mettent les collines sur les terres labourées, le riche tapis des cultures aux couleurs variées. Aussi loin que se porte le regard, il ne voit que des ondulations… »[1]

Maurice Barres (1862-1923), vers 1885 (c) Sipa 00520128_000047
Sion, la pointe sacrée
Le site aurait été occupé dès le Ve millénaire. Un oppidum celte se dressait sur la pointe de Vaudémont et les Romains installèrent aux deux extrémités du plateau des postes fortifiés. Le nom semble dériver de « Waldonis mons », la colline de Waldo (Wodan ?), qui devint Wasdesmons puis Vaudémont. Un hameau se développa à l’époque mérovingienne, relevant de la paroisse de Sion. Prenant peut-être appui sur des éléments fortifiés gallo-romains, un château y fut associé à partir du XIe siècle à l’initiative du comte Gérard Ier. En 1325 Vaudémont devint une ville, qui reçut du comte Jean et de son épouse Marguerite de Joinville une charte de franchise le 19 février 1369. Sous le règne d’Antoine (1416-1447) la ville s’agrandit et le château fut renforcé.
Le nom de Sion n’est pas forcément un emprunt biblique. On trouve au VIe siècle le nom de « Sointense » puis « Suentisium » (870) et « Seionz » en 955. Des documents mérovingiens et carolingiens évoquent le « pagus Sugentensis » (709 et 800) : le Saintois est le pays de Sion. L’étymologie demeure incertaine. Peut-être est-ce une déformation de « Sego-dunum » (Forteresse de la Victoire), qui aurait désigné l’oppidum celte primitif (comme Lugdunum a donné Lyon). L’expression « pagus sugentensis » pourrait aussi provenir du latin « segetes » (les moissons) et désigner une riche terre à blé. E. Nègre dans sa Toponymie générale de la France (Genève, 1990) suggère quant à lui un patronyme germanique « Swind ».
À l’emplacement de la basilique actuelle, les Leuques ont vénéré la déesse de la fertilité Rosmerta. Les Romains y associèrent Mercure, dieu du commerce alors que la colline était placée le long de l’axe reliant l’Italie à la Moselle via la Saône. Au IVe siècle, la Vierge remplaça Rosmerta. Des chanoines, relevant de la collégiale de Toul, s’implantèrent en 986 et Sion devint un lieu de pèlerinage dès 1070. En 1626, l’Ordre des Tiercelins développa le sanctuaire marial et en 1669 Notre-Dame de Sion fut proclamée souveraine de la Couronne de Lorraine. Le couvent fut abandonné en 1792 et le culte ne reprit que sous les frères Baillard, mis en scène dans La colline inspirée. Après qu’ils eurent été chassés par l’autorité épiscopale, la relève fut assurée par les Oblats de Marie en 1853. Le chœur, reconstruit au XIVe siècle, est la partie la plus ancienne de l’église ; le reste du bâtiment fut aménagé aux XVIIe-XIXe siècles. La basilique est inscrite au titre des Monuments historiques depuis 2003.
Les puissants comtes de Vaudémont
À son apogée, la fortification enserrait tout le village et comptait sans doute plusieurs tours dont un donjon de 15m de haut, la tour dite « de Brunehaut », construite la première[2]. Un fossé profond de 7 m et large de 12 séparait le château du village. Depuis cette forteresse, les comtes de Vaudémont assirent un pouvoir qui fit d’eux les grands rivaux des ducs de Lorraine. L’imposante enceinte résista sans peine au siège organisé par René II de Lorraine en mai 1431. À la fin du XVe siècle, elle commença à être délaissée et à s’abîmer. L’ensemble fut anéanti sur ordre de Richelieu en 1639 ; les habitants utilisèrent les pierres pour leurs maisons. Il n’en reste aujourd’hui que les vestiges de la tour Brunehaut éventrée et une partie de la courtine sud[3]. Le village qui comptait encore 114 habitants en 1962 n’en abrite plus que 63.
En 1048, par décision impériale, le comte Gérard d’Alsace devint duc de Haute-Lotharingie. À sa mort en 1072 ses deux fils se partagèrent le duché : le cadet, Gérard, reçut les terres situées le plus au sud, autour de Vaudémont érigé pour l’occasion en comté. Ses descendants héritèrent les uns après les autres du titre et du comté. À partir du XIIe siècle, bien que sujets d’empire, les comtes se rapprochèrent du roi de France. Plusieurs moururent à ses côtés lors de la guerre de Cent Ans : Raoul tomba à Crécy en 1346, Ferry Ier à Azincourt en 1415 et Jean Ier combattit aux côtés de Du Guesclin. Ce tropisme français s’explique en partie par l’indifférence témoignée par les souverains germaniques envers ces terres périphériques de leur empire.
A lire aussi : De Gergovie à la Limagne
Le fils de Ferry Ier, Antoine de Vaudémont, se distingua par ses ambitions. Privé de la succession à la tête du duché de Lorraine au profit de René d’Anjou, duc de Bar, qui avait épousé la fille du duc Charles II, il entra en guerre en 1431, n’hésitant pas à recourir à des Routiers pour attaquer les possessions ducales. Les exactions commises entraînèrent l’intervention du roi de France, Charles VII. Allié au duc de Bourgogne Philippe le Bon, Antoine participa à la bataille de Bulgnéville (2 juillet 1431), où les Lorrains furent écrasés, le duc capturé. Mais après ce point d’orgue, Antoine, déçu de ne pas avoir droit à la rançon de René Ier, se rapprocha du roi de France. En 1473, le duché et le comté furent réunis entre les mains de René II issu du mariage du fils d’Antoine de Vaudémont et de la fille de René Ier. Lors du siège de Nancy (1477) face aux armées de Charles le Téméraire, il fit combattre ses troupes sous l’étendard de Notre-Dame de Sion, affirmant son lien avec le comté de Vaudémont et le culte de la Vierge implanté sur la colline.

Vue aérienne de la colline. Source : https://france3-regions.francetvinfo.fr/grand-est/emissions/pourquoi-chercher-plus-loin-la-carte/actu/sion-la-colline-inspiree.html
« Ce n’était pas pour toujours ». Face à l’Allemagne conquérante
Créée lors du partage de Verdun, la Lotharingie portait le nom d’un homme (le fils aîné de Louis le Pieux), et non d’un peuple comme les deux Francie, occidentale et orientale, qui l’enserraient. Ce royaume de Lothaire, qui s’étendait de la mer du Nord à la Lombardie, fut partagé en 959 en Haute (au sud) et Basse Lotharingie, toutes deux situées au sein du royaume de Germanie, puis de l’Empire allemand. La Haute Lotharingie fut vite scindée : le comté puis duché de Bar, le duché de Lorraine, les évêchés de Metz, Toul et Verdun en constituaient les pôles de puissance. L’ensemble était en contact avec le royaume de France dont ne le séparait que le cours de la Meuse. À partir du XIIe siècle, les liens avec la France s’étoffèrent ; des relations s’établirent entre les noblesses lorraine et champenoise. Saint Louis entama la lente progression des Capétiens, grignotant peu à peu, par achats, arbitrages, etc., l’espace frontalier du royaume.
À partir de 1870, en moins d’un siècle, trois guerres provoquèrent quatre changements de frontières et de nationalités pour l’ensemble des Alsaciens et une partie des Lorrains. Deux ans après le traité de Francfort, une foule de 30 à 40 000 pèlerins se rassembla sous la pluie devant la basilique de Sion, le 8 septembre, fête du Couronnement de la Vierge. Le privilège du couronnement avait été octroyé à Notre-Dame de Sion par Pie IX lors de Vatican I. La cérémonie aurait dû avoir lieu le 15 septembre 1870 : on avait attendu le départ des troupes d’occupation (31 août 1873). Furent installées dans l’église les bannières de Strasbourg, Metz, Château-Salins et Lixheim, voilées du crêpe de deuil (remplacé en décembre 1918 par des rubans tricolores après l’entrée des troupes françaises dans ces villes). L’évêque de Nancy, Mgr Foulon, l’avait annoncé : « À côté des bannières de Nancy, marcheront, douloureux souvenirs, celles de nos deux sœurs, Metz et Strasbourg. » L’inscription de la bannière messine appelait à transformer le deuil en joie, celle de Strasbourg invoquait l’espoir salvateur. Apportée par des Lorrains des régions annexées une plaque de marbre noir en forme de croix bourgeonnante fut apposée dans l’église. À l’extrémité inférieure on avait gravé : « Alsace Lorraine. À Notre Dame de Sion ». Les trois autres extrémités affichaient les mots « Ave Maria ». La plaque portait au centre une blanche couronne d’immortelles, symbole de deuil, encadrée des mots « Espoir » et « Confiance ». Les fleurs entouraient une croix de Lorraine brisée, surmontée de l’inscription en patois mosellan (dont l’usage fut vivace durant les décennies d’annexion) : « Ce name po tojo », « Ce n’est pas pour toujours ».
En 1914, comme en 1870, Sion servit de champ de tir à l’armée française ; le front n’était guère qu’à une vingtaine de km. Pendant la Grande Guerre, de nombreux soldats y vinrent en pèlerinage implorer la protection de la Vierge et y déposer de nombreux ex-voto. Le 24 juin 1920, 40 000 personnes se retrouvèrent sur la colline, pour célébrer le retour des provinces annexées. Devant une foule gagnée par l’émotion, Maurice Barrès plaça sur la croix, à l’emplacement de la fracture, une palme dorée enrubannée de tricolore. On ajouta au-dessus du cadre l’inscription « Ce n’ato me po tojo » (« Ce n’était pas pour toujours »). Sion n’était pas loin de devenir un sanctuaire national.
A lire aussi : Que peut-on encore apprendre de la guerre de 1870 ?
Le 23 septembre 1928 fut dressée sur le point culminant de la colline une lanterne des morts en hommage à Barrès. L’emplacement avait été choisi par le Maréchal Lyautey. Les anciens Présidents de la République, Raymond Poincaré et Alexandre Millerand assistèrent à l’inauguration, en compagnie d’évêques, de parlementaires, de Lyautey lui-même. Trois des faces du bloc de base portent des inscriptions extraites d’ouvrages de l’écrivain lorrain. L’une évoque le lien entre le culte des morts et la vie de la Cité : « Honneur à ceux qui demeurent dans la tombe les gardiens et les régulateurs de la cité », tandis qu’une autre dépeint l’impression ressentie à contempler l’immense paysage alentour : « L’horizon qui cerne cette plaine, c’est celui qui cerne toute vie, il donne une place d’honneur à notre soif d’infini en même temps qu’il nous rappelle nos limites. »
La colline connut les combats en 1940 : le Général Flavigny y fut capturé avec le 21e corps d’armée et le corps d’armée colonial le 23 juin. Le 8 septembre 1946, 80 000 personnes assistèrent à la cérémonie présidée par le Général De Lattre de Tassigny qui plaça au-dessus de la plaque une croix de Lorraine portant une nouvelle et définitive inscription répartie sur ses deux branches : « Estour / inc po tojo » : « Maintenant (« À cette heure ») /un pour toujours »…[4]

Vierge de Sion. Source : https://www.le-lorrain.fr/files/uploads/2016/05/colline-sion-lorraine-statue-vierge-marie-tour.jpg
On est ici au cœur de la Lorraine. Un point de vue unique permet d’identifier depuis la table d’orientation plus de 80 villages et de porter le regard jusqu’aux Vosges, voire, par très beau temps, jusqu’aux Alpes de l’Oberland bernois à 250 km. Elle demeure pour beaucoup un point d’ancrage : « Il plane sur ce petit coin de Lorraine une atmosphère indéfinissable que l’on ne trouve nulle part ailleurs, calme, sérénité qui permettent de durer et d’espérer » (Général Marcel Bigeard in La revue lorraine populaire, n° 80, février 1988, p. 94).
Bibliographie
Gérard Giuliato, Châteaux et villes fortes du comté de Vaudémont en Lorraine médiévale, Nancy, Presses universitaires de Nancy, 2008.
- Mangenot, Sion, son pèlerinage, son sanctuaire, Nancy, 1919 (réimpr. Lacour-Ollé, Nîmes, 2013).
[1] La colline inspirée, éd. Pierron, Sarreguemines, 1985, p. 246-247.
[2] Le flanc de la colline avait été creusé au-dessous des murailles : l’éperon aux pentes abruptes était ainsi rendu d’accès très difficile.
[3] La restitution réalisée fin XIXe siècle et présentant le château vers 1630 est imaginaire (Archives de Meurthe-et-Moselle, Carte postale – 2 Fi 1352). Une photo réalisée au début du XXe siècle permet de se faire une maigre idée des remparts d’origine (Archives de Meurthe-et-Moselle, Carte postale, début XXe siècle, 2 FI 3274).
[4] En 1973, année du centenaire, on rajouta au sommet le mot « Réconciliation ». Cette fois ce n’était plus en patois… L’inscription avait été déposée par des Allemands.
Article publié initialement le 16 mai 2020.