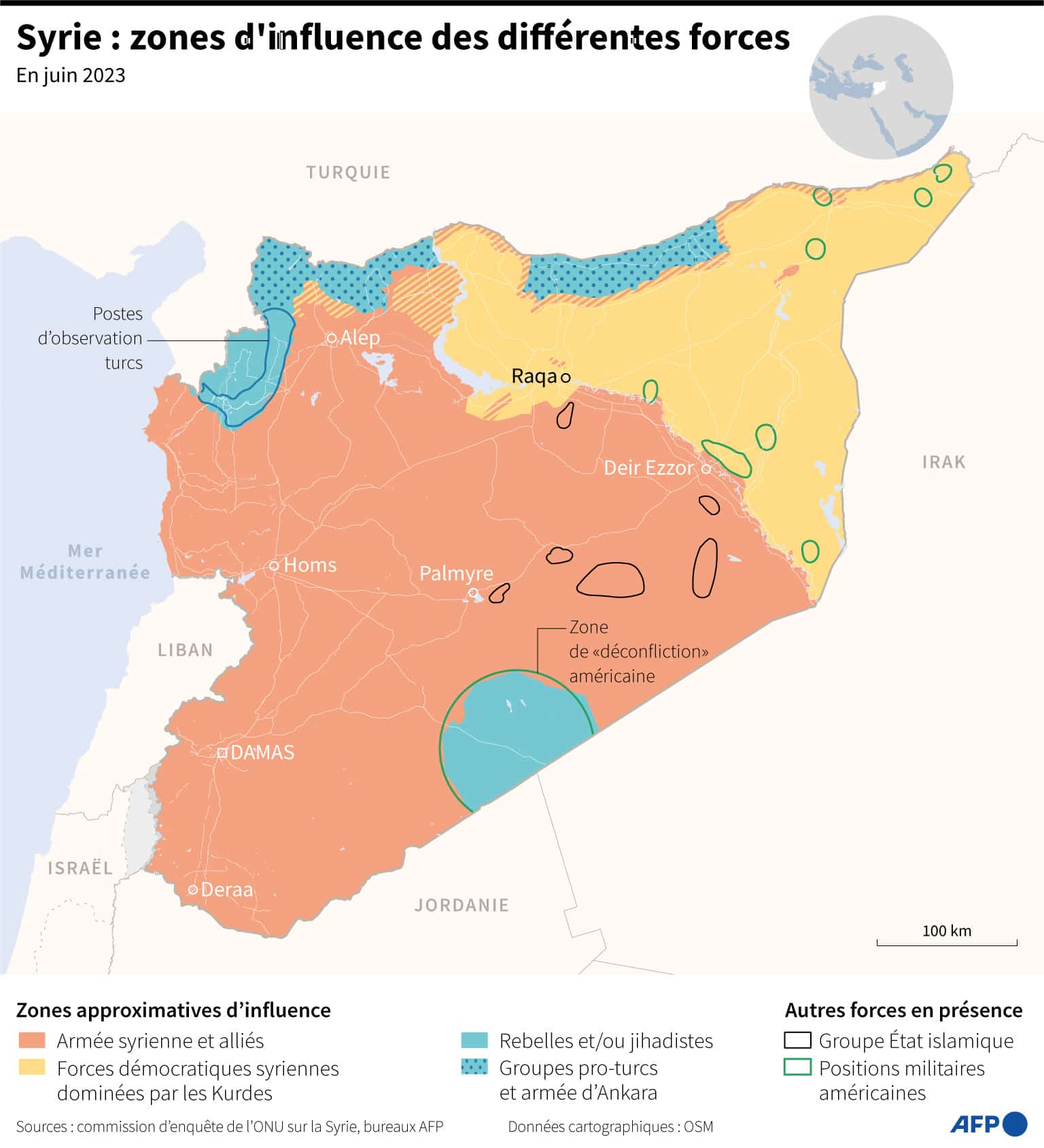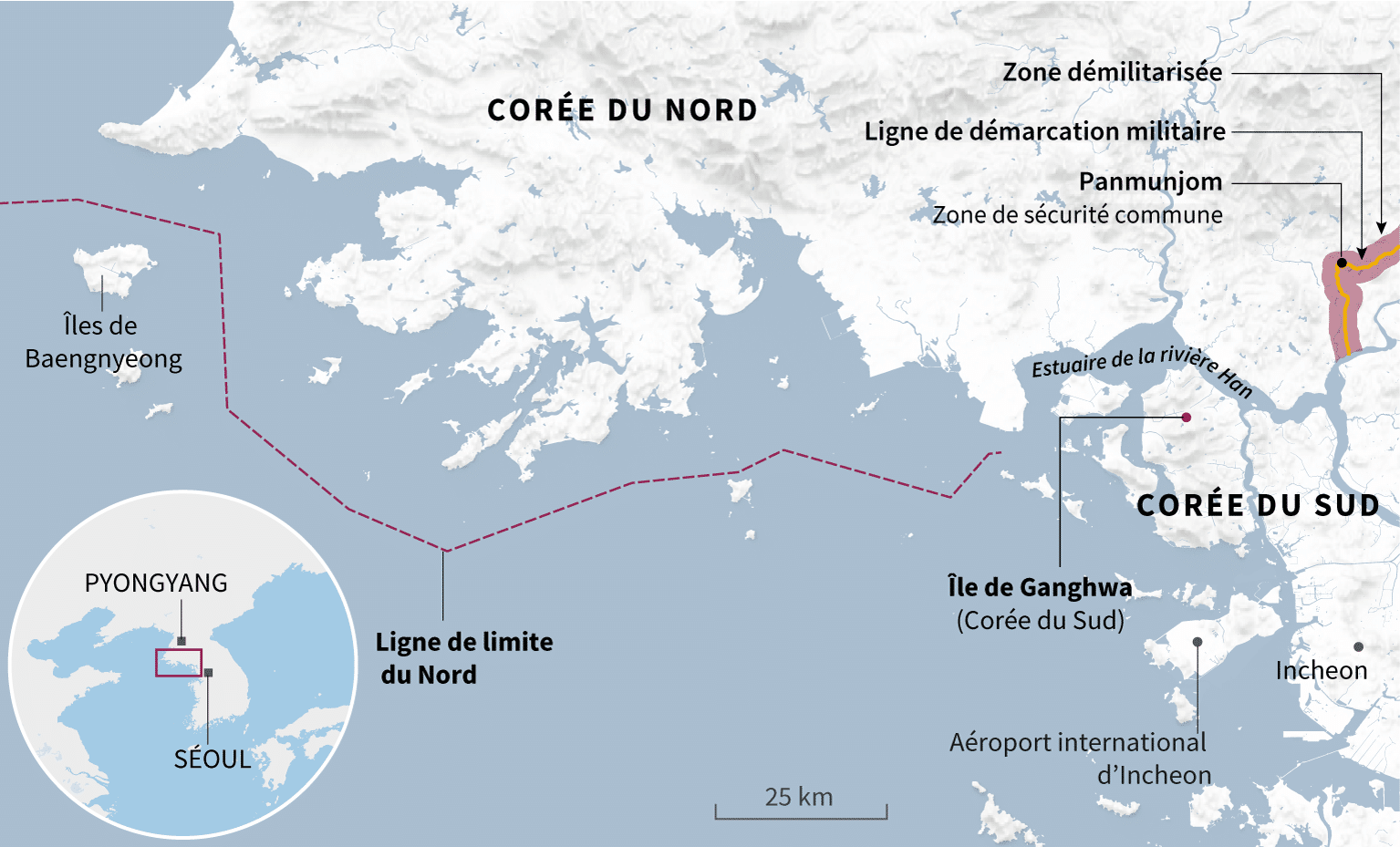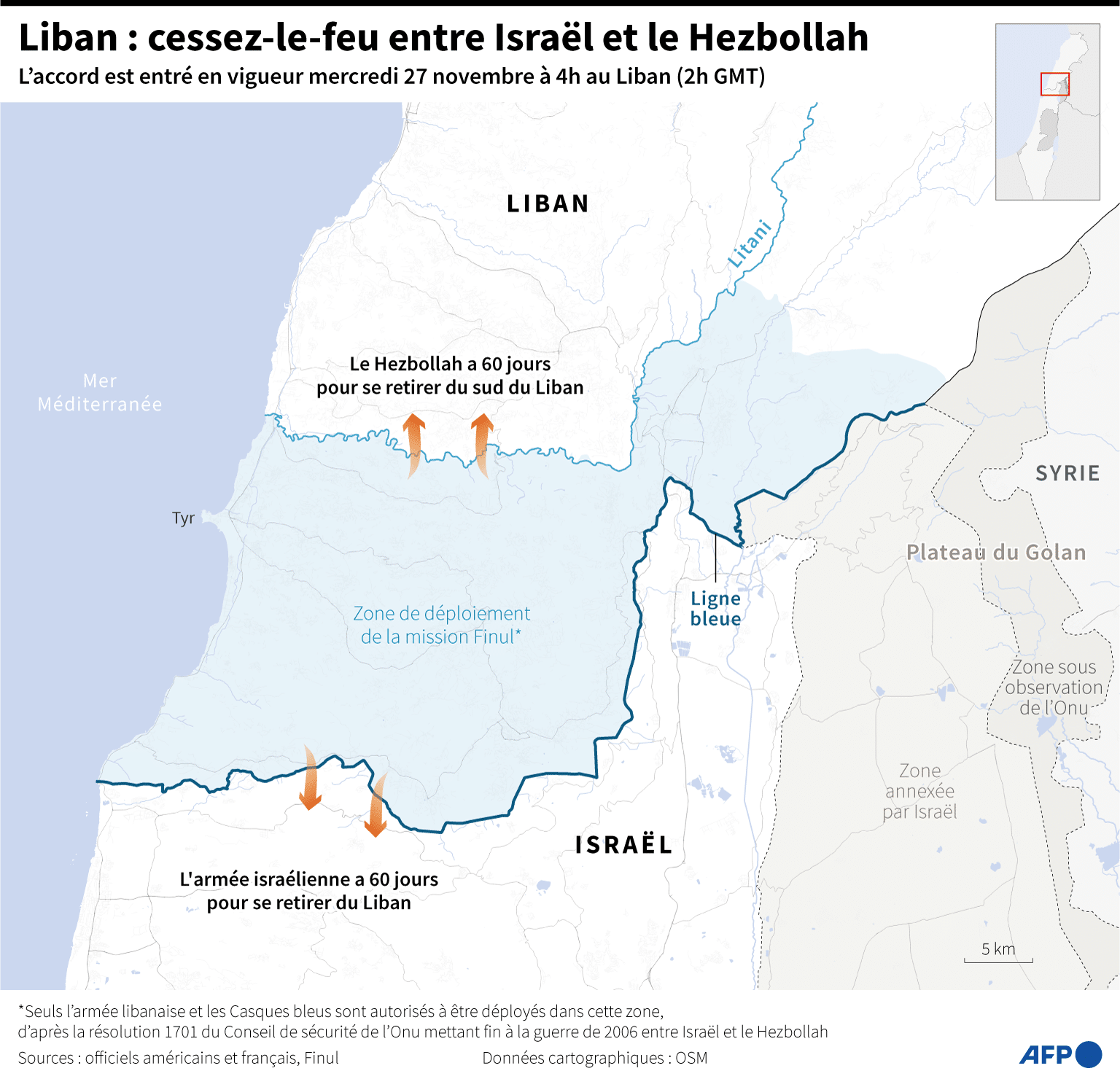Si la Birmanie est plongée dans la tourmente politique depuis son indépendance, la guerre civile a pris une nouvelle dimension en 2021. Entre affrontements militaires et tensions ethniques, le pays est confronté à une guerre sans fin. Entretien avec Amaury Lorin.
Propos recueillis par Louis-Marie de Badts.
Amaury Lorin, docteur en histoire de l’Institut d’études politiques de Paris, contribue depuis 2010 à la revue Questions internationales (La Documentation française). Il a vécu à Rangoun (Birmanie) de 2013 à 2015, où il contribuait notamment aux pages « Culture » du Myanmar Times. Dernier ouvrage paru : Variations birmanes, Bruxelles, Samsa, 2022.
Retrouvez tous les articles de la série.
« Ce n’est pas le pouvoir qui corrompt, mais la peur : la peur de perdre le pouvoir pour ceux qui l’exercent, et la peur des matraques pour ceux que le pouvoir opprime » : ces mots du prix Nobel de la paix de 1991 (Aung San Suu Kyi) résonnent avec la situation actuelle de la Birmanie, mais quelles sont les origines de ces tensions internes ?
La situation birmane depuis le nouveau coup d’État du 1er février 2021, une guerre civile pour la qualifier d’emblée sans ambiguïté, a des racines anciennes et complexes. Alors que les jeunes Birmans quittent les villes pour rejoindre les rangs des armées ethniques dites « rebelles », et que le régime dictatorial du général Min Aung Hlaing demeure sourd depuis deux ans aux pressions d’une communauté internationale apparemment impuissante à le contrer, il faut revenir à l’histoire de ce pays, celle d’une quête désespérée d’une impossible unité : monarchie absolue pendant huit siècles avec une succession ininterrompue de rois despotes jusqu’au XIXe siècle, la Birmanie, toujours tiraillée entre les appétits de ses deux voisins, l’Inde et la Chine, géants démographiques prédateurs, a ensuite connu cent-vingt-quatre ans de colonisation britannique (1824-1948), puis cinq décennies de dictature militaire parmi les plus féroces de la planète (1962-2011) après le coup d’État du général Ne Win. Les dix ans d’ouverture et de relative stabilité qu’elle a connus (2011-2021) furent brusquement stoppés le 1er février 2021 : la Birmanie a depuis lors replongé dans les ténèbres.
A écouter également :
Podcast – Birmanie : les mystères de la junte. Amaury Lorin
Plus précisément, l’accord final de la Conférence de Panglong, tenue du 7 au 12 février 1947 dans l’État Shan, est à l’origine d’un grand malentendu quant à son contenu. Il porte les germes des actuelles tensions internes birmanes. Le charismatique général Aung San (1915-1947), père d’Aung San Suu Kyi, assassiné par l’un de ses rivaux, était apprécié des représentants des minorités ethniques birmanes (135 groupes ethniques officiellement reconnus). Il disposait de leur confiance, à la différence de sa fille. Il envisageait une Birmanie bâtie sur le principe de « l’union dans la diversité ». Il fit deux promesses lourdes de conséquences politiques aux populations des minorités ethniques de Birmanie à l’issue de la conférence, acte fondateur problématique de la Birmanie moderne : une structure pseudo-fédérale sur une base ethnique, qui les intégrerait de manière pacifique (mais inégalitaire), comparable à ce que fut en Europe la Yougoslavie (1929-2003) ; et un droit de sécession dix ans plus tard en cas d’insatisfaction. Cette conférence, dont la mémoire construite est ambiguë, a valeur de quasi-constitution. Ses interprétations contradictoires depuis 1947 entretiennent l’espoir d’une Birmanie unie ethniquement. Or l’union de la Birmanie est un mythe en soi. Cet accord, inspiré de la stratégie Divide and rule (« diviser pour régner ») héritée des Britanniques, ne fut finalement jamais mis en œuvre. Il explique pour beaucoup l’actuelle situation birmane : un kaléidoscope ethnique fracturé, présentant un risque de fragmentation élevé.
Entre coup de force militaire et révolte grandissante, à l’heure où tous les médias sont tournés vers l’Ukraine, qu’en est-il de la situation birmane ?
Je remercie vivement la revue Conflits de ne pas oublier la Birmanie dans le dossier qu’elle consacre opportunément aux guerres négligées, voire oubliées, par les médias occidentaux notamment, alors que la guerre en Ukraine depuis le 24 février 2022 a eu pour effet d’éclipser les guerres plus lointaines des priorités médiatiques. On peut le regretter. Il demeure très important de continuer de parler de la Birmanie et du sort des Birmans dans une guerre civile, qui produit chaque jour son lot d’horreurs. Le bilan est de 2.500 à 4.000 civils tués, selon les sources, et au moins 1,3 million de civils déplacés, fuyant des crimes attestés contre l’humanité.
Les affrontements entre la junte et des milices locales armées sont sanglants depuis deux ans. Il s’agit d’une situation confuse, pour ce qu’on en sait, car le régime dictatorial birman exerce une censure très forte, en même temps qu’une répression féroce contre tous ses opposants. Le gouvernement démocratique est en exil. Le gouvernement de prétendue « unité nationale », dirigé depuis deux ans par le général Aung Min Hlaing, n’est pas reconnu en Europe. Depuis le coup d’État, toute intervention étrangère est perçue de manière allergique comme une ingérence dans ses affaires intérieures par la Birmanie, de nouveau isolée du reste du monde. Ce qui n’empêche pas la junte militaire birmane d’être soutenue par la Russie et par la Chine, qui lui vendent des armes et en profitent pour mieux piller ses ressources naturelles.
A écouter également :
Podcast – Birmanie : la junte face à sa population. Guillaume de Langre
La Birmanie, ou République de l’Union du Myanmar, fêtait le 4 janvier 2023 les 75 ans de son indépendance, après avoir eu des gouvernements divergents. Malgré une période de trouble socio-économique, la junte au pouvoir ne semble pas inquiétée par les différents heurs de la population. Comment la population se positionne-t-elle par rapport à son gouvernement ? Le souvenir du gouvernement antérieur joue-t-il contre le pouvoir en place ?
L’accès à l’indépendance si ardemment souhaitée, le 4 janvier 1948 après cent-vingt-quatre ans de domination britannique, est une date fondatrice très importante pour la Birmanie. On ne peut rien comprendre, en effet, à l’actuelle situation birmane sans cette expérience historique longue.
La junte au pouvoir depuis deux ans mène une politique de terreur : exécutions sommaires, exactions brutales, massacres, justifiés comme des « opérations antiterroristes » contre des « rebelles » dans les régions qui résistent au régime. Des condamnations verbales occidentales, mais peu d’actes, comparativement à l’Ukraine.
Pendant un long demi-siècle (1962-2011), un régime militaire dictatorial obscurantiste a rendu la population birmane « occupée de l’intérieur » par sa propre armée, autrement dit « prisonnière dans son propre pays », selon les mots d’Aung San Suu Kyi, symbole international de la résistance à ce régime. Pour la population birmane durement assujettie, si longtemps coupée du monde, monastères et couvents étaient, et sont redevenus depuis 2021, les seuls refuges pour tenter d’échapper, de l’intérieur, à cette dure réalité. L’oligarchie militaire birmane cherche de nouveau depuis 2021 à légitimer son pouvoir en utilisant le bouddhisme.
L’autoritarisme est présenté par certains Birmans comme l’une de ses « valeurs politiques », ainsi que le pose Maung Maung Gyi. L’hypothèse d’une « prédisposition naturelle birmane à l’autoritarisme », allant jusqu’à impliquer qu’« un mauvais gouvernement est intégré comme une fatalité inévitable et un héritage psychologique par les Birmans », demeure évidemment discutable. Elle relativise la responsabilité britannique dans les déboires politiques du pays après 1948. La monarchie, la vie monastique, les structures et institutions traditionnelles de gouvernement birmanes furent certes profondément bouleversées par l’arrivée des Britanniques en Birmanie au XIXe siècle, qui exilèrent de force le roi birman Thibaw en 1885 en Inde et divisèrent les minorités ethniques du pays pour mieux régner. On ne peut pas, pour autant, attribuer toutes les difficultés politiques birmanes à cette expérience coloniale longue.
La diaspora birmane, notamment en France, s’organise comme elle peut. Saluons le courage de la jeunesse birmane, qui a engagé un mouvement de désobéissance civile pacifique comme elle a pu, forçant le respect.
La condition apatride des Rohingyas est représentative d’un problème plus confessionnel que politique. Quel est votre point de vue face à cela ?
Au moins 6.700 musulmans rohingyas furent tués fin août 2017 par l’armée birmane dans l’État de Rakhine (historiquement l’État d’Arakan), notamment dans la région autour de Sittwe, réputée birmanophobe. Dans ce contexte, près de 720.000 d’entre eux durent alors fuir vers le Bangladesh voisin en franchissant le fleuve Naf. Cette minorité est persécutée depuis 2012 en réalité sous la forme de pogroms par la majorité bouddhiste du pays. Le bouddhisme, proclamé religion d’État en 1958 en Birmanie, serait pratiqué par 88% de la population birmane. Cette crise des Rohingyas, à l’origine de flux migratoires ayant bouleversé l’équilibre démographique de toute la région, a brusquement rappelé au monde entier les profondes fragilités structurelles de la Birmanie : un pays en proie à des tensions intercommunautaires, qui le minent.
Cependant, contrairement à la présentation qui en est souvent faite en Occident, l’affrontement entre bouddhistes birmans theravāda et musulmans rohingyas sunnites n’est pas que religieux. Pour le gouvernement birman, il s’agit d’abord de lutter contre une menace pour la sécurité intérieure, de type terroriste. Or les médias internationaux figent le sujet dans une présentation systématiquement manichéenne en noir et blanc : bouddhistes bourreaux contre musulmans victimes. Elle mérite assurément d’être nuancée. L’État central birman cherche à contrôler les minorités ethniques dans les marges périphériques du pays. Une dictature a, en outre, besoin d’un ennemi pour exister !
A lire également :
Histoire de la Birmanie, d’Antoine C. Sfeir
L’Arakan, peuplé de bouddhistes et de musulmans depuis la fin du XVe s., fut rebaptisé État de Rakhine en 1989 par la junte militaire au pouvoir. Les Britanniques l’annexent en 1826 suite au Traité de Yandabo, marquant la fin de la première guerre anglo-birmane (1824-1826). Ils installent ensuite des migrants musulmans du Bengale pour développer une riziculture intensive à vocation commerciale sur les terres fertiles des Arakanais bouddhistes ayant fui à l’arrivée des Britanniques. Jusqu’à faire de la Birmanie le « grenier à riz » de l’Inde. La question a donc aussi une origine foncière. Une main-d’œuvre est ainsi massivement importée, sans limite, en provenance du Bengale sous administration britannique entre 1826 et 1937, afin de satisfaire les besoins croissants de l’économie impériale britannique. Les Indiens détiennent alors jusqu’aux deux tiers de la terre cultivable de Birmanie. Engagés pour cette raison auprès de l’ancien colonisateur britannique, les Rohingyas sont de ce fait détestés comme des « traîtres » par les bouddhistes, qui ne leur pardonnent jamais cet engagement et continuent de les associer au système colonial britannique.
Considérés comme « la minorité la plus persécutée au monde » en 2019 par l’ONU, les Rohingyas sont victimes depuis plusieurs décennies d’une discrimination systématique. Ils formaient déjà avant la crise de 2017 la plus grande communauté apatride au monde. La population est estimée entre 1,5 et 3 millions de personnes, selon les sources, soit la plus nombreuse des communautés musulmanes de Birmanie. Des libertés fondamentales telles que la libre circulation dans le pays, l’accès à des services publics comme l’éducation et les droits élémentaires, tels que le mariage ou le vote, leur sont notamment refusés en vertu d’une loi restrictive datant de 1982 sur la citoyenneté birmane, dont ces parias dépourvus de nationalité, apatrides de jure, sont exclus.
Les enjeux autour du Rakhine dépassent le simple cadre national birman. La Birmanie représente un intérêt stratégique et économique considérable pour la Chine. En effet, 80 % du pétrole importé par la Chine transite par voie maritime par le détroit de Malacca, foyer de piraterie endémique, et la mer de Chine méridionale, où des contentieux territoriaux opposent la Chine aux pays riverains. Alors que la Chine est devenue le premier importateur de pétrole au monde, on comprend tout l’intérêt que représente pour Pékin un accès par les côtes birmanes aux ressources en hydrocarbures du golfe du Bengale. Il s’agit pour elle d’ouvrir une « nouvelle route maritime de la soie » en prolongement de son « collier de perles », qui s’étend sur les rives de l’océan Indien. Le gazoduc (2013), doublé d’un oléoduc (2015), construits et financés par Pékin entre le Rakhine birman et le Yunnan chinois s’inscrivent dans cette perspective. La construction en 2016 par la Chine d’un port en eau profonde et d’une zone économique spéciale (ZES) à Kyaukpyu répond au port construit par New Delhi à Sittwe. Des gisements de titane, d’aluminium, d’uranium, de nickel et de terres rares ont, en outre, été découverts au Rakhine. Un secret d’État. Une population n’y est-elle dès lors pas souhaitable, afin de pouvoir mieux exploiter ces ressources convoitées ? La situation géographique de la Birmanie, entre Chine de l’intérieur et océan Indien, apparaît idéale aux yeux de Pékin. L’océan Indien sera en effet fondamental pour les Chinois dans les décennies à venir. La Birmanie peut-elle dès lors devenir leur « Californie », dans la mesure où elle peut fournir un accès à une seconde côte tant recherchée ?
Trente-trois ans. C’est le nombre d’années de prison que devra effectuer Aung San Suu Kyi, dirigeante birmane déchue par l’armée lors du coup d’État du 1er février 2021. Cela mène à une négation de la démocratie et des libertés, et dans le même temps les Rohingyas de l’Arakan restent refoulés hors du territoire. De quelle manière envisagez-vous la suite de ce conflit ?
On assiste à un acharnement judiciaire délirant, hors de toute proportion raisonnable, contre Aung San Suu Kyi, qui risque désormais jusqu’à cent-vingt ans de prison au total. Ces parodies de procès organisés par le régime du général Min Aung Hlaing rappellent les procès staliniens. Symbole international de la résistance à la junte militaire birmane au moment où lui fut décerné le prix Nobel de la paix en 1991, la fille du général Aung San a, d’abord, commis le crime transgressif d’épouser en 1972 un citoyen britannique, Michael Aris (1946-1999), nationalité de l’ancienne puissance colonisatrice, alors que la colonisation britannique de la Birmanie (1826-1948), pratiquement aussi longue que celle de l’Algérie française (1830-1962), a représenté un profond traumatisme pour le peuple birman, humilié. Un péché originel, impardonnable pour les Birmans, qui font payer le prix fort à la « Dame de Rangoun ». Autre motif d’inquiétude : « l’icône fracassée » (Bruno Philip), centrée sur son propre destin national, n’a pas préparé sa succession au sein de son parti politique, la National League for Democracy.
Quel effet le coup d’État militaire du 1er février 2021 peut-il avoir sur la question rohingya ? Risque-t-il de détourner l’attention du monde sur le sort de cette minorité ou au contraire de la focaliser ? Dans l’actuel chaos engendré par ce bouleversement, qui n’a pas surpris les observateurs du pays sur une longue durée, il s’agit d’une des inconnues, parmi de nombreuses autres, d’une trajectoire birmane décidément bien singulière et incertaine, alors que le pays semble s’enliser dans son indépassable impasse identitaire. Une politique de sanctions économiques peut-elle efficacement affaiblir le régime militaire dictatorial issu de ce coup d’État ? Seule la population birmane en souffre hélas de nouveau.
À l’occasion du 75e anniversaire de l’indépendance de la Birmanie (1948), la junte affirme sa volonté d’organiser des élections « libres et équitables », soutenue par Moscou et vivement critiquée par les États-Unis. La Birmanie vit des heures troubles. Pendant que l’armée putschiste fait face aux nombreuses milices locales, croyez-vous-en la « bonne foi » du gouvernement ?
On ne peut aucunement faire confiance à ce régime criminel, dépourvu de toute légitimité démocratique. En 2011 déjà, le passage d’un régime militaire direct, en place depuis le coup d’État du général Ne Win en 1962, à un gouvernement habilement présenté à l’étranger comme « quasi-civil », fut une grande source de malentendus. Un enthousiasme mondial, non dénué d’arrière-pensées économiques, saluait alors la naissance miraculeuse d’un « nouvel eldorado » asiatique, à très fort potentiel de développement. Mais il fallait comprendre « quasi-militaire » encore, plutôt que « quasi-civil » !
Les Nations unies, bloquées par la Chine et la Russie, apparaissent impuissantes. Comme en 2021, la Birmanie n’a pas été conviée au congrès de l’ASEAN (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) en novembre 2022 au Cambodge, ce qui renforce son isolement international. Des sanctions internationales ciblées sur les secteurs pétrolier et gazier, et/ou sur les pierres précieuses (notamment le rubis), sources de revenus importantes pour la junte militaire, permettraient de pénaliser le régime plutôt qu’encore et toujours la population. Black-lister les entreprises finançant la junte permettrait aussi d’atteindre les intérêts économiques du régime militaire, en touchant au « nerf de la guerre ».
N’abandonnons pas et n’oublions pas la Birmanie, un pays si spirituel, aussi fragile qu’attachant, compliqué qu’envoûtant, comme on a abandonné l’Afghanistan !
A lire également