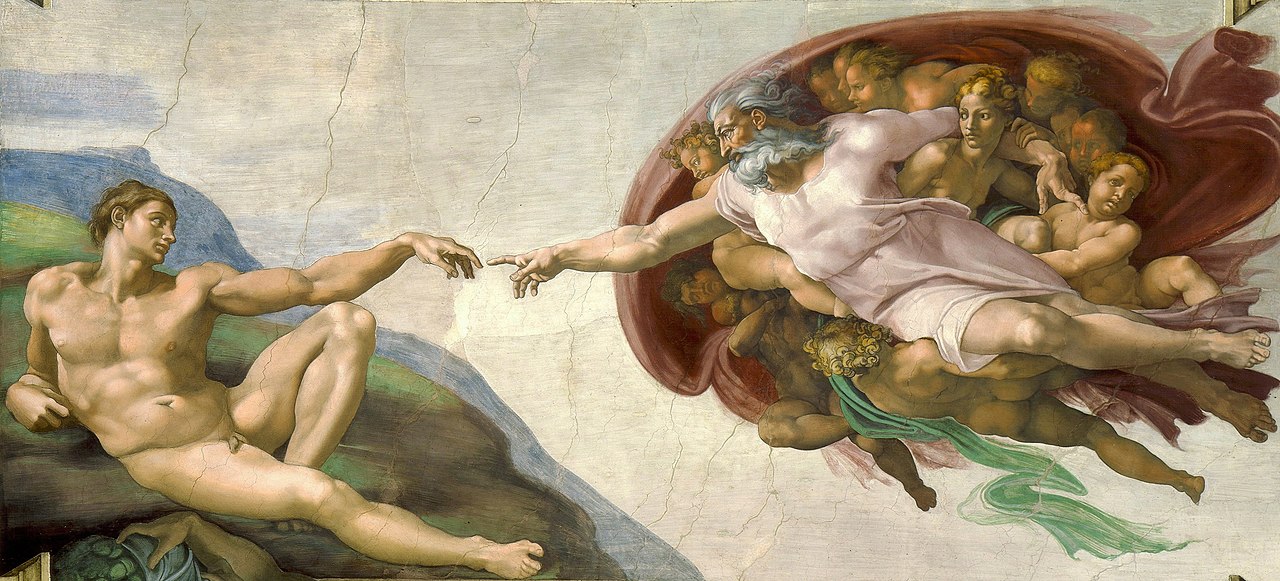L’Amérique latine, pour le Mexicain Octavio Paz, représente « les faubourgs de l’Histoire », et ses habitants « des intrus qui arrivent au spectacle de la modernité au moment où les lumières vont s’éteindre » (Le labyrinthe de la solitude, 1950).
Une littérature hétérogène
Si elle reflète souvent cette désillusion de vivre à la marge du monde, la littérature latino-américaine n’a pourtant rien d’un ensemble cohérent. Elle révèle au contraire les diversités culturelles et linguistiques de cette immense région. Aucun point commun, par exemple, entre le Mexicain Héctor Aguilar Camín, auteur d’un polar sur une mafia syndicale au pays du pétrole, La Mort à Veracruz (1985), et l’Argentin Jorge Luis Borges qui, dans Fictions (1944), vous fabrique en 18 contes des univers où l’imagination, l’élégance, les jeux de l’esprit et les effets de miroir déclinent un talent délicat. Une même langue, l’espagnol, ne suffit pas à cimenter l’ensemble.
Elle suit des chemins, un vocabulaire et des prononciations différentes, et donne à chaque lieu une littérature singulière. D’où ma réticence à céder à la facilité des généralités, d’autant qu’à l’espagnol s’ajoute une autre langue, le portugais du Brésil, foisonnante et diverse elle aussi. Cette addition lusophone pose un caillou dans la chaussure du conformiste qui aime ses catégories dans des paquets carrés, l’époque du boom, puis du post-boom, enfin, celle du réalisme magique, lesquelles ont existé, bien sûr, souvent inspiré du surréalisme, et ont survécu avec charme, comme le twist ou les bas couture, dans la bienveillance de nos mémoires que balayent d’un coup sec les textes modernes. Prenons la charmante trilogie Coupable d’avoir dansé le cha-cha-cha, écrite comme une musique de Bach par le Cubain Guillermo Cabrera Infante (1995), trois histoires d’amour répétitives et contrastées, mais de l’eau tiède à côté du bouillon brûlant d’une autre trilogie cubaine, celle de Pedro Juan Guttiérrez, Trilogie sale de La Havane (1998), qui nous décrit de façon crue la déglingue, le sexe et les combines de la survie durant la « période spéciale en temps de paix », définition officielle d’un désastre absolu.
L’existence d’un tronc commun
Malgré leur diversité survivent quelques traits communs aux littératures latino-américaines pour porter les traces des humiliations coloniales, des guerres anciennes, des horreurs dictatoriales, du tragique de l’histoire. On y retrouve aussi la mélancolie, la truculence, la sensualité, l’ironie, la violence, la fantaisie et la mort qui vient sans rendez-vous. On peut citer ici Les Bas fonds du rêve (1992) de l’Uruguayen Juan Carlos Onetti. Comme celui-ci, chaque roman, nouvelle ou poème, conte l’histoire d’un lieu. Ainsi le Chili, dans Mon Pays Réinventé (2003) d’Isabel Allende, ou Lima, dans La Ville et les chiens (1963) du Péruvien Mario Vargas Llosa. Ainsi, la littérature sert-elle de guide de l’âme des nations. L’une des exceptions est l’extraordinaire Chant général (1950) du Chilien Pablo Neruda qui, en 280 poèmes, tente avec une force lyrique singulière d’englober la longue et vieille histoire du sous-continent.
A lire aussi: Amérique latine : La reprise en mains
Quatre figures idéalisées – le dictateur, le métis, la putain, l’exilé – dominent ce foisonnement d’écritures. Vieux, cruel et rusé, le dictateur apparaît en 1946 avec Monsieur le Président, de Miguel Ángel Asturias, diplomate et poète du Guatemala. Puis vient le dictateur du Mexicain Juan Rulfo dont l’unique roman, Pedro Páramo (1959), forme un récit fantastique qui préfigure, et a peut-être inspiré, Cent ans de solitude (1967) du Colombien Gabriel Garcia Márquez, récit époustouflant qui fait tourner les générations et efface la frontière entre irréel et réalité dans un village, Macondo, « où l’on meurt quand on peut ». Garcia Márquez, avec L’Automne du Patriarche (1975), a écrit lui aussi son livre de dictateur, paranoïaque, si vieux qu’il n’a plus d’âge, déambulant dans un palais dévasté.
Un an plus tôt, en 1974, Augusto Roa Bastos, grand romancier du Paraguay, publie Moi, le Suprême, portrait réaliste d’un homme qui ne l’était pas, le Dictateur Suprême, puis Perpétuel, José Gaspar Rodriguez de Francia, qui gouverna le pays de 1814 jusqu’à sa mort, en 1840.
Le Chilien Luis Sepúlveda, torturé sous le régime de Pinochet, avait sans doute des raisons personnelles pour ne pas ajouter son dictateur à la liste des autres. Il aborde cependant ce thème dans deux ouvrages, une collection d’articles avec La Folie de Pinochet (2002), et un polar, La Fin de l’histoire (2017).
En deux ouvrages d’un fantastique éclatant, Le Roman de Peron (1985) et Santa Evita (1995), Tomas Eloy Martinez établit la topographie du régime autoritaire et de ses affiliés. Enfin, Mario Vargas Llosa, Péruvien d’Arequipa et Espagnol de Madrid, ferme ces « satrapies » (c’est son mot) avec La Fête au Bouc (2000), d’un réalisme inoubliable sur l’assassinat en 1961 du dictateur de Saint-Domingue, Rafael Leonidas Trujillo.
Avec L’Appel de la tribu (2018), Vargas Llosa confirme son goût des sociétés ouvertes que chanta avant lui Karl Popper, et dès lors chérit le métissage, thème récurent, de la littérature d’Amérique latine.
Le Mexique a tenté d’instaurer l’homme nouveau du Nouveau Monde, métis idéalisé. Le Monumento a la Raza, sur la place des Trois Cultures, lui est dédié. Mais ce métis a pour malheur d’être le voisin des Yankees et Carlos Fuentes souligne dans La Mort d’Artemio Cruz (1962) l’ambiguïté du Mexicain à l’endroit de son puissant voisin du Nord : « Tu admires leur efficacité, leur confort, leur hygiène, leur pouvoir, leur volonté, et tu regardes autour de toi et l’incompétence, la misère, la crasse, l’indolence, le dénuement de ce pauvre pays qui n’a rien te semblent intolérables. »
Le métissage est une évidence au Brésil où indigènes, Portugais et esclaves africains ont fait ensemble, au fil des siècles, les enfants d’aujourd’hui. Un essai brillant, Racines du Brésil, de Sérgio Buarque de Holanda (1936), met au crédit des Portugais « l’absence de tout orgueil de race » qui a fait du métissage « un procédé normal ». Et l’on en retrouve les acteurs dans deux grands romans, Vive le Peuple brésilien (1984) de João Ubaldo Ribeiro, et La Cité de Dieu (1997), de Paulo Lins, nom d’une favela de Rio où l’écrivain a vécu. Il y règne « la pauvreté pour vouloir s’enrichir, les yeux pour ne jamais voir, ne jamais dire, jamais, les yeux et le cran pour faire face à la vie, déjouer la mort, rafraîchir la rage, ensanglanter des destins, faire la guerre et être tatoué ».
La putain, quant à elle, garde sa dignité et ses multiples rôles, consolatrice, généreuse, disruptive. L’Argentin Pedro Mairal, dans Une nuit avec Sabrina Love (2001), n’oublie ni la générosité ni les malheurs de la sujétion. Dans Mémoire de mes putains tristes (2004), García Márquez met en scène un nonagénaire et son désir d’une jeune vierge, méditation morose sur le déclin de la vieillesse et les souvenirs des femmes, tandis qu’une tenancière rappelle au protagoniste que « la morale est une question de temps ». Plus picaresque et joyeux, le roman de Mario Vargas Llosa Pantaleón et ses visiteuses (1974) présente un officier conformiste, mais bon organisateur, chargé d’établir un bordel de campagne pour calmer les ardeurs des soldats stationnés dans l’Amazonie péruvienne. Et comme toujours, le sexe bouscule l’ordre établi.
A lire aussi: L’Amazonie est-elle un grenier ou une bibliothèque ?
L’exil, enfin, constitue un chagrin partagé par de nombreux écrivains. Notons parmi eux Julio Cortázar, le plus parisien des Argentins, et son roman « contraint » avec double lecture et une touche de surréalisme, Marelle (1979). Ceux de Cuba sont parfois partis à Paris, eux aussi, sans jamais oublier leur île. Ainsi Alejo Carpentier, qui vient en France en tant que diplomate cubain (exil ambigu) et décrit, avec Le Siècle des Lumières (1962), l’influence de la Révolution française dans les Caraïbes. Eduardo Manet, Cubain devenu français, offre le reflet de sa vie errante dans La Sagesse du singe (2001). Reinaldo Arenas, poète, romancier et homosexuel, mêle bonheurs compliqués, humiliations, son exil à New York et son sida dans Avant la Nuit (1990). Enfin, Zoé Valdés qui, en exil en France, nous dit La Douleur du dollar (1996) dans La Havane de Castro : « La mer, les palmiers, l’ombre sous les arcades, le doux soleil permanent sans vacances, tout ce tralala de la cubanité qui ressemble tant à une maladie vénérienne. »