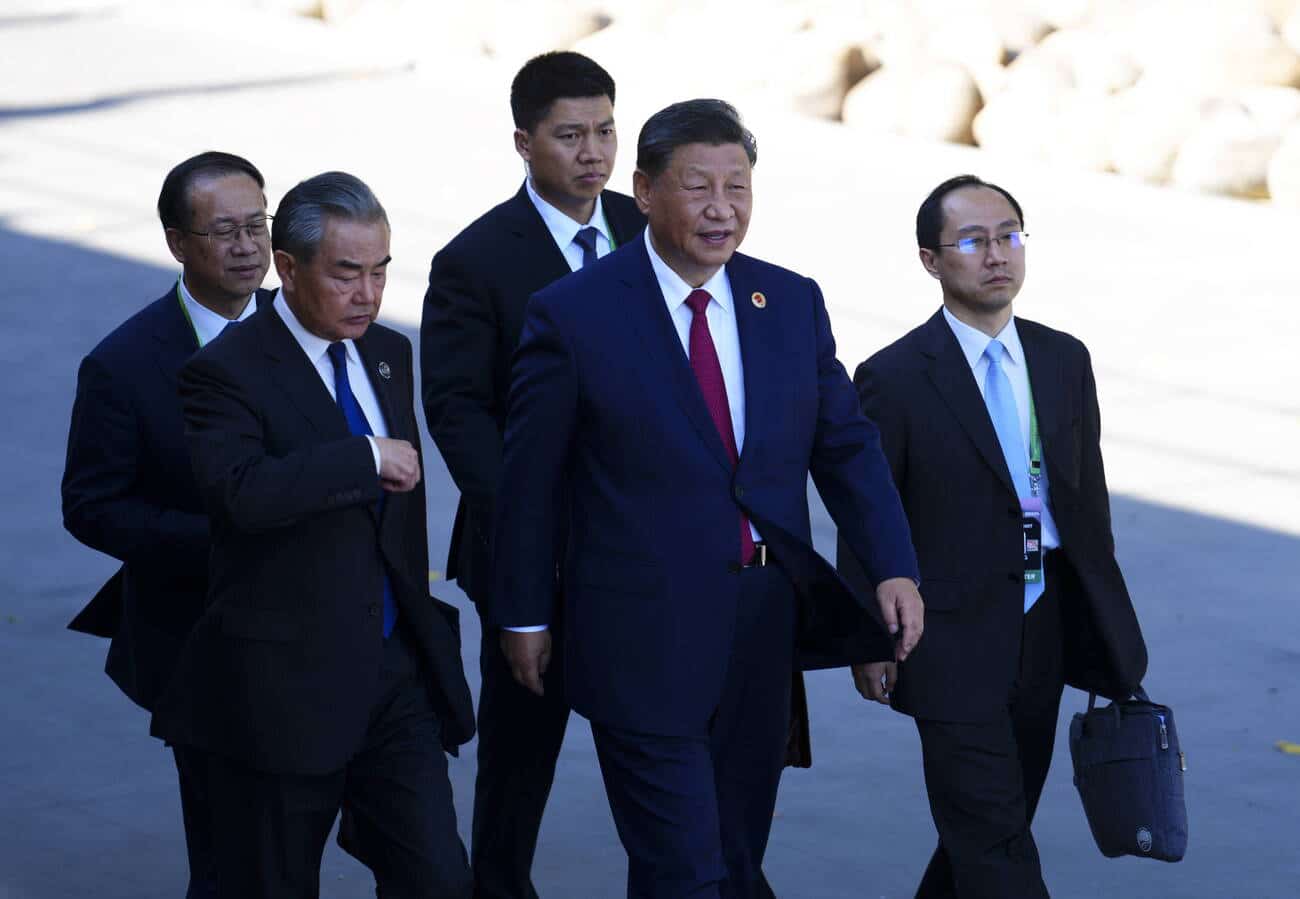L’américanisation est d’abord un transfert vers l’Europe occidentale. Notamment celui des méthodes de production, des modèles de consommation, du mode de vie, des pratiques socioculturelles ou des cadres de pensée nés ou adoptés originellement aux États-Unis. Si l’on suit cette définition, l’américanisation de la France depuis la seconde partie du vingtième siècle relève de l’évidence et les nombreux exemples observables chaque jour par tout un chacun viendront la confirmer.
Cette américanisation correspond-elle à une volonté expresse d’emprunt au modèle américain ou à un processus d’homogénéisation passive conforme à celui de l’ensemble des sociétés occidentales, lequel n’impliquerait pas alors automatiquement adhésion idéologique au modèle suggéré par le soft power ? Après tout, la modernité pose partout les mêmes problèmes et les mêmes solutions paraissent s’imposer, venues du pays le plus moderne au monde, les États-Unis.
La particularité de l’américanisation de la France se situe entre ces deux attitudes, puisque c’est dans notre pays que les résistances à ce processus furent les plus fortes, notamment chez nombre de chefs d’entreprise et de scientifiques, alors même que l’ensemble de la société française absorbait massivement les mœurs américaines.
Au commencement était l’économie
C’est surtout après le second conflit mondial que les États-Unis font valoir en France leur modernité et primauté confirmées par leur victoire. Alors la consommation de masse vient compléter et soutenir la production de masse. Un mode cohérent de fonctionnement de l’économie surgit, « cimenté par une culture de masse dont ce n’est pas la moindre des fonctions que d’assouvir et de générer des besoins de consommation ».
Les responsables français qui espèrent le relèvement économique de la nation attendent beaucoup de cette modernité conquérante venue d’Amérique. Le modèle américain de la prospérité s’impose d’autant plus en France que l’aide économique, en particulier le plan Marshall, est accordée en échange de l’adoption des méthodes américaines.
Les entrepreneurs français sont incités à aller étudier aux États-Unis mêmes dans le cadre des « missions de productivité » et des « missions techniques » envoyées aux États-Unis à l’instigation des branches professionnelles, des gouvernants ou des entreprises pour s’imprégner des techniques de production et de management qui expliquent la supériorité américaine. Ces missions de productivité ont un rôle considérable dans la diffusion de l’influence économique et technologique américaine après la Seconde Guerre mondiale ; le productivisme qu’elles diffusèrent en fit un véhicule de l’américanisation. Le promoteur de la productivité en France était Jean Fourastié, collaborateur de Jean Monnet.
Les missions de productivité françaises prenaient différentes formes : professionnelles, avec des ingénieurs, des cadres et des syndicalistes ; techniques et interprofessionnelles, avec de jeunes ingénieurs et diplômés des grandes écoles ; mais aussi managériales à destination de dirigeants d’entreprises, notamment petites et moyennes, souvent provinciales aussi. Les objectifs étaient le rattrapage technologique, comme dans la sidérurgie ou la construction, l’introduction de nouvelles techniques de management, directement dans l’industrie, ou, de manière indirecte, par l’enseignement de Business Schools à l’américaine.
A lire aussi : Hollywood, fabrique du soft power américain
Avec l’économie, l’American way of life et l’idéologie
À partir des années 1960, les capitaux privés américains ont pris le relais des fonds publics, processus naturel du capitalisme, le travail de séduction et de conversion par la démonstration se situant dorénavant à l’échelle de la très grande entreprise multinationale. Leur rôle grandissant accompagne une libéralisation décisive des échanges internationaux. L’internationalisation de la production, l’extension des marchés et la tendance à uniformiser modèles de consommation et pratiques culturelles de masse mettent à la portée des États-Unis toutes les couches de la société française jusque-là à l’abri des influences prépondérantes d’origine étrangère.
Le processus d’américanisation de la France par l’économie devient phénoménal ; il s’accélère et touche l’ensemble des secteurs, le capitalisme américain étant orienté tant vers la production de biens intermédiaires et de biens d’équipement que celle de biens de consommation (Boltanski). Si le Coca-cola, le chewing-gum, les blues jeans, la science-fiction, les comics, le Reader’s Digest et le film hollywoodien (par les accords Blum-Byrnes de 1946 préparés par Jean Monnet) déferlent sur la France, ils sont accompagnés par la standardisation du mode ménager, la préfabrication de la construction, l’aménagement de l’espace pavillonnaire et industriel et la création de campus universitaires, non plus en centre-ville à l’européenne mais en périphérie à l’américaine, parmi de nombreux exemples.
Le modèle américain transféré repose de plus en plus sur l’essor de la publicité, lui-même en liaison avec l’affirmation grandissante du rôle social des médias (radio, télévision, téléphone) et l’irruption de l’informatique. Le lien entre révolution des moyens de communication et américanisation est au moins aussi fort qu’avec les flux et les échanges d’hommes, de marchandises et de capitaux. Le message est toujours le même : la libéralisation du commerce, c’est la paix et la démocratie. Il faut détruire les entraves au commerce qu’engendre l’État-Nation et le nationalisme, sa conséquence nécessaire, créer un nouvel ordre global destiné à la « grande famille humaine » (selon la formule d’Allais).
À la suite des investissements des grandes firmes d’outre-Atlantique et des prises de participation des fonds de pension, se généralise la formation des cadres de l’économie dans des MBA et des écoles de commerce américanisées où s’apprennent également méthodes modernes de management, de communication et de marketing. Si, dans les années 1960, les Français admirent la supériorité du management et de l’organisation américaine, dans les années 1990 c’est l’essor des nouvelles technologies (informatique, robotique, miniaturisation, biotechnologies, etc.) qui les fascine.
La dimension politique de l’américanisation provoque les programmes de libéralisation intérieure, de régulation par le marché, de déstructuration du cadre collectif. Enfin, l’américanisation s’applique au domaine des idées : foi dans la technique pour la résolution de tout problème, illusion des solutions instantanées, incapacité à lier les faits entre eux ou à leurs causes (Saul), notamment par le phénomène d’hyperspécialisation, de plus en plus visible dans les formations de l’Enseignement supérieur, par exemple. Si la France est la patrie des ingénieurs, les États-Unis est celle des lawyers, et l’américanisation a imposé la tendance lourde à la judiciarisation des rapports sociaux au pays de Descartes.
Le « production drive » a constitué à la fois un outil de modernisation et de propagande et, par suite, de domination (selon l’analyse de Kuisel) notamment par l’insistance à l’intégration européenne de la France.
Un nouveau monde
En raison d’un mélange de fatalité et d’engouement, la transformation culturelle de la France et le refaçonnement de la société se sont opérés en profondeur. L’investissement massif dans les nouvelles technologies de l’information et de la communication donne aux Américains la maîtrise de l’image et de la représentation et leur permet de ringardiser les autres modèles et de diffuser leur mode de vie, notamment via les GAFAM. Visiblement d’abord : les Français et leurs journalistes-animateurs sur-utilisent les anglicismes-américanismes et favorisent certains genres musicaux répétitifs. La généralisation d’un menu télévisuel dont les sources sont aisément identifiables, a imposé séries d’outre-Atlantique ou imitées, mais aussi techniciens, professionnels, experts, spécialistes disciplinaires et commentateurs familiers des plateaux de télévision aux heures de grande écoute. Une simple plongée dans les archives audio de l’INA nous fait ressentir combien, en quelque trente années seulement, nous sommes passés du recours aux érudits généralistes développant des raisonnements construits, même s’ils étaient parfois un peu ennuyeux, à la recherche de l’effet immédiat et de l’affect, au divertissement quasi systématique, à la mise en scène, à la télégénie, aux effets pour la galerie, aux petites phrases et aux réparties (bashing, buzz, etc.) à l’américaine.
Dans le cadre politique, les campagnes électorales insistent de plus en plus sur les postures, le physique des candidats, la bataille marketing, la fabrication d’« images » et d’« éléments de langage », l’influence des spin doctors, des sociétés de communication politique et de sondage. Tout cela est rattaché, avec plus ou moins d’exactitude, à l’influence américaine. Tout comme l’importation artificielle du système des primaires en France faisant récemment exploser les deux partis dits de gouvernement. Encore plus discrètement, les sondages Gallup à leur époque, puis les messages plus ou moins subliminaux de la communication politique et commerciale se sont transformés aujourd’hui en techniques d’orientation de l’opinion publique et d’orchestration d’un consensus censé caractériser la politique américaine – ce qui est d’ailleurs de moins en moins vrai. Les partis de droite français sont devenus de plus en plus libéraux tandis que ceux de gauche, eux aussi devenus libéraux, ajoutent la touche ouvertement libertaire pour se distinguer. La droite s’est d’ailleurs rebaptisée « Les Républicains » tandis que la gauche ressemble de plus en plus aux démocrates d’outre-Atlantique.
Car l’américanisation est aussi sociale : évolution vers une pédagogie qui marginalise les savoirs, affirmation du féminisme mais aussi d’une société de violence, montée des sectes, libéralisation des mœurs, promotion du communautarisme. La généralisation de la restauration rapide (fast food), qui fait partie des éléments visibles, cache la réalité plus profonde d’un mode de vie domestique devenu américanisé où la place de la cuisine traditionnelle s’est réduite au profit de celle, industrielle, livrée préparée et destinée au micro-ondes.
Même la conduite des Affaires étrangères n’oublie pas de se conformer au modèle américain, pénétrée de moralisme, apprêtée aux exigences des médias, personnalisée sans justification ou exprimée en formules empruntant au domaine des relations publiques. Le phénomène se traduit par l’éclipse du réalisme, la critique du modèle westphalien et viennois, l’adoption de Livres blancs de Défense et de traités européens consacrant le placement sous l’aile américaine et… le retour de la France dans le commandement intégré de l’OTAN.
La conversion des élites
L’américanisation s’est également illustrée par une action spécifique sur les élites françaises en s’appuyant sur des Français admirateurs du système politique et économique américain, comme par exemple Jean-Jacques Servan-Schreiber et le tirage à dix millions d’exemplaires de son Défi américain, l’envoi d’étudiants et de professeurs aux États-Unis grâce aux bourses Fulbright entre autres (voir pages 42-43). Ce qui plaît à cette élite urbanisée et câblée aux références new-yorkaises, c’est l’exemplarité de l’américanité parce qu’elle représente la configuration sociale, économique, politique et culturelle la plus fonctionnelle de son époque, en dehors de tout jugement de valeur, et celle qui légitime son pouvoir.
Pourtant cette jeunesse, actrice privilégiée de l’américanisation en France, répète, sans le savoir, un message vieux de soixante-dix ans selon lequel les États-Unis d’aujourd’hui sont l’avenir de demain ; avec leur dizaine ou vingtaine d’années d’avance, les Français seront demain comme les Américains sont aujourd’hui, bref les maîtres de la modernité. Pourtant, parmi de nombreuses réussites comme Jean Monnet, les cas de Jean-Jacques Servan-Schreiber ou de Jean Lecanuet, par exemple, viennent démontrer par leur échec politique combien les Américains ont pu parfois surestimer l’efficacité de ces relais auprès de l’opinion française.
Car les résultats ne sont pas totalement à la mesure des espérances. Plus perplexe qu’admiratif, le public français n’est pas persuadé des mérites du modèle promu. Le paradoxe est que la France est en même temps américanisée et critique du processus d’américanisation. Le regard populaire de beaucoup de Français sur la société américaine n’est guère flatteur : ils y voient mépris de ceux qui ne réussissent pas, brutalité, idolâtrie de la technique, utopisme, bonne conscience, superficialité, simplisme, conformisme social, « creuse philosophie du bonheur ». Le vide intellectuel et culturel le disputerait à la mystification sociale. Le jugement est sévère et même injuste, mais il est largement répandu.
Cependant la transplantation et les greffes ne sont plus l’unique forme d’américanisation : la mondialisation a imposé, avant son reflux, le recours à des formes d’américanisation qui peuvent ne pas être d’origine américaine et, subrepticement, la France est ainsi contrainte notamment par une Union européenne devenue à son tour « génératrice d’américanité[1] ».