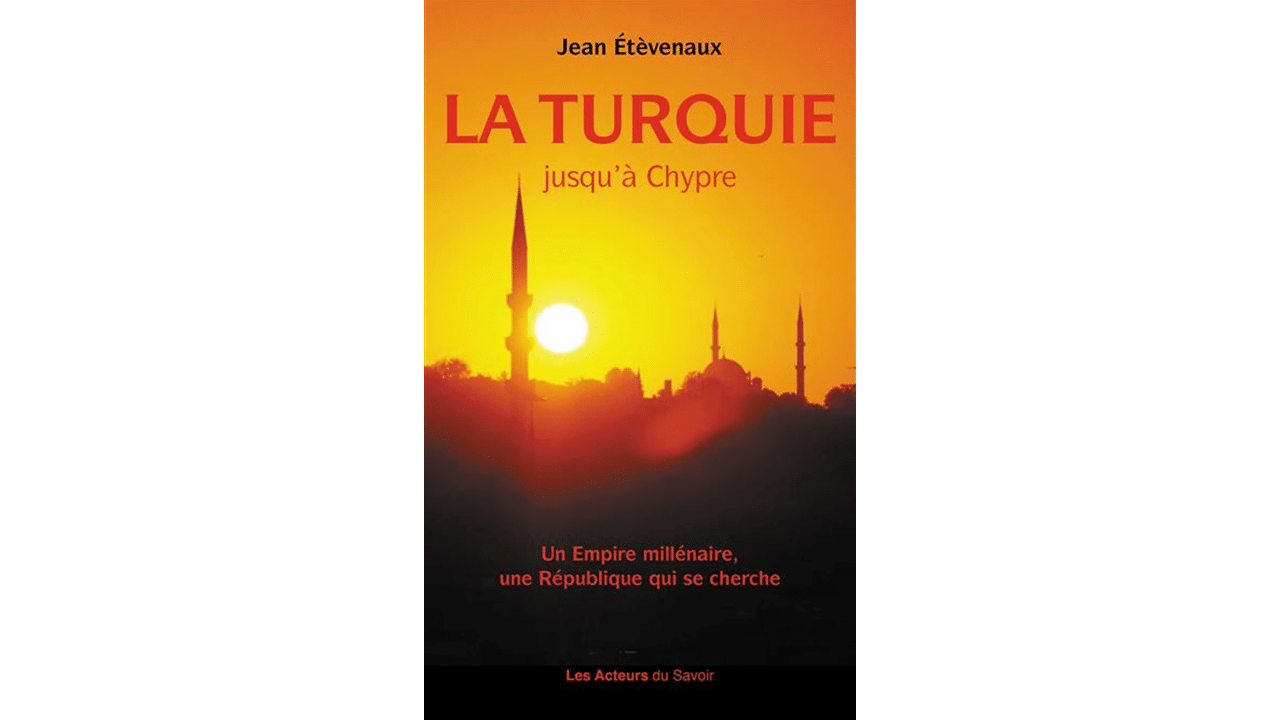« Les héritages qui nous habitent plus ou moins consciemment relèvent autant des institutions que de la psychologie et constituent une culture sociale et politique très particulière. » Ainsi Emmanuel de Waresquiel étudie-t-il dans son dernier ouvrage la construction et la diffusion des mythes liés à la Révolution.
Emmanuel de Waresquiel est l’auteur d’une œuvre imposante sur le xviiie siècle, la Révolution, l’Empire et les monarchies constitutionnelles. Il a consacré une biographie à Talleyrand et Fouché, ainsi qu’une étude au procès de Marie-Antoinette.
Propos recueillis par Lucien Rabouille
Emmanuel de Waresquiel, dans votre ouvrage, vous ne traitez pas vraiment la Révolution comme fait historique, mais plutôt comme événement. Vous vous intéressez au souvenir qu’elle a laissé dans la culture humaine et à la manière dont ses scènes vont être écrites, réécrites, enjolivées ou noircies. Qu’est-ce qui a pu motiver cette démarche ?
La Révolution française est au cœur de mes recherches depuis une vingtaine d’années. Dans cet ouvrage, j’ai davantage travaillé sur le rapport de l’événement à ses mémoires. Je prends des événements, des lieux, des symboles de la Révolution. Je les étudie sur le temps long de l’histoire dans une perspective diachronique pour en comprendre la réception. Comment et pourquoi ces lieux, ces événements, ces symboles ont-ils façonné nos imaginaires ? Des sources immédiatement contemporaines (carnets, journaux, rapports, correspondances) nous servent de témoignages. En les utilisant, en les analysant, on mesure mieux leurs déformations de mémoire. Ce dont on s’aperçoit en effet, c’est que ces événements ont été vécus d’une façon bien différente de la manière dont ils ont été racontés par la suite. Ce qui m’intéresse comme historien, c’est de comprendre comment ces événements ont été utilisés au travers des régimes politiques qui se sont succédé jusqu’à nos jours.
Le serment du Jeu de paume par exemple n’est pas le premier des grands serments laïcs de la Révolution. Il a été prêté sur la défensive dans le brouillard des peurs qu’habitaient les députés du tiers état persuadés qu’ils seraient renvoyés ou arrêtés par le roi. La Bastille n’a pas été prise. Le marquis de Launay en a ouvert les portes. Elle n’a pas été attaquée parce qu’elle était « l’antre de la tyrannie », mais parce qu’il y avait de la poudre. Les trois couleurs ne sont pas nées miraculeusement le 17 juin 1789 quand Bailly, premier maire de Paris, offre à Louis XVI la « cocarde de la liberté ». Il a fallu attendre trois ou quatre ans avant qu’elles ne deviennent ce qu’elles sont aujourd’hui. Le blanc n’était pas la couleur de la monarchie, ce sont les révolutionnaires qui en ont fait le symbole de la réaction en réinventant en partie la fameuse scène du banquet offert par des gardes du corps du roi aux officiers du régiment de Flandres, à Versailles, le 1er octobre 1789.
Même chose pour la guillotine : au moment de la discussion sur le Code criminel, elle est vue comme un progrès. De fait, elle constitue une amélioration dans la façon de donner la mort. Puis elle prend une dimension politique et légitimante. Elle devient la « sainte guillotine », au cœur des nouvelles sacralités laïques de la Révolution. Elle est, le 21 janvier 1793, l’autel métaphorique et symbolique d’un renversement de souveraineté, de la tête du roi à celle du peuple, par le sang versé de l’ancien monarque. Elle redeviendra par la suite le gibet terrifiant des imaginaires romantiques. Il faut passer par la littérature si l’on veut comprendre cette obsession de têtes coupées qui habite presque tous les romans du xixe siècle. Relisez les pages consacrées par Victor Hugo à la guillotine dans Quatre-vingt-treize.
La littérature – et tout autant les images – nous en dit souvent plus sur les imaginaires d’une époque. Par leurs intuitions, les romanciers ont, mieux que les historiens, cette capacité à restituer un climat, l’air du temps d’une époque donnée.
Les symboles et mots d’ordre de la Révolution ont servi de puissants leviers. Vous étudiez dans votre ouvrage la séduction qu’ils ont exercée sur les contemporains et leurs héritiers, c’est-à-dire nous.
La Révolution, c’est en effet le pouvoir des mots : qui tient la tribune des différentes assemblées qui se sont succédé à cette époque, jusqu’à la Convention nationale, tient le pouvoir tout court. Significativement, Robespierre est tombé en juillet 1794 pour n’avoir pas pu prononcer son discours à la tribune de la Convention. On est entré avec la Révolution dans le monde des apparences, des abstractions et des mots. Talleyrand avait très bien compris cela lorsqu’il demandera en avril 1814 aux anciens caciques des assemblées révolutionnaires de travailler à une constitution nouvelle : « Voyez Garat [l’ancien ministre de la Justice de 1792], il y a de quoi remuer les âmes patriotiques et faire les plus belles phrases du monde sans danger. » Et de parler des « patriarches de la Révolution qui savent si bien démolir les trônes avec les mots de patrie, de tyrannie et de liberté ».
Nombre de principes révolutionnaires peinent à trouver leur traduction concrète. Par exemple, celui de l’unité et de l’indivisibilité de la nation. La Révolution est indissociable d’un idéal d’unanimisme. Elle n’a jamais bien traité ses minorités d’Assemblée dont nombre de ses membres ont été exclus quand ils n’ont pas été envoyés à la guillotine. En pensant l’indivisibilité, la Révolution s’est montrée incapable de penser ses adversaires autrement qu’en ennemi ou en traîtres. Les conditions brutales et unilatérales dans lesquelles s’effectue en 1789 le renversement de souveraineté, la transformation de l’ancien absolutisme monarchique en un autre, au nom de la nation puis du peuple, expliquent en partie nos héritages politiques qui privilégient l’affrontement plutôt que le compromis.
Tout cela ne va pas sans une certaine forme de réécriture de l’histoire. Si le serment pourtant fondateur du 17 juin 1789 par lequel les députés du tiers état des États généraux du royaume se constituent en Assemblée nationale est sorti de notre mémoire collective, c’est qu’il n’était pas unanime. Plus de 90 députés – sur 500 – votent contre. On lui préfèrera très vite celui du 20 juin alors même qu’à la lecture de leurs journaux écrits à chaud, les acteurs de ces deux journées accordent beaucoup plus d’importance à la première qu’à la seconde.
Dans les faits, l’unanimité est une utopie. Sa recherche obstinée explique en grande partie les glissements de violence de la Révolution, jusqu’à la Terreur. Le principe d’indivisibilité contient en germe un principe d’exclusion. L’indivisibilité appelle le complot, qu’il ait été réel ou imaginaire, et le complot est au cœur de la dynamique révolutionnaire.
À lire également
 La Conciergerie : un haut lieu de la Révolution française. (c) Pixabay
La Conciergerie : un haut lieu de la Révolution française. (c) Pixabay
Quelles réminiscences de la Révolution française observe-t-on encore aujourd’hui ?
Elle constitue aujourd’hui encore les murs de la maison : la souveraineté du peuple, les droits de l’homme, les codes, l’administration centralisée, et uniformise, à commencer par les départements, la notion de représentation nationale jusqu’à la Convention et les conseils du Directoire. J’ai voulu montrer dans mon ouvrage que ces héritages qui nous habitent plus ou moins consciemment relèvent autant des institutions que de la psychologie et constituent une culture sociale et politique très particulière. La Révolution a inventé des principes abstraits et les a placés très haut comme autant de « terres promises » : indivisibilité de la nation, égalité, liberté, fraternité. Certains de ces principes nourrissent chez les Français un attachement quasi obsessionnel. C’est le cas de l’égalité, d’abord civile puis politique. Nous y sommes si attachés que nous en sommes encore à courir après une impossible égalité sociale. Par ailleurs, la Révolution était aussi le théâtre d’un conflit entre le régime d’assemblée et le pouvoir de la rue, ce qui donne souvent lieu à des déformations mémorielles. Ainsi, quand les Gilets Jaunes se rendent au Jeu de paume pour prêter un nouveau serment, ils ne réalisent pas que cette scène incarne tout ce qu’ils détestent, à savoir la démocratie représentative. On se réclame souvent d’une Révolution qu’on ne connaît pas.
Les mythes peuvent être compris comme un ensemble de récits légendaires. Pourtant, la Révolution hérite du rationalisme des Lumières et s’est attaquée au cléricalisme. On comprend en vous lisant qu’elle a aussi versé dans l’irrationnel et suscité des adhésions quasi religieuses. Comment éclairer ce paradoxe ?
En matière religieuse, la Révolution se déroule sur un fond d’ambiguïté. Elle est profondément imprégnée de christianisme. À la Convention, un député sur dix est d’origine cléricale. Le bas clergé adhère à la Révolution à ses débuts au nom d’un idéal de retour à un christianisme des origines, égalitaire, épuré de ses ors, fortement imprégné de jansénisme. En juin 1789, le ralliement des curés du premier ordre du royaume aux députés du tiers état contribue largement à la victoire de ces derniers.
D’un autre côté, toute l’histoire de la Révolution est celle de l’invention d’une nouvelle sacralité laïque par les serments prêtés à la romaine, par de nouvelles icônes, par de nouveaux martyrs, par des processions et des fêtes imprégnées de paganisme. Cette nouvelle sacralité laïque s’impose souvent par la violence dans la mesure où l’ancienne foi catholique résiste. Ajoutons que l’exécution du roi, dans sa dimension proprement sacrificielle, est une phase essentielle de l’instauration de cette nouvelle sacralité.
La Révolution est à ce titre volontiers contradictoire. Cette volonté d’imposer la laïcité tout en récupérant les anciens codes du christianisme (« catéchisme révolutionnaire », « missionnaires de la République ») conduit à des tensions permanentes et à des ambiguïtés dont on n’est toujours pas sorti. Les discours d’inauguration des temples de la Raison, de la Vérité ou de l’Être suprême procèdent d’un curieux mélange de philosophie rationaliste, de providentialisme et de déisme naturaliste à la sauce rousseauiste. Voltaire et son grand horloger ne sont pas très loin non plus. On retrouve ces ambiguïtés révolutionnaires sur la nature même de la sacralité à l’époque des débats sur les lois laïques de 1905 comme dans les controverses contemporaines, entre les partisans d’une laïcité de combat et ceux d’une laïcité comprise comme une simple règle du jeu, comme une garantie au libre exercice des consciences et des cultes.
À lire également
Histoire de la laïcité en France, entretien avec Emmanuel Tawil
Dans l’étude du politique, le mythe recouvre une acception plus large que la légende ou la fiction. C’est aussi un récit mobilisateur qui utilise les inconscients et les imaginaires à des fins politiques. Georges Sorel, Raoul Girardet, Raymond Aron… ont travaillé sur cette question. Par-delà le seul événement révolutionnaire, quelle place accordez-vous au mythe dans l’histoire et le discours politique ?
Ma démarche n’est pas celle des sciences politiques. Je n’aborde pas le mythe comme quelque chose qui nous serait donné et qui nous préexisterait, mais plutôt comme une déformation de ce qui a été. Aussi, je pars de l’événement lui-même et de la manière dont il a été vécu par les contemporains en m’intéressant à ce dont ils ont témoigné. À partir de là, on peut reprendre l’histoire de l’événement et voir comment il s’est transformé en mythe. On comprend alors les raisons de l’idéalisation de certains événements devenus fondateurs, par les moyens d’une construction volontariste et étatique qui parfois échappe à leur créateur. Les mythes de la Révolution me font penser à une sorte de bovarysme politique (cf. Flaubert, Madame Bovary, lorsqu’au dîner du château, Emma trouve le sucre plus blanc qu’il ne l’est en réalité).
Raoul Girardet (Mythes et mythologies politiques, 1986) procède par catégories et recherche dans l’histoire des exemples propres à les justifier : l’âge d’or et le paradis perdu, le complot, le sauveur… Ma démarche est un peu différente. Je commence par étudier l’événement dans le présent de ses sources et j’en observe ensuite les déformations à travers les deux siècles qui nous séparent de la Révolution.
À lire également
Vidéo. Claude Lévi-Strauss : Qu’est-ce qu’un mythe ?
Les mythes sont donc une construction politique. Ils ont aussi un usage politique. Quels besoins les acteurs politiques ont-ils eu d’enchanter des événements et de les réécrire en déformant l’histoire ?
Dans leurs usages politiques, les mythes sont incroyablement élastiques. Leur puissance se mesure à leur souplesse. Lorsqu’on étudie les évolutions des mémoires de la Révolution sur le long terme, on leur trouve sans cesse des glissements de sens. Un seul exemple avec le drapeau : le tricolore naît à gauche sous la Révolution et devient en 1871 celui de la bourgeoisie conservatrice de M. Thiers, face au drapeau rouge de la révolution sociale et ouvrière. Les premiers grands discours « écologiques » sont prononcés sous la Restauration, à la Chambre des pairs, par Chateaubriand et certains ultraroyalistes à l’occasion de la discussion du projet de loi de vente des forêts du clergé. L’écologie (et le régionalisme) restent à droite jusqu’à la Seconde Guerre mondiale au risque de certaines compromissions avec le régime de Vichy, puis passent à gauche après la Seconde Guerre mondiale. Le colonialisme naît à gauche avec Ferry puis passe à droite. Les politiques se servent le plus souvent de l’histoire sur fond d’amnésie, à leur usage personnel, en fonction de tel combat ou de telle thèse. Au mieux comme d’une boîte à outils, au pire comme d’un instrument de légitimation de leurs programmes ou de leurs actes.

Détruites à la Révolution, les statues des rois de Notre-Dame furent retouvées par hasard en 1977. (c) SIPA 00700396_000084
Justement, notre société actuelle a-t-elle encore besoin de mythes ?
La mémoire dans l’usage politique qui en est fait est une arme très puissante. On l’évoque à des fins de réconciliation nationale au lendemain des périodes de guerres ou de crises. Je pense au rituel des grandes panthéonisations, depuis celle de Jean Moulin et du discours de Malraux en 1964, comme si toute la France avait été résistante sous l’Occupation. Il faut attendre 1995 et le discours de Jacques Chirac avant que l’on ne finisse par admettre la responsabilité du régime de Vichy dans la déportation des juifs. Les choix de mémoire qui furent faits après-guerre sont évidemment politiques.
Ce besoin qu’éprouvent les sociétés de cultiver leur mémoire naît également d’un constat pour le moins mélancolique. La Révolution a été vécue comme une formidable accélération du temps. On a fait table rase du passé. Tout ce qui a précédé est voué aux gémonies. Souvenons-nous du discours de Rabaut Saint-Étienne à la tribune de l’Assemblée nationale : « L’histoire n’est pas notre code. » L’invention même du mot « Ancien Régime » en dit long sur cet état d’esprit. Nous éprouvons aujourd’hui ce même sentiment d’accélération du temps par la révolution de nos moyens de communication en constante évolution depuis trente ans : Internet, les réseaux. Le passé s’éloigne quand on ne l’a pas purement et simplement oublié. On y pense comme on penserait au « monde d’avant », comme d’un âge d’or à jamais révolu, sans en avoir l’intelligence et sans en comprendre la complexité. Le présent, sinon l’instant, domine tout. Nous vivons le temps comme une suite d’instants successifs et juxtaposés sans solution de continuité les uns par rapport aux autres. Au point de perdre notre faculté de concentration au bout de quelques pages de lecture. Qui sommes-nous si nous ne sommes plus capables de nous situer dans un rapport de temps qui convoquerait à la fois le passé, le présent et le futur. La connaissance du passé est le secret de notre liberté.