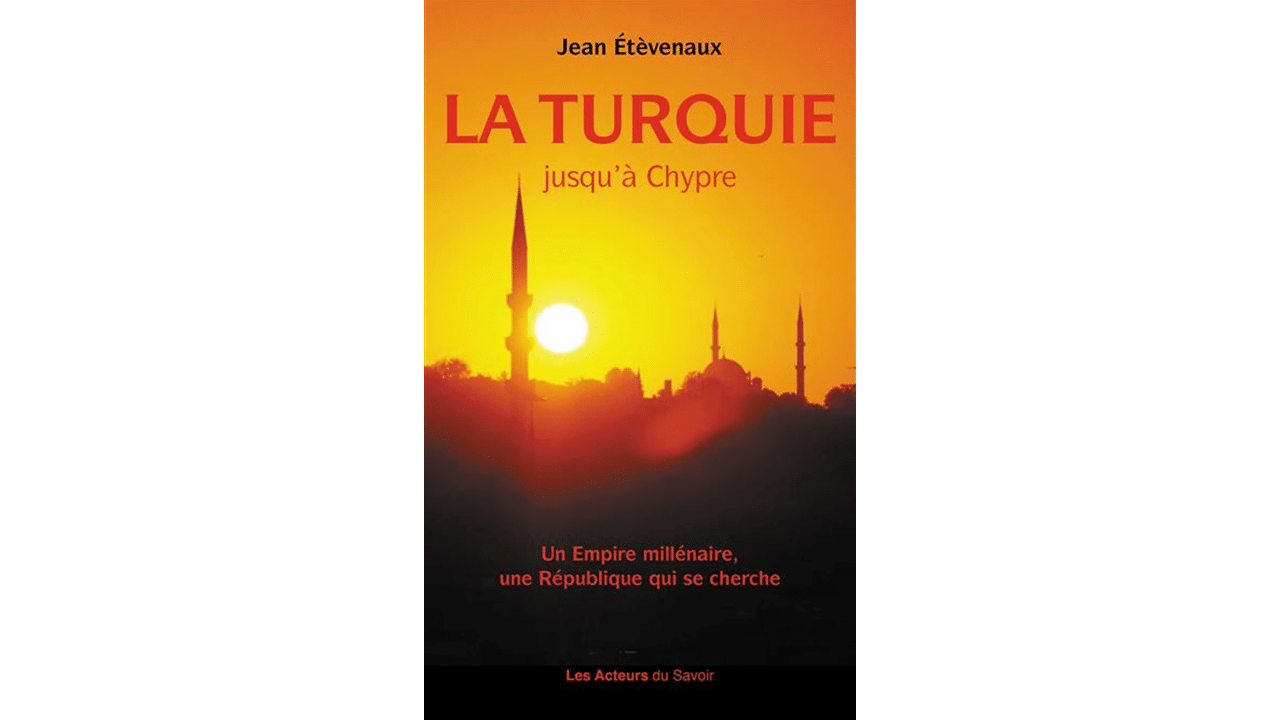Les États-Unis n’ont pas échappé à la guerre civile mais ils en ont fait des films. La réalité et la crainte de cette forme de guerre traversent tout le cinéma américain, comme pour tenter de conjurer le danger.
Fille de l’injustice, la Stasis, s’alarme Platon dans La République, est causée par l’oubli de la vertu de tempérance. Les écarts de richesse au sein de la cité se creusent et les grands, jaloux de leurs privilèges, se heurtent au peuple lésé. Irrésoluble querelle. Les Ottimati contre le Popolo, continue Nicolas Machiavel dans Le Prince, publié à titre posthume, en 1532. Pour le meilleur comme pour le pire, l’inimitié civile engendre une instabilité inhérente à l’exercice politique. À l’orée de la modernité politique, l’ordre constitutionnel prétend réguler la conflictualité afin qu’elle ne dégénère pas en guerre civile, « le pire des maux[1] », s’inquiète à son tour Thomas Hobbes. Alors que les guerres de religion pulvérisent les familles et les royaumes, le contrat social doit l’inhiber. Et l’« égalitarisation des conditions[2] », décèle le philosophe libéral Alexis de Tocqueville, assure le lent mais inéluctable triomphe d’une démocratie stabilisatrice. Avant de conclure que « dans les siècles d’égalité, les guerres civiles deviendront beaucoup plus rares et plus courtes ».
Parce qu’elle a su se construire comme démocratie égalitaire dominée par une classe moyenne tempérée, l’Amérique aurait dû échapper au péril des guerres civiles qui minèrent l’Europe jusqu’à la « guerre civile européenne[3] » du premier xxe siècle (1901-1945).
« We, the People »
La formule ouvre le préambule de la Constitution de 1787. Selon que le lecteur retient le pluriel, pour désigner les Provinces-Unies contre l’Angleterre, ou le singulier du peuple rangé sous une même bannière, la confusion entraîne d’innombrables malentendus. La guerre de Sécession (Civil War), qui opposa les confédérés du sud aux unionistes du nord et de l’ouest des États-Unis entre 1861 et 1865, vide la querelle. La victoire des Yankees consacre la rupture avec le modèle aristocratique européen, fondée sur la transmission d’un capital foncier. La richesse du nord repose au contraire sur une économie de marché industrielle. La concurrence et les opportunités y interdisent en théorie la captation de rentes par des castes aristocratiques figées.
À lire également
La fin d’un empire. Les États-Unis dans le piège afghan. Entretien avec John Christopher Barry
Toutefois, l’égalité libérale, qui efface les classes, ignore les ordres, au profit d’une « moyennisation[4] » de la société, révèle d’inédites vulnérabilités. Le philosophe Guillaume Barrera observe que « la classe moyenne n’a pas d’unité : elle se disloque donc aisément[5] ». Censés éloigner la guerre civile, le contractualisme libéral américain en a plutôt accompagné les mutations.
Le péché originel américain
« Pour être ce que nous sommes, il nous a fallu tuer une grande race et ravager une grande nature. » En 1856, George Sand prête ce propos accusateur à James Fenimore Cooper, père de la littérature américaine et auteur en 1826 du roman Le Dernier des Mohicans, récit de la disparition des tribus indiennes prises dans l’affrontement entre Anglais et Français pendant la guerre de Sept Ans (1756-1763) pour la conquête du Nouveau Monde. D’un côté reflue le monde des Mohawks, liés par la fidélité à la parole donnée, de l’autre progresse la société moderne européenne, fondée sur une double supercherie. La loi n’y est pas consentie mais imposée. Ceux qui la proclament sont les premiers à la transgresser. Alors que les valeurs de l’Amérique libérale triomphent à la faveur de l’effondrement de l’URSS, en 1991, le réalisateur Michael Mann adapte judicieusement le roman de Fenimore Cooper pour déconstruire l’euphorie libérale. « Le Dernier des Mohicans se concentre ainsi sur ce moment où la loi des puissants a produit, non pas de l’égalité, mais une illusion de démocratie, commente l’historien Jean-Baptiste Thoret. Ce qu’apportent avec eux les Anglais et les Français est une forme de perversion, non pas de la loi, mais de l’égalité de tous devant elle, de ce légalisme qui sera bientôt inscrit au cœur de la philosophie politique américaine[6]. » Le massacre des indigènes et le « péché originel » de la consécration de l’esclavage des Noirs par les Pères fondateurs lors de la Convention constitutionnelle de Philadelphie, en 1787, placent le pays de la Destinée manifeste dans une situation ambivalente : l’égalité proclamée, la paix, l’unité dissimulent les violences qui ciblent les dominés.
De la naissance d’une nation à sa « balkanisation »
Loin d’avoir éloigné le spectre de la guerre civile, les États-Unis sont bâtis sur le péril du retour de ces querelles intestines. Le film de 1915 Naissance d’une nation, de David W. Griffith, fonde pendant la guerre de Sécession la mythologie américaine sur l’opposition sanglante entre deux familles, les Stoneman, favorables à l’Union, et les Cameron, fidèles à la Confédération. L’unité reste fragile. La crise endémique de l’économie de marché depuis 2007 altère la cohérence de la classe moyenne américaine dans une société d’individus où les liens communautaires se distendent. Les plus précaires déplorent leur prolétarisation, accélérée par l’érosion des aides sociales. Les classes moyennes supérieures, dans les métropoles, se félicitent d’un système qui favorise leurs performances. L’inégalité est au cœur de cette « ploutocratie » américaine, détaillée par Bertrand Russell[7].
À lire également
États-Unis : les divisions pourront-elles être surmontées ?
L’hypothèse d’une nouvelle Civil War irrigue d’autant plus facilement les cultures populaires, observe la journaliste Barbara Walters[8], qu’elle semble crédible à près de la moitié des Américains. Plutôt qu’une séparation nette entre nord et sud, l’antagonisme radical prendrait selon le géopoliticien Maxime Chervaux la forme d’une « balkanisation de la société américaine[9] ». Elle confronterait la majorité silencieuse conservatrice, des zones rurales et suburbaines, à une Amérique des métropoles dont le wokisme de façade compenserait la férocité capitaliste. The Hunt (2019), de Craig Zobel, dévoile la sanglante chasse à l’homme à laquelle s’adonnent de riches liberals américains, connectés et méprisants, à l’encontre des « deplorables », ces électeurs trumpistes de l’Amérique profonde raillée en 2016 par Hillary Clinton. Dans Get Out (2017), Jordan Peele retourne la bienveillance des démocrates à l’égard des Afro-Américains. La famille Armitage, blanche et progressiste, accueille avec enthousiasme Chris Washington (Daniel Kaluuya), le compagnon noir de leur fille. Pour mieux l’asservir et tenter d’accaparer les qualités supposément supérieures des Coloured People.
Le face-à-face politique est exalté le 6 janvier 2021 lorsque des partisans de l’ancien président Donald Trump s’emparent du Capitole pour entraver l’investiture de son successeur. Les images virales des partisans complotistes de QAnon circulent d’autant plus facilement qu’elles résonnent avec un imaginaire cinématographique occidental. « Les innombrables films-catastrophes témoignent de ce fantasme, qu’ils conjurent évidemment par l’image en noyant tout cela sous les effets spéciaux. Mais l’attraction universelle qu’ils exercent, à l’égal de la pornographie, montre que le passage à l’acte est toujours proche[10]. » Dans son article « L’Esprit du terrorisme », le philosophe Jean Baudrillard observe qu’avant même leur survenance, les attentats du 11-Septembre ont été fantasmés par les œuvres hollywoodiennes, comme La Tour infernale, en 1974, de John Guillermin, ou Black Sunday, en 1977, de John Frankenheimer. « Nous devons garder cette prégnance des images, et leur fascination, car elles sont, qu’on le veuille ou non, notre scène primitive », conclut le philosophe. Dans une Amérique née avec le cinéma, sous le signe de la prolifération de l’image, la fiction nourrit autant la réalité qu’elle s’en inspire, au point d’entretenir une indistinction entre les deux régimes. Les images des combats acharnés au Capitole se superposent étrangement sur celles du peuple de Gotham City insurgé contre les terroristes barricadés dans l’hôtel de ville du film de Christophe Nolan, The Dark Knight Rises (2012). Quant au bien nommé Captain America. Civil War, des frères Russo, il sort sur les écrans en 2016, quelques mois à peine avant l’élection de Donald Trump. Dont la présidence chaotique nourrit en retour le film de guerre Civil War (2023), d’Alex Garland. La photographe de guerre Lee (Kirsten Dunst) tente d’atteindre Washington pour y interviewer le président retranché dans la Maison-Blanche alors que ses forces loyalistes ploient sous les assauts d’une faction séparatiste, les Western Forces, réunissant entre autres la Californie et le Texas.
Mort d’une nation
Hypertrophie du 6 janvier, le film au succès considérable – 115 millions de dollars de recettes pour un budget d’à peine 50 millions – refuse toute mythification de la guerre et de l’histoire américaine. La célèbre réponse que le journaliste fait à Ransom Stoddard (James Stewart) à la fin de L’Homme qui tua Liberty Valance (1962), de John Ford – « Quand la légende est plus belle que la réalité, imprimez la légende » – permettait à l’Amérique de camoufler sa sauvagerie et ses mesquineries. Ici, le dispositif est installé, mais Alex Garland refuse la mythification. Le général Lee avait renoncé à atteindre Washington. Lee Smith y parvient, mais la quête est vaine : elle ne verra du président que son cadavre. Aucun romantisme guerrier dans la défense du dernier carré de soutiens autour du chef fantoche, associé à Mussolini et Ceausescu. Le président gaspille ses derniers fidèles comme boucliers humains avant d’être abattu entre deux sanglots. Le mythe mobilisateur qui fondait l’Amérique, cette « scène primitive », est réfuté.
Pourquoi cette guerre civile ? Quelle entente politique improbable entre le Texas (conservateur) et la Californie (progressiste) ? L’utilisation des appareils argentiques évoque le souvenir du Vietnam (1955-1975), à la fois traumatique et matriciel dans l’histoire du rapport de l’Amérique à l’image violente. Mais un Vietnam confus, amoral, où chaque camp occuperait une position illisible. Certes, le président, manifestement démagogue, est abattu par une soldate noire… mais celle-ci avait la minute précédente abattue une civile noire et désarmée. Toute clarification politique est refusée.
Pourquoi même encore photographier la guerre, puisqu’il n’y a plus ni réseau social ni journal ? Filmer devient un geste vampirique, morbide. Lee meurt d’une balle dans le dos pour avoir eu la faiblesse de céder une fois à l’empathie. S’investir dans son travail, sans chercher de sens à ce carnage, ou mourir : aucune autre loi ne prévaut en Amérique. D’où le noir et blanc désuet des photographies : nul ne témoigne pour un avenir hypothétique. Presser une gâchette ou le déclencheur de l’appareil relève d’un même réflexe pavlovien de réitération d’un passé de violences racistes, d’hécatombes et de lynchages, empruntés confusément aussi bien à l’histoire (les guerres indiennes, la guerre de Sécession…) qu’à la fantaisie hollywoodienne (La Chute de la Maison-Blanche, en 2013, d’Antoine Fuqua).
L’omniprésence de la pellicule traduit un rapport à l’histoire américaine qui ne peut plus s’envisager que rembobinée. Ici, dans cette dystopie, les armes parlent sur le territoire de la bannière étoilée. Comme dans un western. À ceci près que le western indique une poussée vers l’ouest qui procède d’une ascension civilisationnelle. La conquête de l’Ouest coïncide avec celle de la loi et de la justice. À rebours, dans Civil War, les armées de l’ouest se jettent sur la ville de Washington, acculée à l’est. La loi se tait, les armes s’imposent.
La nation de la Destinée manifeste a échoué. Hantée par le souvenir de promesses jamais tenues, elle ne vit plus son histoire que sur le mode de la régression barbare.
À lire également
Les États-Unis face à leurs démons
[1] Thomas Hobbes, Léviathan, Gallimard, 2014 [1648].
[2] Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, Flammarion, 2010 [1835-1840].
[3] Ernst Nolte, La Guerre civile européenne. 1917-1945, Éditions des Syrtes, 2000 [1987].
[4] Henri Mendras, La Seconde Révolution française. 1965-1984, Gallimard, 1984.
[5] Guillaume Barrera, La Guerre civile. Histoire philosophie politique, Gallimard, 2021.
[6] Jean-Baptiste Thoret, Michael Mann. Mirages du contemporain, Flammarion, 2021.
[7] Bertrand Russell, Histoire des idées au xixe siècle. Liberté et organisation, Gallimard, 1979 [1934].
[8] Barbara Walters, How Civil Wars Start: And How to Stop Them, New York, Crown, 2022.
[9] Maxime Chervaux, « Les fantasmes de la guerre civile dans la culture politique américaine », in « La guerre civile », Pouvoirs, 2024.
[10] Jean Baudrillard, « L’Esprit du terrorisme », Le Monde, 3 novembre 2001.