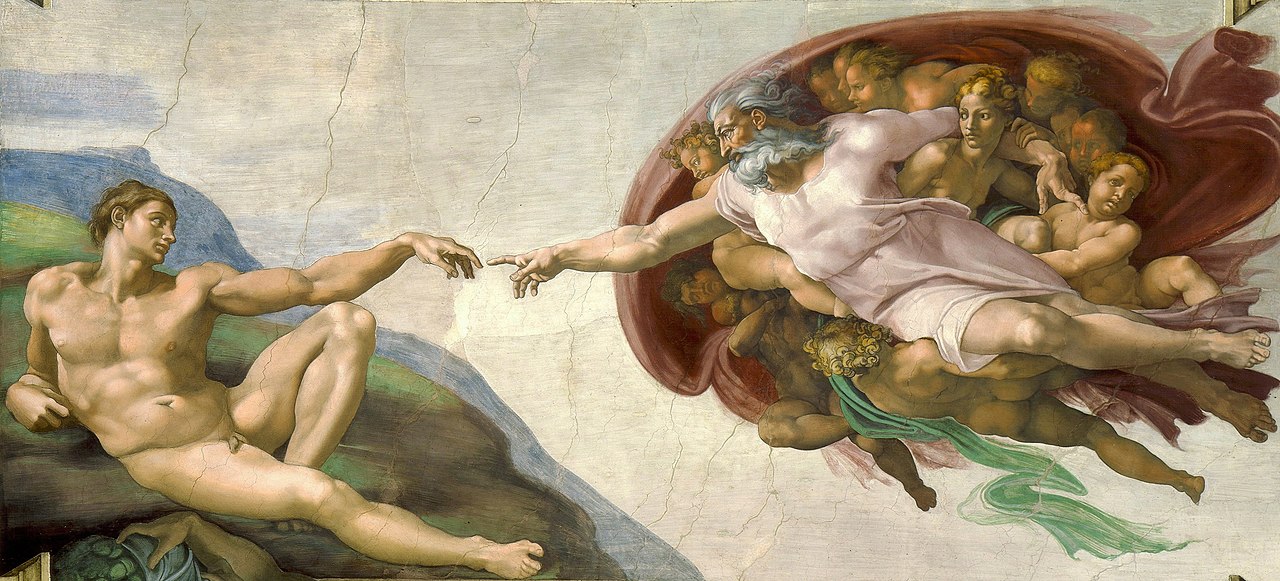Venise ou Cannes ? Animer un festival de cinéma dans une ville est tout autant un choix culturel que politique. Histoires de styles, de visions politiques, d’antagonismes européens.
Article paru dans la Revue Conflits n°51.
D’abord ignorant des capacités de mobilisation collective du cinéma en un siècle où démocratie et césarisme se disputent l’adhésion des masses, Benito Mussolini n’accorde de réelle attention à l’écran qu’au début des années 1930. Il prétend alors contrecarrer la diffusion de films parlants américains[1]. L’interventionnisme de l’État, qui ne cesse de se renforcer jusqu’en 1943, prend notamment la forme d’un soutien en 1932 à la création du festival de Venise au sein de la biennale d’art organisée depuis 1895 et de l’inauguration des célèbres studios de la Cineccittà en 1937.
Première manifestation cinématographique importante au monde, la Mostra d’arte cinematografica compte parmi les vitrines internationales du régime. L’événement, avec sa distribution de coupes pensée sur le canevas des rencontres sportives, est autant mondain et touristique que culturel. Nul ne s’émeut des chemises noires et tous se pressent dans l’ancienne Cité des doges. René Clair s’y fait applaudir sans vergogne pour À nous la liberté et James Whale pour Frankenstein. L’action volontariste de l’État participe à la redynamisation du cinéma italien, au moins en termes quantitatifs : pour encore 45 films produits en 1938, l’Italie en sort 119 de ses studios en 1942. Elle domine le marché européen. Une coupe Mussolini est adressée dès 1934 à un film italien et une autre au meilleur film étranger de l’année.
La Mostra révèle la compréhension tardive par les fascistes des potentialités du cinéma. Régulièrement primés, les films de Carmine Gallone, par exemple, résonnent d’allusions politiques. Son péplum Scipion l’Africain (1937), notamment, évoque, sous l’acclamation du général romain victorieux de Carthage, l’écho des prouesses de l’armée italienne galvanisée par son nouveau condottiere en 1935-1936.
La condamnation par l’Angleterre et la France de l’agression de l’Éthiopie justement éloigne le Duce des démocraties et le pousse vers Berlin. Lorsque Hitler annonce reconnaître la Méditerranée comme « mer italienne », Mussolini annonce publiquement, à Milan, le 1er novembre 1936, la constitution d’un axe Rome-Berlin, avant même le Pacte d’acier de 1939. Le cinéphile ministre de la Propagande Joseph Goebbels, fidèle à la Mostra depuis 1936, en profite pour critiquer la surreprésentation du cinéma français dans le palmarès. En 1937, La Grande Illusion du communiste Jean Renoir, censuré en Allemagne pour son pacifisme censément émollient, obtient le prix du meilleur ensemble artistique.
Rivalités avec la « sœur latine »
Hier admirés, les Français en plein marasme seraient devenus « un peuple sans échine », confie le Duce à sa maîtresse[2]. Aussi, à la Mostra de 1938, et sur recommandations de Goebbels, Olympia, de Leni Riefenstahl, est sacré meilleur film, au détriment du film de Marcel Carné, Quai des brumes. La France ne gagne aucun trophée et renonce en 1939 à participer. Systématiquement jusqu’en 1942, la coupe échoit aux réalisateurs allemands les plus reconnus, comme Veit Harlan, dont Le Juif Süss avait ouvert la cérémonie en 1940 et qui est en 1942 distingué pour Le Grand roi, à la gloire de Frédéric II.
La victoire en France du Front populaire en 1936 permet à Léon Blum, président du Conseil, d’orienter sa politique de gauche vers la lutte antifascisme. Le ministre de l’Éducation nationale Jean Zay soutient l’historien Philippe Erlanger et le directeur des Beaux-Arts Georges Huisman pour défendre le projet français d’organisation d’un authentique festival de cinéma qui exclurait les œuvres de propagande. À Cannes, justement, en référence à la ville italienne où Hannibal avait infligé une sévère défaite aux légions romaines. La Méditerranée ne sera définitivement plus Mare Nostrum.
« Cannes 39 est un lieu d’invention de la diplomatie culturelle française[3] », écrit Olivier Loubes. Les Américains, qui avaient boycotté la Mostra l’année précédente, encouragent l’initiative dans laquelle ils voient l’occasion d’assurer une large diffusion de leur production sur le marché européen. Sous couvert de fictions, Hollywood s’apprête pourtant bel et bien à brosser un portrait très flatteur du mythe américain, fait d’héroïsme viril avec Seuls les anges ont des ailes, d’Howard Hawks et de célébration de la saine démocratie de Washington avec Mr. Smith au Sénat, de Frank Capra. L’illusion d’un art détaché des servitudes est dissipée par la mobilisation générale du 30 août qui annule la cérémonie.
La cérémonie cannoise : « grand rite » ou « combines » ?
« Le Festival doit être une victoire pour la France », assène le gouvernement français dans un communiqué officiel de 1946. Concurrent direct de la Mostra avant-guerre, Cannes apprend à se détacher d’un passé belliqueux pour se projeter vers de plus vastes horizons. « Cette cérémonie cinématographique, équivalente des triomphes romains et de l’ascension de la Vierge, est quotidiennement recommencée. C’est le grand rite », écrit en 1955 le sociologue Edgar Morin dans Les Temps modernes. 21 pays étaient représentés en 1946, 35 en 2023. Le glamour de la French Riviera, mondialement célèbre depuis la naissance en 1956 du mythe Bardot grâce au film de Roger Vadim tourné à Saint-Tropez Et Dieu créa… la femme, décuple l’attention médiatique. Quant à l’organisation contiguë du Marché du film à partir de 1959, elle attire, en 2023, 14 000 professionnels. Français – jusqu’en 1982, la présidence est occupée exclusivement par des hexagonaux – mais pensé sur un modèle anglo-saxon et investi par les Américains, le festival de Cannes peut dans la salle Louis Lumière au palais des congrès accueillir 2 300 spectateurs.
Le cinéma trouve-t-il son compte dans ce gigantesque barnum ? En 1957, dans les colonnes d’Arts, François Truffaut y déplore « la combine, les compromis, les faux pas ». Avant Fritz Lang en 1984, aucun cinéaste d’envergure ne préside un jury plus souvent abandonné à des personnalités littéraires, comme André Maurois ou Maurice Genevoix. Pourtant, si la « dimension politique du Festival est parfois occultée, nul ne contestera, en revanche, son ouverture au renouvellement esthétique du cinéma contemporain[4] », observe Michel Ciment. Sans mécontenter les producteurs, Cannes ne rechigne pas devant la polémique. Ainsi, la remise de la Palme d’or 1961 à Viridiana, de Luis Buñuel, suscite la colère des autorités franquistes. Le scandale aussi est un marché.
Italie année zéro
« Il nous semblait que l’école réaliste française avait quelque chose d’exceptionnel[5] », se remémore Federico Fellini lorsqu’il évoque le Ventennio dominé par les bluettes édifiantes du style des « téléphones blancs ». Le vice et le crime n’y avaient pas droit de cité. Le néoréalisme de l’« école italienne de la Libération », selon l’expression d’André Bazin, naît de l’admiration pour les œuvres crues de Marcel Carné, Julien Duvivier et Jean Renoir. Rome, ville ouverte (1945), de Roberto Rossellini, ouvre une voie dans laquelle s’engouffrent Giuseppe De Santis, Luchino Visconti et Vittorio De Sica, qui revendique de « planter la caméra au milieu de la vie réelle ». Le peuple italien y est campé dans sa misère sublime, victime des bourgeois fascistes et des Allemands. Pour le public français, l’agresseur de 1940 est oublié. Et dans la péninsule, le prestige du cinéma français est sans précédent. À Venise, un Français (Jean Renoir) est récompensé en 1946, puis un autre en 1949, 1950, 1952… Le néoréalisme n’y récolte lui aucun laurier, alors que Cannes, dès 1946, récompense du grand prix Rome, ville ouverte et en 1951 consacre d’une Palme d’or Miracle à Milan, de Vittorio De Sica. Pire : en 1960, le jury vénitien se détourne de Rocco et ses frères, chef-d’œuvre de Visconti, pour lui préférer un film du Français André Cayatte, Le Passage du Rhin.
Par un chiasme qu’explique la piquante rivalité entre les deux manifestations majeures, la Nouvelle Vague, snobée à Cannes, triomphe à Venise : Lion d’or pour Prénom Carmen (1983), de Jean-Luc Godard et Le Rayon vert (1986), d’Éric Rohmer. Et lorsque Cannes s’interdit de sélectionner L’Anglaise et le Duc en raison de sa coloration contre-révolutionnaire, la Mostra s’empresse d’honorer Éric Rohmer d’un nouveau Lion d’or pour l’ensemble de sa carrière. Un duel à fleurets désormais mouchetés oppose Cannes, de gauche et paradoxalement plus commerciale, à la Mostra, de droite, plus exigeante, plus audacieuse aussi. Venise constitue par exemple une tête de pont du cinéma asiatique en Europe, avec le triomphe de Rashōmon, d’Akira Kurosawa, en 1951.
Mort à Venise
« Je vous parle de solidarité avec les étudiants et les ouvriers, vous me parlez de travelling et de gros plans. Vous êtes des cons ! », lance à Cannes, le 18 mai 1968, Jean-Luc Godard. Sous pression des réalisateurs de la Nouvelle Vague (Louis Malle démissionne du jury), Cannes ferme ses portes. Toutefois, Cannes a eu la malice de ne pas s’enferrer dans une posture. Hier défi identitaire français lancé au fascisme, Cannes est devenu une parade officielle et rentable ouverte aux vents de la mondialisation culturelle. Bien sûr, la politisation des festivals caractéristique des années 1960 a laissé sa trace[6], jusque dans des Palmes d’or récentes accordées à des brûlots provocateurs, comme Fahrenheit 9/11 (2004), documentaire de Michael Moore contre l’intervention américaine en Irak. Toutefois, cette fièvre contestataire échauffe la croisette sans faire fuir les investisseurs. Au contraire, elle apporte une caution à une entreprise fondamentalement commerciale. Aussi, dès 1969, Cannes retrouve son rythme de croisière.
A contrario, la Mostra, marquée par son origine fasciste, subit une longue éclipse. Les années de plomb, ouvertes par l’attentat de la Piazza Fontana de Milan en 1969, plongent l’Italie dans le chaos. De 1969 à 1980, aucune compétition n’est plus organisée, les projections ont souvent lieu en plein air dans la plus loufoque désorganisation.
Enfin, la Mostra a pâti du déclin du cinéma italien dès la seconde moitié des années 1970. La mort des géants, De Sica en 1974, Pasolini en 1975, Visconti en 1976, Rosselini en 1977 laisse un art orphelin. La Cour constitutionnelle italienne autorise en 1976 le développement de chaînes privées. Le Milanais Silvio Berlusconi en profite pour bâtir un empire médiatique et économique qui finance des comédies sans envergure, aux objectifs strictement commerciaux. La RAI, média public, doit s’aligner pour survivre et cesse de produire des projets exigeants. Environ 100 films par an sortent des studios italiens (290 en France), réservés dans l’immense majorité des cas au marché intérieur.
Alors que les réalisateurs italiens étaient jusqu’en 1978 neuf fois repartis de Cannes avec la Palme, depuis, un seul film italien a su autant séduire le jury cannois : La Chambre du fils, de Nanni Moretti. Et depuis le début du siècle, un seul film italien a eu, en 2013, l’honneur du Lion d’or à Venise, un documentaire, Sacro GRA de Gianfranco Rosi. Modeste production qui n’a, en dehors de la péninsule, atteint que le marché français, où il dut se contenter d’une diffusion confidentielle.
« Il reste encore demain » ?
Lieu commun de la critique depuis près d’un demi-siècle, l’agonie commerciale et artistique du cinéma italien pourrait enfin être démentie. Le succès d’Il reste encore demain (2023) annonce peut-être une résurrection. Avec 5,5 millions d’entrées sur le territoire, le mélo de Paola Cortellesi confronte l’Italie patriarcale aux violences conjugales. Une audace qui pourrait réconcilier en 2024 les jurys de Cannes, présidée par la réalisatrice féministe Greta Gerwig, et de Venise. Mais comment prévoir les réactions de cette étrange chimère qu’est le festival, « un mélange d’art et d’argent, de rapacité et de générosité, de classe et de vulgarité, d’envie et de pitié, d’aspirations élevées et de vies médiocres », comme le définissait si bien le réalisateur John Boorman, jury en 1992 de sa 45e édition ?
[1] Jean A. Gili, Le Cinéma italien, La Martinière, 1996.
[2] In Gilles Bertrand (dir.), La France et l’Italie. Histoire de deux nations sœurs de 1600 à nos jours, Armand Colin, 2022.
[3] Olivier Loubes, Cannes 1939. Le festival qui n’a pas eu lieu, Armand Colin, 2016.
[4] In Olivier Wieviorka, Michel Winock (dir.), Les Lieux de l’histoire de France, Perrin, 2017.
[5] In Jean A. Gili, Le Cinéma italien, tome 2, U.G.E., 1982.
[6] Cf. Anaïs Fléchet (dir.) Une histoire des festivals. xxe-xxie siècle, 2013.