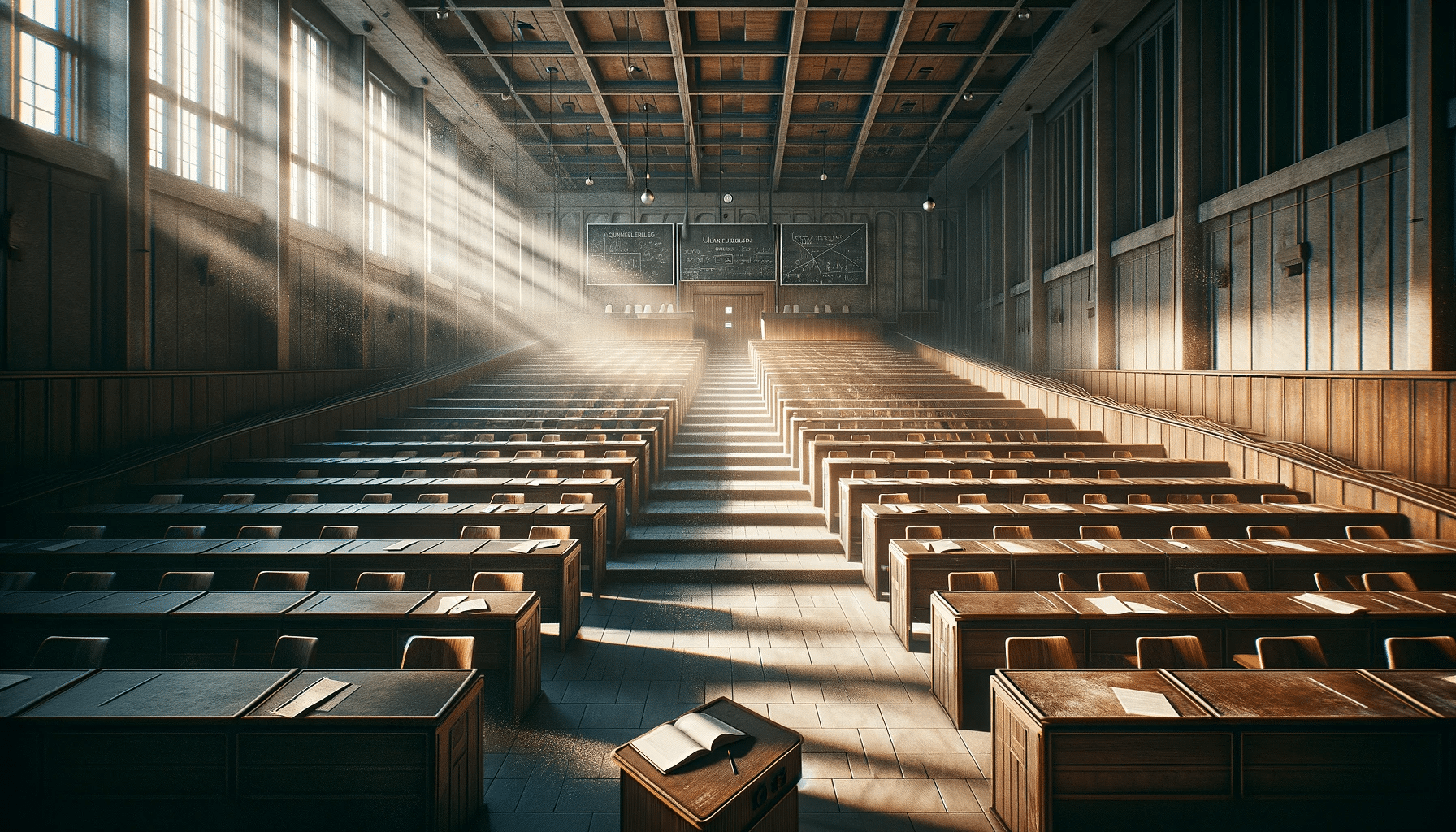La formation des élites est essentielle pour le développement et la survie des pays. Si les élites françaises sont aujourd’hui décriées, c’est souvent parce que leur formation n’est pas adaptée à la direction des affaires. Dans un ouvrage analysant la sélection des intelligences, Thomas Viain étudie les carences de cette formation intellectuelle.
Thomas Viain, La sélection des intelligences. Pourquoi notre système produit des élites sans vision, L’Artilleur, 2024. Propos recueillis par Louis Juan.
Tout d’abord, entendons-nous bien sur le sens des mots employés. Quelle définition donneriez-vous du terme « élite » dans l’angle par lequel il est entendu dans votre livre ?
Je prends très clairement le parti de parler des élites cognitives, que je qualifie, d’un terme légèrement péjoratif, de « surdiplômées » et que j’identifie au produit d’une sélection scolaire, qui trouve son aboutissement dans le système des grandes écoles.
Qu’est-ce qui fait que ces « élites » sont considérées comme telles ? Est-ce d’abord une question de statut social, ou surtout un rapport d’intelligence ? Comment sont-elles sélectionnées ?
Ma définition a le mérite d’ancrer toute de suite le débat dans la troisième forme de domination décrite par Weber, de très loin hégémonique dans nos démocraties libérales, devant les formes traditionnelles et charismatiques, à savoir la domination légale-rationnelle.
Il ne faut pas chercher beaucoup plus loin la raison pour laquelle ces élites cognitives sont considérées comme telles. Cet aspect se trouve renforcé par un intérêt « français » pour les intellectuels, assez bien étudié de Tocqueville à Michel Winock. La question du statut social, si elle est décorrélée de toute dimension cognitive, me semble avoir une incidence très limitée sur les destinées d’une démocratie libérale : pour charismatiques qu’ils puissent être, des millionnaires comme Johnny Hallyday ou Kylian Mbappé, que je sache, n’ont jamais présidé de manière déterminante au choix des politiques publiques. Je laisse la question des « influenceurs » de côté, qui nous ferait prendre un chemin de traverse.
L’hypothèse de mon essai est donc de considérer que la méthodologie qui traverse notre système scolaire, mélange d’esprit critique, de contextualisation, de mise en regard d’auteurs et de thèses hétérogènes, explique pour la plus grande part la forme d’esprit de ces élites cognitives, qu’elles soient de gauche ou de droite étant en l’occurrence sans pertinence.
Quel est, selon vos travaux et votre expérience personnelle, le principal problème dans le dialogue entre les élites et le reste de la population ?
Si je devais mettre en avant un des phénomènes explicatifs majeurs des vingt dernières années, je citerais les réseaux sociaux. Jusqu’à récemment, les sondages donnaient une image assez sage de la distribution des opinions démocratiques. Les réseaux sociaux ont balayé cela. Soudain, des intellectuels, des journalistes, des politiques (nos élites cognitives) ont vu surgir du ventre des réseaux sociaux des opinions, arguments, théories qui leur semblaient (le plus souvent à tort) irrationnelles ou stupides.
Cela fragilise d’ailleurs leur confiance dans le suffrage universel. Je pense qu’ils n’ignoraient pas que l’opinion populaire était traversée par des courants volcaniques, mais la nouveauté des réseaux, c’est qu’il n’est plus possible de faire comme si cela n’existait pas. L’opinion publique pouvait être vue autrefois comme globalement magmatique, mais se coulant assez bien dans les institutions démocratiques. Avec les réseaux sociaux, le rideau tombe et le spectateur diplômé voit soudain s’agiter sur la scène un peuple qui lui paraît bruyant, irrationnel, mal éduqué et pulsionnel. Je tente d’expliquer pourquoi cette position condescendante et de surplomb est erronée. Mais telle est du moins la sensation déplaisante qu’ont plus d’un politique, journaliste ou universitaire, sans oser forcément l’exprimer aussi crûment, de peur de passer pour de piètres démocrates.
A lire également
Ce premier mécanisme est renforcé par un second. L’accès facilité à l’information, et par conséquent à l’ensemble vertigineux de paramètres dont doit tenir compte la prise de décision publique ou politique, a créé un autre phénomène de dévoilement. La classe diplômée elle-même se rend compte qu’elle ne mesurait que de très loin l’ampleur de la complexité de la chose publique. Elle voit donc s’agiter en bas un peuple qu’elle croit partiellement irrationnel et, au-dessus d’elle, se dévoiler une technicité des politiques publiques que nous rappellent désormais quotidiennement les chaînes d’information continue : toute prise de décision politique est immédiatement analysée comme ayant des conséquences en cascade sur une infinité de domaines. Ce second dévoilement, en retour, accentue d’autant l’idée, chez les diplômés, que la population générale est plus que jamais désespérément dépassée par la complexité du réel.
Votre livre s’emploie à disséquer un concept que vous déduisez de votre approche des élites, nommé « intelligence horizontale ». Pouvez-vous nous éclairer sur ce terme ?
C’est précisément pour digérer cette complexité croissante sécrétée par nos sociétés post-industrielles, traversées par des injonctions démocratiques souvent contradictoires, que le système scolaire et académique, et plus particulièrement nos grandes écoles, se donnent pour tâche de nous « apprendre à penser », c’est-à-dire de nous doter d’une immense capacité de synthèse critique, une forme d’esprit qui nous permet d’aller aux faits les plus saillants et pertinents et de mettre à distance critique une quantité considérable d’informations, d’auteurs et de théories : c’est exactement ce que j’appelle l’intelligence horizontale.
Bien malgré elle, l’école ne voit pas qu’elle s’éloigne toujours davantage de ce qui a fait, c’est en tout cas une de mes hypothèses de travail, la force de la tradition de pensée grecque puis, plus généralement occidentale : de Platon à Kant, en passant par Descartes, penser consistait essentiellement à rattacher des connaissances particulières à des principes plus généraux les conditionnant et les organisant, et à remonter ainsi graduellement l’échelle des causalités.
Quel est le risque pour un peuple ayant une approche « horizontale » vis-à-vis des connaissances?
J’explique dans mon essai pourquoi les élites cognitives sont le plus touchées par cette forme de pensée, même si la population majoritaire ne sort pas non plus tout à fait indemne du système scolaire. Le risque est très simple : il est absolument impossible d’avoir ce qu’on pourrait appeler une vue d’ensemble avec ce type d’intelligence. Pour utiliser une analogie : à une image pyramidale de connaissances particulières qui se ramasseraient sous des principes de moins en moins nombreux et de plus en plus généraux, l’école a désormais substitué le modèle du réseau de sens : une excellente copie, c’est une copie qui est capable de mettre en réseau les différents points de vue, d’expliciter les meilleurs arguments, de les articuler, pour finir par trancher de manière ferme en choisissant de retenir, toujours en fonction d’un certain contexte et de la spécificité du sujet traité, des principes auxquels elles accordent plus de « poids ».
Vous pouvez sortir d’un tel système sans rien penser de consistant conceptuellement, mais en réfléchissant à tout de manière critique et argumentée.
A lire également
La France dans ses colères. Entretien avec Christophe Bourseiller
Les grandes écoles, mais avant cela l’éducation nationale participent-ils selon vous à cette relativisation des champs du savoir ?
Je ne dirais pas qu’il y a une relativisation des champs du savoir. Cela nous engagerait dans un débat un peu long sur Max Weber et surtout Raymond Boudon, un de mes sociologues favoris. Dans un petit essai de 2002, Déclin de la morale ? Déclin des valeurs ? Boudon montre très intelligemment pourquoi parler paresseusement d’un relativisme ou d’un nihilisme contemporain est une erreur intellectuelle (mais je sais que je deviens minoritaire en me rattachant encore à l’école wébérienne sur ce point).
En revanche, ce que ne voit pas bien Boudon, c’est qu’il y a une anomie fondamentale des champs du savoir, conséquence difficilement évitable du projet moderne, tel qu’issu notamment des Lumières. Les grandes écoles se greffent sur une organisation horizontale des savoirs, dont elles héritent. Mais elles contribuent fortement à la renforcer, c’est ce que j’ai essayé de montrer dans mon travail.
Par le passé, il n’était pas rare de voir des ministres être historiens, écrivains. Considérez-vous que l’aplatissement des connaissances soit une des causes qui font qu’aujourd’hui, nos « élites » nous apparaissent comme désincarnées de leurs compétences intellectuelles?
Je crains que le problème ne soit plus profond. J’évoque quelques exemples récents d’ouvrages d’histoire écrits par des personnalités politiques actuelles. Si on ne voit pas que le système universitaire pâtit des mêmes formes d’intelligence que les grandes écoles, produit finalement les mêmes esprits critiques, soucieux de contextualisation et de mise en regard, on ne comprend pas pourquoi des personnalités politiques, qui semblent avoir une profondeur historique à faire valoir, s’expriment pourtant exactement comme les autres.
Je ne voudrais pas accabler inutilement l’une ou l’autre, mais je ne vois pas que François Bayrou, homme fin et cultivé, et auteur d’une biographie d’Henri IV, se distingue radicalement, dans sa forme d’esprit et dans sa manière d’aborder la chose publique, d’un Emmanuel Macron ou d’un Edouard Philippe. En revanche, cet aplatissement des degrés du savoir participe très certainement à ce sentiment d’absence de consistance intellectuelle que nous avons à l’endroit de nos élites, qui nous fait soupçonner que leurs connaissances théoriques ne parviennent plus à s’enchâsser réellement dans leur action publique.