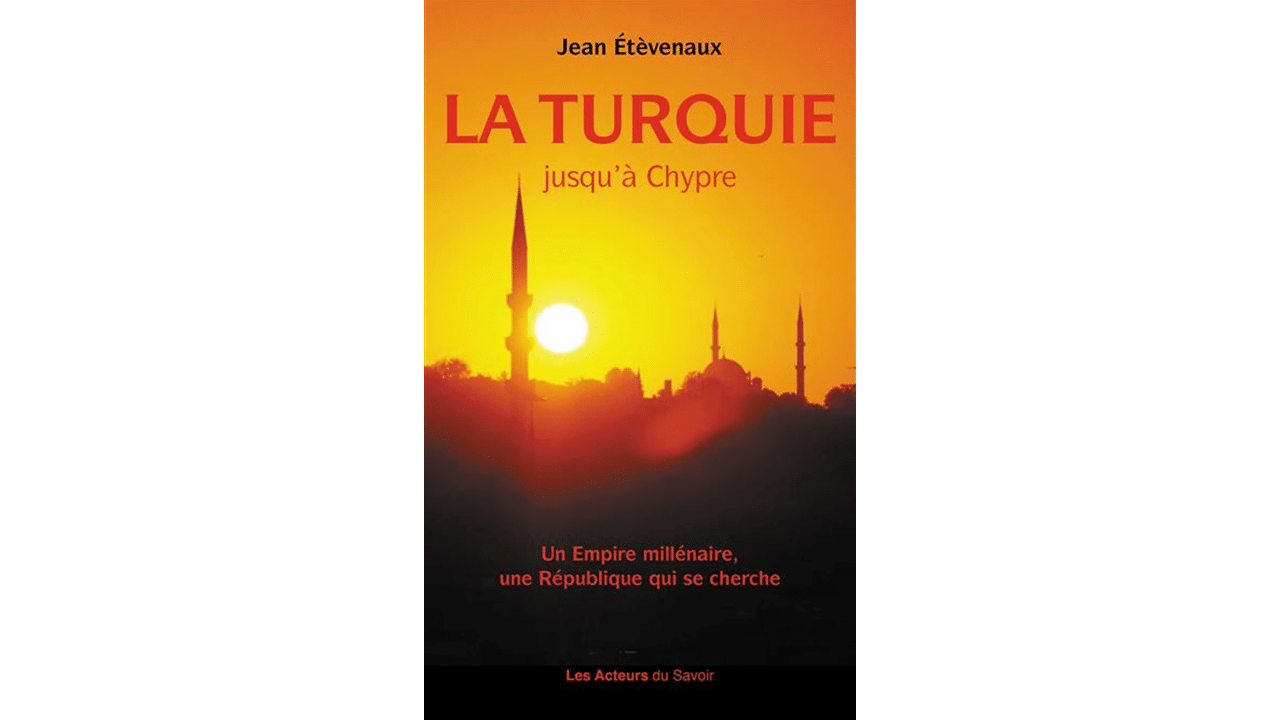Entre les différents locataires de la Maison-Blanche et Israël s’est nouée une « relation spéciale » comme on la qualifie à Washington. Un partenariat à la fois sentimental et cynique qui perdure jusqu’à aujourd’hui.
Article paru dans le numéro 49 de janvier 2024 – Israël. La guerre sans fin.
« Kikes ! » Le mot, injurieux, horrible, n’est guère plus prononcé aux États-Unis que dans les milieux néo-nazis. « Youpins ! », pourrait-on traduire. C’est celui qu’utilisait en privé Harry Truman ou Richard Nixon dans leurs conversations. Le premier était, c’est vrai, originaire d’un milieu modeste du Missouri, où ce genre de termes était usité dans les classes populaires, le second avait des accès racistes en privé sous le coup, parfois, d’un excès de boisson. Harry Truman aura été pourtant le plus rapide des dirigeants mondiaux à reconnaître Israël en 1948 (onze petites minutes après sa déclaration d’indépendance !) et Richard Nixon celui qui aura littéralement sauvé la peau du jeune État en le réalimentant en armes et munitions en 1973, lors de la guerre du Kippour. Leurs saillies antisémites (loin des micros, encore que Nixon ait été parfois enregistré dans ses diatribes paranoïaques) n’ont pas empêché leur défense inconditionnelle d’Israël, pour des raisons électorales, des considérations religieuses parfois ou par pur calcul stratégique, ce qui revient aux États-Unis à la même chose. Car de Harry Truman à Joe Biden, il est une constante qu’aucun président, qu’aucune administration – fût-elle critique, et il y en eut, on le verra – n’ont jamais remise en cause : celle de cette « relation spéciale » des États-Unis avec Israël ainsi qu’est qualifiée systématiquement cette alliance qui oscille entre amitié franche et partenariat intéressé.
Truman avait beau trouvé, dans son journal intime, « les juifs égoïstes » (en date du 21 juillet 1947, tel qu’il est cité sur le site de sa bibliothèque présidentielle), c’est vers eux, avec une arrière-pensée politique toute démocrate (la même prévaudra au moment du vote sur les droits civiques des noirs américains) qu’il se tourne en 1948, alors qu’il est au plus bas dans les sondages et qu’on le donne perdant face à son rival républicain Thomas Dewey. Il n’y a pas en Amérique meilleure chance d’inverser une élection qu’en se mettant une minorité dans la poche, ne serait-ce que pour quelques milliers de voix. C’est vrai aujourd’hui sous Joe Biden, ça l’était tout autant après guerre. Quand son entourage et notamment George Marshall lui fait part des répercussions que cela pourrait avoir les relations entre les États-Unis et les pays arabes, dont beaucoup lorgnaient déjà sur l’Union soviétique, au tout début de la Guerre froide, Truman rétorque : « Il n’y a pas d’Arabes chez mes électeurs. » Il est pourtant peu vraisemblable que sa décision de reconnaître l’État d’Israël ait favorisé son élection auprès d’une communauté juive, principalement installée dans l’État de New York qui votait alors pour les Républicains. Il est plus plausible que Truman, un baptiste très religieux, ait saisi l’importance que revêtait chez les évangéliques la création d’un État juif : aujourd’hui encore, il n’est pas rare de voir dans leurs temples le drapeau israélien côtoyer la bannière étoilée et leurs pasteurs – davantage encore que les rabbins libéraux de la côte Est – être les premiers défenseurs d’Israël.
A lire également
Podcast – Les États-Unis et la guerre du droit. Frédéric Forgues
On aurait tort de voir pourtant dans cette « relation spéciale » une sorte d’amour tout à fait linéaire. Il y eut des hauts et des bas et les dissonances furent souvent bipartisanes. Jusqu’en 1967 et la rupture gaullienne de son alliance militaire avec Israël, les États-Unis n’avaient pas encore le rôle de protecteurs qu’on leur prête aujourd’hui. Le Congrès sortait le chéquier, mais sous forme de prêt uniquement. Succédant à Harry Truman, le général Eisenhower a longtemps été considéré comme le moins israélophile des locataires de la Maison-Blanche. La légende de sa défiance fut si tenace que longtemps Yasser Arafat se plaisait à répéter à ses interlocuteurs : « Ah, si seulement il y avait un nouvel Eisenhower à Washington ! », sans bien sûr prendre en compte la conjoncture à laquelle Ike devait faire face à l’époque. Disons que l’anticommunisme du héros du Débarquement était plus fort que son attachement à la cause sioniste.
Israël et pays arabes
Ike n’était pourtant pas un antisioniste (à quelque degré que ce soit) et encore moins un antisémite. Accompagné de Patton, le général Eisenhower avait visité le camp d’Ohrduf, une annexe de Buchenwald, pour rassembler des preuves de l’holocauste. Sa correspondance avec le Premier ministre David Ben Gurion est ferme, mais non dénuée de chaleur. Le président républicain définissait d’ailleurs sa relation comme celle d’un « ami objectif » impliqué dans des liens qu’il a lui-même souvent qualifiés « d’impartiaux ». Les Arabes se souviennent que c’est lui qui a ordonné, en 1956, aux Israéliens (ainsi qu’aux Britanniques et aux Français) d’évacuer le canal de Suez et le Sinaï, forçant cette alliance tripartite à avorter une expédition militairement réussie afin d’éviter un conflit plus large qui aurait pu impliquer l’Union soviétique. Exemple type de real politik, la doctrine Eisenhower, qui consistait à limiter la pénétration de l’idéologie communiste au Moyen-Orient et à soutenir l’État hébreu sans lui livrer d’armes, n’avait certes pas réduit au strict minimum cette « relation spéciale », mais avait dégradé ce partenariat né sous son prédécesseur. La présidence d’Eisenhower marque aussi la naissance de puissants lobbys, tels que l’American Zionist Committee for Public Affairs (AZCPA), créée en 1953 après le massacre du village de Qibya, en Cisjordanie, durant l’opération Shoshana menée par Ariel Sharon et au cours de laquelle Tsahal tua 69 Palestiniens, majoritairement des femmes et des enfants. Cette structure, ancêtre de l’AIPAC (le nom qu’elle prendra dix ans plus tard sous Kennedy) ayant alors pour mission de redorer le blason d’Israël dans l’opinion publique s’est très vite muée en groupe de pression, auprès des membres du Congrès comme de potentiels candidats à une élection présidentielle. Dès sa fondation, sentant que l’AZCPA était en réalité une organisation financée par l’étranger, Eisenhower a tout fait pour la dissoudre… Sans succès.
L’Amérique devrait donc composer avec cet ami extérieur (et intérieur) pour longtemps. La superpuissance avait été capable de battre les nazis et de défaire le Japon, mais s’était toujours reproché de ne pas avoir pu empêcher la Shoah. Cette impuissance est toujours perçue aux États-Unis comme une tache dans l’histoire américaine. Fils d’un des plus célèbres antisémites que l’Amérique ait connus (avec Henry Ford), John Fitzgerald Kennedy fut un allié tout aussi prudent que son prédécesseur républicain. Pas question non plus pour le jeune démocrate de s’aliéner les régimes arabes, si fragiles. Mais JFK se souvient que l’intervention américaine pour faire cesser l’expédition de Suez n’a pas eu les effets escomptés : l’Égypte a au contraire renforcé ses liens avec l’URSS. Sous sa présidence, on parle enfin d’armes. Il n’est pas question d’alliance formelle (et d’ailleurs, il n’y a jamais eu de traité d’assistance militaire entre l’Amérique et Israël), mais Kennedy consent à exporter enfin des armes vers l’État hébreu, là où il n’y avait que la France et la Grande-Bretagne pour le faire. Les États-Unis finiront par vendre des missiles sol-air Hawk : une première ! Cette longue absence de l’Amérique dans cet approvisionnement vital pour Jérusalem, et qui paraît tout à fait inimaginable aujourd’hui, avait permis à Israël de développer sa propre industrie d’armement et ses ambitions nucléaires. Là aussi, Kennedy voit rouge : pas question que les alliés israéliens déstabilisent un peu plus cette région en acquérant cette technologie. Il organise une rencontre à l’hôtel Waldorf-Astoria de New York, en 1961, avec David Ben Gurion qui lui garantit que le projet de centrale à Dimona, dans le désert du Néguev est purement pacifique. « Israël veut de l’énergie peu coûteuse » et autorisera les inspections de scientifiques américains. Visites partielles, parfois sur des sites répliqués de Dimona, qui ne donneront rien… Israël se dotera bien de l’arme nucléaire même si ça n’a jamais été réellement officiel. L’allié avec qui tous les présidents américains assurent partager « les mêmes valeurs », celui dont ils disent qu’il est « la seule démocratie de la région » s’avère encore trop peu fiable pour les Américains et surtout trop intrépide dans le monde de la Guerre froide. Les États-Unis font peu de place à la sentimentalité quand il s’agit de leurs intérêts.
A lire également
Podcast – Guerre à Gaza. Quelle stratégie pour Israël ? Gil Mihaely
Résoudre le problème palestinien
Et pourtant… En succédant à JFK, le Texan Lyndon B. Johnson devient le président le plus sincèrement philosémite et, peut-être, le plus ouvert à la cause sioniste que l’Amérique ait jamais eue. Petit-fils de membres de l’église christadelphe, il a été éduqué selon les préceptes de ce mouvement qui fait de la protection des juifs un devoir. En 1967, il prend le relais de la France qui gèle les livraisons d’armes offensives après la guerre des Six Jours. C’est à partir de LBJ que les États-Unis deviennent le premier protecteur officiel d’Israël : des avions et de l’armement lourd lui seront fournis… Même la résolution 242 de l’ONU aurait vu la mention de Jérusalem biffée sous la pression de Johnson.
Calculs électoraux et intérêts internationaux.
Ses successeurs ne sont plus en la matière que les héritiers de LBJ. Nixon, l’homme qui voyait à Washington des complots juifs contre lui, volera au secours de l’État hébreu en 1973 à court de munitions, dépassé par la supériorité inattendue des armées arabes, proche de la défaite, en envoyant des avions militaires américains chargés d’équipements. Les représailles des pays arabes ne sont font pas attendre : ils augmentent le prix du pétrole. C’est aussi Nixon qui sera le premier président américain à fouler le sol israélien, en 1974, soit vingt-six ans après la création de l’État d’Israël. On est loin des onze minutes des origines !
Jimmy Carter hérite d’un contexte fragile : c’est le début de la montée de l’islamisme politique et sur la scène intérieure son pays ne s’est pas encore extirpé des ravages de l’inflation. Il se met en scène à Camp David, finalisant l’accord de paix entre Begin l’Israélien et Sadate, l’Égyptien, dont le pays a définitivement quitté la sphère d’influence soviétique. C’est surtout le début de la politique du chéquier annuel (et c’est valable aussi pour l’Égypte). L’Amérique ne se contente plus de prêter, elle donne des milliards de dollars chaque année avec cette contrepartie ; Israël achètera du matériel américain. Israël est un client, mais aussi un partenaire stratégique indispensable : l’Iran vient de tomber aux mains des mollahs, Israël acquiert, tel un proxy, la responsabilité de la sécurité de la région et à travers elle de celle du monde libre. Dans le logiciel de la sécurité américaine, il ne s’agit pas de cadeau effectué sous la pression de lobbys, mais plutôt d’un investissement. « Israël, disait Alexander Haig, le premier secrétaire d’État de Ronald Reagan, est le plus grand porte-avions du monde qui ne puisse être coulé et sur lequel il n’y a aucun marin américain. »
On ne s’étonnera pas dès lors que cette vision stratégique aille au-delà de la seule défense des « valeurs communes », mises en avant dans les discours officiels entre les deux « amis ». Sous Reagan, on établira des exercices militaires communs, car les ennemis sont désormais communs. Téhéran veut la mort du « grand Satan », comme du « petit Satan ». On partage des renseignements… parfois contre le gré de l’Oncle Sam. L’affaire Jonathan Pollard, du nom de cet officier juif du renseignement de la marine américaine ayant transmis, au milieu des années 80, des milliers de documents à Israël entachera longuement la confiance entre les deux pays.
A lire également
Podcast – Guerre en Israël, tensions en France
Et la Palestine dans tout cela ? Elle est le grand raté de toutes les présidences. Celle de Bill Clinton avec l’échec des accords d’Oslo qui n’ont pas su mettre un terme à un conflit vieux de plusieurs décennies. L’arrivée au pouvoir d’une droite israélienne intransigeante, celle du Likud, incarnée par Benjamin Netanyahu et ses alliés les plus durs ainsi que l’affaiblissement de l’Autorité palestinienne fragmentée entre le Fatah, perçu comme une marionnette des Américains, et les terroristes du Hamas qui contrôlent la bande de Gaza brisent le rêve d’une Pax Americana dans cette région. Si Johnson a été le plus sensible à la cause israélienne, Obama aura été le plus allergique à la politique menée par Jérusalem. Il snobe le vieil ami en se rendant en juin 2009 au Caire sans s’arrêter en Israël, dénonce la politique de colonisation qu’il perçoit comme une agression et surtout il approuve un accord sur le nucléaire iranien donnant l’impression de vouloir normaliser les relations avec Téhéran qui continue de financer les milices du Hezbollah et le Hamas.
Une amitié qui résiste
Pas étonnant que Trump, dans ces conditions, ait été perçu comme l’un des meilleurs amis d’Israël, lui qui a enfin honoré la vieille promesse américaine de transférer l’ambassade à Jérusalem, reconnu la souveraineté israélienne sur le Golan et mis en œuvre les accords d’Abraham, normalisant les relations entre l’État hébreu, le Maroc, les Émirats arabes unis et le Bahreïn. Jamais pourtant il n’est question de la Palestine. Les États-Unis misent alors sur un statu quo dangereux : le monde arabe s’en accommodera comme le reste du monde d’ailleurs, pensent-ils avec une fausse naïveté… Le monde arabe a d’autres priorités, spécialement l’Iran.
C’est aujourd’hui un vieil ami du pays, un homme qui a connu Golda Meir ou Yitzhak Shamir qui doit faire face aux défis de cette « relation spéciale » alors même que la démographie de son pays a changé. Joe Biden est un homme des années 70 confronté à une réalité américaine contemporaine : la population musulmane américaine a augmenté et atteint celle de la population juive. Le voilà dans une position inconfortable : tenir le rôle que l’Amérique tient avec Israël depuis 1967 tout en n’injuriant pas l’avenir. Et son avenir, aujourd’hui, pourrait se jouer à quelques voix près, dans un État clé, au Michigan, en banlieue de Détroit, où vit une communauté musulmane importante qui a promis de ne pas voter pour lui s’il ne changeait pas de politique au Moyen-Orient. D’un côté, deux porte-avions mouillent en Méditerranée orientale, de l’autre des milliers de voix se font entendre : les jeunes sont de moins en moins sensibles à Israël et la gauche américaine est devenue, elle aussi, un lobby en soi, qui pourrait peser sur le devenir des relations entre les deux pays. Joe Biden est peut-être le dernier président démocrate pro-Israël que l’Amérique connaîtra.